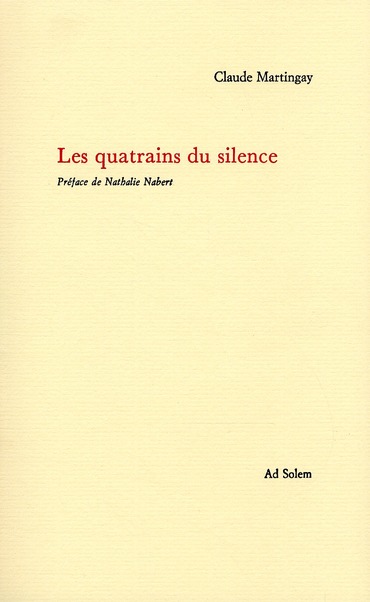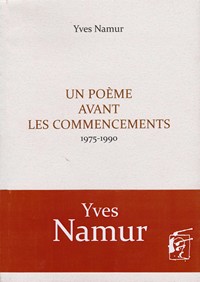Le scalp en feu (5)
« Poésie Ô lapsus » - Robert Desnos
Le Scalp en feu est une chronique irrégulière et intermittente dont le seul sujet, en raison du manque et de l’urgence, est la poésie. Elle ouvre un nombre indéterminé de fenêtres de tir sur le poète et son poème. Selon le temps, l’humeur, les nécessités de l’instant ou du jour, ces fenêtres changeront de forme et de format, mais leur auteur, un cynique sans scrupules, s’engage à ne pas dépasser les dix pages pour l’ensemble de l’édifice. Lecteur, ne sois sûr de rien, sinon de ce que le petit bonhomme, là-haut, ne lèvera jamais son chapeau à ton passage car, fraîchement scalpé, il craint les courants d’air.
Enfin, Le Scalp en feu sera, à partir de ce 5e numéro, publié simultanément sur les sites de RECOURS AU POÈME et de LA CAUSE LITTÉRAIRE. / Septembre 2013 – Michel Host
Sommaire :
- Chronique légère - p. 2
- Le Poétique (2) - p. 2
- Les Mains libres, Paul Éluard et Man Ray, Texte intégral, dossier par Henri Scepi, Lecture d’image par Juliette Bertron, FolioPlus classiques N°256, 258 pp., prix non indiqué. - p. 3
- Nuits de Carton, Anick Roschi, Le Chasseur abstrait éditeur, Illustrations de Valérie Constantin, 70 pp., 16 €. - p. 5
- Le poète annoncé, Pierre Gabriel. – p. 7
Chronique légère
Ce 31 août 2013, au petit matin, l’oreillette collée à l’oreille, j’écoute France-Culture. Un jeune romancier d’Israël, poète et traducteur, est à juste titre célébré sur l’antenne : il vit à Tel-Aviv-Jaffa et publie un roman dont l’héroïne est Yolanda, sa grand-mère, à laquelle il porte une affection admirative que l’on ne peut qu’approuver ; ce jeune homme a traduit en hébreu Baudelaire et d’autres poètes français. Ses propres poèmes reçoivent le meilleur accueil. Pour ces incontestables raisons il est, chez lui, une célébrité, voire une gloire littéraire, ce qui me réjouit. Il n’a cependant pas atteint au rang de poète officiel qui, seul en France, vous octroie l’accès aux colonnes du Monde et aux studios de la radio. Que cette disgrâce[1] lui soit épargnée, nous en sommes heureux tout autant, quoique nous demandant pourquoi les miracles de cet ordre n’ont lieu qu’au Proche-Orient et plus jamais à Paris.
Le Poétique (2)
La tentative de le définir est désormais en suspens. J’ai failli ne plus m’intéresser à la question en lisant, je ne sais chez quel littérateur, que seul un esprit apoétique (soit un prosateur volant en rase-mottes) pouvait se formuler à lui-même une telle interrogation. Il irait donc de soi que « le poétique » va de soi et ne demande surtout pas qu’on prenne la peine de le cerner. Permettez que mon désaccord persiste et que je ne renie pas ma qualité de poète. Bon ou mauvais ?... c’est une autre affaire dont je ne veux ni ne peux décider. Je vous propose donc ceci :
La poésie ouvre la nuit à l’excès du désir.
Georges Bataille, La Haine de la poésie
Tout le poème
Est dans les yeux d’un gorille en cage.
Werner Lambersy, Journal par-dessus bord
Les Mains libres, Paul Éluard et Man Ray
Le recueil fut originellement publié en 1947, par les éditions Gallimard ; sa publication d’aujourd’hui prend la forme d’un « petit classique » nouvelle formule : je veux dire qu’il ne s’ouvre pas sur un portrait de l’auteur par Mme Vigée-Lebrun ni ne se ferme sur les appréciations circonspectes de M. Émile Faguet suivies de quinze sujets de dissertation et d’explication de texte. Néanmoins je conserve précieusement mes « petits classiques Larousse », avec leur mine modeste, leur couverture mauve, leurs notes de bas de page, leur papier jauni ou tavelé, et il m’arrive d’en acheter encore chez les revendeurs d’occasions. Cela dit, l’écolier d’aujourd’hui aura intérêt à se procurer ces poèmes d’Éluard, non seulement parce que l’érotisme n’en est pas absent (une bonne éducation se doit d’être complète, Rabelais et Montaigne la souhaitaient telle et les écrans encombrés de pornographie ne peuvent suffire à tout), mais parce que des portes de la poésie et de l’imagerie contemporaine s’y ouvrent à lui, et aussi que s’y trouve posée la problématique de la confrontation de l’image et du texte.
En effet, contrairement aux habitudes, ce sont ici les poèmes d’Éluard qui illustrent les dessins de Man Ray, lequel était rétif à l’idée de hiérarchie dans les arts divers. Rappelons qu’il était aussi photographe, et qu’un cliché de Nush Éluard et de Sonia Mossé figure en bonne place dans ces pages. Juliette Bertron précise : « Un tissu d’interconnexions, de correspondances et d’échos, si cher à la recherche surréaliste qui favorise ce type de mélange et de rencontre, s’exprime donc ici sous plusieurs formes. »
La réflexion de Juliette Bertron est ample et générale : elle s’étend au rappel de ce que fut le surréalisme, lointainement né de Rimbaud et Lautréamont, approfondi dans une « subversion totale » par André Breton et ses amis, donnant sa voix à des formes d’irrationalité dont des preuves évidentes (s’il fallait les donner encore) sont offertes ici par les dessins de Man Ray et les poèmes d’Éluard. L’inconscient, auquel on peut croire sans adhérer pour autant à la « science » freudienne, est au cœur de la nouvelle esthétique proposée par le surréalisme, terrain fertile ou stérile selon les évolutions du poème et de l’art. Et, avec l’inconscient, l’image, elle aussi centrale dans la démarche surréaliste, franchit bien au-delà les limites de la seule illustration. L’écolier donc, mais aussi l’étudiant, s’ils n’ont pas entièrement fermé leur cerveau à la littérature et à l’art, trouveront dans cet excellent dossier d’accompagnement une rampe de lancement vers le monde sensible qui pourrait bien demeurer (soyons optimiste !), pour quelque temps encore, le versant plus secret de la vie humaine.
Les images que nous propose Man Ray ont toute la fraîcheur et le surgissement des inventions et trouvailles surréalistes. Associations non pas étranges, cela va de soi au point qu’à le noter nous frôlons le pléonasme, mais claires et obscures du même pas, images désirantes, corps et objets mêlés à dessein (tout un pan de l’art d’aujourd’hui pousse ses surgeons dans ce champ-là, art authentique comme art de l’imposture, art de la rencontre et de l’étonnement : souvenons-nous de Dali réunissant le parapluie et la machine à coudre sur une table de dissection.) Recherche de « la merveille », du Graal, de l’unique en somme, ce que perçoit très bien Éluard qui s’introduit lui-même en exergue : « Le papier, nuit blanche. Et les plages désertes des yeux du rêveur. Le cœur tremble. / Le dessin de Man Ray : toujours le désir, non le besoin. » Ces mots « illustrent » l’image d’une femme dénudée dormant sur les arches du Pont d’Avignon.
Oui, tout cela va de soi en dépit de la surprise. Je m’en tiens à deux exemples : d’abord à cette autre femme que Man Ray place en pleine page, buste coupé aux hanches, sans le soutien newtonien du tripode de bois habituel, et elle jetée dans les airs, mais hiératique, figée, bras relevés, doigts exprimant une sorte de volonté d’éloignement, visage semi-profilé, semi-souriant, coiffure inconnue sous nos climats du XXIe siècle mais en vogue dans les années 1930, regard mystérieux enfin, regard perdu, toujours à définir et à cerner dans le reflet de notre désir. Déjà, en 1947, Éluard en offrait sa traduction :
LE MANNEQUIN
Unique guirlande tendue / D’un bord à l’autre de l’enfance / Petit pont de perfection / Premier amour de l’écolier / Suppression des distances.
Oui, des femmes semblables j’en vis dans mon enfance : elles dormaient sans respirer, vivantes néanmoins, ou au bord de l’asphyxie, dans les vitrines des tailleurs. Elle préfiguraient un amour premier mais aussi des amours, des caresses vagues qui déjà prenaient au ventre le gamin que j’étais, l’arrêtaient fasciné ou le jetaient dans une fuite qui ne s’arrêterait qu’avec sa vie.
Second exemple, l’imitation d’une carte postale ou d’une photographie : quatre fermes rassemblées autour du clocher de l’église avec, sur l’horizon, la montagne, sorte de Sainte-Victoire nordique. Le clocher est un demi-crayon aigu tel un pal dressé vers le ciel. Dans la plaine, au deuxième plan, sortant de terre, un long serpent, sorte de couleuvre régnant sur les terres. Sa queue au loin se contorsionne derrière la montagne. Image glaçante. Éluard « l’illustre » ainsi :
OÙ SE FABRIQUENT LES CRAYONS
La dernière l’hirondelle / À tresser une corbeille / Pour retenir la lumière / La dernière à dessiner / Cet œil déserté
Dans la paume du village /Le soir vient manger les graines / Du sommeil animal
Bonne nuit à la pensée
Et j’appelle le silence / Par son plus petit nom.
Ici le mystère insondable, le poème-exorcisme, l’entrée de la pensée dans sa nuit ; là, l’évidence du mystère de l’objet sans mystère, à moins qu’il n’acquière une vie intérieure d’un autre type.
Je conclus, toujours avec Juliette Bertron, sur « L’exaltation réciproque du texte et de l’image » (p.228) : « Définissant le genre hybride du "Poème-objet", Breton le présente comme "une composition qui tend à combiner les ressources de la poésie et de la plastique et à spéculer sur leur pouvoir d’exaltation réciproque" (Le Surréalisme et la Peinture). Il s’agit bien de « mobiliser totalement les ressorts de l’imagination et sa puissance de transformation des données immédiates de la perception. » Cela avait commencé avec Maurice Scève et l’emblème, avec Rimbaud le voyant, avec Apollinaire et ses calligrammes… Cela se poursuit sous de multiples formes aujourd’hui. Ce recueil nous le rappelle, qui est une machine à rêver et à imaginer, à penser sans doute aussi, quand on nous en laisse la possibilité, et à nous préparer à changer la vie qui en a bien besoin.
Nuits de Carton, d’Anick Roschi
Recueil bref, tranchant comme le couteau dans la plaie, comme le cri éploré dans la nuit de l’humain. Il s’ouvre sur les Clandestines :
Dans le repli
D’une vague argentée
De jeunes corps s’échouent
Ces « jeunes corps », avec d’autres moins jeunes parfois, c’est sur les côtes de la Calabre, de la Sardaigne et de l’Andalousie qu’ils se rendent, après les rêves, « À de funestes / Rendez-vous ». Nous savons de qui ils sont, de quelles incuries ils ont péri, sur quelles espérances ils se sont fracassés. Anick Roschi tient cette note basse tout au long, il saisit la peine de l’Autre, mais n’en agite pas la marionnette sur les scènes poétiques. Il ne hurle pas contre tant de cruauté, il n’accuse ni ne se fait pleureuse patentée ou hurlante ou vaticinante contre l’injustice. Voilà ce qui m’a arrêté, avec cette « vague argentée » dont Lorca eût fait una cuna, un berceau pour le malheur de ce monde. D’ordinaire, je ne goûte pas du tout, je veux dire que j’exècre cette poésie de la plainte universelle et des bons sentiments qui auraient dû, s’ils avaient eu au cœur et au sang quelque degrés de l’alcool de vérité avec un peu de force, éviter que l’on eût tant de malheurs à déplorer, tant de plaintes à proférer. Cette poésie-là, qui vient après Senghor et Césaire, et Nicolas Guillén, lesquels ne sont pas en cause par conséquent, emplit de nos jours des recueils par milliers avec de vaines paroles qui jamais n’ont rien changé, paroles de l’après-coup que j’assimile aux pleurnicheries du résistant de la dernière minute, de celui qui sait bien la pose qu’il convient de prendre pour n’avoir pas le sentiment de venir trop tard ou simplement . De cet art de la nostalgie apitoyée des éditeurs (de poésie notamment) font ployer leur rayonnages, art simulé de l’espoir du jour meilleur, de la grande fraternité tant souhaitable quoique, hormis les mots creux et répétitifs ou les comédies habituelles, on ne fasse rien ou si peu pour la mettre en œuvre. Poésie bouillie pour les chats maigres, tu m’écœures ! L’esclave est mort, tu demandes à son petit-fils de gémir encore et toujours, parfois même tu jettes l’anathème et fais mine d’aller combattre à nouveau. Avec toi, le petit-fils de l’esclave restera esclave dans sa tête, il ne se sortira pas de ce pétrin. Quant à l’esclavagiste-colonisateur, je n’en parle pas. Lui non plus, son petit-fils veux-je dire, ne s’en tirera pas comme ça, d’ailleurs tu ne le souhaites pas, il te le faut cet ennemi, quoique mort et enterré depuis longtemps. D’où que tes vers, libres ou comptés, devraient lucidement s’appeler idéologie et non poésie. Tu ne « fais » rien, tu n’engages pas l’avenir autrement qu’en ton éternel et stérile planctus. Tu es poésie de répétion, morte et enterrée[2].
Anick Roschi, ce n’est pas cela, c’en est même fort loin, ses
Déferlantes esclaves / Aux mains volontaires… et [leurs] Rois maudits / Secouent / Nos lits / De gouvernance.
Ah, nos bonnes gouvernances ! Nos risibles gouvernances ! Tout l’humour de ce poète consiste à n’en pas dire davantage. Il laisse le lecteur, le récitant, libres de compléter et de conclure. Il ménage l’ambiguïté, car le poème s’intitule Rois maudits… Qui sont-ils, ces rois-là ? De quels siècles ? De quels continents ? Le monde de l’ignominie est sans fin ni frontières : c’est ici Anna Politkovskaïa : Une colombe, ce soir, est tombée. C’est là Neda, pour moi une inconnue, on ne peut tout savoir de la méchanceté, surtout si Le tout puissant / a décidé // Pour toi / Neda, et même (et surtout) si Ton sang / Coule / Sur nos petits écrans.
Anick Roschi ne procède pas par amples tableaux de bataille, par furieuses dénonciations. Le coup d’épée dans l’eau, le coup de pied de l’âne, ce n’est pas son genre. Il jette une seule pierre à l’homme qui change la femme en pierre - Femme pierre / D’un jour répudié // Pierre d’amants / Pierre d’aimés / Homme pierre / D’obscurité. Il songe à l’oubli où demeure désormais le peuple Tamoul, au passant que tue la bombe un jour de marché… car au bout de ces choses, au bout de la rue, […] rue défigurée / Dieu est passant / Dieu est passé : sous l’image, le sens caché. Dieu, oui, est bien passé par là, et il s’est tant fait à notre indifférente ressemblance que nous ne distinguons plus sa silhouette. Le poète nous lance ses suggestions avec cette sérénité que procure la force du constat. S’il s’attache aux Mémoires, c’est aussi bien aux victimes du Zyklon B qu’à celles aux yeux / Hagards / s’agripp[ant] / À nos regards / Nus, et à celles de la Terre murée / Isolée /Niée / Encore abandonnée de Palestine. Il est dans toutes les mémoires, même celles qu’il ne nomme pas. Il sait qu’elles se lient les unes aux autres par l’obstinée souffrance. Il permet le double sens et le double regard : rien n’est univoque, et surtout pas le mal. En cela il se rend inacceptable pour la pensée unique qui tranche avec une papale autorité du bien et du mal, des bons et des méchants. On ne le recevra ni à droite ni à gauche, pour autant qu’existent encore ces catégories désuètes. S’il prononce ces mots, finalement : - Liberté… Égalité… Fraternité… -, nos emblèmes ou notre ritournelle, c’est qu’il cherche, appelle et voit un autre temps, d’un désir renouvelé À chaque naissance, seule excuse au péché d’idéalisme :
Voici le temps / Exorcisé / De nos raisons planétaires / Le temps / Articulé / D’une capitale / Terre.
C’est donc là croyance humaine en ce qu’elle n’exclut d’autres croyances, sachant que la folie, le mal, la faiblesse sont les choses du monde et de cette terre les mieux partagées. Cette poésie nous parle à voix retenue et pas pour ne rien nous dire. Elle est belle, clairement à l’honneur de la pensée du temps présent et des temps à venir[3].
Les illustrations de Valérie Constantin méritent d’être remarquées, car elles entrent de plain-pied, il me semble, dans le projet poétique. J’en parle tardivement, mais non par raccroc, car elles sont essentielles, répétant ad nauseam ces nuits de cartons de beaucoup de ceux que « la vague argentée » n’a pas retenus dans son mortel « repli ». Ces emballages compressés, liés en énormes ballots et que l’on voit transportés par camions entiers vers les usines de transformation, ce sont les mêmes dans lesquels, sous lesquels, à Tokyo et à Paris, à New-York et à Moscou… se protègent du froid de la nuit ces inconnus échoués dans l’ailleurs, chez nous, nos frères que nous méprisons en ne les voyant plus. Allons, que je cesse ma plainte !
Le poète annoncé, Pierre Gabriel, paraîtra dans un prochain Scalp.
_____________.
Fin du SCALP V.
[1] Aucune contradiction dans le propos : les chroniqueurs et interviewers parisiens chroniquent et interviewent, il faut voir comme !
[2] Je me rappelle avoir entendu, il y a de cela quelques années, le romancier malgache Jean-Luc Raharimanana s’élever contre cette éternelle complainte mortifère et, au fond, satisfaite.
[3] Autres publications d’Anick Roschi : Le voyage des ombres, Editions du Cygne, 2007. Pour Haïti (ouvrage collectif) Editions Desnel, 2010.