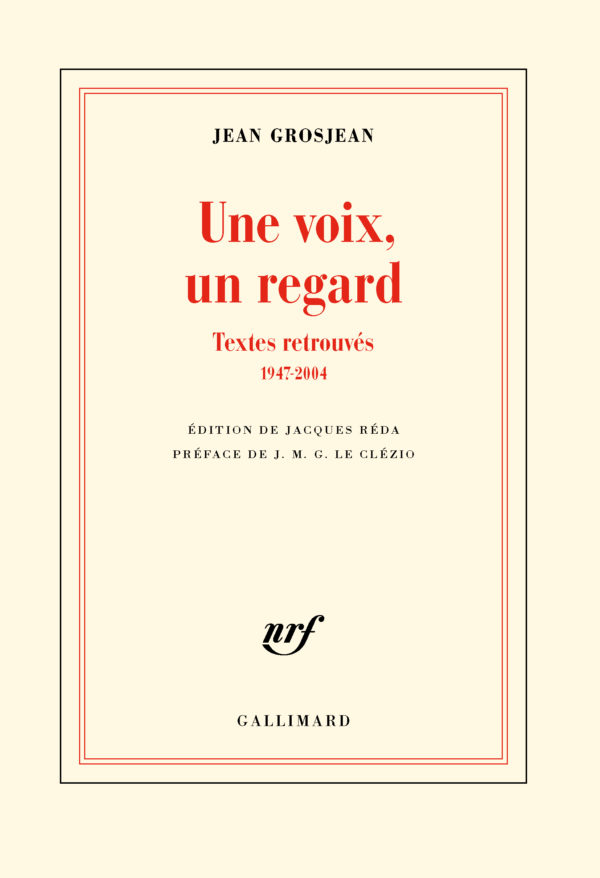Le corps, lieu d’expérience de Dieu dans les Evangiles, lieu de circulation et de salut. C’est dans la matérialité de l’hostie que le christianisme appelle à faire l’expérience de Dieu. La relation physique avec le Christ passe par la transsubstantiation.
L’hostie, en fondant dans la bouche de Sainte Thérèse d’Avila, ne l’emplit-elle pas d’un liquide tendre et chaud ?
Une religion fondée sur la Résurrection de la chair et sur l’incarnation ne dissocie pas l’âme du corps.
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du logos de vie – car la vie s’est manifestée (…) nous vous l’annonçons. (Premier épître de Jean).
Si le Christ sauve l’homme, il le sauve bien corps et âme.
…
C’est la filiation qui est évidemment en jeu dans cette lamentable affaire du « mariage pour tous ». Les mutations génétiques, la marchandisation du corps (la vente des ventres et des enfants) déconstruisent le principe généalogique qui fondait l’humanité. Le corps qui était le temple de l’esprit et la charnière du salut devient la charnière de la damnation marchande et technique.
La chair est la charnière du salut. De sorte que, lorsque l’âme est choisie par Dieu pour le salut, c’est la chair qui fait que l’âme peut ainsi être le choix de Dieu. Ainsi, la chair est lavée pour que l’âme soit purifiée ; la chair reçoit l’onction pour que l’âme soit consacrée ; la chair est marquée d’un signe pour que l’âme soit protégée ; la chair est couverte de l’ombre de l’imposition des mains pour que l’âme soit illuminée par l’esprit ; la chair se nourrit du corps et du sang du Christ pour que l’âme se repaisse de la force de Dieu. On ne peut donc pas les séparer dans la récompense puisque le service les réunit (…) (Tertullien, « La résurrection de la chair » dans Patrologie latine).
L’individu auto-construit est l’horizon du dernier homme. Il se dessèche car il cesse de transmettre la parole qu’il a reçue. Il n’est plus debout sur terre, à contempler le ciel, mais dans la jouissance nécrophile du déchet, préoccupé uniquement par la saisie et la consommation de l’objet. En niant la différence sexuelle, il s’enferme dans son propre linceul.
Son nihilisme entraîne une débâcle des montages symboliques et normatifs (Pierre Legendre). Sa barbarie opère dans la gestion technique de l’espèce humaine.
…
Une élucubration parmi d’autres, celle-ci de Monique Wittig : Il faut détruire politiquement, philosophiquement et symboliquement les catégories d’homme et de femme.
Le natif, le donné et le déjà-là sont balayés par l’individu post-humain dont les droits (et les droits les plus extravagants) sont devenus la référence absolue. Si personne, jusqu’à ce jour, n’a réussi à naître tout seul, ce sera prochainement possible, à défaut d’être souhaitable. Ce dont la médecine démiurgique rêvait - une indifférenciation sexuelle, une vie sans naissance et une chosification transhumaniste – le nouvel ordre moral le fonde. La prière de Maimonide : Eloigne de moi l’idée que je peux tout, s’est sauvagement renversée. La relation technicienne et fonctionnelle entre le monde de l’individu autofondé détruit la filiation. Le droit des minorités dissocie. Que serait le nom s’interroge Xavier Lacroix (Le corps retrouvé, Bayard) sans la loi et l’héritage, la mémoire et la tradition ?
Il sera lobotomisé et par conséquent disqualifié. Le déclin du Père symbolique n’a-t-il pas déjà disqualifié la place du père réel ?
…
Dans ce monde nouveau, codifié par la loi, le sexualité n’est plus nécessaire à la reproduction. La différence sexuelle n’était-elle pas qu’un brouillon, qu’une donnée accidentelle qu’il s’agit maintenant de gommer ? L’enfant, conçu dans un tube de verre, délocalisé hors de sa mère (on délocalise bien les industries) et né de spermatozoïdes inconnus fait de lui un pur artifice. Le diktat social ne crée pas de symbolique. Il instrumentalise le corps de la femme et celui de l’enfant, objet tous deux, d’un contrat marchand. Le bébé idéal – au corps machine – soustrait aux déficiences, mis en vente prochainement sur internet, parviendra à stopper son vieillissement cellulaire et multipliera ses performances. Dans l’indifférenciation généralisée, seules des options (de couleurs notamment) seront permises.
…
J’ai toujours eu un mépris absolu pour l’opinion publique, je n’ai jamais souhaité appartenir ou m’assimiler à un groupe social. N’ai-je pas pris le risque, à plusieurs reprises dans ma vie, de manifester qui j’étais et de renoncer à ce que je possédais ?
Moi, je ne dois rien au forum, rien au champ de Mars, rien à la curie : je ne veille sur aucun bureau, je ne m’empare d’aucune tribune, je ne guette aucun prétoire, je ne respire pas l’odeur des canaux… Je ne plaide pas en hurlant, je ne suis ni juge, ni soldat, ni roi : je me suis retiré du peuple. (Tertullien).
Baudelaire : Parmi l’énumération nombreuse des droits de l’homme, deux assez importants ont été oubliés qui sont le droit de se contredire et le droit de s’en aller.
C’est le christianisme qui a défendu la sphère privée – le « je » - porté par le Verbe souverain et l’anarchisme. Ce « je » est en guerre, contre lui-même d’abord (dans son combat pour une identité nouvelle), et contre tout collectif. Le corps des croyants et des mystiques n’est-il pas au cœur de leur témoignage ? La découverte concrète de l’humanité du Christ se construit sur une identité propre, à chaque fois unique, refusant la totalité hégélienne : L’esprit ne peut s’attarder sur les souffrances de quelques individus, les buts particuliers se perdent dans le général. Et bien non, justement. Car de quel esprit s’agit-il ? Sans doute pas de l’esprit chrétien pour lequel chaque âme, et surtout celle qui souffre – compte plus que le sens de l’histoire.
…
L’homme est tombé de Dieu sur lui-même (Bossuet).
Le christianisme n’est pas la religion du progrès, mais la religion du salut (Péguy).
L’idée de progrès est l’idée athée par excellence (Simone Weil).
Lecture en continu (ça coule de source) du livre de Gustave Thibon : Les hommes de l’éternel (Mame). Le mythe du progrès, nous rappelle t’il, qui fut une ligne de force du romantisme, est une hérésie, une projection caricaturale et assassine, dans le monde profane, d’une aspiration à l’Eden. Ce mythe de la rupture s’en est pris à la paysannerie héréditaire, à la culture du peuple de France, aux convenances strictes et aux mobiles intimes qui gouvernaient les anciens.
L’homme taupe, enchaîné à lui-même, a fini par vider la mer, effacer l’horizon, détacher la chaîne qui liait la terre au soleil (Nietzsche). Quand le souffle du vide lui fait face, l’homme taupe cherche refuge dans la trépidation et l’abrutissement. Le « faire n’importe quoi, mais faire quelque chose » l’agite quotidiennement. Ne trouvant aucune raison de vivre et d’agir, il s’enferme dans la défaite de l’amour. Et pour masquer cette course à l’oubli, cette impossibilité de transmettre, l’enfer moderne se fait légal et souterrain. On gagne l’univers et on perd son âme, on conserve les ovules au frais (« la vitrification ovocytaire »… soulignons l’élégance des ces mots) et on rompt toute filiation, on massacre et encore plus qu’autrefois mais on massacre sous couvert de générosité et d’égalité.
…
Je suis royaliste de sentiment et gaulliste de raison, autrement dit je suis à la marge de la marge. Mais les minorités dédaignées ne sont-elle pas les laboratoires de demain ? Ne viennent-elles pas bousculer les injonctions morales, les bons sentiments, les menaces et les platitudes de nos gouvernants et des chiens de garde du divertissement pour tous ? La république, veuve de ses rois, entachée par la faute et par la soumission est incapable de surmonter, sans se diviser, les crises graves. Pire, elle les provoque et les accentue jusqu’à céder parfois à un roi-dictateur (Pétain/Laval), à un ersatz greffé sur le royalisme traditionnel. Elle a rompu le lien charnel qui relie le présent au passé, elle a déraciné la pensée et fabriqué, après les redoutables conquêtes de la science et les fausses promesses politiques, l’école du désespoir. En sanctifiant le temps humain, christianisme et royalisme unissaient tout un peuple. Ils déjouaient le culte de la race pure et le culte de la classe laborieuse.
Toute résistance autre que symbolique est devenue inutile, le spectacle d’hypnoses collectives sort vainqueur, mais pour combien de temps encore ?
…
Une pédagogie de la déconnexion et une éthique du détachement s’imposent devant le bruit et la fureur de notre actualité. L’avenir n’appartient-il pas aux ordres contemplatifs ?
Nous sauvera de la chute évolutive vers les sociétés d’insectes celui qui inventera une nouvelle génération de monastères : ce mot signifie une association paradoxale de solitaires et de solidaires. Nous aurons besoin d’un saint Benoît, d’un autre moi et d’autres prochains (Michel Serres : Hominescence, Le Pommier).
Mais pour consentir à la distance et à la proximité, il faudrait cesser de se prosterner devant soi-même et devant les idoles. L’homme s’est perdu dans son affirmation de soi, l’intemporel de la vie liturgique est totalement étranger à la nouvelle souveraineté capricieuse de l’individu.