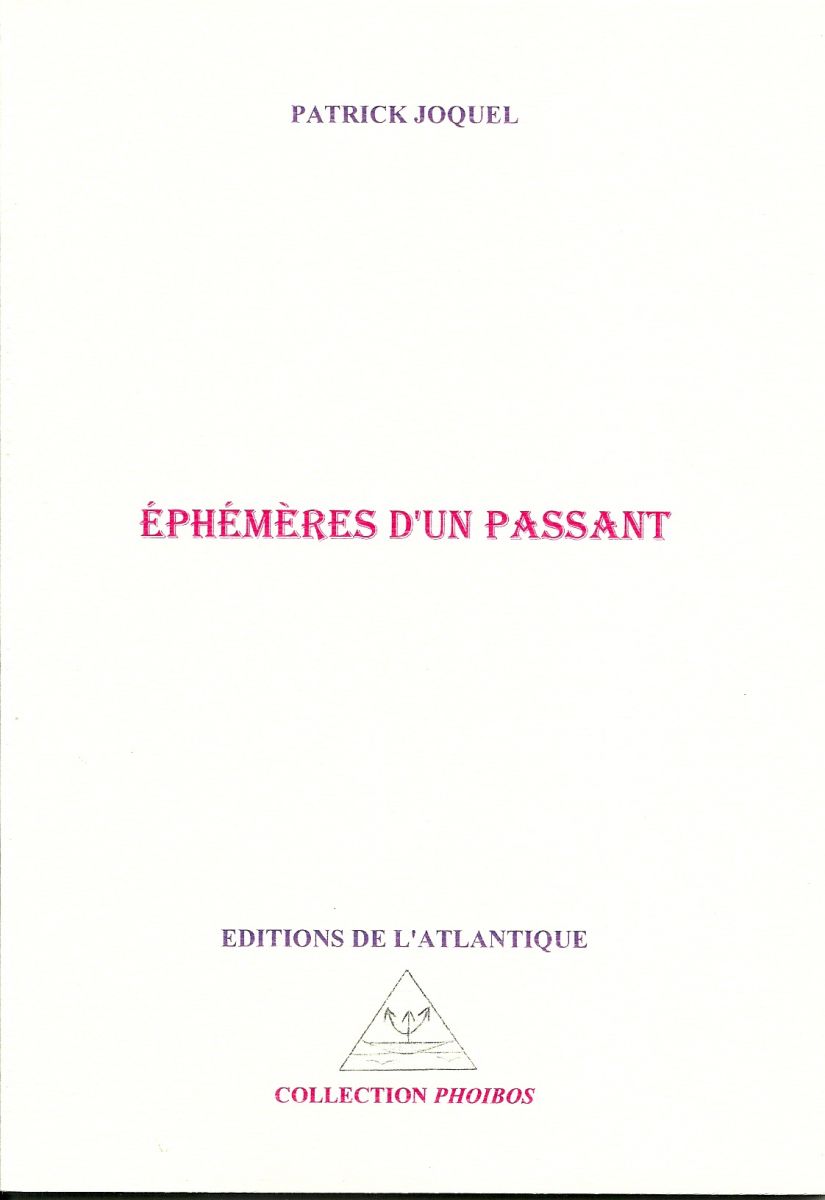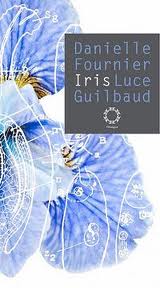Ce texte est un extrait du livre de W.S. Merwin, à paraître prochainement sous le même titre, dans cette traduction de Pascal Riou et Jean Markert
Je suis passé de Venise à la Sainte montagne de la Vierge, à l’Athos, en à peine deux nuits.
Chacun s’attendrait à ce qu’un tel passage soit source d’un contraste si abrupt et si entier qu’il en devienne choquant — un grand écart entre parfaits contraires. De fait, le contraste fut bien là, partout. Mes oreilles résonnaient encore du bruit de succion des sombres canaux, de l’effervescence anonyme des foules Piazza San Marco, alors que je commençais à entendre le vent dans la châtaigneraie qui se déploie juste en-dessous de ces crêtes où nichent les corbeaux. La lumière d’automne, ses reflets miroitant sur l’eau et le long des façades de tant de palais construits sur de la boue, les vanités évanescentes, la légèreté trompeuse et les secrets insaisissables de la Reine de l’Adriatique — merveilles de composition réglée — un goût pour la possession réclamant jusqu’à la mer, année après année, comme maintenant la mer la réclame, une cité qui choisit le mariage comme figure de soi (ce n’est pas un hasard si Othello se déroule à Venise), une ancienne république dont le pouvoir et la grandeur furent représentés par d’anciens prisonniers élus, une cité toute en feuilles mais sans arbres, à la fin septembre, cité que le sommeil du voyage avait avivée et non voilée —, lorsque j’arrivai à pied, seul, au détour d’un virage relevé, et vis, dans la prime lumière, loin vers le sud-est, à travers les bois, l’ombre nue s’élevant à plusieurs centaines de mètres au-dessus de la mer, jusqu’à la pointe de marbre que certains prirent pour ce sommet extrême d’où le démon montra à Jésus tous les royaumes de la terre et leur gloire, et que beaucoup croient être, en l’approchant par le nord (et donc depuis l’endroit où je me tenais), le lieu que la Mère de Dieu avait reçu pour jardin terrestre. Au premier abord, ces deux lieux semblent n’avoir rien en commun sinon la planète et ses révolutions, mais lorsque l’on passe de l’un à l’autre, cette simple pensée révèle d’autres liens. L’Athos et Venise se font écho comme paroles de l’être, en disent les dimensions et les trésors, et tous deux regardent bien au-delà de nous. Ni l’un ni l’autre n’appartiennent à notre siècle, pourtant tous deux donnent à entendre un sens qui, bien que clairement partagé par de nombreuses époques, semble caractéristique du présent et de son allure : une touche de vertige, la sensation de pierres du gué s’enfonçant sous les pieds qu’elles aident à traverser.
Venise, bien sûr, s’enfonce littéralement, engloutie par ses triomphes, succombant sous ses propres monuments. Les piliers de bois ayant plongé profondément dans la vase et l’argile, ayant pourri sous le poids du marbre, on a encore ajouté du marbre au pavage, rehaussant le niveau mais aggravant
la charge. Sur les canaux, les marches de marbre blanc qui montaient jadis aux embarcadères disparaissent maintenant sous l’eau polluée. Barges de livraison, vedettes à rideaux des riches, vaporetti aux diesels surpuissants, hors-bord chics de ces éternels adolescents qui ont beaucoup à prouver et disposent de moteurs pour le faire, tous envoient les vagues ricocher le long des canaux étroits. Année après année, elles éclaboussent plus haut les portes pourrissantes et glissent plus avant dans les demeures, charriant des morceaux de bois flotté, des canettes, des trucs en plastique usagés, des sacs-poubelles noirs tombés à l’eau en glissant des barges d’ordures, des nappes d’essence, de détergents, et jusqu’aux effluves dernier cri. La pierre qui borde la ligne d’eau est peu à peu rongée. Les fissures grimpent dans la maçonnerie, les campaniles penchent d’un côté ou de l’autre sur des fondations qui vont s’affaiblissant. Lors des grandes marées, à l’équinoxe d’automne, la Piazza San Marco et les rues qui l’environnent sont sous l’eau. La lagune refoule par toutes ses rigoles d’écoulement aménagées entre les pavés bien alignés. Elle monte jusqu’à pénétrer dans la somptueuse basilique Saint-Marc dans laquelle le saint est si souvent représenté traversant les eaux, où la colombe la plus visible sur le plafond du porche est bien celle de Noé. Certains jours les doigts de l’eau recouvrent le pavement de mosaïques. Des planches permettent aux files de touristes d’avancer et de reculer lentement et d’enjamber le pavement pour entrer et sortir de l’église. Les gondoles amarrées aux jetées semblent mouiller au large de la lagune. Beaucoup disputent de la vitesse à laquelle la ville s’affaisserait, mais il semble certain que le phénomène s’accélère au rythme du pourrissement des piliers. Par ailleurs, la surface — pas seulement celle des eaux, mais tout le superficiel : le visible, l’extérieur, l’ornement, le public, la monstration — ont toujours fait partie intégrante de la nature, de l’architecture et de la vie de Venise, et si Venise peut être préservée, même morceau par morceau, il est évident que cela ne se fera pas sans des marques d’attention publique, complexes, onéreuses et telles que Venise puisse continuer d’être vue. L’Athos, c’est une autre affaire. Ici aussi la richesse s’est affairée, ici aussi on aura pratiqué l’accumulation : rois et reines ont édifié des monastères, les ont dotés, restaurés, protégés, et ajouté à leurs trésors. Ici aussi les apprêts du visible — fresques, manuscrits enluminés, architecture, sculpture — sont appréciés, admirés, jusqu’à vénérer certaines icônes. Mais, tandis que Venise profite des touristes et pourrait pour finir devoir son salut à leur argent, l'Athos n’attend rien d’eux ni de ce qu’ils représentent sinon sa destruction imminente. Car l’Athos comme la cause de sa ruine sont d’essence invisible.
Sur le strict plan géographique, le chemin pour s'y rendre passe par la Grèce. Trois péninsules, disposées tels les doigts d’une main, composent la Chalcidique et plongent dans la mer Égée. La Montagne se trouve au bout de la plus orientée, celle qui regarde Lemnos. Une quarantaine de kilomètres de long, rien que du rocher, élevé, même si à la pointe nord un morceau de terre s’abaisse presque au niveau de la mer. La fable veut qu’entre les deux rives certains bords d’une gorge à peine visible soient la trace d’un canal creusé sur l’ordre de Xerxès qui, cinglant contre la Grèce au début du V° siècle avant J.C, redoutait d’affronter les eaux terribles qui battaient le pied de la montagne. Quelques années auparavant, une flotte entière avait sombré en la contournant. Au sud de cet hypothétique mémorial, la terre s’élève en de douces collines sur quelques kilomètres, puis se soulève en de rudes plissements qui courent jusqu’au sommet. Au début de ce siècle, la frontière de la Sainte Communauté de l’Athos se trouvait bien plus au nord qu’aujourd’hui. Le gouvernement grec a exproprié de vastes surfaces à la base à peine déclive de la péninsule — la plupart de ses meilleures terres agricoles — et les a cédées à des fermiers ou pour des fins autres qu’agricoles. Comme compensation, on promit aux monastères dont on prenait les terres, quelque subside régulier et c’est de celui-ci qu’ils dépendent. (Son versement est aujourd’hui remis en cause.) La communauté monastique, d’après les termes de la charte qui la régit, se gouverne elle-même. Et, s’il existe bel et bien un lien avec l’état grec, il semble ne satisfaire aucune des deux parties. Le premier contact du visiteur avec la communauté se fera probablement à Thessalonique, dans les locaux de la police. Selon le traité de Lausanne de 1923 et la charte de l’Athos de 1924, dessinés communément par la Grèce et la communauté monastique, si les moines sont sujets grecs et soumis au système pénal grec, l’administration ecclésiale est, elle, laissée aux représentants des vingt monastères — une police ecclésiastique peut ainsi refuser l’entrée aux visiteurs. Il y a peut-être encore cinquante ans, les pèlerins pouvaient débarquer sur la péninsule athonite sous nul autre drapeau que le leur propre et y demeurer sans lettre de créance jusqu’à leur mort — certains, dit-on, firent ainsi. Dans cette ancienne tradition, l’hôte était un envoyé du ciel et devait être reçu comme le Christ. Maintenant les papiers sont requis, en triple exemplaire. Ils doivent être fournis par la police grecque, ce qui nécessite de traverser la ville, de se rendre dans un autre bureau, puis de recevoir ensuite confirmation des autorités de l’Athos. Jusqu’à il y a peu, aucune limite ne s’imposait aux visiteurs quant à leur séjour. Maintenant, consécutivement au
nombre croissant de touristes, une semaine est un maximum, sauf si les représentants du monastère décident d’étendre l’autorisation et, normalement, un visiteur n’a pas le droit de séjourner plus de vingt-quatre heures dans chacun des monastères.
C’est la route qui a permis ou, à tout le moins, aménagé ce changement. Pendant des siècles, le voyage jusqu’à l’Athos fut long et exigeant. Il exigeait plus que de la curiosité, quelques heures et le prix d’un ticket de bus, pour celui qui, à dos de mule ou bien à pieds, devait traverser les quelques cent cinquante kilomètres de montagne inhospitalière qui vont de Thessalonique au pied de la péninsule. Ces dernières années, la route a été arasée et goudronnée jusqu’à la frontière actuelle, située jadis bien plus à l’intérieur du domaine monastique. Pendant la majeure partie du trajet, elle serpente à pic entre les bois de châtaigniers et les pentes dénudées, reliant quelques sanctuaires et petites villes, passant sous les murs d’un château en ruines à Stagire où vécut Aristote —, un panneau rédigé en alphabets grec et latin invite à faire un détour jusqu’à une statue blanche: la forme d’une barbe et d’une toge. Un profil régulier faisant face à la mer contre le ciel vide, alors que le bus prend un virage —, profil qui a l’air tout neuf. Le Philosophe, vous savez. Dans ces petites villes, un moine me le racontera, ils ont des stades de football mais pas de bibliothèques. Villages de collines plantés au milieu de vergers dont les pommiers ploient sous les fruits, branches maîtresses prêtes à rompre et s’affaissant sous leur poids jusqu’à toucher de vieux murs par dessus lesquels se déversent les pommes, tout cela immergé dans la lumière d’octobre. Dahlias, géraniums, calendules. Des gens attablés dehors à l’ombre de treilles dont les dernières feuilles virent à la transparence après la vendange. Chiens qui se faufilent entre les ombres des tables. Serviettes pendues près des portes ouvertes. Familles faisant face aux bus comme si elles attendaient le photographe. Feux de bois. Antennes de télévision. Poules sous les étendages. Tas de briques creuses rouges et neuves, mortier blanc, tuiles brutes. Erissos, en bas sur la rive de la mer Égée, est parfaitement moderne — partout des logements (dans leur version sud-européenne) dont on dirait que chaque pièce pourrait servir de salle de bains. La vieille ville a été ravagée en 1932 par un tremblement de terre qui tua nombre de ses habitants. Un peu plus loin en contrebas, sur la côte, à l’écart du rivage et au milieu des arbres, au-delà de petits champs et de pâtures dans lesquels vaches et ânes sont laissés à l’attache, on voit les coupoles d’une minuscule église, un avant-poste de l’Athos, et plus loin sur la côte, avec vue sur la mer, une construction de ciment brut : un hôtel. Peu de voitures
sur la route, mais les développeurs ont des projets ! Après la première tentative d’hôtel, la route s’élève et traverse la péninsule pour finir sur la première baie profonde. En l’espace d’une année, on a achevé un complexe de béton sur les rochers dominant l’eau : route avec vue panoramique, éclairages banlieusards, semper virens en grande livrée : architecture de clinique de carte postale ou d’un secteur chic du Mur de l’Atlantique. Et le nom, Eagle’s Palace Hotel (sic), en anglais, pour qu’il n’y ait pas d’erreur possible. Soyons certains que ce n’est que le premier d’une longue série. Sur la rive en contrebas, sur le petit quai de Tripiti, des bateaux de pêche font la traversée jusqu’à l’île d’Ammouliani. Après quelques minutes, la route descend jusqu’au village côtier d’Ouranopolis, le terminus , pour l’heure.
Les alentours du village sont bordés de constructions à plusieurs étages à demi finies : les hôtels du resort prévu l’an prochain. Mais le bâtiment qui domine pour l’heure l’endroit est la tour de Phosphori, du XIII°siècle, sise sur les rochers du rivage. Ce fut jadis une dépendance du monastère de Vatopedi, et il se peut qu’elle signale le site de la ville païenne de Dion. Au début du siècle dernier elle devait se dresser, presque seule, au bord de l’eau. À côté, une petite et vieille maison qui pendant quelques années servit d’auberge et, face à la mer, les vestiges de quelques autres maisons de campagne reconverties en boutiques et en gargotes. À mon dernier passage, il y a un an, en septembre, quoique commençant à décliner, la saison battait encore son plein. Nombre des tables sous les pergolas et dans les restaurants étaient occupées par des allemands — on m’a raconté que le goût de cette nation pour la Grèce avait été mis à profit par le propriétaire du nouvel hôtel soigneusement paysagé, situé sur la plage à la périphérie de la ville, lequel avait des liens avec des voyagistes en Allemagne. On est confiant : chaque année sont attendus de plus en plus de bus d’allemands toutes classes confondues. Un étranger, on lui parle d’évidence en allemand. Mais le premier octobre, cependant, la Vie revient chez elle. On remise la plupart des tables, ferme les restaurants, l’antiquaire retourne à Thessalonique, et les portes sont laissées ouvertes qui donnent sur la mer afin que les femmes, des chats à leurs pieds, puissent profiter du soleil de l’après-midi pour leur ouvrage. La majeure partie du village fut construite après la première guerre mondiale afin d’y loger deux groupes de grecs d’Asie mineure conduits là sous l’égide de la SDN, au titre de la réimplantation des populations déplacées. Un an après mon passage on s’était débarrassé de presque toutes les structures originelles et des chemins qui les reliaient, la place était nette pour de futurs hôtels. Mais en octobre les gens du cru s’asseyent toujours sous la treille du seul
café ouvert, et le doigt de résiné dans leurs verres brille de toute l’immense lumière marine. Au-delà de ces tables, le quai et le sable du rivage. Mes affaires déposées à l’auberge, je suis descendu jusqu’à la plage vide, ai dépassé un pointu tiré sur le rivage, un camion déglingué, un hôtel tous volets clos, des rochers éboulés courant à la mer. Oiseaux dans les épineux parlant du soir — voix de pipit, de bergeronnette ou d’alouette, trille cristallin de quelque pinson, aucune d’elles totalement familière, bien que les mots antiques demeurassent clairs. Ombres tourbillonnant sur la face sombre des rochers, puis sur celle dont se retirait la lumière. Le soleil descendait dans des nuages frangés d’or. La dernière brise mourrait. Le clignotement d’une bouée signalant un amer faisait écho, écho durable, avec les quelques lumières aussi ténues que des étoiles brillant au-dessus d’Ammouliani, où, m’a-t-on dit, il n’y a pas l’électricité. Au-delà, vers l’ouest, la péninsule se fondait dans la mer sombre. Celle-ci fut consacrée, jadis, au dieu de la mer, et son sommet désigné comme son fils. Soudain des nuages d’insectes minuscules surgirent, voletant au dessus du rivage dans la pénombre, et la lune, presque neuve, rassembla la lumière au-dessus des eaux. Alors que je rebroussais chemin, un petit chien courut vers moi le long de la plage —, comme s’il me connaissait.
Strabon écrit que ceux qui vivaient au sommet du mont Athos voyaient le soleil se lever avec trois heures d’avance. Il n’a pas dû venir vérifier la véracité de sa phrase: le sommet est un éperon rocheux inhabitable. Mais, peut-être, ne faut-il pas lire dans son assertion cette offrande de faits vrais que nous exigeons aujourd’hui de chaque phrase, mais quelque chose comme : « un haut lieu, à demi légendaire, qui dialogue en propre avec le matin ». Ceux qui vivent maintenant sur la rive occidentale, à la base de ce long promontoire, se lèvent avant le soleil, comme le font partout les habitants des villages de pêcheurs. Ils n’ont pas l’air pressés : ils traversent la brume d’un pas traînant, cols relevés, des châles sur la bouche, portant des sacs ou les mains vides, comme s’ils attendaient que quelque chose passe ou repasse. Quelques silhouettes finissent par se rassembler sur le quai de ciment, à côté de caisses de poisson, de paniers, de tonneaux de fuel ; trois ou quatre portent des sacs à dos, il y a plusieurs moines en robe noire avec des sacs en peau de chèvre ; pour finir les pêcheurs arrivent, le passeur, et l’inévitable policier. Il n’y a pas bien longtemps, la majeure partie du trafic de pêche et du trafic côtier se faisait sur des caïques ou sur de petits bateaux à vapeur qui jetaient l’ancre au large des villages avec une certaine régularité, voire souvent. Depuis la dernière guerre, les bateaux de pêche ont adopté une
forme moins caractéristique —, et des moteurs. Les pionniers de cette conversion ont toujours leurs barres de gouvernail et leurs garde-corps en bois et des rampes bien chevillées. Ceux qui les ont remplacés sont de gros diesels d’acier avec de larges poupes conçues pour le chalut et le frète, et des moteurs stertoreux. Ces deux types de navires assurent le trajet jusqu’à Dafni, le port de l’Athos. Le bateau part à sept heures. En octobre, le premier soleil a juste commencé de blanchir la façade orientale de la tour de Phosphori et la mer qui la baigne. Le bateau pique vers la côte sans jamais s’en éloigner. L’état monastique commence un peu plus loin en bas du village. La frontière actuelle est un mur de pierres effondré, après lui règne l’antique règle monastique de l’Athos, instituée dit-on par la Vierge elle-même.
Ils disent, sur la Montagne, que la Vierge et Saint Jean sont venus en bateau depuis Joppé pour rendre visite à Lazare ressuscité qui vivait alors à Chypre. Une tempête avait drossé leur vaisseau vers la Montagne et la Vierge aborda près du site de l’actuel monastère d’Iveron. À cette époque il y avait là un temple dédié à Poséidon mais, lorsque la Mère de Dieu apparut, les idoles tombèrent en morceaux. Elle bénit la Montagne et dit que ce serait là son jardin, elle interdit à toute autre femme d’y poser le pied. Cette injonction a été quasi strictement respectée. Au douzième siècle, des bergers valaques vinrent s’installer dans la partie nord du promontoire, trois cents familles, et des femmes qui se révélèrent fatalement séduisantes pour bien des moines. Quand les bergers furent finalement expulsés, les pères qui avaient fauté furent excommuniés et leur nombre fut tel que la population de la Montagne fondit. On dit qu’à plusieurs reprises l’impératrice Placidia et Maria, la fille du prince serbe George Brankovic, qui avait épousé un sultan, sont venues en visite à l’Athos. Toutes deux furent des bienfaitrices de l’État monastique. Mais à Vatopédiou on affirme que l’icône maintenant connue sous le nom d’Antiphonitia de Placidia s’est adressée à l’impératrice en l’avertissant de ne pas aller plus loin : « Car c’est une autre reine qui règne ici ». On raconte que la reine Maria, au quinzième siècle, a posé le pied sur le rivage à Agios Paulou (Saint-Paul), apportant avec elle l’or, la myrrhe et l’encens que les rois mages avaient offerts à l’enfant Jésus, mais on entendit une voix qui n’était pas de la terre lui interdire de faire un pas de plus, et ce pour la même raison. Des filles des villages situés au nord franchissent le mur à l’occasion pour ramasser des olives ou ramener des chèvres égarées et, en 1948, la guérilla parmi laquelle figuraient vingt-cinq femmes, occupa brièvement Karyès, la capitale. Reste qu’en général ce commandement a non seulement été observé, mais également étendu, pour lui inclure les animaux
domestiques femelles et toutes les « personnes qui ne portent pas la barbe », quoique la règle qui concerne les animaux varie d’un monastère à l’autre — des chats se promènent dans la plupart des maisons et des poules aux alentours de certaines — et, quant à la barbe, la règle, lorsqu’il s’agit de visiteurs, est en pratique simplement comprise comme : « suffisamment âgé pour en laisser pousser une ».
À mesure que monte le soleil, des rayons brumeux se déversent dans les ravins broussailleux et les failles plongeant jusqu’à la mer. Le matin d’un lieu sans pareil. Aucune habitation visible. On dirait qu’est inaudible le bruit du bateau sur le rivage. Eau verte au-dessus des rochers, au détour d’une pointe, un abri à bateaux sur une plage de galets, une prairie tout près que clôt un mur, avec quelques vignes et des oliviers. Personne en vue. Un peu plus loin sur le rivage, un autre abri à bateaux et un bâtiment à deux étages plein de recoins, orné de stucs, avec un porche au niveau du second étage : un moine est dehors qui aère des draps sur la balustrade ; personne sur la jetée. Les falaises s’élèvent plus haut depuis la mer. Sur de toutes petites saillies rocheuses, au-dessus des eaux ou de gorges étroites, des ruines apparaissent. Quelques-unes de la taille d’un gros corps de ferme, avec la coupole en pierres de leurs chapelles encore intacte. Ce furent des skites — mot traduit par « cloître » : un collège de moines attaché à un monastère mais vivant ailleurs sous la direction d’un prieur. Ou bien, si elles sont plus petites, il s’agit de kelli, établissements dans lesquels logent au moins trois moines travaillant aux champs. Ou encore des ermitages. Les toits de beaucoup d’entre eux se sont effondrés. On voit le ciel à travers leurs murs. Des vestiges de jardins, de terrasses pas plus grands que des tables de cuisine, se cachent dans une végétation ensauvagée qui continue d’attraper le soleil du matin. Une autre pointe à l’écart révèle le premier des monastères de la côte : Dohiariou. Abri à bateaux en pierre, mi-grange, mi-fortification ; arches, porches, piliers carrés et cheminées en pierre. Le monastère se dresse derrière : hauts murs, longs balcons lancés sur le vide, haute maçonnerie frustre, plâtre peint de rose et de bleu, montants de bois, rangées de fenêtres, tuiles rousses, coupoles, dômes et cheminées qui tous montent jusqu’au donjon carré massif et crénelé, adossé à des terrasses d’oliviers et fiché sur une pente raide et boisée. Moines qui attendent : le bateau fait escale, un moine descend et avec lui un bric-à-brac de sacs et de boîtes. La chose se répète un peu plus loin au monastère suivant, Xenophontou, qui élève à même la plage de galets une autre gerbe de créneaux, tours, balcons et dômes. Idem au troisième, St
Pantaleimonou, un monastère russe et, jusqu’à la révolution de 17, le plus grand de l’Athos : énorme, sombre, relativement moderne (en grande partie bâti au dix-neuvième), une aile entière détruite par le feu, jamais réparée, il ressemble à une usine en ruines. Au tournant du siècle, ce monastère abritait environ quinze cents moines. Il possède un port dans lequel pouvaient mouiller des navires de haute mer. Dans l’une des tours est suspendue la deuxième plus grosse cloche du monde, amenée là depuis Moscou. Maintenant n’y demeurent qu’une vingtaine de moines, et maigres sont les chances d’en voir d’autres arriver de Russie, comme celles de voir le gouvernement grec leur permettre de rester s’il en venait. Au détour d’une pointe après St Pantaleimou, Daphni apparaît : une jetée, un bâtiment au bout, une courte série de maisons décorées de stucs blancs fait face à la mer.
L’uniforme traditionnel de la police de l’État monastique comprend une veste rouge à liseré doré, portée sur une chemise blanche, des chaussures à pompons et un chapeau qui oscille entre le calot et le béret. Certains éléments du costume sont indéniablement très anciens. Au quotidien, le seul article de cet accoutrement qui soit réellement porté est le moins impressionnant, il s’agit du chapeau. Un homme qui en portait un, l’air contrarié, attendait à l’entrée de la baraque des douanes, au bout de la jetée et arrêtait chaque visiteur pour lui tendre un prospectus rédigé en quatre langues : de brèves explications sur la Montagne de l'Athos trouvaient leur raison d'être au dernier paragraphe : « En conséquence de quoi, il est attendu de vous qui vous apprêtez à visiter la Sainte-Montagne, que votre apparence générale, tant quant aux vêtements que quant à la chevelure, fasse preuve de la modération appropriée. Nous serons au regret de nous sentir obligés de refuser l'entrée à ceux qui n'observent pas cette règle. ». Indépendamment d’autre significations possible, cela signifie : « pas de hippies », quel que soit le sens donné à ce mot. Plus précisément et la plupart du temps, la modération appropriée correspond aux canons de beauté de la classe moyenne grecque contemporaine et laïque, et cela signifie : « pas de cheveux longs » —, bien que les moines portent les leurs relevés en chignon sur la nuque. Le jeune allemand dont les boucles blondes tombent sur les épaules ne s'en est pas encore rendu compte mais, s'il veut un laissez-passer à Karyès, (et il en aura besoin s'il veut séjourner sur l’Athos), on l'emmènera certainement à l'arrière d'un bâtiment, chez un barbier installé entre quatre planches, une construction récente à mi-chemin entre des latrines faites avec les moyens du bord et la baraque d'une diseuse de bonne aventure, et là on s'attachera à modérer ses boucles de la manière
appropriée —, bien dégagée sur les oreilles. Dans l'unique rue, deux véhicules attendaient dans la poussière entre les baraques des douanes et la rangée de magasins. Un bus antique, avec une échelle à l’arrière pour monter les bagages, parmi lesquels des caisses de poissons et des plants de gardénias. Et une Land Rover grise, très classe, propriété de la police grecque. J’ai musardé jusqu'à entrer dans un magasin pour récupérer une nouvelle carte de l'Athos (il y a plusieurs éditions disponibles, mais toutes dépourvues d’intérêt pratique pour trouver son chemin dans le labyrinthe des sentiers pédestres qui serpentent de ravin en ravin au long des crêtes) et pour regarder les gravures sur bois réalisées par les ermites et les objets vendus à destination des ouvriers et des moines : tissus épais, plats robustes, lanternes, savon, lampes torches, fers de hache, cordes, riz. Partout les mêmes choses et partout différentes. Après le troisième ou quatrième magasin une pergola abritait les tables d'un café. J'ai posé mon sac, à l'ombre. À l'une des tables un grand moine à la barbe grise, était en pleine discussion avec trois hommes en tenue de vacances qui venaient clairement de l'extérieur. La conversation se déroulait en anglais et, pendant que je refaisais mon sac de telle sorte que la nouvelle carte fût facilement accessible et rangeais le pull dont je n'avais plus besoin, j'ai entendu le moine, qui parlait avec un accent américain, expliquer à ses visiteurs, dont il s’avéra qu’ils étaient des prêtres catholiques romains, les règles des différents monastères concernant les habits des ecclésiastiques appartenant à une église autre que l'église orthodoxe. Ils dépendaient largement de ce qu'en pensaient les différents abbés. Un des visiteurs dit que sa soutane lui manquait pendant la nuit et qu'il avait eu froid. Le moine fit l’apologie de la sévérité de certaines maisons. Le bus a klaxonné, mais je l'ai laissé aller son chemin bruyant entre deux embardées sur la route sale. Je connaissais ce voyage en bus: une heure à brinqueballer dans cette vieille boîte à biscuits, pour monter la route des jeeps et franchir directement la crête de la péninsule. Les nuques des moines se balançant tout de go à l'unisson. Des icônes en guise de pin-up. Des panneaux pour interdire Ceci et Cela. La route du moteur rapetassé, et son odeur. J'étais heureux de déjà connaître tout cela. Cette fois-ci j'irais à pied.
La route suit la mer sur une courte distance puis tourne brusquement sur la droite et se transforme en pente raide. Une rangée de poteaux téléphoniques reliant Dafni et le continent se déploie parallèlement à la côte et disparaît brusquement alors que la route monte en lacets et s'éloigne de l'eau. Portails ouvrant sur des terrasses envahies par la végétation, dans la lumière vive du soleil ; mulets et chevaux paissant sous les oliviers. Sons des cloches harnachées, pinsons. La route fait des allers-retours
constants, grimpe, prend la direction d'un ravin abrupt, bifurque et repart vers un promontoire, vire vers l'intérieur du pays. Houx, arbousiers, lauriers. Abeilles. Grands papillons languides dans la quiétude du matin. Au sommet de la première longue montée, soudain un plateau étale et ombreux, puis au loin sur la droite, parmi de grands arbres, les hauts murs d'un monastère, un petit bas-relief usé qui représente un cavalier avec une lance — Saint Georges ? — inséré dans le coin le plus proche de la route, une fontaine face à laquelle est posée une louche d'étain. Un paysan qui empile des bûches sous les arbres. Xeropomatou, un énorme carré de pierre : vide. Fondé au dixième siècle sur le site d'un village plus ancien dont le nom est désormais l'objet de disputes. Un monastère qui a survécu à des tremblements de terre et des incendies et qui a été reconstruit par plusieurs dirigeants, parmi lesquels un sultan, Selim I. Il avait vu en vision les Quarante Martyrs de Sébaste— des Arméniens qui, au quatrième siècle, avaient été jetés dans un lac pour y mourir de froid — ceux-ci lui avaient ordonné de reconstruire le monastère incendié par des pirates peu de temps auparavant. Les martyrs, quant à eux, l'aideraient à combattre les arabes. Longtemps après la mort du sultan en 1519, ses successeurs continuèrent à approvisionner en huile les lampes installées devant l'icône des Quarante Martyrs dans l'église de Xeropomatou.
La montée se poursuit, aussi raide qu'auparavant ; le monastère, vu du dessus, rapetisse jusqu'à ressembler à une ferme sur une crête surplombant la mer. Le soleil grimpe dans le ciel, mais les hauteurs gagnent en fraîcheur. Le maquis propre aux terrains calcaires cède la place à des châtaigneraies, sur les pentes desquelles les mulets vaquent à l’ombre. La chaleur du soleil a dissout les dernières brumes ; la route serpente de plus en plus haut. Puis, sans prévenir, une présence soudaine, au loin sur la droite, barre un grand vide: la première apparition de la Montagne. Une fois vue, on gardera avec soi le sens de sa présence, où qu'on aille sur le promontoire et que le pic lui-même soit visible ou non. La route continue de se hisser sur la crête et la mer orientale, la Sainte Mer, se dessine derrière le feuillage des châtaigniers puis, en contrebas, derrière les bois, les toits de Karyès apparaissent : tuiles et fer rouillé, jardins, skites, et kellis semés sans ordre à partir du centre, un village en pente épousant les courbes de la piste qui descend, sinue, puis en devient l'unique rue.
Karyès, qui doit son nom à ses noisetiers, est la capitale de l'État monastique de l'Athos. À l'exception de Koutloumousiou, qui est considéré comme trop proche pour en avoir besoin, chacun des
monastères possède une maison en ville, appelée konaki. Elle héberge sa députation à la Sainte Épistasie, le corps qui gouverne et siège dans la Demeure de la Sainte Communauté, un grand bâtiment relativement moderne dominant la partie la plus élevée du village. La route s'élargit en une petite place poussiéreuse : dans le coin nord-ouest, moines et muletiers chargent et déchargent les mulets et les chevaux, des canassons castrés aux maigres pieds de chèvres qui savent toujours trouver la bonne direction sur ces sentiers de montagne abrupts et sinueux, bien souvent réduits à rien qu’une mince zébrure dans la roche. La rue elle-même commence par une volée de marches qu’entoure un chemin pavé : elles courent tout au long de deux pâtés de maison et devant quelques boutiques qui, pour la plupart, semblent aux mains de laïcs. Les vitrines exposent des gravures sur bois et d’autres objets faits par la main des ermites, des outils pour bricoler, des légumes secs —, dans l’une j'ai vu une cartouchière et un étui à pistolet. Boutiques de cordonniers, de selliers. À mi-chemin, la rue traverse la partie est de la place sur laquelle se dresse l'antique Protaton, l'église principale de Karyès, pour ensuite, dans un virage, descendre la colline en direction des bois. Une règle interdit de descendre la rue principale à dos d'animal, les moines mettent pied à terre et mènent par la bride chevaux et mulets sur les gros pavés usés. Cette règle ne semble pas s'appliquer aux grosses jeeps de la police grecque —, sans doute est-il plus dur de mener une jeep par la bride ! C'est ce véhicule qui m'avait dépassé dans un rugissement alors que je grimpais depuis la mer, à son volant se trouvait un jeune homme chez qui tout concordait ostensiblement : l’uniforme, le visage, la position à laquelle il s'était élevé —, le James Bond de Dafni. La jeep était garée sur la place par ailleurs déserte du Protaton, soulevée par un cric et sans les roues, un laïc couché sous le châssis, et le chauffeur penché légèrement afin de donner à son mépris de toute serviabilité sa hauteur toute relative. Le commissariat de police était encore ouvert, j’y récupérai mon passeport, mais la Demeure, qui est l'équivalent de la mairie de Karyès, étant fermée jusqu'à trois heures, il ne me serait pas possible d'obtenir mon laissez-passer avant cette heure. Descendre les marches vers la petite gargote où les deux chefs du commissariat — les seuls clients à part moi — étaient déjà installés. Il y a les jours poisson, les jours poulpe. Ce jour-là, aucun des deux. Murs pistache avec des affiches pour vanter le 21 avril et une photographie maculée de mouches du caudillo en exercice (3 octobre 1973), penché depuis le haut du mur comme un portrait de famille. Si jamais le décor avait donné envie de s'attarder, le cuistot m'expliqua clairement qu'il avait hâte de fermer : sa sieste lui tardait. La rue était vide. J'explorai la boutique d'un tailleur, il y avait à la fenêtre un carreau d'étain servant à faire passer le tuyau d'un poêle et, à l'intérieur, de poussiéreuses machines à coudre
plus vieilles que quiconque sur la Montagne. Un an auparavant, j'avais passé ici une heure en compagnie d'un moine à la fine barbe blanche, d'un muletier et d'un prêtre français en civil que j'avais rencontré sur les marches de la Demeure et avec qui nous étions convenus de visiter le nord de la péninsule; il avait voulu louer les services d'un guide et de son mulet pour porter les sacs à dos. Une heure de marchandage délirant, dans un bain de langues, tandis que j'essayais d’explorer les recoins de l'arrière-boutique —, resserres pleines de vies que j’avais cru avoir oubliées. J'avais observé les chaussures du moine : des boîtes de cuir noir, moitié sabot et moitié pantoufle, plus faites pour se traîner que pour marcher, et pour rester debout au cours des vigiles qui durent toute la nuit. La boutique était fermée : on n’aurait peut-être jamais dû s'y trouver. En été, en milieu de journée, Karyès la méditerranéenne cuit sur sa colline. Mais en automne, dans l'ombre de la rue, un froid sort des pierres qui est le froid des villes de montagne situées plus haut que les bosquets de noisetiers, un froid que l'on trouve aussi dans les villages tout au nord de la Grèce, nichés dans les hauteurs, entre calcaire et granit. Le flot du froid dans les rues vides à midi qu’accompagne le son de ces nombreux petits ruisseaux coulant depuis les châtaigneraies et traversant la ville endormie. Je retournai sur la place, à l'ouest du Protaton, et m'assis au soleil sur des marches qui montaient vers les romarins et les roses trémières tardivement fleuries, en attendant une hypothétique ouverture. Le sac à dos en guise d'oreiller, je m'assoupis au son des abeilles et ce furent les cloches des harnais tintant presque directement au-dessus de ma tête qui me réveillèrent : c'était le muletier rencontré de ma première journée de l'année passée, il montait le chemin, nous nous sommes serrés la main très fort dans un échange de congratulations et de mimiques. L'église était ouverte. À l'intérieur, un jeune moine déplaçait une échelle, s’occupait à remettre des cierges en cire d'abeilles dans une grande corona de cuivre : le candélabre circulaire suspendu dans la nef. Les étrangers ne sont pas toujours les bienvenus dans chaque église de la Montagne — le prêtre français m'avait déjà raconté avoir été froidement reçu au Protaton — et je me glissai sans faire de bruit par la porte ouverte afin de regarder les peintures murales mur après mur.