Maja Herman Sekulić Une Généalogie du 20ème siècle
4 poèmes en français et anglais
4 poèmes en français et anglais
Il est étrange de lire le mot « roman » sur ce livre de poète. Julliard aurait-il peur de la poésie ? À moins que Jean-Luc Marty ne le sache pas encore, ou bien qu’il soit en voie (on est tenté d’écrire « voix ») de le découvrir : l’état de son esprit n’est pas ici état de l’esprit d’écrivain enchaîné à la littérature mais bel et bien état de l’esprit de poète. Du reste, Gilles Lapouge, dans sa préface, le dit. On n’échappe pas à Gilles Lapouge. L’écriture de ce volume naît d’une image, ce qui forme – si l’on veut en croire Octavio Paz – la fondation même d’une poésie, « fondation » étant entendu ici au sens de ce qui sacre le temple. L’image est un des axes du poème, en effet. L’autre supporte la langue, celle qui ne se transforme pas mais fait passage selon Jean Grosjean. Un long poème donc, où « l’histoire » importe peu. Ce qui compte c’est l’image associée à la langue. Et cela dit bien plus qu’une des nombreuses histoires paraissant périodiquement, à coup de centaines de volumes entassés. La poésie est un temple rare. Ici, elle part de la prose, s’interroge, se cherche et conduit jusqu’aux poèmes de la fin du livre, annoncés comme des danses, et en effet il y a de la danse en transes dans l’acte même de la poésie, cette transe reliant l’être s’assumant poète au monde de la poésie, le Poème. Et au fil des pages, la prose s’évanouit. Pour laisser la place à une sorte d’auto-initiation poétique de l’écrivain Jean-Luc Marty, au poète qu’il est dans le réel. C’est pourquoi Dada surgit. Tout passe par la langue. Un beau livre en soi, d’autant plus beau qu’ici, au sein de Recours au Poème, rien ne nous plaît plus que d’assister à la naissance d’une poésie.
Jean-Luc Marty, Un cœur portuaire, Julliard, 2012, 120 pages, 16 euros.
………………………………..

Et rien de sûr si ce n’est la ville
chien fidèle. La ville compagne
la ville soutien. Elle te pardonne
chaque trahison, t’accueille à nouveau
dans ses bras. Te délivrant
du corps que tu désires
et que tu n’as pas.
[M. Pieris, Ville chien fidèle]
Cette anthologie choisie des poèmes de Pieris est traduite, composée et présentée par le meilleur connaisseur francophone de la poésie grecque contemporaine, Michel Volkovitch. Pieris est né sur l’île de Chypre. Son enfance s’est déroulée sur les hauteurs de Limassol. Etudiant en Grèce, il assiste à l’invasion de l’île par l’armée turque en 1974, puis à la partition de Chypre. Une partition toujours d’actualité sur une île dont la partie grecque est membre de l’Union Européenne, ce qui atténue un peu la propagande pacifiste « européenne » dont on nous serine les oreilles depuis des années. Sans que la sauce du virtuel ne prenne aussi bien que le souhaiteraient nos communicants européens. Tout cela dit beaucoup sur la manière dont l’Union Européenne se regarde. Cette histoire collective est source de l’histoire personnelle du poète. Car Pieris est parti en exil, en Australie d’abord durant 20 ans, puis dans différentes villes du monde, avant de revenir à Chypre et de vivre aujourd’hui à Nicosie. Ses Métamorphoses d’une ville sont nées de l’errance. Les poèmes ici représentés proviennent de divers recueils, ils tournent tous autour de la ville, des villes, et de l’apparition/disparition continuelle d’une femme pour nous inconnue. Le recueil comporte de très beaux poèmes, dont ceux consacrés à des villes françaises – ainsi, Paris. Pieris parle des villes comme l’on parle parfois des femmes en poésie, sans cesser d’être un poète du voyage. Il y a beaucoup d’émotion dans cet ensemble où la femme qui passe se fond dans le décor de villes qui naissent et disparaissent de mots en mots.
Ceci par exemple :
Je veux une ville qui me cache
Une ville qui tolère une ville qui vient en aide
une ville qui comprend une ville qui coopère
une ville qui accepte une ville qui approuve
une ville qui incite une ville qui compatit
une ville plus propice à la vie cachée.
Une ville qui stimule une ville qui excite
une ville qui conspire une ville qui participe
une ville qui se déchaîne qui se laisse aller
avec remords aux plaisirs illicites…
Qui se donne chaude comme deux bras ouverts
en des heures et des circonstances précises
et couvre nos péchés de sa bonne allure.
Je veux, je cherche une ville qui me cache.
Une ville aux figures inconnues
aux lieux nouveaux chaque soir
proposant une foule de rapprochements
de coïncidences inattendues et d’occasions fortuites.
Je veux une ville hardie une ville qui réchauffe
une ville qui se passionne une ville qui inspire
une ville aux douces paroles une ville qui console
une ville réconfort qui apaise mon esprit
une ville qui m’enferme dans sa chaude poitrine.
je veux, je cherche une ville qui me cache.
Et non du village indiscret le cœur
froid et dur, le visage glacial
et les nombreux miroirs, les maisons
transparentes, les micros dans les rues.
Mihàlis Pieris, Métamorphose des villes, Circé, 2012, 175 pages, 19,5 euros.
………………………………..
 Sur le plan chronologique de l’écriture, les textes de Un tango pour Amalia (2007) précèdent ceux de Sinon dans la chair (2009). Entre les deux, il y a la souffrance source de la violence sublime qui anime ces poèmes de Deschizeaux. Violence de la perte, celle de l’être proche.
Sur le plan chronologique de l’écriture, les textes de Un tango pour Amalia (2007) précèdent ceux de Sinon dans la chair (2009). Entre les deux, il y a la souffrance source de la violence sublime qui anime ces poèmes de Deschizeaux. Violence de la perte, celle de l’être proche.
(…) j’entends quelqu’un chanter le christ, et dans le marbre de mes ténèbres, il n’y a plus que marionnettes et prose en berne.
Ces mots tirés du tout premier texte du recueil donnent le ton. Où est Dieu absent quand la vie rend l’être souffrant ? Cette colère pose une vraie et fréquente question : celle de l’origine de ce que nous nommons le Mal. Pourquoi Dieu créateur du Bien provoquerait-il ce Mal qui nous entoure ? Bien des réponses ont été tentées, tant en poésie qu’en philosophie. En une telle matière, il n’est évidemment pas de réponse unique et aucune réponse possible devant la souffrance vécue intérieurement et intimement. Le Mal absence de Bien plutôt que produit de Dieu étant ce Bien est pourtant un ailleurs de Dieu. Il naît, pour le christianisme, de la chute liée aux agissements humains. Ainsi, il n’est pas de Mal en ce que les chrétiens nomment Dieu. Simplement le principe de vie, vie et vies qui ensuite se développent en liberté. Le principe n’est pas l’origine du Mal, il n’est que l’origine de lui-même. Le miroir que nous lui tendons est nôtre. Reste que la poésie de Deschizeaux confronte la douleur de la mort à cette présence / absence de Dieu. Mais aussi aux belles valeurs dont nous sommes imprégnés, la démocratie, la république (des mots peu fréquents en terres de poésie contemporaine).
Je suis étranger au prêtre qui bénit mon poème, au reflux surréaliste qui rougit ma voix, au sacrifice de l’ange sur le mont d’ébène, mon corps est un don de vieillesse, un mystère sur la primauté du ventre, je veux ignorer le goût de ton sang, celui qui dégouline comme l’azur sur mes lèvres de cendre.
Sinon dans la chair est le cinquième recueil publié par le poète.
Olivier Deschizeaux, Sinon dans la chair suivi de Un tango pour Amalia, Rougerie, 2011, 70 pages, 12 euros.
On peut écouter une lecture de ce recueil ici :
http://www.youtube.com/watch?v=PKzkyNvCIpg
………………………………..
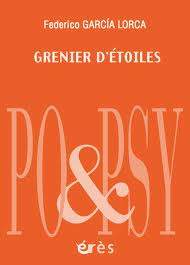 « Grenier d’étoiles », un titre choisi par Danièle Faugeras dans le poème Rêves, ici reproduit de superbe façon au cœur du volume. Les poèmes de cet ensemble proviennent de Canciones (1921-1924) et de Suites (poèmes publiés en revues entre 1920 et 1928). Je n’aurais pas ici l’outrecuidance d’écrire au sujet de Garcia Lorca, poète et poésie qui ont sans doute aucun entraîné le plus de commentaires jamais écrits sur une œuvre. Laissons la parole à Lorca.
« Grenier d’étoiles », un titre choisi par Danièle Faugeras dans le poème Rêves, ici reproduit de superbe façon au cœur du volume. Les poèmes de cet ensemble proviennent de Canciones (1921-1924) et de Suites (poèmes publiés en revues entre 1920 et 1928). Je n’aurais pas ici l’outrecuidance d’écrire au sujet de Garcia Lorca, poète et poésie qui ont sans doute aucun entraîné le plus de commentaires jamais écrits sur une œuvre. Laissons la parole à Lorca.
Initium
Adam et Ève.
Le serpent
brisa le miroir
en mille morceaux,
et la pomme
fut la pierre.
Saluons la beauté de cette traduction amoureuse réalisée par Danièle Faugeras.
L’univers
est en attente de quelque chose
qui encore n’a pas éclos.
La flore infinie
des étoiles
et les faunes de l’âme
retiennent leur souffle
et regardent vers un point
qui est loin
attendant la clé
du mystère,
point qu’attaque la mort
avec un marteau fantastique.
Car si le point lointain
venait à s’effacer du ciel
il y aurait une catastrophe
d’étoiles
un énorme amas
d’étoiles
couronnées de fantastiques
squelettes.
On ne choisit pas de traduire de tels poèmes par hasard, de les citer non plus.
Federico Garcia Lorca, Grenier d’étoiles, traduit par Danièle Faugeras, érès, collection Po&Psy, 2012, 10,5 euros.
Au-delà du " bien faire " et du " mal faire " il y a un espace,
C'est là que je te rencontrerais.
Mowlavi
Au carrefour des langues, où se croisent des consciences éveillées au langage, la tentation est d'habitude grande de s'exiler provisoirement de sa langue maternelle, et d'écrire dans la langue de l'autre, surtout quand il est question de la langue française dont le nom évoque souvent ceux de culture et de littérature. L'écrivain iranien met grandement sa plume en péril en utilisant le français comme moyen d'expression pour aborder les questions de société, ou la philosophie, en un mot, le vaste domaine des idées, notamment, à l'intérieur et à travers la littérature. Par le passage d'une langue à une autre, lesdites idées risquent en effet de paraître moins fines et moins subtiles. Sa langue maternelle étant le persan, l'écrivain veut écrire en français, à l'exemple d'un champion de natation qui rêverait de la première place en gymnastique. Dans la langue d'origine et dans la langue visée, on trouve de singulières tournures, difficilement transposables et qui, le cas échéant, exigent une bonne part de savoir faire. Et même si le savoir faire vient à manquer, que pourra-t-il faire, le novice, face à l'appel de l'écriture ? Ce gibier qui piste le chasseur !
L'écrivain qui baigne dans une atmosphère culturelle différente, est d' " ailleurs ". Il veut rendre compte de " l'étrangeté " dans une langue qui lui est, de son côté, étrangère. " Ecrire, c'est mourir ", dit Maurice Blanchot ; l'écrivain meurt en soi pour ressusciter en l'autre. Dès que sa plume se pose sur la feuille, l'écrivain est alors une première fois dépaysé (car l'acte d'écrire est en soi un dépaysement) puis il subit un second dépaysement, quand apparaît la volonté d'écrire dans une langue étrangère. Cette situation délicate s'accentuera encore si celui-ci n'a pas l'avantage d'évoluer dans un contexte francophone. L'histoire de la littérature française est peuplée d'écrivains et de penseurs qui n'appartiennent pas originellement à la culture et à la langue française, mais qui ont longtemps vécu en France : Beckett, Ionesco, Troyat, Todorov, Kundera, etc. Ces auteurs, venus d'un peu partout, ont certes été eux-mêmes, à un moment de leur parcours scolaire, des apprenants du français (comme langue étrangère). Il faudrait à cet égard étudier le processus cognitif d'intégration de cette deuxième langue chez ces derniers. Mais, ce qui nous intéresse pour l'heure, c'est de réfléchir à l'intérêt que peut trouver un iranien, dans la pratique écrite du français. L'iranien qui écrit en français, le fait-il par devoir, par nécessité, ou par passion ? Pourquoi écrit-il ? Pour communiquer ses idées, pour se mettre en avant, ou tout simplement par envie d'écrire ? On le sait bien, cette lancinante question ne concerne pas uniquement le français. C'est en ces termes néanmoins que nous choisissons de la formuler, eu égard à l'importance des auteurs précités, et bien évidement, compte tenu de l'intérêt personnel que nous portons à cette langue.
S'engager dans l'écriture ne revient pas forcément à s'enfermer dans des combats idéologiques ou à militer dans le cadre de la lutte des classes. L'écriture sonde les profondeurs de l'être pour accéder à cet ultime sol où l'homme entre en harmonie avec l'autre et avec l'univers, là où se partagent les joies et les douleurs, où le mot devient une note de musique. Aussi offre-t-elle à celui qui écrit, la possibilité de découvrir en soi les recoins les plus obscurs où se tiennent ses violences, ses appétits de confrontations, mais aussi ses bontés, son goût pour le respect et pour la camaraderie. C'est dans ces profondeurs que s'unissent les consciences, où qu'elles soient dans le monde. Les archétypes qui nous révèlent nos affinités de croyances ne sont-ils pas, à ce titre, éloquents ?
Ecrire c'est aussi, pour reprendre le mot de Barthes, disposer une interrogation indirecte dans le monde. Et il revient à chacun d'entre nous d'en formuler la réponse, " (…) en y apportant son histoire, son langage, sa liberté ; mais comme histoire, langage et liberté changent infiniment, la réponse du monde à l'écrivain est infinie : on ne cesse jamais de répondre à ce qui a été écrit hors de toute réponse : affirmés, puis mis en rivalité, puis remplacés, les sens passent, la question demeure."1 Quelle joie de fonder un foyer d'interrogation sans propriétaire, où chacun apporte, son bouquet de réponse qui réchauffe " le corps du monde ". Et le monde se dilate grâce à cette chaleur, grâce à cette parole qui dit : Au commencement, il y avait le Calame, et au terme du commencement, l'écriture.
Existe-t-il une raison plus convaincante pour nous faire emprunter le chemin de l'écriture ?
Il faut donc écrire pour ne pas oublier ce commencement: Lis au nom de ton Dieu qui a créé2. Et puis, Dieu a soufflé dans le cœur de l'homme pour qu'il crée à son tour. Aussi, il faut écrire afin de ne pas perdre de vue l'itinéraire de la création, pour ne pas oublier l'être. L'être qui, soit dit en passant, est déchiqueté sur les champs de guerre, et qui subit la violence au lieu de profiter de la lumière et de ses couleurs, de celles qui viennent de tous les horizons, d'Orient ou d'Occident. A chacun sa part, à chacun sa différence. Voilà le nœud du problème: comment faire avec les différences? Il y en a autant qu'il y a de nations, et même d'individus. Existe-t-il une possibilité d'entente?
Laissant de côté tout complexe d'infériorité ou de supériorité, nous n'avons à mon sens qu'à nous orienter vers un dialogue, par exemple, celui du " dialogue des cultures". Dans cette optique, le plus utile, le plus économique et le plus magnifique des moyens qui nous amènerait à nous comprendre, c'est l'écriture. Car pour se comprendre, il faut s'entendre; et écrire, c'est écouter l'autre dans son altérité, sans chercher à imposer son discours. L'écrivain, dans son acception la plus noble du terme, essaie de préparer le terrain pour accueillir le discours de l'autre. Il projette " d'ouvrir, comme le dit Michel Foucault, des possibilités de discours, et de mêler (son discours) aux autres, d'entrelacer son discours avec celui des autres, comme un support."3
Ecrire, c'est aussi un acte d'engagement : on s'engage à écouter et à respecter l'autre. En ce sens, il s'agit d'un acte d'audace, car il faut du courage pour admettre et pour tolérer l'étrangeté parfois choquante que l'on retrouve dans le discours de l'étranger. Ecrire c'est donc aussi un acte de transgression face auquel, au besoin, il faut savoir résister, non pas par le recours au fusil, mais en se servant du verbe, du mot. Mot pour mot, on écrit pour provoquer l'autre à écrire. Ecrire, c'est faire écrire.
Il faut aussi écrire pour qu'aucun peuple n'en arrive à se considérer comme détenteur universel de toutes les beautés, de la vérité absolue ; pour dire que partout, tant en Orient qu'en Occident, dans le tiers monde et dans le "premier monde", en Iran qu'en France, il y a nombre de sujets qui méritent l'attention. Quand on écrit, on participe ; on apporte sa contribution à la dynamique du changement dans le monde, et à la créativité. Créer, c'est participer à l'embellissement du monde. J'écris, donc je crée.
En tant qu'oriental, je donne libre cours à mon imagination, clairement marquée par ma vision iranienne du monde; profondément ancrée dans une atmosphère riche en couleurs, qu'il s'agisse, indistinctement, d'idées ou de formes. Je me trouve au cœur de l'Iran, au centre de l'Orient, et c'est de là que je vous adresse "une écriture". Ecrire sans vous, c'est écrire dans le vide. Il faut écrire pour les autres, pour participer à la vie des autres ; pour mettre en commun ce qu'on a de meilleur.
Ainsi se forme un nouvel horizon, qui dépasse les frontières géographiques, politiques, idéologiques; où la nudité humaine se fait jour. Ce commun lieu de rencontre est, pour ce qui nous concerne, la langue française. On s'y donne de temps en temps rendez-vous pour se lire. Ecrire c'est aussi (et surtout ?) lire ; c'est s'appeler à lire :
Appelle-moi donc !
Ta voix est bonne.
Ta voix est la sève verte de cette étrange plante
Qui pousse au bout de l'intimité de la souffrance.
…..
Viens pour qu'on essaie ensemble de comprendre quelque chose au sens de la pierre.
Viens avant qu'il ne soit tard pour voir les choses.
….
Viens m'aider à ne plus avoir peur des villes, dont le sol noir sert de pâture aux grues.
Ouvre-moi comme une porte qui s'ouvre à la chute de la poire
En ce siècle d'assomption de l'acier.
….
Raconte-moi l'histoire des bombes qui tombèrent pendant que je dormais.
Et des joues qui se mouillèrent pendant que je dormais.
….
Et alors comme une foi chauffée au feu de l'équateur,
Je te ferai asseoir au commencement d'un jardin"4
1- Roland Barthes, Sur Racine, éd. Du Seuil, 1963, p. 11.
2- Le Coran, sourate Alagh, verset 1.
3- Michel Foucault, Entretien avec Roger-pol Droit, juin 1975.
4- Sohrab Sepehri, " Au jardin des compagnons de voyage ", in Les huit livres.
Depuis le mois de Juin, le microcosme de la poésie, je veux dire ce que la poésie , qui ne saurait être réduite à cela, compte d’auteurs plus ou moins reconnus, d’éditeurs, d’organisateurs d’évènements, d’institutions , a été agité , par divers mouvements et réactions. Ce fut d’abord , en début d’été une pétition , lancée par certains, que Jean-Luc Godard appelait les « professionnels de la profession » , contre une réforme souhaitée par la direction du Centre National du Livre ; réforme dont, au demeurant, nul ne sait ce qu’elle recouvrait , sinon que le budget de subventions alloué à la poésie n’était pas remis en cause , puisqu’elle n’a pas eu le temps d’être présentée avant qu’elle ne soit rangée dans les cartons … Et l’été passa et la vaine polémique s’éteint quand l’automne vint . C’est alors que le ciel s’assombrit et que la foudre tomba .Dans un appel « au secours » , à la fois désespéré et pathétique , Jean-Pierre Siméon , le directeur artistique du « Printemps des poètes » apprenait à la planète « poésie » , deux choses :d’une part que le Ministère de l’Education Nationale amputait la subvention qu’il accorde depuis des années de soixante-mille euros, d’autre part que ce manque de soixante-mille euros remettait en cause l’existence même du prochain « Printemps des poètes » ; De plus , il invitait tous celles et ceux qui aiment la poésie à écrire à Monsieur le Ministre de l’Education Nationale pour qu’il rétablisse sa part de subvention. Depuis, des milliers et des milliers de personnes ont envoyé cette lettre à M. Le Ministre de l’Education Nationale. J’espère que les signataires, prompts à pétitionner en Juin, ont tous répondu à cet appel … Depuis, de nombreuses « personnalités » du monde poétique ont écrit. Depuis, les réseaux sociaux se sont mobilisés et ont recueilli, eux aussi, des milliers de signatures. Pour l’instant, en vain. Le Ministère de l’Education Nationale fait la sourde oreille…D’aucuns, rêvant sans doute d’un « grand soir » de la poésie en sont à envisager de défiler derrière des banderoles. D’autres encore s’apprêtent à créer un « syndicat des poètes » …Et l’hiver arrive, temps de la réflexion, avant que les forces de la vie ne germent à nouveau et qu’éclose le Printemps.
Que penser de tous ces évènements ?
Tout d’abord que le Conseiller de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale a fait faire à Vincent Peillon, éminent philosophe qui connait la fonction primordiale de la poésie , qui est de contribuer à « ré-enchanter le monde » , de redonner du sens et de l’espérance, de réveiller le rêve ( Qui a dit qu’il voulait « réveiller le rêve français » ?) et dont l’engagement en faveur de la poésie ne saurait être , à priori, remis en cause , plus qu’une erreur comptable . Il lui a fait faire une vraie « Faute » politique . Connait-il, celui-là, la petite école de Louisfert , où pendant des années, le « hussard noir de la République » qu’était l’instituteur René-Guy Cadou , après avoir « enseigné » toute la journée à des enfants de paysans à lire, écrire et compter, repoussait ces cahiers d’écoliers qu’il venait de corriger , pour écrire une des plus grande œuvre de la poésie française du vingtième siècle , œuvre d’ailleurs apprise dans les écoles ? Sait-il, celui-là , que l’association « Le printemps des poètes » a implanté , avec le soutien de la Fédération Nationale des Collectivités pour la Culture , la poésie au cœur de la vie citoyenne, dans trente villes et villages français, en leur accordant le label, inventé en 2011, « Villes et villages en poésie » ? Ignore-il que cette même association, ses responsables et son personnel , compétent, créatif et entièrement dévoué à la promotion de la poésie, organise , chaque année , avec l’Office central de la coopération à l’école , des stages destinés aux enseignants , et décerne le label « Ecole en poésie » . Mésestime-il le rôle de reconstruction du lien social , qu’à travers les milliers d’évènements , organisés chaque année dans le cadre du « Printemps des poètes » , celui-ci joue ?
Certainement ! Il faut donc conclure que « la poésie » n’est pas au programme de l’Ecole Nationale d’Administration, ce qui est dommage et dommageable.
Ensuite, que le « Printemps des poètes », « invention » heureuse de quelques personnalités du monde de la culture , dont un politique « éclairé » connaissant , lui, la fonction sociétale des symboles et de la fête dans toute société , dont il ne vient à l’idée de personne qu’il disparaisse , ne saurait dépendre seulement des fluctuations budgétaires de quelque ministère que ce soit , ni des orientations politiques de tel ou tel gouvernement . La poésie appartient à tous : poètes, éditeurs, comédiens, organisateurs d’évènements poétiques le plus souvent bénévoles , enseignants, libraires , lecteurs et surtout au public, ce public , issu de tous les milieux socio-culturels , qui se compte par centaines de milliers de personnes ,qui assistent et participent aux plus de dix-mille évènements organisés au printemps mais , préparés et coordonnés toute l’année par l’association « Le printemps des poètes » . Certes, la poésie , dans son ensemble , est économiquement très fragile et ne saurait se passer des subventions publiques , que ce soit celles des collectivités territoriales ou celles, nationales , des différents ministères . C’est , effectivement, essentiellement grâce à deux événements que la poésie a retrouvé droit de cité . L’un , précurseur , créé il y a trente ans , Le Marché de la poésie, qui a su fédérer , à sa manière , tous ceux qui participent à la création , édition et diffusion de la poésie en France, l’autre, le « Printemps des poètes » qui a su rassembler sous sa marque, devenue elle-même un « label » , les milliers de bonnes volontés créant et animant des événements poétiques , en transcendant les clivages qui marquent ce milieu. Mais suffit-il que toutes celles et ceux-là pétitionnent et manifestent ? Certes, il faut le faire, pour que les pouvoirs publics maintiennent et même augmentent leurs soutiens et leurs aides. Mais le monde poétique ne saurait se contenter d’un statut d’assistanat. Souvenons –nous de l’origine du mot poésie : « Poïesis » : Faire .
Enfin, qu’il faut «sauver le printemps des poètes » en ne laissant pas l’association qui l’anime et le coordonne dépendre du « bon ou mauvais vouloir des gouvernants ». Si la poésie est, par excellence, acte de partage gratuit, sa diffusion, sa promotion, sa propagation ne sauraient mésestimer le rôle de l’argent pour ce faire . Sauver « Le printemps des poètes » c’est donc donner à l’association qui le gère et l’anime, des moyens financiers. C’est en mobilisant tous celles et ceux qui, à quelque titre que ce soit, aiment la poésie, que cela peut se faire. L’association « Le Printemps des poètes » a besoin de mécènes ! Que tous ceux qui ont, un jour, participé, à quelque titre que ce soit au « Printemps des poètes » y aillent de leur obole, même modeste, surtout si elle est modeste. Que tous ceux qui ont bénéficié de son soutien en voyant leur travail « labellisé » aient quelque reconnaissance. Que tous ceux qui aiment la poésie fassent un geste de générosité, en faisant honte aux épiciers du cœur. L’association « Le Printemps des poètes » n’a pas besoin de charité mais de solidarité, en actes, c’est-à-dire en espèces « sonnantes et trébuchantes »
Revenons à l’essentiel : la poésie vous aide à vivre ? Aidez-le « Printemps des poètes » à vivre..
Que la poésie vous garde…
Wajdi Mouawad est un tragédien. On le sait depuis quelques années si on a eu le bonheur de voir les quatre pièces du cycle Le Sang des Promesses (Littoral, Incendies, Forêts et Ciels). Théâtre épique a-t-on lu, ici et là. Certes. Tragique aussi. Il n’est pas étonnant que le metteur en scène se soit ensuite attelé aux textes de Sophocle : Les Trachiniennes, Antigone et Electre. Son dernier roman, Anima, est écrit dans la même veine. En même temps, il est très différent des textes écrits pour la scène : le silence – celui du personnage principal mais aussi celui de l’auteur au moment où il a écrit ce livre – est au centre d’Anima. Le roman tient autant de l’odyssée – terme choisi par Wajdi Mouawad lui-même – que de la tragédie, disais-je. Il s’ouvre d’ailleurs sur une citation de Sophocle :
Où sont donc les foudres de Zeus,
où est le soleil flamboyant,
si, à la vue de pareils crimes,
ils restent sans agir dans l’ombre ?
Juste après, on entre dans le vif du sujet, le drame – un meurtre abominable – et sa conséquence : le chagrin infini d’un homme.
Il y a eu la nuit puis le soleil et encore la nuit puis des nuages et la pluie et encore la nuit et des oiseaux avant que la porte ne soit fracassée et que des hommes, que je ne connaissais pas, ne viennent les prendre et les emporter tous les deux.
Ceux qui prennent en charge la narration ne sont pas des narrateurs ordinaires. Un chat, des oiseaux, un chien, un poisson racontent le fil des événements : la découverte du corps, l’entretien avec le coroner, l’enterrement… Tous comprennent, d’emblée, ce qui se joue sous leurs yeux, perçoivent immédiatement le chagrin immense de Wahhch. Leurs voix forment le chœur.
Quand Wahhch décide de se lancer dans une chasse à l’homme, il croise une foule d’animaux sur sa route qui deviennent les témoins de l’un ou l’autre épisode – parfois très court – de son épopée. Plusieurs animaux sont abasourdis par ce qu’ils découvrent : cette nuit effroyable qui est le propre des humains. Si l’histoire se déroule en temps de paix, dans un pays dit civilisé, certaines scènes rappellent les guerres les plus cruelles. Alors on est, à plusieurs reprises, saisis d’effroi. Certaines petites bourgades du Kansas, décidément, n’ont rien à envier à l’enfer.
Quelques-uns des narrateurs ont pitié :
Les humains sont seuls. Malgré la pluie, malgré les animaux, malgré les fleuves et les arbres et le ciel et malgré le feu. Les humains restent au seuil.
Certains perçoivent surtout les odeurs : celles de la fatigue, de l’inquiétude ; d’autres sont sensibles aux modulations de la voix. Nombreux sont ceux qui voient en Wahhch un individu singulier. C’est le cas du rat devant lequel il s’accroupit et auquel il adresse la parole : « Moi aussi ! Moi aussi ! sous terre, sous terre, et seul ! », avant d’éclater en sanglots. Le rat n’en revient pas.
Les humains ne sont pas tous des pièges, ils ne sont pas tous des poisons, je veux dire par là qu’ils ne sont pas tous des humains.
On se souvient de Montaigne qui, dans l’un de ses Essais, explique qu’il y a « plus de différence de tel homme à tel homme que de tel animal à tel homme » (Essais, II, 12). Wahhch acquiescerait. La plupart des animaux qu’il croise aussi. Wajdi Mouawad, lui, ajouterait que c’est un autre essai philosophique, celui d’Elisabeth de Fontenay (Le silence des bêtes) qui a joué un rôle important lorsqu’il s’est lancé dans l’écriture de son roman. Mais Elisabeth de Fontenay n’est-elle pas très proche de Montaigne ?
Le propos de Wajdi Mouawad n’est pas manichéen : d’un côté la sauvagerie humaine, de l’autre la bonté animale. Les choses sont bien plus compliquées que cela. La corneille ne le nie pas : elle prend plaisir à déchiqueter le ventre de sa proie. Quant aux hommes perdus que rencontre Wahhch, ils sont des victimes autant que des bourreaux : ils ont été traqués, déracinés, parqués dans des réserves.
En marchant sur les traces de l’un d’eux, Wahhch remonte de plus en plus loin dans le souvenir enfoui d’une autre tragédie, plus ancienne. Car il est né loin du Québec, au Liban. Parallèlement à l’odyssée à travers le nord de l’Amérique, nous assistons à un voyage intérieur. Celui de Wahhch rejoint sans doute celui de Wajdi Mouawad, ici. Pour l’auteur aussi, les massacres de Sabra et Chatila sont une scène originelle. Car, comme il l’explique au micro de Marie Richeux sur France Culture, dans l’émission Pas la peine de crier du 28 septembre 2012, Wajdi Mouawad appartient à la communauté chrétienne libanaise. « Ceux qui ont fait ça sont des miliciens chrétiens, qui sont entrés dans les camps et qui ont, alors qu’ils avaient la figure du Christ tatouée sur leur corps, posé les gestes les plus monstrueux qu’on puisse imaginer. » Il est donc plus que concerné par les questions que se pose son personnage. Il dit à Marie Richeux qu’il aurait pu, s’il avait été un peu plus vieux, être l’un de ceux qui ont participé aux massacres. Il partageait leurs valeurs, leur amour pour le Président de la République, Bachir Gemayel, qui avait été assassiné.
« Il se trouve que, quand Bachir Gemayel est mort, moi-même j’ai senti une peine effroyable [...]. Je crois que si j’avais eu l’âge qu’il fallait, ça n’aurait absolument pas été impossible que je fasse partie de ces gens qui ont posé ces gestes-là. […] Ce qui m’a protégé, c’est mon âge. J’étais trop petit pour faire ça ». Ce qui l’a protégé, c’est aussi l’exil et la rencontre avec d’autres cultures.
Pas étonnant en tout cas que l’une des étapes les plus importantes de la route de Wahhch soit cette ville de l’Illilois appelée Lebanon (Liban). On pense forcément au film d’Ari Folman Valse avec Bachir (2008), qui est aussi le récit d’une lutte contre l’enfouissement définitif d’un traumatisme. Wahhch n’est pas très bavard, mais son passé affleure, de loin en loin, dans quelques paroles. Et lorsqu’il reste silencieux, le chœur des animaux devine ce qu’il porte en lui. Un rongeur qui le voit approcher ne se trompe pas sur son compte :
Le voilà, ombre dans l’ombre, une masse d’obscurité.
La parole des animaux ne se limite donc pas au témoignage. Ils se montrent capables de réflexions philosophiques sur la condition humaine. Et leur réflexion n’est pas dénuée d’humour – noir souvent. Ce roman est une plongée dans d’autres conceptions du monde : celle des animaux, celle des Indiens du Nord (les Mohawks), les deux n’étant pas très éloignées l’une de l’autre. Des visions poétiques du monde. Dans l’émission radiophonique citée plus haut, Pas la peine de crier, Wajdi Mouawad évoque Francis Ponge. D’autres poètes se tiennent dans l’ombre, que Wajdi Mouawad cite dans la notice sur laquelle le livre se referme : Robert Davreu et Dylan Thomas.
Anima jette des ponts : entre les guerres et les autres abîmes, entre le bourreau et la victime, entre l’homme et l’animal... On est embarqué, brusqué, ravi.
Chez Wajdi Mouawad, la parole et la pensée sont libres. Pas d’auto-censure. L’un des hommes que rencontre Wahhch lui demande si, en un sens, il ne se sent pas libéré depuis la mort de sa femme. Voilà qui dérange forcément.
– Toi, ça t’arrange pas de te retrouver seul ? Avec ton sac à dos puis plus rien à t’occuper ? Plus de ménage à faire, plus de courses, plus de loyer ? La liberté ? […] Je connais plein de chums qui sont passés de chien méchant à gros toutou, gentil caniche bien frisé avec une couverture sur le dos, des coussinets dans les pattes parce qu’ils ont rencontré une femme. C’est pas gérable. Y a que la mort qui peut t’en sortir. On dira bien ce qu’on voudra, mais ça reste le meilleur liquid paper qui existe.
Avant de conclure, je citerai quelques lignes trouvées sur le site de Wajdi Mouawad (http://www.wajdimouawad.fr/) :
Un artiste est un scarabée qui trouve, dans les excréments mêmes de la société, les aliments nécessaires pour produire les œuvres qui fascinent et bouleversent ses semblables. L’artiste, tel un scarabée, se nourrit de la merde du monde pour lequel il œuvre, et de cette nourriture abjecte il parvient, parfois, à faire jaillir la beauté.
Cela sied bien à tout ce qu’il entreprend depuis plus de quinze ans. Wajdi Mouawad est cet alchimiste qui se nourrit de violence et accouche de poésie. Un peu du sang de Baudelaire, qui convertissait la laideur, l’odeur nauséabonde ou la pourriture en beauté, doit couler dans ses veines.
Après la lecture de ce roman, un petit tour sur le site des éditions Actes Sud permet de prolonger le voyage, d’approcher celui qui a écrit ce livre monumental. Un homme tout en douceur, finesse et sensibilité. Deux courtes vidéos, à voir absolument : http://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature/anima
Sur la toile, il y a d’autres pistes à suivre, précieuses. Par exemple cette émission (enregistrée en mars 2011) sur France Culture, dans laquelle le chemin de Wajdi Mouawad croise celui de Jane Birkin : http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=3787741
Il y est question d’enfance, de mise en scène (notamment d’une pièce de Tchekhov), de guerre et d’un projet que Wajdi et Jane ont mené ensemble, La sentinelle.
Wajdi Mouawad est né au Liban en 1968. Depuis, il a vécu en France, au Québec… Il est dramaturge, romancier, metteur en scène et comédien. Son premier roman, Visage retrouvé, est paru chez Leméac / Actes Sud en 2002 (il est disponible aujourd’hui dans la collection Babel).
Ce texte a été prononcé par Jean-Luc Maxence, le 1er décembre 2012, lors de la journée d'études organisée autour de l'oeuvre de Jean Grosjean par Recours au Poème, le Collège des Bernardins et l'association Art, culture et foi.
A quatre-vingt-quinze ans passés, en 2004, alors que je dialoguais régulièrement avec lui dans la perspective de la rédaction d’un « Poètes d’aujourd’hui » que les éditions Seghers m’avait demandé, Jean Grosjean m’a enseigné que tout homme était capable, même en ce siècle guerrier et matérialiste à outrance, de répondre présent à l’appel de Dieu. De cela je rends témoignage et je ne l’oublierai jamais.
« Allô ? Pourrais-je parler à Jean Grosjean ? » ai-je souvent demandé à son épouse Jacqueline, par téléphone, en général toujours à la même heure, en fin d’après-midi. En effet, j’étais inquiet et peu sûr de moi, scribouilleur de doute et d’incertitude, assez mal ailé à vrai dire. Je savais qu’André Marrissel s’était essayé déjà à résumer l’itinéraire du poète pour une monographie et avait échoué. Je n’en menais pas large, comme on dit.
J’étais allé, quelques mois avant mes entretiens téléphoniques, à Avant-lès Marcilly, présenté par Pierre Oster et accompagné par un directeur littéraire, rencontrer Jean Grosjean dans ce petit village du bout du monde devenu sa retraite studieuse et où il retournait dans le détachement de la nature, dans ce creuset de la poésie. J’avais d’ailleurs en tête la phrase de Le Clézio : « La poésie est la source pure, elle est l’eau de la vérité, et c’est cette eau que nous donne Jean Grosjean ».
Il était si exceptionnellement attentif à l’autre… L’œil du cœur, sans doute. Il n’y avait nul dogmatisme dans son attitude, il se méfiait de la Gnose comme des gloses ! Il m’expliqua vite combien il partageait avec André Malraux son admiration pour Tête d’Or, pourquoi il aimait tant Maupassant, comment il demeurait toujours aux aguets du dieu vivant, en quoi il n’était pas un mondain, mais un poète discret, « éternel découvreur amoureux des Livres sacrés » le Coran et la Bible, , traducteur d’Eschyle et de Sophocle, de Shakespeare, et un critique parfois sévère et toujours insolite. Il était comme une sorte d’anarchiste chrétien, traquant l’instant « comme une rivière tranquille » (écrit-il dans Les Vasistas) et se moquant superbement, sereinement, des effets de mode en poésie, de l’éphémère des marchands du Temple. Il me confiait, à mots sobres, le fil d’or du Sens de sa vie, n’hésitant même pas à revenir sur certains de ses projets qui, selon son expression employée dans un poème de La Lueur des jours « furent des retraites de Russie / dont chacun s’est tiré comme il a pu ». Avec lui flatteries et redondances ne passaient pas. J’aimais sa réserve, sa bonté, une qualité révolutionnaire chez un homme d’aujourd’hui, son regard fin et en définitive frondeur sur le paysage de la poésie de son temps.
Et je m’entendais avec lui spontanément, sereinement, ai-je envie de dire, et je n’ai pas besoin d’en appeler à ma longue mémoire pour le revoir devant son bureau, m’expliquant sa vie, me rassurant d’un geste sobre afin que je poursuive sans nulle crainte la présentation de son œuvre.
Ensuite, nous prîmes vite un rythme de croisière. A l’heure du déclin du soleil, je lui téléphonais tel un enfant indiscret et il répondait avec netteté et douceur à mes questions même les plus maladroites. Cela durait toujours 10 minutes. « Il ne faut point le fatiguer » recommandait sa femme. Mais je savais bien que je n’avais pas de temps à gaspiller, aux portes de l’intemporel et de l’éternité que je pressentais.
« Jean Grosjean, parlez-moi de la façon dont vous faites un poème ? Parlez-moi du ciel ? Parlez-moi du bon renoncement des choses de ce monde ? Parlez-moi de l’incarnation ? Parlez-moi d’un monde qui n’est pas de ce monde, et qui n’est pas encore hors du monde, de l’autre côté des choses et des gens de la Terre ? ».
Qui disait qu’on approche avec pertinence la poésie de Grosjean qu’avec le sentiment irrésistible de devoir ôter ses sandales, comme devant je ne sais quel buisson ardent ? Grosjean, le poète du numineux, avec un N, le N sacré et qui fait peur, celui de Carl-Gustav Jung…
Et puis l’heure vint de lui adresser le manuscrit du « Poètes d’aujourd’hui », l’heure de lui demander ce qu’il en pensait. L’heure du verdict, en somme. Et ce fut le dernier coup de fil donné au poète quelques mois avant sa disparition. « Ne suis-je donc pas passé trop à côté de l’Essentiel ? Ai-je capté quelque peu la brise qui contient tout entière la transcendance discrète du monde ? Ai-je été à bonne école ? »…
Et Grosjean me répondit d’une voix tranquille, basse mais joyeuse et distincte, maîtrisée, pas seulement rassurante mais affective : « Maxence, vous allez bientôt cessé d’avoir peur. Nous allons pouvoir parler enfin cette fois ! de vous, de Dieu, de nous. Nous allons pouvoir parler sans crainte, il est temps. Oui, oui, votre texte me convient. Pour vous en assurer, écoutez donc les titres choisis de chacun de vos paragraphes : « Ouverture, de la poésie comme patience et aventure spirituelle, Tout un chemin de sérénité en si peu de mots, De quel Dieu capter les signes du frémissement ? Balises de vie face à l’intemporel, Puiser à la source des livres sacrés évite d’inventer, Héraut de Dieu et alchimie du langage, L’appréhension du Réel sous l’apparence du sensible »… Voilà un seul poème pour dire ma vie. Merci pour cette attention que vous avez si bien soutenue ».
Et le livre parut. Et je ne revis plus Jean Grosjean qui devait rendre sa vie à son Dieu. La conversation sans peur, le dialogue promis n’eut pas lieu. Notre contact téléphonique était à jamais coupé. « Il n’y a plus d’abonné poète au numéro que vous avez demandé ! Il n’y a plus d’abonné poète au numéro… »
Je ne revins jamais à Avant-lès-Marcilly entendre, dixit l’homme célèbre du village, « sonner l’heure au clocher du village / quand la nuit danse à grands pas sur les herbes / dont la senteur l’enivre ».
Je n’osais plus rappeler personne. Je me retrouvais seul et Grosjean comme devant, comme il plaisantait parfois. Aujourd’hui, je me refuse à faire des effets mondains de manche, des phrases à sortir en Sorbonne, des faire-part pompeux pour « bluffer » avant d’être un fossile au fond des roches.
Il ne me reste que ses poèmes. Et « l’âme de la forêt » pour interroger un futur sans visage. Et tout l’invisible que l’on n’a pas pu se dire. « l’inconsolable et calme regret ». Tout va si vite. Si vite, comme cette énigme d’un des derniers poèmes de Jean Grosjean, que je connais, par cœur :
On a frôlé les villages du monde,
On s’arrache à ces jours qu’on n’a pas vus,
On s’écarte de soi. Tout va si vite.
Juste eu le temps de m’essuyer les mains.
J’aurais aimé avoir longtemps vingt ans
Comme un busard qui plane ».

Matthieu Baumier et Olivier Germain-Thomas lors de l'hommage à Jean Grosjean au Collège des Bernardins, Paris, 1/12/2012
A propos du Manifeste pour la vie d'artiste, de Bartabas.
Nous n’avons plus l'habitude des Manifestes. Nous conservons celle de manifester. Le Manifeste engage la personne humaine, qui expose un programme d'action ou une position. C'est un type de profession de foi. La manifestation est réactive. On s'insurge contre. Rares sont les Manifestes, régulières les manifestations. Aussi avons-nous été très attentifs à la publication par Bartabas, le cavalier légendaire, de son Manifeste pour la vie d'artiste. Connaissant l'exigence de l'homme, il y a fort à parier que sa parole manifestée soit à la hauteur des enjeux contemporains. A l'heure du Simulacre, la parole authentique ne peut que porter. Si toutefois l'on peut encore la comprendre. Alors un Manifeste, dans une époque ayant fait du faux la totalité de la réalité ? Un manifeste pour quoi faire ?
Un Manifeste, cela engage la vie d'un individu. D'un groupe d'individus. Il engage aussi la société à laquelle elle s'adresse. Un Manifeste provoque par définition une réaction de la société à son encontre. Et si nous en étions arrivés à vivre dans une société où plus aucun Manifeste ne s'exprimait ? Une société ayant gagné.
Bartabas se manifeste. Un Manifeste différent des Manifestes du surréalisme, qui proposaient un rêve ; du Manifeste futuriste, qui engageait une utopie. Le Manifeste pour la vie d'artiste de Bartabas est prononcé depuis le lieu de celui qui a vécu pleinement la vie d'artiste, et la revendique comme modèle de vie propre. Qui continue de vivre absolument la vie d'artiste en en connaissant les joies et les contraintes. Le théâtre équestre Zingaro est né d'une utopie, et Bartabas parle depuis cette utopie réalisée, assumée et vécue. Il parle une langue que notre société unilatéralement marchande ne peut accepter. Le passé de Bartabas vaut preuve. Ne voulant pas soutenir, en 2003, la grève des intermittents du spectacle, peu avaient alors compris son attitude. Nous l’avions comprise. Les perpétuels indignés du Bien se sont fait l'écho du Simulacre, ne pouvant admettre la position de Bartabas, non pas contre les intermittents − il en est un lui-même − mais contre leur idée de la grève et de l'annulation du festival d'Avignon, estimant qu'il existait d'autres moyens artistiques de protester. Le Simulacre jalouse les artistes et les reconnait simultanément comme ses ennemis essentiels.
En écrivant un manifeste pour la vie d'artiste, Bartabas, face à la soumission généralisée au système financier, affirme que le statut d'artiste, depuis la nuit de l’art, est un choix dangereux, mettant en œuvre l’entièreté d’une vie. Un choix devenu impossible ou presque devant la puissance du code barre tatoué sur nos cerveaux. D’ailleurs, au moment de la grève des intermittents en Avignon, Bartabas s'insurgeait contre ces artistes prétendant ne pas vouloir travailler ailleurs, afin d'exercer leur seul art. Oui, on peut être serveur de café six mois de l’année pour être peintre six autres mois. Et alors ? Il était choqué que des artistes réclament d’être pris en charge par la société. Que des hommes ayant théoriquement engagé l’ensemble de leur vie dans l’art fassent… grève.
Le premier chapitre de son Manifeste s’intitule "Chevaucher la vie". Aucun « bon esprit » de « gauche » ne paraît avoir remarqué la référence évolienne, la culture se perd. Rares sont nos contemporains à pouvoir estimer chevaucher la vie et Bartabas, s'interrogeant sur l'artiste qu'il est devenu, n'étant pas un enfant de la balle, affirme : "s'engager dans cette voie là, c'est non seulement choisir l'activité artistique qu'on se propose de développer mais c'est choisir le mode de vie qui va avec, et si ce n'est le choisir au moins l'accepter". La liberté, cela se paie. Et ce prix est celui de la contrainte. Paradoxe magnifique hors duquel il n'y a pas de liberté véritable, hors duquel la vie d'artiste ne mène à aucune œuvre de sang ni d'esprit.
"Une des exigences au départ, c'est d'y aller sans calcul. Certaines époques s'y prêtent sans doute plus que d'autres. Aujourd'hui, parce que la société a ainsi évolué (involué ?), parce que les incertitudes du lendemain effraient plus qu'elles ne fascinent, la jeune génération est moins incline à risquer une vie aventurière".
Une vie aventurière. Entendons-nous bien. Que les rebelles officiels et jouant du décalage comme d'un conformisme bourgeois largement rémunérateur entendent ce que veut dire Bartabas lorsqu'il parle de vie aventurière. L'aventure ? Notre temps nous fait croire que les aventuriers découvreurs, tels Vasco de Gama ou Christophe Colomb, sont prolongés par les sportifs des courses autour du monde. Que découvrent-ils, ces aventuriers d'eau douce, quelles terres, mêmes intérieures, révèlent-ils à l'humanité, sinon de savoir monter un budget prévisionnel et de voguer contre le chronomètre toute voile sponsorisée dehors ? Dans la notion de vie aventurière dont parle Bartabas, il y a, au centre, la notion du temps. On ne court pas contre la montre. On ne tente pas d'arriver le premier. On travaille un matériau le plus authentiquement possible pour que l'art naisse et soit partagé par un public dont l'inconscient s'en trouvera nourri. Cela ne peut pas faire de mal à ceux qui ont vendu une part de leur cerveau, volontairement, à coca cola et consorts.
Le public, notion capitale dans la démarche de Bartabas. "Je crois que le spectacle vivant a cette obligation d'être en phase avec le public de son temps. On doit avoir pour préoccupation principale, quel que soit le propos qu'on entend tenir, qu'il se passe quelque chose, qu'une relation intime s'établisse avec le public". Là est tout le génie de la démarche de Bartabas artiste. Car les spectacles de Zingaro sont tissés d'images et de scènes éveillant la profondeur inconsciente du "public". Ces spectacles peuvent apparaître élitistes. Mais comme le dit Bartabas avec beaucoup d'intelligence, ces spectacles ne raisonnent pas, ne démontrent rien d'autre que la force époustouflante de leur beauté, beauté contenue dans des tableaux pouvant parler à tous, hors narration traditionnelle, parlant au cœur du profond de l'être. Calacas, le dernier spectacle, charrie la mort, et c'est une vision de la mort joyeuse, comme une danse macabre anachronique nous faisant prendre conscience que sans la vie d'artiste, nous sommes déjà, ici bas, et maintenant, déjà morts, sans nous en rendre compte. Aussi la démarche est-elle populaire, bien que n'étant absolument pas (nous employons le mot dans son sens étymologique) vulgaire. Ce que nous suggère Bartabas avec cette considération éminente du public est qu'un artiste doit avoir un public ; il doit aller trouver le public ; il doit garder lien et partage avec le public.
"Dresser un cheval ce n'est pas lui faire acquérir des automatismes, c'est d'abord se construire avec lui un vocabulaire commun, puis une grammaire commune, puis, s'il le veut bien, finir par dire des poèmes ensemble". Nous y voilà. Le projet de la vie d'artiste de Bartabas, c'est de parvenir à dire des poèmes avec ses chevaux. Or, pour que ce récital soit possible, il faut en amont travailler, puis il faut s'assurer d'un public fasciné par l'émanation du poème. En ces temps où la poésie, en France, connaît des difficultés, au point que certains printemps soient voués à flétrir avant même la sortie de l'hiver, il faudrait que les acteurs du poème mobilisent leur intelligence plutôt que de manier la pétition. Saugrenue, un poète qui… pétitionne. Car le problème n'est absolument pas dans le déficit des subventions. Une subvention oblige à un devoir de résultat. Or, à travers l'habitude des aides publiques se sont formés des féodalismes. Oui, des féodalismes. De gauche. La situation est à proprement parler ubuesque. Un Buster Keaton aurait fait un bon film. Beaucoup d'acteurs du monde de la poésie ont reproduit le système officiel à petite échelle. Et se servent de ce système pour faire un peu d’argent, au nom de la défense de la poésie.
Poésie, que ne fait-on pas en ton nom ?
On voit d’étranges gredins qui occupent des postes officiels fort peu poétiques et sont financés par l’Etat. De quel droit ? La poésie n’existerait pas sans cela, dit-on. Ici, nous pensons exactement le contraire. Et nous faisons exactement le contraire. Si la poésie française manque de lecteurs, il s’agit alors de réhabiliter le poème dans la cité, la cité réelle et contemporaine. Dans la vie humaine en son instant présent. Aller d'abord chercher le public. Sinon, à quoi bon éditer de la poésie ? Si elle n'est pas indispensable, pourquoi aller demander des subventions ? Et si l'âme de la nation a oublié en quoi la poésie était indispensable, car appartenant, comme le pain, au besoin profond des êtres de chair, alors d'abord se mobiliser pour en affirmer l'essence fondamentale."Une œuvre forte est celle qui parle aux gens, à tous les gens, au-delà des niveaux de connaissance, de culture", affirme Bartabas. Faire œuvre de sang. Et d'esprit. Avec le public. Faire œuvre de sang. Et d'esprit. Avec des lecteurs. Des auditeurs. L'œuvre authentique passe où elle veut.
Le manifeste de Bartabas vaudra témoignage : dans la collaboration généralisée envers le capitalisme contemporain, collaboration de toutes les couleurs politiques, comme autrefois, des voix se sont élevées. Il témoignera d’une résistance réelle. Celle-là même dans laquelle Recours au Poème prétend sans gêne se reconnaître. L’art ne saurait être autre que fraternel, mais d’une fraternité vraie et non de « fraternités » détournées. Cette aventure se vit dans l’épreuve de ce plus de réel qu’est la vie libre.
L’éternité portée sur les vertèbres serre la vis des
gisants
Des massacres de présumés innocents ont lieu dans les
sous-sols
Exécutés avec sobriété d’une balle d’or alchimique
entre les yeux
En compagnie de derviches ayant mal tourné,
D’équilibristes tombés dans la misère
Et autres personnages voués dès la première ligne à être
crucifiés
Par le point final du roman.
[Marc Alyn, Les Enfers gigognes]
L’œuvre de Marc Alyn est de celles qui inspirent Recours au Poème et ses animateurs. Sur un plan personnel autant que sur un plan collectif. Le poète des profondeurs qu’est Marc Alyn joue ainsi un rôle qu’il ignore dans notre aventure. Mais l’ignore-t-il tant que cela ? En poésie, il est des Amitiés secrètes, fraternelles, qui se fondent sur le silence et la discrétion. C’est ainsi que nous nous sentons des affinités électives avec le poème tel qu’Alyn le vit, tout comme nous nous sentons aussi des affinités, pour les mêmes raisons, avec des poètes comme Valente, Grosjean, Grall, Juarroz, Char, Daumal, La Tour du Pin, Michaux, Cendrars, Reverdy, Garcia Lorca, Nerval, Kazantzaki, André Pieyre de Mandiargues ou Renéville. Entre autres. Là où s’inscrit le « point final du roman » commence ce que nous nommons Recours au Poème. Là où naît la poésie en tant qu’elle est prophétie de l’instant.
Ce volume est précédé d’un texte d’André Ughetto, par ailleurs rédacteur en chef de la revue Phoenix, laquelle prolonge la belle histoire de Sud et d’Autre Sud. Un texte qui est la meilleure introduction à la vie et à l’œuvre du poète. Avec de tels volumes, la collection Présence de la Poésie occupe progressivement la place qui était autrefois celle de Poètes d’aujourd’hui chez Seghers, et elle l’occupe de fort belle manière. On sent que nombre de ses volumes sont appelés à servir de référence. Pour ce qui est de celui-ci, la chose est évidente. Avec le titre, tout est dit des fondements et des profondeurs de la poésie de Marc Alyn : « Permanence de la source », écrit Ughetto, lui-même poète, arpenteur des mêmes contrées pérennes. Nous sommes ici en présence d’une poésie qui a pris la mesure du réel. Une poésie qui regarde au-delà du voile de l’apparence des chairs et aperçoit le lien qui unit le tout du réel. Ce qui nous échappe la plupart du temps, au point que nous croyons encore en l’existence de la mort. Cette mort qu’il ne s’agit pas d’accepter mais bien de percevoir comme n’ayant pas d’existence autre qu’immédiatement concrète. C’est de disparition apparente dont il s’agit, et cette disparition est une transformation. Voilà ce dont nous parle la poésie de Marc Alyn, et voilà ce dont parlent tous les poètes des profondeurs : derrière ce que nous appelons « mort » se profile le réel des transformations permanentes de la vie/source de tout l’existant, transformations qui ne se produisent pas dans tel ou tel individu mais dans chaque partie/élément du vivant. Ici, la poésie est rejointe par la physique quantique. Tout est composé de particules. Et ces particules prennent formes selon la manière dont elles sont reliées les unes aux autres. La vie est architecture. Ainsi, la principale chose qui me différencie d’un morceau de roche est la manière dont nos particules sont liées. Le lien, là est le principe de la vie. Et ce lien se nomme poème. Au-delà des illusoires et insignifiantes prétentions du quotidien, nous sommes des maillons. Et la chaîne forme le tout du réel. Il est du reste amusant de constater combien les sciences contemporaines redécouvrent peu à peu ce qui fonde l’essence même de la poésie. C’est bien dans un nouveau monde, ancré sur d’autres paradigmes, que nous pénétrons, nous le sentons, nous ne le savons pas encore mais ce monde nouveau apparaît peu à peu sous nos yeux – un monde de poètes de nouveau reliés en chaque instant au Poème.
Cette vision d’une poésie allant « au-delà » a toujours été une préoccupation essentielle dans le travail de Marc Alyn. On pense au manifeste/tract Défense de la poésie qui, signé par Alyn, Garnier et Bouhier, réagissait dès 1955 aux conceptions d’une poésie « nationale » mises en avant par Aragon, Guillevic et autres. Par cet acte, Alyn et ses amis montraient que la poésie n’est pas inféodée, ni à une idéologie, ni à un parti, ni à un moment de l’Histoire, quand bien même ce moment serait-il celui de la résistance. Ils affirmaient aussi, pour ceux qui lisent posément, que la poésie est une des formes d’expression visible de ce lien unissant toutes les parties de la vie, ce même lien dont nous parlions plus haut. Et de ce point de vue, la poésie voit plus loin et vient de plus loin que ce qu’Aragon pouvait en penser. Sur le moment, ce texte fut très lu, comme on lit dans le moment de leur parution les textes qui semblent contribuer à un débat, parfois à une polémique. Mais il sera surtout relu, à compter de maintenant, en regard de l’histoire de la poésie française de la seconde moitié du 20e siècle, et de celle qui s’écrit en ce moment même. Car, avec le recul, la position de Défense de la poésie prend toute sa force : elle est position de ceux qui connaissaient, malgré les coups et les sarcasmes, malgré le retrait imposé souvent par une poésie alors dominante, dans un contexte idéologique lui aussi dominant, à ceux qui ne pensaient pas comme l’air du temps politique voulait que l’on pense. Une position : ne pas cesser de croire en la possibilité du poème. Et cette position est aujourd’hui nôtre.
Quand un poète engage sa vie sur le chemin de cette position, il lutte pour la poésie, pour que le Poème trouve son chemin en nous et à travers nous, pour que ce même Poème fasse irruption dans nos vies. Et, changeant notre vie, contribue à ce que l’Homme se construise moins malfaisant. La chose n’est guère aisée. Reste que quiconque ne saisit pas cela a encore beaucoup à apprendre, humblement, sur le sens de ce qu’est la poésie. Sa réalité profonde, et non son expression plus ou moins laborieuse dans telle ou telle librairie. Marc Alyn est ainsi un poète engagé, au sens d’un engagement sur la trace des plus anciennes racines du Poème, non dans un sens conjoncturellement politique de peu d’intérêt. Que reste-t-il des « engagements » politiques d’antan n’est-ce pas ? La question n’est pas de croire avoir raison dans un présent bien illusoire, pour ensuite s’apercevoir et peut-être reconnaître combien l’on s’est trompé. La question est celle de la préoccupation profonde : qu’est-ce que vivre ? Quel est ce lien qui me fait être ? La poésie ne parle de rien d’autre. Et elle n’en parle pas uniquement, c’est heureux, en ayant les yeux rivés sur l’humain, modeste acteur et participant d’un ensemble bien plus vaste dont il ne perçoit que les soupentes. Et encore. Marc Alyn écrit depuis l’avant, dans le présent de l’instant. Et son œil coquin trace des possibles au-devant de nous. Que chacun trouve sa porte, elle est plutôt basse mais… que nous nous baissions un peu ne nous fera pas de mal ! La poésie, ce n’est pas rien. En particulier en une époque où la déstructuration généralisée agissant contre les fondations de la vie tend à produire une transformation inversée, poussant cet humain loin de son humanité. C’est de ce combat dont la poésie des profondeurs et celle de Marc Alyn parlent : il s’agit de tenir la position en période troublée. C’est pourquoi les poètes authentiques de maintenant sont les dissidents d’une époque qui cherche à oublier que le Poème est ce qui œuvre dans le réel du monde.
Alors, Présence de la poésie en effet. Le titre de cette collection vaut manifeste et si ses animateurs ne se trompent pas trop, cette collection marquera l’histoire de la poésie.
Georges Bonnet a publié de nombreux livres de poèmes à partir des années 80, une fois sa retraite d’enseignant prise. Livres d’une sensibilité rare, où il s’est affirmé comme un véritable maître de climats et d’atmosphères, artiste de l’infime, en sympathie avec le plus humble. Dans les années 2000, il a commencé à publier des romans poétiques et des nouvelles, chez Flammarion (Un si bel été, Un bref moment de bonheur) et au Temps qu’il fait, le dernier livre en 2010 (Chaque regard est un adieu).
Aujourd’hui, les éditions de L’Escampette font paraître son livre le plus autobiographique et le plus intensément tragique : Entre deux mots la nuit. Il s’agit de son épouse entrée dans une résidence pour gens âgés et dépendants, atteinte d’une maladie proche de celle d’Alzheimer. Le livre fait se succéder des phrases de prose, des fragments de jours, des instants passés là. « La tendresse toujours, inépuisable issue. Je lui dis mon amour, et les mots n’ont pas d’âge. »
Georges Bonnet accompagne cette lente marche vers l’absence et la détresse d’un corps « abandonné », jusqu’au moment où « les mots sont désormais trop lourds pour elle ». Il dit les promenades dans le jardin, les somnolences puis les réveils dans le fauteuil, les allées et venues des sœurs soignantes, la fenêtre de la chambre où « le paysage se pose dans l’instant ». Il regarde cette femme qui s’éloigne et qui lui fait écouter un silence qu’il n’a jamais jusqu’alors entendu. Ils évoquent le passé mais bientôt « c’est un brouillard qui se lève » au fond d’une mémoire épuisée. « Elle veut me parler, mais tout vacille, devient lointain. Elle se tait. Quelque chose en elle s’éteint, qu’elle ne comprend pas. »
Le poète la revoit « en robe légère, coiffée d’un chapeau de paille(…) à la saison où elle ouvrait les portes et les fenêtres aux lilas blancs. » Tout se referme à présent.
« Nous sommes face à face dans la clarté de l’instant.
L’instant accueilli, l’instant rendu au temps.
Sur les platanes, des feuilles jaunies frissonnent, chacune dans son attente. »
Ce livre est d’une intensité poignante, il déborde d’humanité sans aucune sensiblerie ni facilité. Bien au contraire, il affronte l’indicible d’une manière très rarement vue jusqu’ici en littérature, avec des mots de poète certes, mais qui ne pèsent pas leur poids de mots, tant les vibrations qu’ils propagent sont vives, directement ressenties par le cœur. La pudeur et le courage de l’auteur ajoutent encore à la beauté tragique de ce texte.
« Elle sait ce qui se passe autour des choses.
Je reste à l’écart de ce que je ne saurais comprendre et voir. »
C’est dans cet « écart » que se situe l’écriture singulière de ce grand livre et cet « écart » est d’abord et surtout une écoute. L’amour est partout ici, il règne doucement, sans parler, « peut-être qu’aimer est son dernier cordage », suggère le poète. « Nous buvons à la même blessure. » Communion sublime que deux êtres peuvent vivre, l’un à côté de l’autre, déjà presque au bord de la mort ! « La splendeur du vide » est là, toute proche, pour eux. On ne referme pas ce livre- qui est plus qu’un livre- intact.
C’est une grande leçon que Georges Bonnet nous offre ici, un cadeau que seuls les très grands poètes peuvent préparer avec leur souffle et leur sang, pour toute l’humanité.
Retrouvez l'ensemble de la Chronique du veilleur, commencée en 2012 par Gérard Bocholier