Le Scalp en feu est une chronique irrégulière et intermittente, dont le seul sujet, en raison du manque et de l’urgence, est la poésie. Elle ouvre six fenêtres de tir sur le poète et son poème. Selon le temps, l’humeur, les nécessités de l’instant ou du jour, son auteur, un cynique sans scrupules, s’engage à ouvrir à chaque fois toutes ces fenêtres ou quelques-unes seulement. M.H.
SOMMAIRE
-
UNE PENSÉE OU PLUSIEURS / De la rime / de Théodore de Banville à Joë Bousquet et à Louis Aragon. / p. 2
-
LE POÈME / Blas de OTERO / p. 4
-
LE POÈTE / Max PONS et le recueil « VERS LE SILENCE » / p. 10
-
AUTRE(S) CHOSE(S) / p.20 / 2012-JUIN
APHORISMES , SENTENCES ET PENSÉES D’AYMERIC BRUN (inédits)
-
FEU(X) SUR DAME POÉSIE / le poète avec ou sans recueil / p.23
§ ANNE JULLIEN / FLOTTILLES / p.23
§ JANINE MODLINGER / UNE LUMIÈRE À PEINE (Carnets) / p.25
-
LIEUX DE POÉSIE / 5 Lieux, dont ceux de GUILLAUME SIAUDEAU et MARLÈNE TISSOT / p.28
______________________________________________________.
UNE PENSÉE
ou plusieurs
C’est au printemps 1941, dans le numéro 4 de la revue Poésie 41, des mois de mai et juin. Joë Bousquet répond à André Gide qui commente cette définition de la poésie par Théodore de Banville : « … cette magie qui consiste à éveiller des sensations à l’aide d’une combinaison de sons… cette sorcellerie grâce à laquelle des idées nous sont nécessairement communiquées, d’une manière certaine, par des mots qui cependant ne les expriment pas. » Puis Louis Aragon répond à Joë Bousquet.[1]
J. Bousquet : « … le mot qui, dans l’expression en prose est le spectre d’une pensée, devient en vers la substance même de l’expression, où, par irisation, la pensée apparaît. Aussi le poète fait-il la nuit dans les mots, comme le vitrier, obscurcissant les verres (où le noir prendra toutes les couleurs de l’arc, en attendant l’élaboration du vitrail.
Les mots ainsi réduits à leur être physique sont susceptibles d’arrangements admirables. Là est le secret de la poésie ; comme la nature semant les éléments où la vie choisira sa combinaison…
[…] Je n’hésite pas à déclarer que le langage poétique n’est pas le frère de notre pensée, mais le frère de notre être : la pensée s’y reflète au lieu de s’y traduire. […] L’homme pourrait donc dire de la poésie qu’il vocalise en elle son essence. Mais j’insiste surtout sur le fait que dans tout poème le mot est premier à l’idée. »
Puis il est question de la rime. J. Bousquet : « … on ne peut que souhaiter l’obligation de rimer. À chaque vers, la rime apporte un peu de nuit sur la pensée, elle empêche la raison de tirer ses plans. Je l’appelle l’interlocuteur nocturne. »
Louis Aragon, qui ne veut pas « bousculer le système philosophique » « idéaliste » sur lequel repose la réflexion de Joë Bousquet, lui répond sur le point de la rime, venue selon lui jusqu’à nous du bas peuple de Rome et dans les bagages des légionnaires : « Avec autrement d’élévation dans la pensée, vous reprenez pourtant la conception de la rime qu’accuse Verlaine, et qui est celle qui l’oppose à la raison. Pour moi (et d’autres sans doute), la rime à chaque vers apporte un peu de jour, et non de nuit, sur la pensée : elle trace des chemins entre les mots, elle lie, elle associe les mots d’une façon indestructible, fait apercevoir entre eux une nécessité qui, loin de mettre la raison en déroute, donne à l’esprit un plaisir, une satisfaction entièrement raisonnable. Entendons-nous : je parle de la rime digne de ce nom, qui est à chaque fois résolution d’accord, découverte, et non pas de ce misérable écho mécanique, qui n’est qu’une cheville sonore, et qui n’a pas plus de droit en poésie que le mirliton n’est poète, que n’est le faiseur de bouts-rimés. » (Louis Aragon)
Outre que ces citations tronquent le développement des deux pensées de Bousquet et d’Aragon, elles négligent l’ouverture qu’elles proposent sur la fonction humaine de la poésie, sa nécessité primordiale. Néanmoins, il me paraît tout aussi nécessaire d’interroger la poésie dans ses formes qui, tenues souvent pour aller de soi ou d’elles-mêmes (il est une poésie régulièrement métrique et rimée, une autre dite du vers libre et non rimée), ne sont ni discutées ni envisagées dans leur profondeurs signifiantes, leurs conséquences. J’admire donc tout autant, ici, chez Bousquet, l’obstacle obscurcissant que met la rime à la raison raisonnante dans le poème, et que la pensée y pénètre « par irisation », et que notre « être » y ait sa part fraternelle essentielle, que chez Aragon la poésie ne se réduise pas à une sorte de déraison, la rime, la belle rime, la rime nécessaire – j’imagine ! - se chargeant de mettre le bon ordre de la découverte dans les vers qui ne sont pas de mirliton. Je ne suis pas persuadé que d’Aragon à Bousquet il y ait une si franche opposition quand la nuit de l’un nous apporte le mystère humain, quand le jour de l’autre est le lien qui nous donne le sens brillant d’autres feux, mieux accessibles soudain parce qu’il nous semble les découvrir à travers la magie du verbe poétique.
J’ai un faible pour cette rime qui « empêche la raison de tirer ses plans », pour cet « interlocuteur nocturne » : je crois bien qu’il apporte cette vibration, ce tremblement qui fait vaciller un instant la pensée et la porte plus loin. - M.H.
____________________________________________________.
LE POÈME
Prenons-le (prenons-les, j’en donnerai trois) chez Blas de Otero, cet « ange cruellement humain », poète espagnol né en 1916, oublié ou presque aujourd’hui, bien qu’il n’eût me semble-t-il que d’honorables fréquentations intellectuelles : il m’est pénible d’écrire la phrase que je viens d’écrire, mais je ne m’explique pas cette disparition autrement que par la stupidité des aveuglements idéologiques de toutes sortes qui n’ont jamais cessé d’exercer leurs pouvoirs de gommes mécaniques, ou alors par ce désaveu de la poésie et de toute culture qui, dans le monde englué dans les lugubres pantomimes de l’argent où nous pataugeons depuis des décennies constitue un véritable ordre nouveau on ne peut plus fasciste, dominateur et esclavagiste. Blas de Otero fut abondamment lu et commenté, traduit dans diverses langues, et il reste le poète de l’angoisse d’être homme, cette sorte de supplice, où comme dans l’arène, entrer en lice, vivre et mourir participe de la même cérémonie.
Les poèmes ici cités et traduits sont extraits des recueils ÀNGEL FIERAMENTE HUMANO et REDOBLE DE CONCIENCIA, publiés par la Editorial Losada, à Buenos Aires, dans son édition de 1960.
Un mundo como un árbol desgajado.
Una generación desarraigada.
Unos hombres sin más destino que
apuntalar las ruinas.
Un monde comme un arbre arraché.
Une génération déracinée.
Des hommes sans autre destin que
d’étayer les ruines.
Rompe el mar
en el mar, como un himen inmenso,
mecen los árboles el silencio verde,
las estrellas crepitan, yo las oigo.
La mer se rue
Dans la mer, comme un hymen immense,
les arbres bercent le silence vert,
les étoiles crépitent, je les entends.
Sólo el hombre está solo.
Es que se sabevivo y mortal.
Es que se siente huir
ese río del tiempo hacia la muerte -.
Seul l’homme est seul. Car il se sait
vivant et mortel. Car il se sent en fuite
ce fleuve du temps roulant vers la mort -.
Es que quiere quedar. Seguir siguiendo,
subir, a contra muerte, hasta lo eterno.
Le da miedo mirar. Cierra los ojos
para dormir el sueño de los vivos.
Car il veut rester. Continuer de continuer,
monter, à contre-mort, jusqu’à l’éternité.
Il a peur de regarder. Il ferme les yeux
pour dormir du sommeil des vivants.
Pero la muerte, desde dentro, ve.
Pero la muerte, desde dentro, vela.
Pero la muerte, desde dentro, mata.
Mais la mort, de l’intérieur, regarde.
Mais la mort, de l’intérieur, regarde-la.
Mais la mort, de l’intérieur, tue.
… El mar - la mar -, como un himen inmenso,
los árboles moviendo el verde aire,
la nieve en llamas de la luz en vilo…
… La mer - la mer –(*), comme un hymen immense,
les arbres remuant l’air vert,
la neige en flammes de la lumière en suspens…
(*) Le français n’a pas cette possibilité de dire « la mer » au masculin comme au féminin. Au masculin ce serait la mer quotidienne, au féminin la mer selon les poètes. Les dictionnaires le prétendent.
-*-
VÉRTIGO
VERTIGE
Desolación y vértigo se juntan.
Désolation et vertige s’unissent.
Parece que nos vamos a caer.
On dirait que nous allons tomber,
que nos ahogan por dentro. Nos sentimos
Qu’on nous étouffe par dedans. Nous nous sentons
solos, y nuestra sombra en la pared
Seuls, et notre ombre sur le mur
no es nuestra, es una sombra que no sabe,
n’est pas la nôtre, c’est une ombre qui ne sait pas,
que no puede acordarse de quién es.
qui ne peut se rappeler à qui elle appartient.
Desolación y vértigo se agolpan
Désolation et vertige se rassemblent
en el pecho, se escurren como un pez,
dans notre poitrine, s’échappent comme un poisson,
parece que patina nuestra sangre,
on dirait que notre sang dérape,
sentimos que vacilan nuestros pies.
nous sentons que nos pieds vacillent.
El aire viene lleno de recuerdos
Le vent souffle empli de souvenirs
y nos duele en el alma su vaivén,
et au fond de l’âme son va-et-vient nous fait mal,
divisamos azules mares, dentro
nous apercevons des mers bleues, dans
de la niebla infinita del ayer.
l’infini brouillard de l’hier.
Desolación y vértigo se meten
Désolation et vertige se fourrent
por los ojos y no nos dejan ver.
dans nos yeux et nous empêchent de voir.
Un pañuelo en el viento anda perdido,
Un mouchoir dans le vent vole égaré,
Que viene y va, como un trozo de papel,
qui vient et s’en va, comme un bout de papier,
y lo lavan tus manos con las lágrimas
et tes mains le lavent avec les larmes
que nuestros ojos han vertido en él.
que nos yeux y ont versé.
Desolación y vértigo se juntan.
Désolation et vertige s’unissent.
Parece que nos vamos a caer,
On dirait que nous allons tomber,
que nos ahogan por dentro. Nos quedamos
qu’on nous étouffe par dedans. Nous restons
mirando fijamente a la pared,
à regarder fixement le mur,
no podemos llorar y se nos queda
pleurer nous ne pouvons et nous restent
el llanto amontonado, de través,
les larmes amoncelées, en travers,
nos tapamos los ojos con las manos,
nous nous bouchons les yeux de nos mains,
apretamos los dedos en la sien,
nous pressons nos doigts sur nos tempes,
sentimos que nos llaman desde lejos,
nous entendons qu’on nous appelle au loin,
no sabemos de dónde, para qué…
nous ne savons d’où, ni pourquoi…
-*-
Es a la inmensa mayoría, fronda
de turbias frentes y sufrientes pechos,
a los que luchan contra Dios, deshechos
de un solo golpe en su tiniebla honda.
Ceci à l’immense majorité, frondaison
de fronts troublés et de cœurs souffrants,
à ceux qui luttent contre Dieu, défaits
d’un seul coup en leur profonde ténèbre.
A ti, y a ti, tapia redonda
de un sol con sed, famélicos barbechos,
a todos, oh sí, a todos van, derechos,
estos poemas hechos carne y ronda.
À toi, et à toi, mur rond
D’un soleil assoiffé, jachères faméliques,
à tous, oh oui, ils vont à tous, et tout droit,
ces poèmes faits chairs et chansons.
Oídlos cual el mar. Muerden la mano
De quien la pasa por su hirviente lomo.
Restalla al margen su bramar cercano
Entendez-les pareils à la mer. Ils mordent la main
de qui la passe sur leur échine bouillante.
Éclate à l’écart leur mugissement tout proche
Y se derrumban como un mar de plomo.
¡ Ay, ese ángel fieramente humano
corre a salvaros, y no sabe cómo !
Et ils s’écroulent comme une mer de plomb.
Hélas, cet ange cruellement humain
accourt pour vous sauver, et il ne sait comment !
___________________________________________________.
LE POÈTE
C’est Max Pons.
Il sert la poésie, les poètes, les gens de l’être depuis qu’il est au monde ou presque. Il est amoureux des mots et des pierres depuis qu’il sait les lire. La Barbacane, revue et maison d’édition qu’il a fondées, ont avec constance été au service de la poésie. De grands noms s’y côtoient avec d’autres moins grands… trait de vérité, le sens et la beauté du monde s’y éclairent ensemble de tous leurs feux. Max Pons, à l’occasion de la publication de VERS LE SILENCE, son « Itinéraire poétique » et son plus récent recueil, a reçu de la Société des Gens de Lettres le Grand prix de Poésie pour l’ensemble de son œuvre. Ce n’est que mérité pour un homme dont la valeur unique se reconnaît dans ses mots comme dans cette joie qui l’habite. Quoiqu’il puisse connaître les moments qui accablent, il a cette force immuable des pierres, de la langue et du temps. Force de l’amour aussi, qui embrasse, au-delà des littératures, la vie et tous les êtres dont un cœur généreux ne peut que s’éprendre. C’est pour cela que Max nous émeut aussi et nous est l’exemple même de la fidélité. J’ai eu la chance d’être choisi pour préfacer VERS LE SILENCE. Ce fut un plaisir autant qu’un honneur. Voici cette préface. Elle sera suivie de quelques poèmes de Max et de la liste de ses publications.
Préface
« Je suis d’aujourd’hui et de naguère, dit-il. Mais
j’ai quelque chose en moi qui est de demain, et
d’après-demain, et de plus tard. »
Frédéric Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra
Marcher en lucidité vers le silence est sans doute, avec les mots et le rire, l’un des apanages de l’homme. Certains y ajoutent la raison, dont pourtant les traces ont de tout temps été imperceptibles chez les bipèdes. Le poète, que d’aucuns qualifient aisément de fou, paraît devoir s’en passer sans trop de dommages, s’étant de naissance _ je veux dire dès l’éveil de l’esprit _ consacré à l’incalculable, à l’incommensurable. Rentes et rentabilité ne sont pas de son ressort, d’où l’accusation dérisoire. Quand il bâtit, il prévoit aussi bien la demeure que la ruine de la demeure. Il poursuit son chemin et ne s’afflige pas de l’imparable. Il sait les cycles, les périodes, les trésors invisibles, les vraies pauvretés. Disons : la voilà sa raison.
Vient un temps où il faut se retourner sur l’itinéraire, en prendre la distance et le sens. Après ce seront des pas encore, vers l’ailleurs, et c’est dans la certitude d’avoir « fait » pour le mieux que l’on peut fixer cet horizon du dernier inconnu :
Mon regard m’a construit,
La parole bâti,
Ce que j’ai fait m’a fait.
Dans le bonheur des mots
Je suis venu au monde
Pour m’unir au mystère,
Acquiescer au silence.
Max Pons se cite en ouverture. Ce n’est pas suffisance, mais volonté d’énoncer le cap : il ne s’agit ici que de construire et bâtir, du faire en somme - le poieîn des Grecs – inaugurant poésie et poème ! Parole initiale d’ouverture face à l’étrangeté du monde. La trace visible et audible ! L’unique sens possible et les véritables richesses _ l’acquiescement dans le choix des actes _ dont on transmettra l’héritage sans avoir à en rougir : on n’a rien volé à quiconque, on n’a fait que les saisir là où on était seul d’abord à les apercevoir, et on les a légués sans même exiger un merci. C’est ici que l’on édifiera le mieux une vie et son chant. Toute bâtissure - qu’on pardonne le néologisme - sera réplique aux innombrables flétrissures qui noircissent le tableau du monde. Il y faudra donc des pierres, et de toutes sortes.
C’est à Rabelais, je crois, que Max Pons emprunte celles, vives, qui fondent ce recueil qu’il veut testamentaire. Nous avons souvenir de cette repartie de Panurge à Pantagruel, lors de leur échange au sujet des jeunes mariés que certaines lois dispensent d’aller à la guerre [2] :
« […] les beaulx bastisseurs nouveaulx de pierres mortes ne sont escriptz en mon livre de vie. Je ne bastis que pierres vives : ce sont hommes. »
Oui, tout est versé à la vie et aux hommes, et à leur seul crédit. Les banques ne sont pas encore inventées, tout part d’un élan naturel. Aucune retenue, donc, dans le geste et dans le mot.
Nous savons que Max Pons aime « les pierres et les hommes » à la folie - c’est son hubris, sa démesure intime -, au point d’avoir été, des années durant, et de rester en son cœur, le « gardien » de Bonaguil, ce puissant château du Lot-et-Garonne (en fut-il le gardien sourcilleux ? Le dragon débonnaire ?) [3], et d’intituler sa revue La Barbacane, la dédiant elle aussi aux pierres et aux hommes.
Si l’on veut bien s’y arrêter un instant, cette pensée de la pierre est plus qu’essentielle, elle est première ! Tout a commencé, du moins ici-bas, en ce recoin de l’univers, par le feu et le magma originel : de ces gestations incendiaires, de ces compressions titanesque sont nées les cristallisations, les sertissages de pierreries célestes, les schistes et les silex, les granites et les calcaires, la houille et le sable, l’argile et le diamant, la mer et les nuages…
La pluie te rend la mémoire
De l’eau première
Et le soleil te redonne
À l’enfance du feu Le processus vital s’engage alors, et, par la médiation de la Pierre de caresse / Pierre maternelle… […] Cette carrière / devient chair… Puis naissent dans un puissant modelage : architecture et demeure, et seuil, voûte, fenêtre, porte, cintre, passage, vis de l’escalier… où s’abritent chairs, rêves, avec aussi la beauté et déjà tout un passé de femmes… Il n’est pas indifférent que Max Pons grave ici cette discrète allusion à la fine amor, à la courtoisie des âges perdus - à ce « passé de femmes [vrillé] en nous », au chant et à l’âme du troubadour. Il ancre l’esquif de son existence dans les murailles des châteaux, à leurs tours d’angle et de flanc, dans ces images fondatrices qui l’ont peuplé et « bâti » entre instant et éternité. Bonaguil, certainement, et quelques hautes figures minérales dressées sur l’horizon des vieilles terres - « poignante conjugaison de l’horizontalité et de la verticalité » -, sont à l’origine de ses songes et visions. De sorte que s’il est quelque nostalgie au Chant des ruines, il n’est pas de tristesse à leur fatalité. Les ruines tiennent leur essence de la marche et du regard qui les organisent, les distribuent, les réalignent dans le temps renversé. Les herbes mêmes, si fragiles, disent la vie encore, la vie malgré les érosions, les éboulements :
L’herbe, l’herbe partout dans ce chaos pierreux,
c’est sa manière à la grande ruine de porter ses cheveux blancs.
Et c’est le pouvoir du poète de lire sur les portulans les lieux où sont enfouis ces trésors dont je parlais tout à l’heure, les bonheurs, les beautés, l’indomptable permanence des choses qui ne font que mimer leur éloignement :
Quelle est donc cette force sauvage qui habite
La somptueuse gésine minérale, dans la quiétude des mousses.
Dès lors, il n’est plus de ces contradictions, fussent-elles soulignées, voire démontrées par les observations de la science et les ratiocinations de la physique (m’ont toujours paru admirables et étonnantes quoique superficielles, ces oppositions entre roc des collines et eaux des sources et des rivières, parties « molles » et parties « dures » des corps qu’irrigue le sang…) qui n’ont pour objet que de faciliter les descriptions, de donner un semblant de sens aux non-sens et aux hasards. Tout dérive de tout, tout s’inclut dans tout : il n’est plus d’impossible à l’esprit qui veut vivre. Survivre n’est pas encore tout à fait de saison ! De toujours le poète sait ces choses. L’on va et c’est tout. Il n’est que voyages et traversées :
Savoir que la chair est cette pâte à pétrir
Que le sang à fleur de peau rosit la tendresse du monde
…
Le mystère du sexe
Fait éclater le temps
Gai savoir que celui-là, et illimité, nous pouvons le penser, car il va « au plus profond du découvrir… dans la soyeuse grotte… », menant au « vertige tout puissant / de l’insaisissable. » L’invention du sacré est à hauteur d’homme, car il ne se cache pas, mais ne fait que se masquer dans ce « désastre de matière », ces minéralités, dans le leurre de « l’insecte pétrifié » :
Inventer la survie
Débusquer le mouvant
Jusqu’à l’immobilité lucide
Au seuil du sanctuaire
La vie ne cesse pas car la mort est niée radicalement : le mouvant en témoigne, la lucidité la garantit. Dès lors la chair, l’eau, la caresse, les baisers se gorgent de mots, à moins que ce ne soit l’inverse. Les corps ont la parole. Ils l’ont toujours eue, et même s’ils se livrent peu à peu au silence ils se réfractent dans la lumière de la mémoire ; ils ne peuvent donc périr. Cela s’appelle physique du poétique :
Et tes yeux s’ouvriront, sous leurs paupières closes,
Aux sourdes rumeurs de la vie.
Alors je me tairai…
Et ton corps deviendra multiple.
Dans ce chant, comme d’un chœur, du Corps multiple, Ève renaît car elle est « la première et la dernière », elle n’est appelée à aucune disparition : c’est la force du vivant que de « reformer » sans cesse la visible, la sensible, l’indispensable forme du monde. L’amour est en permanente gestation, algues et mousses n’ont ni commencement ni fin, le poète s’est fait démiurge parce qu’il tient sa puissance des formes sensibles du monde dans lesquelles il ne cesse de vibrer:
Je suis du règne de la chair
J’ai faim de viande rouge
Mais aussi de froment
De forêt et de ciel
Au terme de son Chant profond (si justement emprunté à l’Espagne, à Federico García Lorca - « cante hondo » -, le poète que l’on assassina sans pouvoir le faire mourir, parce que de toujours il appartient au règne de la vie : chair, viande, froment, forêt, ciel !), Max Pons peut annoncer à la Totalité : « Je te bâtis ». C’est ainsi que l’on honore la page de sa propre vie et que l’on use des mots pour dire quelque chose plutôt que rien, ce rien étant de nos jours la première des fonctions que leur attribue une société qui a décidé de ne plus parler mais seulement de communiquer.
Les mots ! Les mots !
Max Pons, se libérant des pesanteurs ordinaires, dans le même élan libère ses mots des carcans des proses bienséantes et chargées de sens pratique. Les gains ne sont pas monétaires, mais d’esprit et de pures émotions. Avec eux il « refait le monde / À la mesure d’une fumée ». Lucidité n’est pas désenchantement, bien au contraire : d’un côté les deuils inéluctables, ce « gel du souvenir », de l’autre les visions paisibles, l’âtre et ses braises, la pensée des corps fragiles et le dépouillement des risibles (et vaines) ambitions : « Faire trois petits tours, / Pour le souvenir // Et puis, laisser faire / La mémoire des âges. »
De ces sagesses de chaque jour, qui ne tiennent pas de l’ataraxie épicurienne ni des détachements stoïciens, naît cette énergie qui ouvre les champs de la fantaisie et du songe. Cela aurait à voir avec l’éternel retour peut-être, avec ce mouvement créateur perpétuel que rien ne peut ni ne doit figer, mais peut-être plus encore avec cette essentielle et jeune intuition nietzschéenne :
« Tout luit, tout est neuf, très neuf même.
Midi dort sur l’espace et le temps :
Seul ton œil, énorme,
Me regarde, ô Infini ! »
Les coqs désormais perdent l’esprit de clocher, le théâtre de la Vie rouvre ses portes sur les souvenirs heureux, ceux des gares, par exemple, où cherchaient à se combler les anciennes solitudes amoureuses, et « C’était d’une beauté / Où tout naissait encore. »
Le propre du poète est, non pas de refuser ce qui vient - le « Jour pâle, gris, indécis : / Jour mort de notre vie. » -, ni même de reculer les échéances, mais de ne jamais douter de la puissance de vie qui émane de lui et du monde. La naissance est sa spécialité, il accouche le monde comme Socrate accouchait les esprits. S’étant mis à table, ayant « [mangé] le soleil », il renaît de ses cendres et entraîne tout avec lui, autour de lui. Les vrais objets sensibles, les êtres sont ainsi. Dans la vision poétique ils dessinent leurs visages. Il n’est pas de triste fin, d’irrémédiable perte. Il n’est que naissances et renaissances. Cette confiance belle et généreuse nous est offerte. De ce cadeau témoignent ces paroles admirables :
C’est le début d’un monde.
Résonnent les trois coups.
Le vide s’organise.
Une forme l’habite.
…………………..
L’identité acquise
Il sera donc cet homme
Qui s’acheminera
Jusqu’au bout de son temps.
Vers une plus grande naissance.
M.H. Octobre 2010
TROIS POÈMES DE MAX PONS
(extraits de « VERS LE SILENCE » / Éd. de La Barbacane)
Pierre de caresse
Pierre maternelle
Baignée de patience aquatique
Poisson immobile
La nage des eaux t’a modelé.
Tu ouvres tes yeux de taupe secondaire
Quand le carrier jette à la lumière
Tes cents millions d’années
De reclus
La pluie te rend la mémoire
De l’eau première
Et le soleil te redonne
À l’enfance du feu
Le roc s’est ouvert
Cette carrière
Devient chair
Ici
On se perpétue
Roc bleui à force
De regarder le ciel
Rôti à coups de grand soleil
Tu portes ta charge d’homme
Une tour éblouie du blanc
De la carrière.
[…]
ÈVE
Toi la première et la dernière
Je te recommence patiemment
Toi perdue et retrouvée
Détruite et reformée
Toujours la même
Me voici
Lucide et heureux
Devant dette glèbe
Cette argile fertile
Te pétrir
Te lisser
Te polir
Te reconnaître enfin
Te finir
Me voici
Devant ce val délicatement veiné
À la naissance d’un fleuve d’ombre et de feu
Estuaire au limon de vie
Devant ces meules lourdes de louanges
Cette fête de courbes
Ce langoureux ballet
Paysage pour la grande faim
Du dehors et du dedans
Me voici
Après une longue errance
Aux confins de toute une flore
D’algues et de mousses
Depuis toujours je te connais
Inventée avant de te toucher
Faite pour que je te révèle
Ce que tu es
*
Ô le grand gel du souvenir.
Cette eau glacée à la margelle
De la vie exigeante,
On en croyait tout connaître.
Pourtant, chaque année apportait
Son lot de nouveaux deuils.
Cruauté du grand âge,
Tous ces amis perdus,
Leur survivre est blessure.
Inéluctable marche
D’ultime vérité.
________________________.
Max Pons a écrit :
Bonaguil, château de rêve (Privat) / Évocation du vieux Fumel (Privat) / Calcaire, poème (Rougerie) / Vie et légende d’un grand château fort (La Barbacane) / Écriture des pierres, le château des mots (La Barbacane) / Guide des châteaux de France - Dordogne et Lot (Hermé) / Poésie de Bretagne, aujourd’hui – Anthologie (La Barbacane) / À propos de Douarnenez, récit (La Barbacane) / Visiter Bonaguil (Éditions Sud-Ouest) / Les Armures du silence, poème (La Porte) / Voyage en chair, poème (La Barbacane) / Regards sur Bonaguil, étude (La Barbacane)/ Le poète Raymond Datheil, un grand méconnu (La Barbacane) / Montcabrier, une bastide en Quercy (La Barbacane)
_____________________________________________________.
AUTRE(s) CHOSE(s)
2012 - Juin marque, comme un principe de proche sortie des classes, l’ouverture de l’été. Juin est mi-figue mi-raisin, et le temps aléatoire ne fait rien pour arranger les choses. Cela sent les élections, la farce, la sortie des affaires, l’arrivée aux affaires, les mensonges des Rodomonts, les sourires aux photographes à la montée et à la descente des marches des palais de l’État, la petitesse des personnels politiques… cela pue, l’été est mal parti et ne trouvez-vous pas que c’est là une drôle de poésie ?
*
APHORISMES
SENTENCES & PENSÉES D’AYMERIC BRUN
I - Inédits / janvier-février-mars 2001 (choix)
4 janvier. – Pourquoi désiré-je tant décrire l’homme que je suis ? Ne me connais-je pas ? Serait-ce parce que j’ai le sentiment qu’une partie de moi-même m’échappe ?
7 janvier. – Que sais-je ? Que puis-je découvrir ? Que suis-je condamné à toujours ignorer ?
8 janvier. – Je ne vois partout que chaos et confusion.
11 janvier. – J’écris ordinairement sans but, et comme au hasard.
12 janvier. – Pourquoi devrais-je m’attacher à une opinion, plutôt qu’à une autre ?
15 janvier. – Quel homme en lui-même ne porte plusieurs hommes ?
19 janvier. – Blotti en moi-même, je pense admirablement.
22 janvier. – Comme il y a peu de proportion entre l’univers et moi-même !
26 janvier. – J’aimais tant lire, enfant, que tous les plaisirs me paraissaient fades auprès de la félicité que je goûtais en tournant les pages d’un livre.
30 janvier. – Je m’abandonne au monde tout en aspirant à y renoncer.
31 janvier. – Il faut sans cesse écrire, afin de ne rien perdre.
3 février. – Je n’ai conscience que d’un tout petit nombre de mes actions, que de quelques opérations de mon esprit.
6 février. – Je ressens une félicité délicieuse chaque fois que je me retire en moi-même.
8 février. – Je songe à un roman qui pourrait être le roman de l’ennui.
10 février. – Jésus s’afflige de la grandeur des tourments que souffrent les hommes.
12 février. – La puissance qui a conçu l’univers désire que toutes ses créatures se reproduisent.
13 février. – Je ne vois rien sur quoi je puisse me fonder.
16 février. – Je crains parfois de me rencontrer.
19 février. – Un Dieu a-t-il voulu que je sois ?
20 février. – Les choses que je vois me paraissent si peu réelles que je doute parfois d’être au monde.
24 février. – On ne s’éloigne de Dieu qu’insensiblement, et avec volupté.
25 février. – Pourquoi la puissance qui a formé le monde ne se découvre-t-elle pas à nous ? – Peut-être le fait-elle, mais ne l’apercevons-nous pas.
3 mars. – Une éternité de délices ne saurait racheter un seul moment d’indicible souffrance, un seul instant de détresse absolue.
5 mars. – A quoi les hommes servent-ils ?
8 mars. – Dieu ne se découvre plus aux hommes, parce que l’excès de leurs crimes les en rend indignes.
13 mars. – J’aime rêver que je me promène dans des jardins magnifiques.
15 mars. – Rien ne me semble plus extraordinaire que je puisse penser que Dieu existe et ne pas avoir la foi.
16 mars. – Je n’ai jamais eu le sentiment d’être observé par les morts.
19 mars. – J’ignore qui parle en moi-même. (Je ne sais pourquoi cette pensée me traverse l’esprit, ni quelle puissance ou quel être me l’inspire.)
20 mars. – Je désire parfois des choses dont la possession me serait insupportable.
22 mars. – Je parcours les abîmes qui entourent le monde.
26 mars. – Je vois dans la nature des imperfections qui m’étonnent.
27 mars. – L’homme peut nier la puissance qui l’a créé.
29 mars. – Il est juste que Dieu ne se découvre plus aux hommes, tant leur corruption est grande.
31 mars. – Il m’arrive parfois de penser que, tandis que je crois lire dans ma chambre, je me promène peut-être dans une forêt merveilleusement belle.
Aymeric BRUN
Un choix implique une intervention, et même une sorte de censure dont la seule excuse ici serait le trop-plein, l’extrême abondance. Ce n’est pas cela : d’abord la réflexion d’Aymeric Brun me touche parce qu’elle ne prétend pas briller absolument, ni déborder l’esprit du lecteur par le rire, l’ironie ou la facile drôlerie qui la rendrait populaire. Ensuite, elle se limite le plus souvent à sa personne, à ses questionnements, à ses inquiétudes (c’est le fait d’une vérité intérieure, et en cela poétique) qui parfois répondent aux nôtres, même autrement formulés. À travers ces trois premiers mois de l’an 2001, j’ai fait main basse sur ce que je connais de près moi aussi, qui peut donc sembler quotidien ou même banal, cette angoisse du « chaos et de la confusion » par exemple ; main basse sur ce « roman de l’ennui », celui que Flaubert parvint à écrire et qui n’est pas ennuyeux pour deux sous ; sur le sentiment de la faible utilité de soi au monde… voyons, le ciron pascalien !... et sur cette idée que ce n’est pas moi qui fuis Dieu en niant qu’il existe, mais Dieu qui fuit mon indignité et peut-être me nie quoique certains prétendent qu’il m’aurait créé. Quant à celui « qui parle en moi », je le connais très mal moi aussi. Bref, c’est la pensée de l’autre qui fait ma pensée et nous met « en conversation ». M.H.
A suivre…
________________________________________________________.
FEU(x) SUR DAME POÉSIE
LE POÈTE AVEC OU SANS RECUEIL
Il est plusieurs façon de faire feu : sur qui l’on attache au poteau : il y faudra tout un peloton d’exécution, d’ailleurs difficile à réunir ; et sur qui l’on allume les flambeaux pour voir briller ses joues, son front, ses yeux. Nous préférons user de cette manière. De la première, beaucoup moins, et s’il se peut jamais, quoiqu’il faille bien, parfois, que justice soit faite.
« Dame Poésie » - ne signifie nullement que Le Scalp en feu ne traitera que de la poésie des poétesses.
(en dépit des apparences) [ajout 1]
« Le Poète avec ou sans recueil » - signifie que des débutants, voire des inconnus pourraient se voir ici scalpés sans plus de façons !
Il va falloir nous attaquer à la question du Poème en prose… Songez que l’on y songe. Ce ne sera pas facile ! Pensez-y : qu’est-ce donc qui rend une prose poétique et une autre pas ? M.H.
Poésie avec recueil 1
Anne JULLIEN
FLOTTILLES
Ed. de l’Atlantique, collection PHOIBOS, 50 pp., 14 €
Les flottilles d’ANNE JULLIEN sont de paisibles « réunions » de petits bateaux, genre esquifs de pêcheurs… Un vieux Larousse ne me parle-t-il pas aussi d’escadres, de marine nationale ! Holà ! On pense avoir embarqué pour « le cuir la fourrure les soies / le retour sans faillir à l’herbe à l’eau / à la pertinence d’exister / plantés roulés en terre » - car la terre jouxte forcément la mer, naviguer sur l’eau pour « que le sentiment ne naisse que de nos corps / des plantes des rivières des sables et des eaux… », mais promptement on vire de bord, carguez les voiles ! voici que le temps, celui qui mesure nos vies, se met de la partie :
« les fées mères ne durent pas
un jour elles se détachent
………………………………………
le temps passe
ou c’est nous qui passons
dans le temps immobile »
Il faut rentrer au port, fouler à nouveau le bitume, le pavé, les chemins de campagne… un virage est pris… oh, il est des beautés inégalables, le vol du martin pêcheur, j’en témoigne, ou « la zébrure d’un regard ». Nous sommes au monde, ANNE JULLIEN nous en fait conscience prendre, et le prendre comme notre devoir, sinon comment pourrions-nous vivre. « La poésie / une convalescence » nous guérit quoi qu’il arrive. Le désir de retour vers l’avant, je veux dire vers l’avant-nous, tristes que nous sommes, vers les « choses sans nom » des commencements n’est pas compromis dans ce virage de bord :
«plus loin je ne puis aller
il aurait fallu percer
le mystère des mondes »
Nous ferons avec deux mondes par conséquent, et c’est dit fort bien, haut et fort, avec un brin d’humour :
« je batifole
ma gorge offerte à des soleils coupants
je deviens chauve à mon tour
je vais bien »
Aller bien est une belle chose, mais qui ne suffit pas à nous emplir du suc de la vie. Il en faut plus – toute poésie juste et vraie nous offre une éthique, des ponts où franchir les abîmes, les poteaux indicateurs qui nous y conduiront. S’abandonner à la poésie « éblouie de lumières et de ciels » est notre premier pas, l’ouverture et la condition sine qua non de l’être ; nous explorerons les visages, voyagerons avec le chinois Li Po car nous sommes à lui liés comme au reste, et alors
« la flottille, origami mental, coule
pour de bon, vivre dans le vide laissé
vivre »
Les poèmes d’ANNE JULLIEN recréent notre paysage visible, respirable. Nos savoirs, nos ignorances, les mots eux-mêmes y sont à leur place légitime, loin des barbares, près des oiseaux, « aux côtés de [nos] frères humains ». Les interférences, le dimanche incolore, nos corps « matière du temps », « des nuages de rouille / au-dessus des autoroutes », rien n’est dépourvu de sens. Cela se recompose en nous, de nous, autour de nous. Celle qui écrit se voit dès lors, et mieux encore, elle est « La folle de bassan », l’oiseau que dépeint Buffon (Histoire naturelle : t.1-18 : Oiseaux) qui, lui aussi, fait ce qu’il doit « pour éviter de mourir ». Cette poésie est magnifique dans sa simplicité rigoureuse, elle nous porte à la méditation de notre condition dans l’univers à travers un art délicat et suggestif de la pensée. Une pensée longue et pénétrante. Ne pas lire serait une faute, ou pis encore, une erreur. Talleyrand l’eût répété. Ô vieille histoire… ce qui se perdrait à n’être pas lu !
M.H.
_________.
Pensées avec recueil 2
Jane MODLINGER
UNE LUMIÈRE À PEINE (Carnets)
Ed. de l’Atlantique, collection ATHENA, 80 pp., 19 €
Ces carnets, comme c’est leur fonction, nous offrent le jour le jour, les annotations, impressions, sentiments, pensées, interrogations de Jane MODLINGER. Cela marche comme ses pas la mènent… ici, là, ailleurs… non pas au hasard, mais guidée par l’éveil du regard (de tous les sens, en fait) et de l’esprit, une vigilante attention au monde, à soi… et enfin à l’intérêt primordial pour l’écriture de l’expérience humaine, comme s’il fallait poser ses propres repères, ses amers… les phares, les grands foyers que les marins homériques, depuis la haute mer, apercevaient au sommet des collines de la Grèce aussi bien que dans leur cœur. Gérard Bocholier, préfacier du recueil, situe clairement la personnalité de Jane MODLINGER : « J.M. fait partie de ces veilleurs inlassables, tout entiers tournés vers cette beauté offerte que l’on ne prend pas assez le temps d’accueillir en soi. »
Il y faut la lumière, l’essentiel n’étant pas qu’elle soit forte, ou crue, mais qu’elle soit du dehors comme du dedans, en simultanéité, et n’importe où n’importe quand : « Sur les Alpes ce jour, une lumière comme une aile, une caresse, une lumière à peine. Et pourtant, elle est là, elle vous comble, elle est celle que l’on attend depuis toujours. Une présence totale dans son retrait et son effleurement. »
Dès lors, sous ce jour neuf à chaque fois, la poésie n’est plus affaire de mots seulement, elle devient notre nourriture : « … appelée à devenir germination et fécondité dans la vie elle-même. » Et la mort, qu’en faites-vous ? - dira l’esprit chagrin, le voyant des mauvais jours. On n’a pas oublié que Goethe demandait plus de lumière, à cet instant. Jane MODLINGER en possède assez pour n’avoir pas à la réclamer : « Je me tiens là, dans cette abondance, dans cette clarté. / La mort n’est pas oubliée, mais elle n’est plus une entrave à la plénitude. Un peu comme un bruit que l’on apprend à mettre en sourdine. »
Dès lors, si toute inquiétude ne s’est pas effacée, un art de vivre la vie (notre seule vie, selon moi) s’est mis en place, qui dispose à l’accueil de l’harmonie, de la magnificence, et même du désaccord avec lequel on négociera plus paisiblement, à l’acceptance, en somme, qui tend à rassembler les bonheurs :
« Puiser au puits de joie. »
« Unité bienfaitrice qui jubile en vous, suscite un murmure, un “oui” salvateur. »
Dès lors, on sera prêt à tout, je veux dire aussi à l’intelligence des situations, et jusqu’à la compassion : « Magnificence et misère. Tout l’inconnu et la fragilité d’une vie à travers les plis d’un vêtement, l’impact du pied sur le sol, l’inclinaison d’une nuque. » L’autre se présentera sous un jour neuf : « S’incliner. Inclinaison. Ou bien, prosternation. L’amour entre l’homme et la femme se conçoit aussi dans la grâce de l’inclinaison mutuelle. »
Cela nous emmène vers la prière. Et nous qui ne prions pas, qui n’avons prié qu’une fois et en vain pour qu’un tout petit enfant ne meure pas, nous suivons le poète qui sait approcher « l’invisible » que nous récusons car l’intention est belle, ou noble, ou généreuse, comme on voudra, nous la suivons, elle qui a confiance, jusque dans sa « donation », et d’autant qu’elle n’ignore pas la difficulté des choses : « Lorsqu’il s’émerveille, notre regard fait des étincelles, lesquelles vont nidifier dans le cœur de l’autre. Ainsi d’étincelle en étincelle, cette donation, d’humain à humain. Précarité de tout cela. Certes. Mais qu’importe la finitude, puisque ces fêtes auront eu lieu, et ces feux allumés dans le cours de nos vies. »
Revenons à la lumière : « Chaque jour, gestation de lumière. Telle est ma tâche. » C’est bien là qu’est l’essentiel : découvrir la tâche et y satisfaire autant qu’il est en notre pouvoir. Nous éloigner ainsi de « l’indifférence, premier pas vers la barbarie. » JANINE MODLINGER ne nous dicte pas nos devoirs, elle nous indique les routes que nous pourrions prendre, celui-ci l’une, celui-là l’autre, chacun sur la voie qui lui conviendra pour être entièrement lui-même…
J’ai été arrêté par cette réflexion consacrée à la vulgarité, qui à l’évidence est le premier pas vers la barbarie. « À la question ” qu’est-ce que la vulgarité ? “ Yves Bonnefoy répond : « c’est celui qui reste à la surface de lui-même, qui ne descend pas dans ses profondeurs. » Celui, donc, qui s’il en possède les moyens, ne va pas au bout de sa tâche et des forces qu’elle exige. Plus encore, celui qui s’il en possède toujours les moyens, ne tente pas d’aller au bout de lui-même. Le contre-exemple de toutes les convictions exprimées dans ce très beau recueil, et à quoi peut-être répond, sur la page en regard, l’exigeante solution : « Par rapport à toute chose, ne faudrait-il pas devenir plus poreux. Porosité de l’âme, du corps. Laisser entrer en soi les multiples effluves d’autrui, du monde, dans un mouvement inlassable d’ouverture. Et abolir, abolir enfin la barrière-citadelle du moi. »
Une indispensable somme de réflexions et, avec le recueil d’ANNE JULLIEN, l’honneur des poètes et de leur éditeur. Les plus forts et honnêtes, les plus lucides et sensibles y parviendront, de toutes les manières. Lire les y aidera.
M.H.
____________.
LIEUX DE POÉSIE
Lieu 1
Une taupe amie m’en a fait confidence. Elle aime ses frais corridors qu’elle creuse dans le jardin, elle y voit comme personne que le monde n’est ni blanc ni noir, ni même illisible, mais que tout de même, dans cette grisaille, de bonnes lunettes lui seraient utiles. Elle a trouvé très poétique aussi que je ne la saisisse pas dans des pincettes d’acier, ni ne l’enfume ni ne la gaze ni ne l’emprisonne dans des réseaux d’ondes maléfiques. Bref, elle me croit généreux et aristocrate, sachant combien ses façons nuisent à la culture des carottes et des salades. En fait, elle l’ignore, j’achète mes légumes au marché.
Lieu 2
L’écran du téléviseur éteint. On y voit passer des ombres familières, et parfois, depuis la fenêtre, reflété un instant, l’oiseau qui traverse le monde. Puis c’est l’immobilité : le buffet, le canapé s’y installent. Je constate que je dispose d’un mobilier très ordinaire quoique confortable. C’est un contentement appréciable.
Lieu 3
Les Éditions de l’Atlantique – BP. 70041 – 17 102 SAINTES CEDEX
Bowenchina12@yahoo.fr/
http://mirra.pagesperso-orange.fr/EditionsAtlantique.html
_____.
Les Éditions de l’Atlantique publient aussi la superbe et abondante revue
SARASWATI
dont le prochain numéro devrait paraître à l’automne-hiver 2012-2013 / Thème central : la poésie espagnole contemporaine / Réflexion, logos & spiritualité : Poésie & peinture / Poésie & photographie / Art & Vérité / Poésie & connaissance de soi / Se rencontrer soi-même // Invité : Maxime Godard, photographe et portraitiste / Poèmes / Encres / Notes de lecture / Revue des revues.
______.
Un mot de Michel Host
Les Éditions de l’Atlantique connaissent, comme tous les éditeurs de poésie, des difficultés qui pourraient les conduire à fermer leurs portes dans le courant de l’année 2013. La recherche de soutiens divers est en cours, et celui des poètes qu’elles publient ne leur est pas encore entièrement acquis. Nous savons que poètes, écrivains et « créateurs » réfugiés en haut de leurs tours de mots n’ont pas toujours de gros moyens financiers, mais qu’ils sont aussi de fieffés individualistes, souvent fort peu reconnaissants de l’intérêt que leur porte leurs éditeurs, voire éventuellement les considérant comme des ennemis pour des motifs mineurs, pour n’avoir pas été « servis » comme ils pensent que le mérite leur talent exceptionnel, par exemple, etc. Or ce monde globalisé, dirigé par l’argent et le complot anti-culturel (la culture, c’est l’esprit critique et donc l’obstacle aux achats mécaniques et aveugles) les menace, eux, et menace les quelques éditeurs qui n’ont pas renoncé à la poésie. L’entraide me paraît donc une sorte de devoir élémentaire. M.H.
_________________________________________________________.
LIEU 4
Ne craignons pas de nous répéter, la pédagogie ne peut qu’y gagner :
La revue
NOUVEAUX DÉLITS
est et reste régulièrement publiée par Cathy Garcia, dont l’activité, pour ne pas dire l’activisme, en faveur de la poésie est constante.
Sous une couverture sans chichis, NOUVEAUX DÉLITS offre des trésors, des pages inattendues… L’un de ses derniers numéros (N°41) est en grande partie consacré à la tragédie de FUKUSHIMA et contient des haïkus originaux. Sans être exclusive ni envahissante, la préoccupation de la santé de la planète, celle de la préservation de ce que j’appelle NOTRE JARDIN est bien présente dans les pages de la revue.
Aller sur le site : http://larevuenouveauxdelits.hautefort.com/
et sur : http://www.arpo-poesie.org/
______________________________________________.
LIEU 5
On m’a communiqué les difficultés rencontrées par l’éditeur de poésie ASPHODÈLE-ÉDITIONS, Pascal Pratz, sis au
23 rue de la Matrasserie –
44 340 – à BOUGUENAIS
Il publie des livres qui tiennent dans la poche et la main, on ne peut plus portables, sur un papier de très belle qualité, dans des graphies elles aussi de qualité et dans sa Collection Minuscule. Le soutenir, c’est acheter ses recueils, les faire passer de main en main, les offrir… C’est facile, ils ne coûtent que 7 € !
Les contacts aussi sont aisés :
Tél. 06 43 35 49 14
http://pages-perso-orange.fr/asphodele-edition
asphodele-edition@orange.fr
Pour ma part, dans la Collection Minuscule, j’ai retenu l’humour de Guillaume SIAUDEAU dans ses Poèmes pour les chats borgnes.
Pourquoi les avoir écrits ? Parce que
« C’est étrange d’écrire pour les chats. / Voici quand même quelques poèmes / pour les chats de gouttières, / parce que je me dis qu’il y a peut-être encore / des chats borgnes qui lisent, / la nuit, entre deux combats. »
Parce que
« Nous sommes ce loup qui creuse / la nuit d’un regard / nous sommes cette bête qui enfonce / ses pieds dans les soirs pluvieux / nous sommes ce chien sauvage / qui plante ses crocs / dans les jours faibles / et interminables »
Parce que
« Dans ce désert / il n’y avait que moi / et une brindille / j’étais la faune / et elle la flore / elle ressemblait à une magnifique actrice / qui aurait eu un trou de mémoire / pendant une scène cruciale »
Et dans la même collection, de Marlène TISSOT, Nos parcelles de terrain très très vague m’ont été l’occasion de quelques visites en terrains connus, ceux de la crudité de la vie.
Au cinoche, par exemple :
« Parfois la vie m’emmerde / autant qu’un mauvais film / mais je ne suis pas du genre / à quitter la salle / avant / la fin de la projection / est-ce seulement / pour éviter de faire chier / les gens sur les sièges / d’à côté ? »
ou sur les territoires du matin :
« Ce matin je me suis réveillée / dans un paquet de sucre en poudre / tout était blanc, poudré, cristallisé / les voitures, les maisons, les arbres / c’était joli, tellement joli / que j’ai fini par me demander / si on ne nous avait pas plutôt / roulés dans la farine. »
et là où c’est un « gars » au lieu d’une fille :
« C’était juste un gars rencontré comme ça / à l’intersection d’un jour vide et / d’une nuit froide / au moment où la lumière s’incline / en pente terriblement glissante / quand on s’accroche au premier / sourire venu pour pas tomber au fond de soi / à l’instant où tout ce qu’on demande / pour avoir la force de se relever / c’est un peu de chaleur / animale »
_____________________________.
Qu’on veuille croire que l’auteur de ces lignes n’a aucune participation dans les nombreux et riches portefeuilles d’actions des maisons d’éditions dont il parle. Il considère simplement que s’il lui appartient de parler de poésie, donc de soutenir les derniers poètes de ce malheureux pays, il ne lui est nullement interdit de soutenir aussi ceux qui les soutiennent face au public, leurs éditeurs. / M.H.
Fin de Scalp 2 - juin / juillet / août 2012
[1] On trouvera ces citations dans leur totalité in ARAGON, Œuvres poétiques complètes, vol. I, aux pp. 822 à 829. Biblioth. De La Pléiade, NRF / Gallimard.
[2] Le Tiers Livre, ch.VI
[3] Max Pons a dédié plusieurs ouvrages au château de Bonaguil, « mon université » déclare-t-il. Entre autres : Bonaguil, château de rêve (Privat), Visiter Bonaguil (Editions Sud-Ouest), Regards sur Bonaguil (La Barbacane).
 La poésie et le sacré… décidément… Les éditions Gallimard font paraître un volume signé Kabîr dans leur belle collection de poche consacrée à la poésie, une collection qui gagnerait si je puis me permettre, et je le puis étant donné mon âge avancé, qui gagnerait maintenant – oserais-je donc – à accueillir des poètes francophones trentenaires ou quarantenaires en sus des barons du (minuscule) microcosme poétique parisien. Entendons-nous bien, je ne porte point de critique ici, considérant que des poètes comme Velter ou Deguy par exemple ont très certainement leur place dans la collection Poésie / Gallimard, aux côtés des plus importants poètes de toute l’histoire de la poésie mondiale ; je veux juste donner un avis et cet avis est qu’il s’écrit aujourd’hui, en France même, des poésies vers lesquelles un Paulhan se serait tourné. Mais n’en doutons pas, l’entrée des poètes de maintenant, ceux qui n’occupent encore aucune « position », dans le catalogue Gallimard est certainement à l’ordre du jour, ou en passe de l’être. Gallimard est un grand éditeur de poésie, réalité qui rend toute autre option que celle appelée ici de mes vœux impensable. Kabîr… De quoi s’agit-il ? D’un coup éditorial d’abord. Nous sommes de vieux singes et nous savons faire la grimace ! Bien sûr, personne ne doutera que ces textes de Kabîr découverts dans les archives de Gide par Jean-Claude Perrier méritent d’être édités. Ils le sont ici pour la première fois. Joli coup éditorial donc : imaginez un peu, des textes de Kabîr traduits par… Gide d’après la version anglaise de… Tagore. Les feux des vitrines s’embrasent. Mais qu’importe ? Il y a coup éditorial et coup éditorial, celui-ci est de toute beauté. Il porte même en lui quelque chose de chevaleresque. Cette parution est aussi et encore plus un événement poétique. Car le volume permet de découvrir les textes poétiques de Kabîr, textes d’une extraordinaire profondeur mystique et intérieure. Kabîr vivait en Inde, à Bénarès, et il était tisserand. Musulman converti à l’hindouisme, il a dû fuir et s’est mis à prêcher, voyant venir à lui nombre de disciples. Au point que sa pensée forme aujourd’hui un vaste courant religieux interne à l’hindouisme en Inde. Durant la Première Guerre Mondiale, tandis qu’il traverse une crise le conduisant presque à se convertir au catholicisme, André Gide lit la version anglaise des poèmes de Kabîr et en traduit une partie, on ne sait trop pourquoi. C’est cette traduction que propose ici Jean-Claude Perrier dans un volume qui comporte aussi l’intégralité des « poèmes » de Kabîr traduits par Henriette Mirabaud-Thorens et éditée chez Gallimard dans les années 20 du siècle passé. Lire aujourd’hui un mystique hindou du 15e siècle ne fera pas de mal en ces temps où il arrive que la poésie s’écrive parfois sous couvert de quinze mots de vocabulaire, et trop souvent pour ne rien dire d’essentiel. Ce qui ne l’empêche pas d’être primée.
La poésie et le sacré… décidément… Les éditions Gallimard font paraître un volume signé Kabîr dans leur belle collection de poche consacrée à la poésie, une collection qui gagnerait si je puis me permettre, et je le puis étant donné mon âge avancé, qui gagnerait maintenant – oserais-je donc – à accueillir des poètes francophones trentenaires ou quarantenaires en sus des barons du (minuscule) microcosme poétique parisien. Entendons-nous bien, je ne porte point de critique ici, considérant que des poètes comme Velter ou Deguy par exemple ont très certainement leur place dans la collection Poésie / Gallimard, aux côtés des plus importants poètes de toute l’histoire de la poésie mondiale ; je veux juste donner un avis et cet avis est qu’il s’écrit aujourd’hui, en France même, des poésies vers lesquelles un Paulhan se serait tourné. Mais n’en doutons pas, l’entrée des poètes de maintenant, ceux qui n’occupent encore aucune « position », dans le catalogue Gallimard est certainement à l’ordre du jour, ou en passe de l’être. Gallimard est un grand éditeur de poésie, réalité qui rend toute autre option que celle appelée ici de mes vœux impensable. Kabîr… De quoi s’agit-il ? D’un coup éditorial d’abord. Nous sommes de vieux singes et nous savons faire la grimace ! Bien sûr, personne ne doutera que ces textes de Kabîr découverts dans les archives de Gide par Jean-Claude Perrier méritent d’être édités. Ils le sont ici pour la première fois. Joli coup éditorial donc : imaginez un peu, des textes de Kabîr traduits par… Gide d’après la version anglaise de… Tagore. Les feux des vitrines s’embrasent. Mais qu’importe ? Il y a coup éditorial et coup éditorial, celui-ci est de toute beauté. Il porte même en lui quelque chose de chevaleresque. Cette parution est aussi et encore plus un événement poétique. Car le volume permet de découvrir les textes poétiques de Kabîr, textes d’une extraordinaire profondeur mystique et intérieure. Kabîr vivait en Inde, à Bénarès, et il était tisserand. Musulman converti à l’hindouisme, il a dû fuir et s’est mis à prêcher, voyant venir à lui nombre de disciples. Au point que sa pensée forme aujourd’hui un vaste courant religieux interne à l’hindouisme en Inde. Durant la Première Guerre Mondiale, tandis qu’il traverse une crise le conduisant presque à se convertir au catholicisme, André Gide lit la version anglaise des poèmes de Kabîr et en traduit une partie, on ne sait trop pourquoi. C’est cette traduction que propose ici Jean-Claude Perrier dans un volume qui comporte aussi l’intégralité des « poèmes » de Kabîr traduits par Henriette Mirabaud-Thorens et éditée chez Gallimard dans les années 20 du siècle passé. Lire aujourd’hui un mystique hindou du 15e siècle ne fera pas de mal en ces temps où il arrive que la poésie s’écrive parfois sous couvert de quinze mots de vocabulaire, et trop souvent pour ne rien dire d’essentiel. Ce qui ne l’empêche pas d’être primée.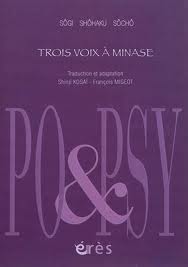 Trois voix à Minase, un renga du 15e siècle rédigé par le maître Sôgi et ses « disciples » Shôhaku et Sôchô, est un classique de la poésie, et plus généralement de la littérature japonaise. Genre ancien de la poésie japonaise, le renga atteint son apogée au 15e siècle. De quoi s’agit-il ? De l’enchaînement de versets composés à tour de rôle par plusieurs poètes travaillant au même endroit et au même moment. C’est ainsi que les trois auteurs de ces Trois voix à Minase se sont réunis à l’instigation de Sôgi pour écrire cet ensemble. Le renga obéit à des règles précises que chaque poète respecte, règles qui donnent une unité à l’ensemble. Le long poème doit commencer par un verset imprégné de la réalité environnante, le paysage souvent, puis se poursuit avec un second verset ouvrant les portes de l’imaginaire. Ensuite, chaque verset doit être lié aux précédents tout en proposant une nouvelle ouverture. On le voit, les « jeux » poétiques de l’Oulipo n’ont rien de neuf. Trois voix à Minase est un modèle du genre et en effet ce texte pénètre son lecteur en profondeur, nombre de versets étant d’une beauté sidérante :
Trois voix à Minase, un renga du 15e siècle rédigé par le maître Sôgi et ses « disciples » Shôhaku et Sôchô, est un classique de la poésie, et plus généralement de la littérature japonaise. Genre ancien de la poésie japonaise, le renga atteint son apogée au 15e siècle. De quoi s’agit-il ? De l’enchaînement de versets composés à tour de rôle par plusieurs poètes travaillant au même endroit et au même moment. C’est ainsi que les trois auteurs de ces Trois voix à Minase se sont réunis à l’instigation de Sôgi pour écrire cet ensemble. Le renga obéit à des règles précises que chaque poète respecte, règles qui donnent une unité à l’ensemble. Le long poème doit commencer par un verset imprégné de la réalité environnante, le paysage souvent, puis se poursuit avec un second verset ouvrant les portes de l’imaginaire. Ensuite, chaque verset doit être lié aux précédents tout en proposant une nouvelle ouverture. On le voit, les « jeux » poétiques de l’Oulipo n’ont rien de neuf. Trois voix à Minase est un modèle du genre et en effet ce texte pénètre son lecteur en profondeur, nombre de versets étant d’une beauté sidérante : Pierre Larcher rassemble et propose une traduction personnelle de deux poèmes préislamiques dont l’un a été adapté en allemand par Goethe, l’autre en français par Armand Robin. Il donne d’ailleurs aussi à lire les traductions de Goethe et de Robin. Ce livre, édité sous le titre de Le brigand et l’amant, est donc une vraie curiosité littéraire. Les deux poètes sont deux poètes brigands arabes préislamiques : Ta’Abbata Sharran et Imru’Al-Qays. Ce pourrait être une simple curiosité littéraire, c’est beaucoup plus que cela. Mais une curiosité littéraire tout de même puisque ces textes étaient soit peu soit non accessibles en langue française. Aussi, parce que Larcher intercale des présentations et des études sur ces poètes et leurs textes en un appareil critique de haut vol. Reste que les poèmes peuvent se lire, chacun dans les deux traductions, indépendamment de tout souci historique ou universitaire. Le brigand, ode signée Ta’Abbata Sharran, est le seul poème préislamique dont Goethe a proposé une traduction dans son West-östlicher Diwan. Son auteur est le plus connu des poètes brigands arabes préislamiques, un type considéré comme « malfaisant » si l’on en croit son surnom. Cela parle d’un homme tué dans un guet-apens et de son cri de vengeance. Violent et beau. Vient ensuite L’amant, poème de Imru’Al-Qays. Un des poètes les plus importants et célèbres du monde arabe. Un homme mystérieux qui, à l’instar d’Homère pour nous, laisse un texte dont tout un chacun ou presque connaît le début, un homme dont l’identité réelle n’est guère certaine. Le poème porte en lui un caractère mystique, discuté en partie par Pierre Larcher, accentué en son temps par Armand Robin. Il se termine ainsi :
Pierre Larcher rassemble et propose une traduction personnelle de deux poèmes préislamiques dont l’un a été adapté en allemand par Goethe, l’autre en français par Armand Robin. Il donne d’ailleurs aussi à lire les traductions de Goethe et de Robin. Ce livre, édité sous le titre de Le brigand et l’amant, est donc une vraie curiosité littéraire. Les deux poètes sont deux poètes brigands arabes préislamiques : Ta’Abbata Sharran et Imru’Al-Qays. Ce pourrait être une simple curiosité littéraire, c’est beaucoup plus que cela. Mais une curiosité littéraire tout de même puisque ces textes étaient soit peu soit non accessibles en langue française. Aussi, parce que Larcher intercale des présentations et des études sur ces poètes et leurs textes en un appareil critique de haut vol. Reste que les poèmes peuvent se lire, chacun dans les deux traductions, indépendamment de tout souci historique ou universitaire. Le brigand, ode signée Ta’Abbata Sharran, est le seul poème préislamique dont Goethe a proposé une traduction dans son West-östlicher Diwan. Son auteur est le plus connu des poètes brigands arabes préislamiques, un type considéré comme « malfaisant » si l’on en croit son surnom. Cela parle d’un homme tué dans un guet-apens et de son cri de vengeance. Violent et beau. Vient ensuite L’amant, poème de Imru’Al-Qays. Un des poètes les plus importants et célèbres du monde arabe. Un homme mystérieux qui, à l’instar d’Homère pour nous, laisse un texte dont tout un chacun ou presque connaît le début, un homme dont l’identité réelle n’est guère certaine. Le poème porte en lui un caractère mystique, discuté en partie par Pierre Larcher, accentué en son temps par Armand Robin. Il se termine ainsi :