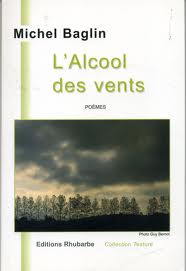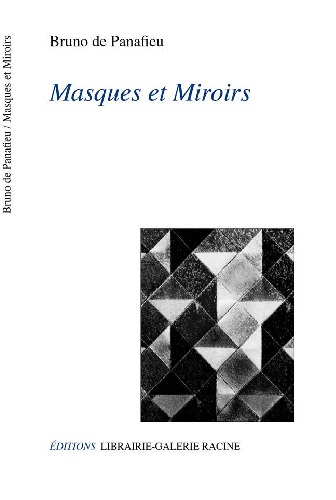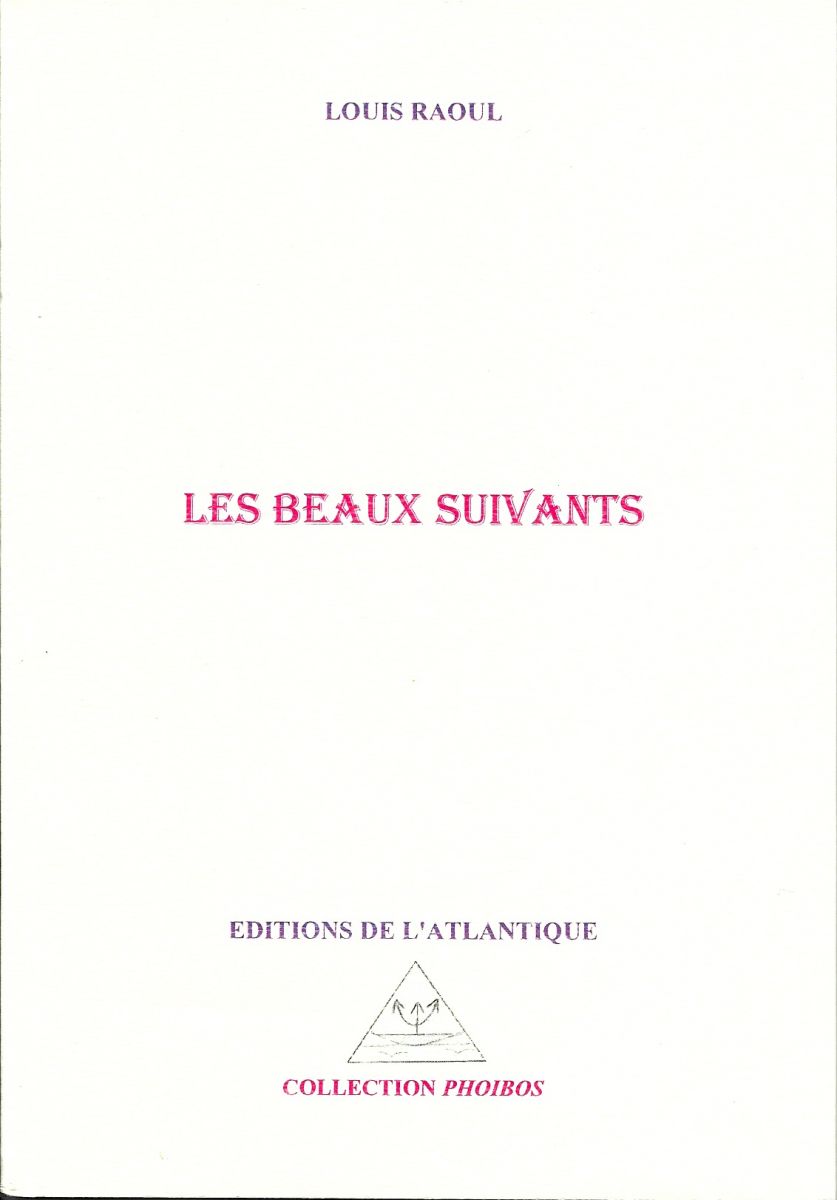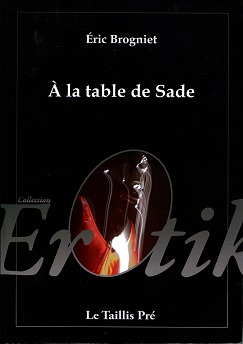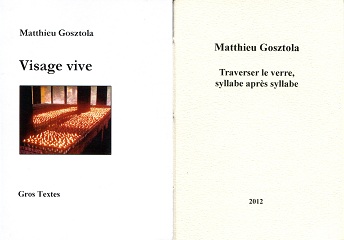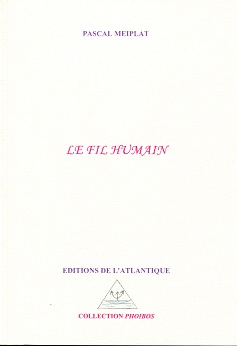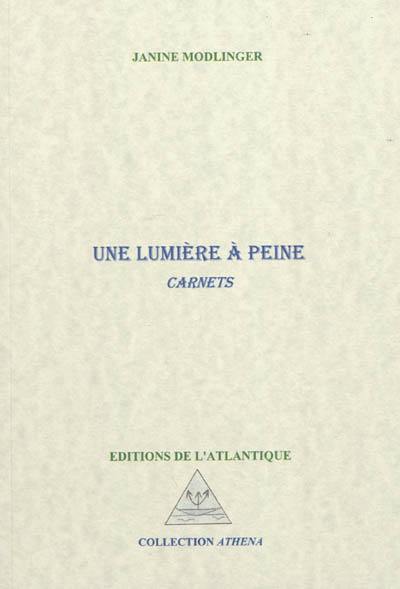Les éditions de l'Atlantique, actives éditions en matière de poésie, publient les fameuses Romancero Gitano de Garcia Lorca, cette fois traduites par Michel Host. Il existe beaucoup de traductions de ce chef d'œuvre. Et nous en avons beaucoup lu, fascinée par la beauté de ce joyau poétique hors norme. Que l'Atlantique décide d'ajouter une traduction nouvelle suscite l'intérêt. Elles n'auraient pas augmenté leur catalogue d'une proposition médiocre. Car la traduction de Michel Host est l'une des meilleures que l'on puisse lire en France. Il y a celle, impressionniste, de Line Amselem, belle dans son rendu de l'essence espagnole. Et puis il y a celle de Host.
Les Romances gitanes sont, comme l'explique le traducteur dans son préambule, une forme poétique très précise, en vers octosyllabiques assonancés aux vers pairs, eux-mêmes issus de la division d'un vers de seize syllabes. C'est le vers le plus ancien de la poésie espagnole, en usage depuis le XIème siècle.
Tradition, donc.
Mais il y aussi la dimension gitane, que nous explique Lorca lui-même : "Le livre dans son ensemble, bien qu'il s'appelle gitan, est le poème de l'Andalousie et je l'appelle gitan parce que le gitan est ce qu'il y a de plus élevé, de plus profond et de plus aristocratique dans mon pays, ce qu'il y a de plus représentatif de sa manière et ce qui préserve la braise, le sang et l'alphabet de la vérité andalouse et universelle. Ainsi donc le livre est un retable de l'Andalousie avec ses gitans, ses chevaux, ses archanges, ses planètes, avec sa douce brise juive, et sa brise romaine, avec ses fleuves, ses crimes et aussi la note vulgaire du contrebandier, et la note céleste des enfants nus de Cordoue qui jouent des tours à Saint Raphaël. (...) Et laissez-moi vous dire maintenant, c'est un livre anti-pittoresque, anti-folklorique, anti-flamenco. Où il n'est pas une veste courte ni un habit de torero, ni un seul chapeau plat ni un tambourin, un livre où les figures peuplent des fonds millénaires et où il n'est qu'un seul personnage, grand et obscur comme le ciel en été, un seul personnage qui est la Peine qui s'insinue dans la moelle des os et dans la sève des arbres, qui n'a rien à voir avec la mélancolie ni avec la nostalgie, ni aucune affliction ou malaise de l'âme, mais avec ce qui est un sentiment plus céleste que terrestre : peine andalouse qui est un combat de l'intelligence amoureuse avec le mystère qui l'entoure et qu'elle ne peut comprendre".
Tradition. Et identité.
Mais il y a aussi ce qui fait l'âme de ce chef d'œuvre séminal. Cette âme, c'est le duende qu'à reçu Lorca dans la composition de ces romances. Citant Torrès en conférence, Lorca dit : " "Tout ce qui a des sons noirs a le duende". Et il n'est pas de vérité plus grande. Ces sons noirs sont le mystère, les racines qui s'enfoncent dans le limon que nous connaissons tous, que nous ignorons tous, mais d'où nous parvient ce qui est la substance de l'art. (...) Non, Le duende dont je parle, obscur et frémissant, descend de ce démon très joyeux de Socrate, marbre et sel qui, d'indignation, le griffa le jour où il prit la ciguë, et de cet autre mélancolique petit démon de Descartes, qui tel une minuscule amande verte, las des cercles et des droites, s'en alla le long des canaux pour entendre chanter les marins ivres."
Transformer en français la beauté qui présida à la composition des Romancero gitano, depuis l'essence de la tradition jusqu'à celle de l'identité baignées par le duende, voilà ce qu'à réussi le poète Michel Host.
Federico Garcia Lorca, Romancero Gitano, suivies de Complaintes funèbre pour Ignacio Sanchez Mejias, Traduction nouvelle de l'espagnol par Michel Host, Editions de l'Atlantique, collection Hermes, 60 pages, 16 euros.
-------------------------------------------------------
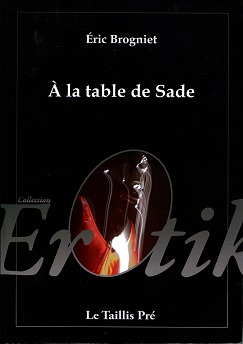
Les éditions belges Le taillis Pré viennent de publier A la table de Sade de Eric Brogniet. Autre voix, autre chemin de parole. Pour accéder à ce "territoire d'une œuvre par ailleurs toute empreinte du questionnement de la condition humaine, Brogniet met en scène le désir comme processus infini de rencontre, de dépassement de soi, de maîtrise et de liberté", nous explique la quatrième de couverture. Au titre du désir, voilà ces poèmes publiés dans la collection Erotik, et c'est alors dilater l'entendement même de ce que nous nommons érotisme pour concevoir la magie du corps aimantée par des sources créatrices de vie. C'est d'ailleurs par A la table de Sade que l'éditeur ouvre cette collection Erotik, collection dont Eric Brogniet est le directeur.
Six parties composent ce livre, ouvert par ce poème issu de Théorème de Sade :
De grands orages se préparent
Sur la table du soir
Et les panneaux anciens
Ils diffusent une lumière délicate
Le temps engendre sans coupure
Des intempéries de jardins
Des photophores lui renvoient
Son image blanc sur noir
Là où ils passent ils laissent
Des ennemis invisibles
Et bien qu'ils soient écrits
En d'autres langues
Ils nécessitent d'être brûlés
De la partie nommée Rhétorique de Sade jusqu'à la sortie Soleils des transgressions, nous abordons Mémoire aux mains nues, Conjuration des présages, Géométries de la fièvre, et Liturgies du labyrinthe.
Les étoiles sont là, métaphoriques. Les sources aussi. Et les rosées dénaturées.
C'est un climat de palmes lentes,
D'airs huilés, de laits doux,
Avec la perle au bord de la mer,
Avec l'origine du monde.
Cannelle, thé vert et ombres blanches,
Votre bouche est un quartier d'orange :
Le poisson d'or et l'anneau
Gisent au fond du lavoir
Quand le poème s'invite A la table de Sade, et la chair se fait verte.
Eric Brogniet, A la table de Sade, Le Taillis Pré, 173 pages, 16 euros.
-------------------------------------------------------
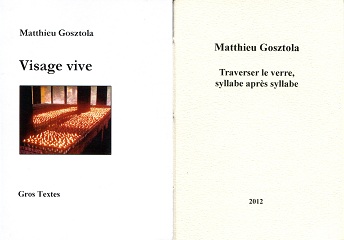
Deux livres de Matthieu Gosztola nous parviennent. L'un, Traverser le verre, syllabe après syllabe, est un poème de quelques pages, publié en édition numérotée par La Porte, recueil de la revue Poésie en voyage. Gosztola fait ici une œuvre pointilliste, de son en son, de phonème en phonème, comme murmurés, comme chuchotés pour, avec délicatesse, ne pas briser la parole comme un verre, mais la traverser comme on traverse un fleuve.
nous marchons sur la berge
avec nos souvenirs
serrés contre le corps
pendant que les arbres
prennent du ciel l'imprenable
des reflets dorment
sous une barque
Pas une seule majuscule dans ce long poème de 22 pages. La voix se fait menue, sautillant tel un geai sans poids sur la mousse du verbe.
le cerisier vient au fond des yeux
comme la neige sans le froid
la lumière de plus en plus claire
la mort devient cette intime
tout s'efface
lueur après lueur
mais ton visage
sera à jamais ce qui vient dans l'aurore
du début du milieu et de la fin du jour
C'est encore la question du visage qui mène le refrain du deuxième livre de Gosztola, Visage vive, édité par Gros Textes. Depuis Débris de tuer, livre écrit par le poète au sujet du génocide du Rwanda, nous sommes habitués à la capacité de Gosztola de déconstruire la grammaire. Un nom masculin assorti d'un adjectif féminin. Première impression, destructurante. Aussitôt corrigée par la douce injonction aussi contenue dans le titre.
Le visage est comme un blason dans la poétique de Gosztola. C'est un thème sur lequel, lancinant, il remet son métier. Quelques fragments :
A nouveau je caresse ton
Visage
Dans la pensée
*
Les visages sont dans la limite
De ce qui s'est trouvé à nu
*
Le visage est nu de mourir
Dans le silence
Il ajoute le ronron
*
Le visage est notre folie
D'être ainsi exposés
*
Nous perdons plus que la vie
Là où les visages
Nous emmènent
*
La peinture du visage n'a pas eu le
Temps
De sécher
Et telle une brodeuse Gosztola tourne et tourne encore, comme pour étoffer depuis la chair du visage les ors ineffables de la face intérieure.
Matthieu Gosztola, Traverser le verre, syllabe après syllabe, La Porte, 2012.
Matthieu Gosztola, Visage vive, Gros Textes, 92 pages, 7 euros.
-------------------------------------------------------

L'anthologie Femmes poètes du monde arabe composée par Maram al-Masri, poète syrienne, édité par Le Temps des Cerises, est passionnante. Maram al-Masri convoque dans ce beau recueil 50 femmes poètes qu'elle présente et traduit. Un travail vertigineux. Le point commun à ces 50 poètes du monde arabe ? Elles écrivent hors des sentiers battus de la tradition poétique arabe, utilisent un vocabulaire contemporain qu'elles insèrent dans des vers libres. Bref, une liberté du verbe affranchie de toute idée d'enfermement, autour de thèmes tels que l'amour, le religieux, les interdits sociaux, le désir, la dignité des femmes.
"On peut constater ces dernières années une véritable explosion de la poésie féminine arabe, sans doute favorisée par Internet et des réseaux sociaux qui font qu'il n'est plus indispensable d'avoir publié des livres pour diffuser ses poèmes", précise Marim al-Masri dans la préface.
Cette anthologie nous permet alors de traverser les pays arabes d'est en ouest, pays par pays. C'est donc de la Syrie au Maroc en passant par la Palestine que nous allons voyager. Et retranscrire trois poèmes, pour nous mettre la soif au ventre. Une anthologie passionnante.
La paix virtuelle
Nada MENZALJI (Syrie)
Cette maigre fumée
dessine sur le miroir un nuage
Aujourd'hui, comme hier, il n'y a pas de pluie
Il n'y a pas sur le ventre de la terre
une fleur pour séduire l'abeille
et le silence n'est pas digne de la prière.
Une mouche vient de terminer sa randonnée
autour du globe terrestre.
Je veux dire que par-delà des mers virtuelles
il doit y avoir des jeunes virtuels
ils sont très pris par un jeu
comme s'ils venaient de le découvrir
ses rôles sont simples :
des poitrines nues
des armées
et des balles
L'armée tire des balles
et les jeunes courent pour tomber par terre
et leurs ailes
palpitent vers le ciel
sans que soit coupé
leur long cri de liberté
*
Des jeunes en deux dimensions
ou digitaux en trois dimensions
des roses rouges sur l'asphalte d'une rue virtuelle
de grands haut-parleurs qui annoncent
la transformation des cellules
du sperme humain
en cellules de mouton
Ce mouton est menacé par l'aboiement des chiens dans les champs
alors, il mange beaucoup d'herbe
pour donner avec grand plaisir
sa chair pour le sandwich au chawarma
avec des piments doux
Mais le chat
qui a dévoré ses enfants
exerce son innocence
et poursuit la souris électronique
le crocodile vert a avalé beaucoup d'éponges
et il se pose comme un gardien devant le portail de l'ouest.
Le mouton-chawarma
n'a pas l'intention de balayer ton portail avec son souffle
et les jeunes virtuels à la poitrine nue et séduisante
sont prisonniers de ton écran
tandis que ton bon mari, sur la colline,
joue sur sa flûte
et que le troupeau de ses spermatozoïdes se met à danser
repose ton corps engraissé d'ennui
laisse reposer ta peur engraissée par ton corps
et dors, dors sur le bord de ta rivière
celle que chante la mythologie
ta rivière qui coule dans le vasque du hammam
nettoyée à l'eau de Javel
et étouffée par l'asphalte
Les mots sont renversés sur le dos
Dors, dors jusqu'à demain, ou après
après...
après...
après demain
car la Liberté-cauchemar
ce jeu de la jeunesse virtuelle ne va pas troubler ton sommeil
Elle est comme une condition nécessaire
mais non suffisante
sauf pour qui
en devient obsédé.
Le Maure
Nathalie HANDAL (Palestine)
Voici ce que je vois :
un grain de blé dans la main d'un petit garçon
pieds nus sur les routes sans nom,
qui dort dans le rêve de quelqu'un d'autre.
Un oud, un violon, une guitare,
un miroir de rosée,
un homme qui va se déshabiller
une femme qui regarde
Un voyageur
qui retourne
partout
et l'étourderie
qui échappe à elle-même.
Mektoûb, dit le Maure,
nus tenons les nuages entre nos lèvres
et nous croyons voir Dieu dans notre souffle.
Je ne suis plus là
Aïcha BASSRI (Maroc)
Je t'ai appelé
Je t'ai appelé pendant de nombreuses années
Et quand tu as dit "oui"
à l'intérieur de moi
le sens des mots était perdu.
Comme les oiseaux sont revenus
le ciel est parti.
Maram al-Masri, Femmes poètes du monde arabe, anthologie, Le Temps des Cerises, 228 pages, 116 euros.
-------------------------------------------------------
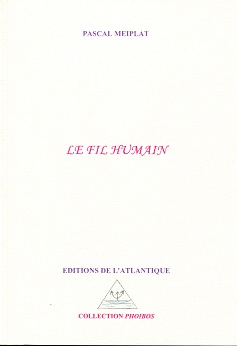
Les éditions de l'Atlantique nous offrent encore, dans leur collection Phoibos, une petite merveille. Le Fil Humain, de Pascal Meiplat, et son tirage à 250 exemplaires feront de ce fil un trait rare, et peu d'heureux mais des heureux comblés. "Ecriture dense et ramassée, parfaitement maîtrisée", nous dit son éditrice Silvaine Arabo avant d'aborder "la subtilité des états d'Etre qu'il porte et sur lesquels nous naviguons comme en haute mer"
Le premier poème nous donne la preuve de la concision extatique du poète :
Je ne laisserai pas
ton visage me traverser
sans tenter d'en retenir
de mes paumes maladroites,
qui se penche vers moi,
le frais baptême d'été.
Le livre s'ouvre par des poèmes courts, disant la force de contemplation du poète abîmé dans ce qu'il adore :
Les lèvres du temps s'entrouvrent :
la nuit n'est pas obscure
puisque
même quand je ferme les yeux
tu existes.
Cette concentration, fruit de l'extase et de l'adoration liés au verbe, dessert son coude pour qu'un souffle plus ample, de page en page, gagne la respiration de la gorge qui chante.
Un printemps de neige et de citrons
galope maintenant sous nos pas ;
ignores-tu encore que ton visage
donne forme exacte à mes rêves ?
A te voir marcher sur cette terre,
j'ai appris à ourler le réel de la clarté
profonde que dessinent ta parole,
ton ventre et ton souffle. Tu portes avec toi
la justesse du premier matin,
l'enfance qui appelle la confiance,
le sourire qu'abreuvent nos désirs.
Comment te dire sinon dans la pauvreté
de ces mots que balbutie mon impuissance ?
En toi se partagent l'approche et la distance
dans le jardin qui sera notre domaine
où vivre est le rire vertical de la lumière.
La voix, confinée au réel, fait son chemin, s'éloigne de la louange pour se risquer au recueil des images auxquelles elle donne rythme et ampleur. Jusqu'au final, qui ouvre le piège de la maison du verbe aux lèvres qui transcendent ceux qui ne portent rien :
Douceur, cesse-là de ne pas être
femme. Pris au lèvres
du néant et de la mort,
ce qui fait le vivant de nos corps
pneumatiques
cèle cela qui demeure toute énigme :
c'est toi l'instrument d'allégresse,
tant cela (ferveur ou faveur)
féconde le temps, nôtre.
Pascal Meiplat, Le fil Humain, éditions de l'Atlantique, 50 pages, 16 euros.
-------------------------------------------------------