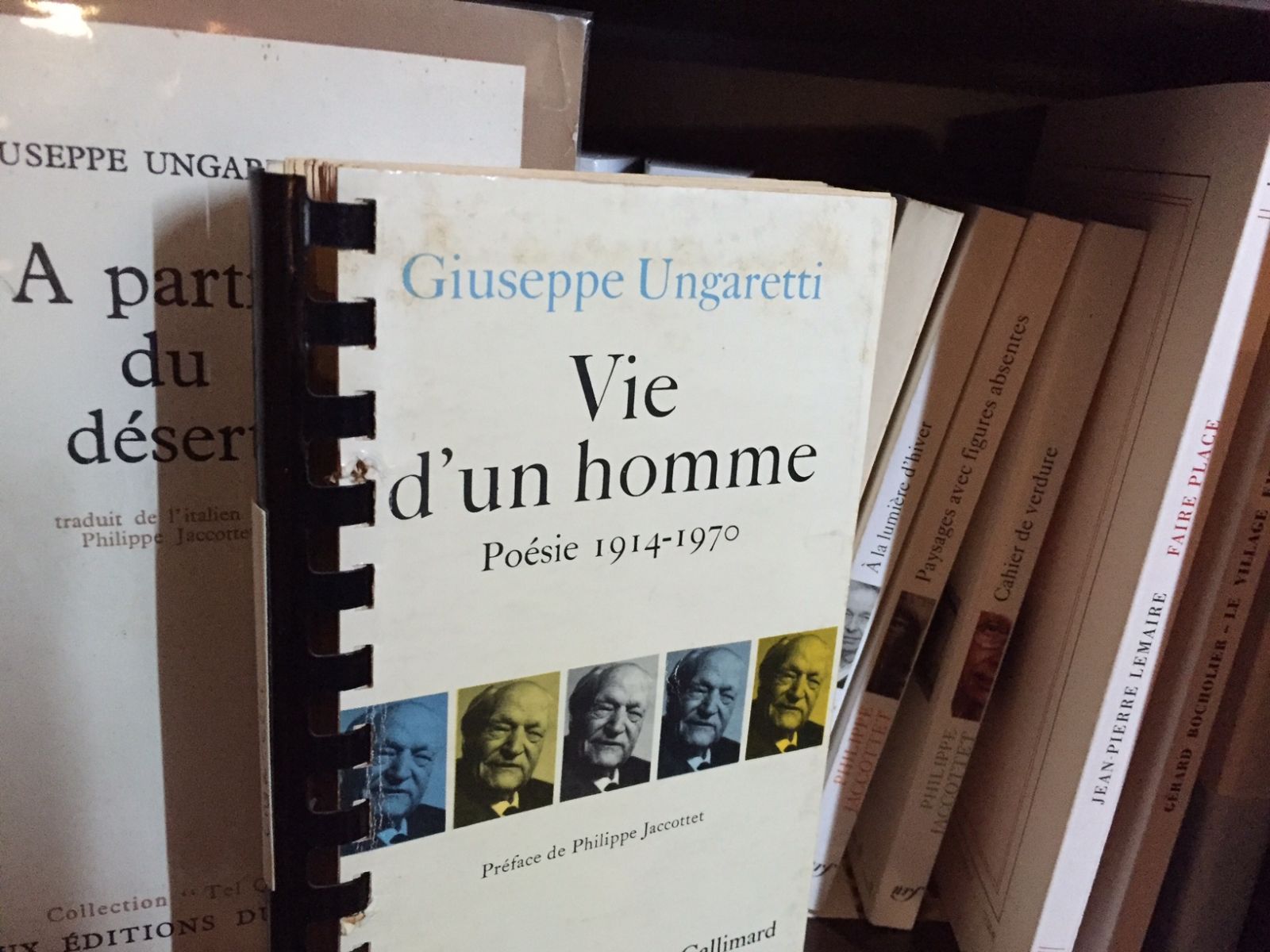« L’amitié participe de ce grand cycle naturel »
« Quand d’autres sont capables d’agir, écrire m’est une nécessité, mais c’est aussi ma façon d’appartenir à une communauté où l’homme cherche à s’identifier, lève le bras et disparaît. L’amitié participe de ce grand cycle naturel » ( extrait de Traces n° 52 – 1975)
Claude Serreau n’est pas un poète solitaire, bien que discret, il a depuis ses débuts en poésie, créé des liens solides avec des poètes et des artistes. Ces amitiés éclairent le présent :
« la terre a gardé, des amis disparus,
le rire des vergers qui éclaire la nuit » ( Réflexion pour la nuit)
Pour ce poète, la mission est de transmettre, comme Gilles Fournel et Michel-Francois Lavaur Claude Serreau est enseignant, tout comme leur poète de référence, l’instituteur de Louisfert , René Guy Cadou dont Claude Serreau dit qu’il se sent le plus proche. Claude Serreau a œuvré pour la Poésie, pas seulement pour la sienne. Il a été de toutes les actions pour la promotion de la poésie en Pays de Loire et en Bretagne. Il est bien, poète du grand Ouest qui s’étend du pays d’Olonne au pays castelbriantais : « J’ai choisi mon hérédité. Je suis de ce pays d’eaux, de terres et de vents, et des premiers hoquets de l’Océan. Je suis d’Ouest, des ports du Pays d’Olonne aux coupes forestières du Castelbriantais, du marais vendéen aux salines de Guérande, à travers les haies bocagères et les fermes isolées jusqu’à l’estuaire. »(Traces n° 52-1975)
La rencontre avec Gilles Fournel
« Le poète dont je me sens le plus proche est évidemment René Guy Cadou et mon premier texte que Gilles Fournel a publié en 1956 dans la revue Sources lui rendait hommage » ( Revue Signes n° 25)
Sylvain Chiffoleau est l’imprimeur de la revue Sources et c’est en allant chez lui que Claude Serreau fait la connaissance de Gilles Fournel et des poètes qui l’entourent : Claude Vaillant, Henry de Grandmaison, ils sont rejoints par Michel Velmans et Michel Luneau. Le comité de rédaction s’élargit à 13 collaborateurs, Claude Serreau en fait partie. Très vite la revue reçoit les encouragements des poètes de l’école de Rochefort, Marcel Béalu, Jean Bouhier, Michel Manoll, Luc Bérimont et Hélène Cadou. Dire la poésie, aller à la rencontre du public c’est la volonté de Gilles Fournel, à laquelle adhère l’équipe. Dès le numéro 3, une décision est prise, faire connaître la poésie à travers des spectacles poétiques ; Gilles Fournel a été élève du conservatoire d’art dramatique, Michel Luneau est comédien dans la troupe de Guy Parisot. Une première soirée a lieu à Rennes, le 17 mars 1956 avec au programme en première partie Rimbaud, Desnos, Lorca et Supervielle et en seconde la poésie des « sourciers ».
Sources, ce n’est pas seulement une revue, ce sont aussi des éditions, elles publieront en novembre 1957 Le vent des abîmes de Michel Manoll, illustré par Guy Bigot ; le recueil obtient le prix Laporte. Gilles Fournel est un découvreur de talent : « Je suis fier de vous avoir fait connaître des poètes aussi doués que Claude Vaillant, Joseph Rouffanche, Marcel Lebourhis, Georges Drano, Claude Serreau (…) dont j’estime que ce sont des valeurs de demain. » (éditorial Sources n°12)
Les difficultés financières ne permettront pas de maintenir la publication de la revue au-delà du numéro 11. Un changement de cap est tenté, en juillet 1958 Sources devient La revue de l’Homme Nouveau, elle fait une place au roman et au théâtre avec comme collaborateurs : Hervé Bazin, Robert Merle, Claude Roy, Charles Le Quintrec, Roger Vaillant, Robert Sabatier… Mais ceci est une autre « aventure ».
La poésie meurt, vive la poésie. Gilles Fournel cesse de publier Sources, mais le flambeau sera repris et pour 50 ans, par un jeune poète en son « lavauratoire »
Michel-François Lavaur en sa « fourbithèque » .
Une équipe naît très vite autour de Michel-François Lavaur qui sera le maître d’oeuvre d’une nouvelle revue poétique : Traces, il a le désir d’y associer les arts graphiques. Lavaur aime dessiner, il a suivi les cours de l’école des Beaux Arts de Bordeaux. Il présente ainsi la revue à la presse : « Désormais nous ferons à la poésie la place qui est sienne, objectivée en des expositions par les arts graphiques et plastiques … ». Le premier numéro de Traces paraîtra en janvier 1963 avec des poèmes de Pierre Autize, Jean Bouhier, Guy Chambelland, Jean Chatard, Georges Drano, Gilles Fournel, Jean Laroche, Michel François Lavaur, Jammes Sacré, Claude Serreau… et bien d’autres.
Claude Serreau, compagnon de la première heure, bien des années plus tard écrira un texte hommage à son ami : « Pour nous les amis des tout débuts du comité de rédaction, un bien grand mot pour une équipe plutôt fraternelle, Norbert Lelubre, Jean Laroche,nos prestigieux aînés hélas décédés, Alain Lebeau et moi-même qui restons naufragés sur ce radeau dorénavant à la dérive, Michel a été l’initiateur et le fédérateur d’une œuvre qui s’est imposée par le large accueil qu’elle offrait à tous ceux que Lavaur, jamais on ne l’appela Michel-François, jugeait dignes de figurer dans sa revue. » ( revue 7 à dire n° 66)
Claude Serreau comme il s’amuse à le dire, sera ce « buveur d’eau parmi les buveurs de muscadet ».
En 1961 M.F. Lavaur a été nommé instituteur au Pallet ; en 1962, il entre en contact avec Sylvain Chiffoleau qui lui transmet l’adresse de Claude Serreau ; en se promenant à Nantes, il avait vu à la vitrine d’une librairie, un recueil de RG.Cadou et la revue Sources, il y avait découvert des poètes dont Claude Serreau et Gilles Fournel à qui il dédicacera bien plus tard ce poème :
Ainsi donc je naquis
presque par mégarde
à la poésie des pays d’ouest
…………..
Louisfert proche et Cadou mort
je ne sais plus comment
j’allai jusqu’à Fournel
à cause d’un nom à l’occitane
et ce titre d’eaux vives
le féminin pluriel
de sa revue Sources
n’est pas sans cousinage
avec mes Traces.
(extrait de Poèmes 15 janvier 1983)
La revue Traces est réalisée par M.F.Lavaur sur une presse à manivelle, l’imprimeur Souchu à Clisson réalise la couverture, les six lettres du logo ont été dessinées par Paul Dauce. 174 numéros succèderont au premier numéro sorti en janvier 1963 ; ainsi que 178 recueils car Traces est aussi, comme Sources, une maison d’édition. Dans sa maison de Sanguèze, son « lavauratoire » ou « fourbithèque » seront publiés : M.Baglin,G.Baudry,J.Chatard,G.Cathalo, J.C.Coiffard, A.Lacouchie, N.Lelubre ,A.Lebeau, G.Lades… M.F.Lavaur sera le premier éditeur de Poèmes du pays qui a faim de Paol Keineg (1967). Paol Keineg avait concouru pour le prix de Traces en 1966, prix dont M.F.Lavaur avait eu l’idée en 1965, l’équipe « a raté » le manuscrit, ce qui fit dire à M.F. Lavaur : « Si je ne suis pas capable de repérer Keineg, ce n’est pas la peine de faire un prix ! »
Claude Serreau publiera l’essentiel de son œuvre aux éditions Traces, 10 des 14 recueils qu’il publie entre 1966 et 2010. Son premier recueil publié aux éditions Traces en 1966 Raisons élémentaires obtient le prix Théophile Briant, prix qui lui a affirmé sa place de poète. Ce titre commence par un R, en hommage à René Guy Cadou ; tous les titres des recueils de C. Serreau commenceront par cette lettre, gage de sa fidélité au poète. Claude.Serreau est présent, du premier numéro paru en janvier 1963 à l’ultime numéro « 50ans de poésie » Traces n° 176, il y souligne alors le rôle majeur de Traces dans le paysage poétique français : « Un document essentiel et un témoignage sans égale pour qui veut ou voudra connaître ce que fut en France et en particulier dans l’Ouest, au cours des cinquante dernières années une vie au service de la Poésie. »
Les actions poétiques
Pendant plus de 50 ans , depuis Sources en passant par Traces, de nombreux poètes avec Gilles Fournel et Michel François Lavaur ont eu cette volonté de toucher le public populaire, d’accroître le rayonnement de la poésie. Les « actions poétiques » nées sous l’impulsion de Gilles Fournel soutenues par N. Lelubre, J. Laroche et Claude Serreau sont prolongées par M.F. Lavaur.
Les membres de l’Académie Régence, future Académie de Bretagne, y participeront. Dès 1956, les poètes « sourciers » et l’Académie Régence collaborent à une anthologie 13 poètes du pays nantais,éditée par Sylvain Chiffoleau, Armel de Wismes en fait la présentation à la presse, madame Francine Vasse lit des poèmes de RG. Cadou et Hélène Cadou, la librairie Coiffard organise une dédicace à laquelle la majorité des auteurs participent dont Yves Cosson, Norbert Lelubre, Claude Serreau… Du 20 au 27 février 1960 la galerie Michel Colomb expose des poètes nantais parmi les participants : J. Laroche, N. Lelubre, P. Rossi, G.Voisin et Claude Serreau. Du 24 janvier au 7 février 1963, une exposition de peinture et de poésie est organisée par les amis de Traces dans le hall de Presse Océan sous le patronage de l’Académie de Bretagne, y participent : J. Bouhier, H. Cadou,Y. Cosson, G. Drano,G.Fournel, M.F. Lavaur,J.Laroche,A.Lebeau, N.Lelubre, J.Rousselot, C.Serreau, M. Velmans ; parmi les peintres P. Dauce bien sûr…
À chacun sa musique
« J’aurais aimé savoir écrire la musique elle aussi propice à l’évasion… » C. Serreau ( revue Signes n° 25)
Claude Serreau est mélomane, outre le français, il a enseigné la musique et voue une passion à l’œuvre de Jean-Sébastien Bach.
« Claude Serreau est un mélomane averti. Il nous rend une partition de haute gamme tant la mesure est exacte, la couleur sonore des images, la rythmique des vers : tout est en place quelque soit le thème. » Gilles Baudry
Le compositeur Roger Tessier s’intéresse aux rapports de la musique et de la poésie, il est un abonné fidèle de la revue 7 à dire, à laquelle collabore depuis ses début Claude Serreau ; il a découvert dans cette revue le poème inspiré de l’abbaye de Sénanque, il le choisit pour sa pièce pour contre ténor, vielle de gambe et quatre luths, crée en 2014 au conservatoire de Toulon. Roger.Tessier connaît Claude Serreau depuis les années 1970, ils se sont rencontrés lors d’un stage estival à Saint-Clar dans le Var, Roger Tessier avait demandé à Claude d’écrire un petit texte Arcanes sur lequel il avait composé une musique pour flûte à bec et petit chœur. Récemment Roger Tessier a choisi la conclusion d’un poème paru dans le recueil Retrait des rives, « et l’espace s’accroît de l’invisible errant », comme sous titre d’une pièce pour flûte. Claude Serreau compte aussi parmi ses amis musiciens, le compositeur Martial Robert qui a utilisé les titres de ses recueils pour composer War Vor une pièce de huit voix mixtes et sons fixés.
Claude Serreau pourrait se sentir bien seul aujourd’hui, car de cette belle et longue « aventure » poétique autour de Gilles Fournel et Michel-François Lavaur, il ne reste comme compagnon que le poète Alain Lebeau. Mais Claude n’est pas seul, il a toujours su créer des liens solides, se tourner vers d’autres horizons, aller à la rencontre d’équipes qui font vivre la poésie et plus particulièrement celle de l’Ouest. Il a répondu à l’appel de Jean.Marie Gilory, quand celui-ci a lancé en 2002 la revue 7 à dire ( à ce jour 64 numéros) et les éditions Sac à mots. Claude fait partie du comité de rédaction, en compagnie de J.C.Coiffard, J.P. Plaintive , M.Morillon-Carreau, E.Turki, comité qui comptait aussi Yves Cosson …
La poésie reste vivante et fraternelle à Nantes, portée par des poètes qui, comme Claude Serreau, restent fidèles à leur passion, à leurs amis, à une poésie profondément humaine, à l’image de l’œuvre de RG. Cadou.
« Merci pour vos poèmes qui m’apportent l’air de notre pays, ce pays qui n’en finit pas de nous étonner. Vous êtes un vrai poète, un jeune frère de René. » Hélène Cadou ( 6 janvier 1958). Ces mots d’Hélène n’ont pas vieilli, le « jeune poète » a aujourd’hui pris quelques rides mais il est bien un « vrai poète » qui a su porter haut la poésie en ce pays de l’Ouest et d’ailleurs.