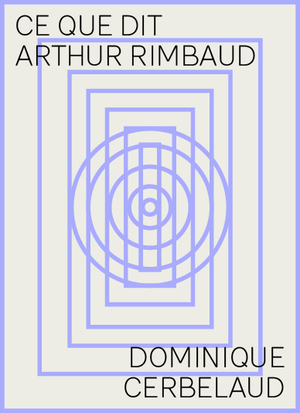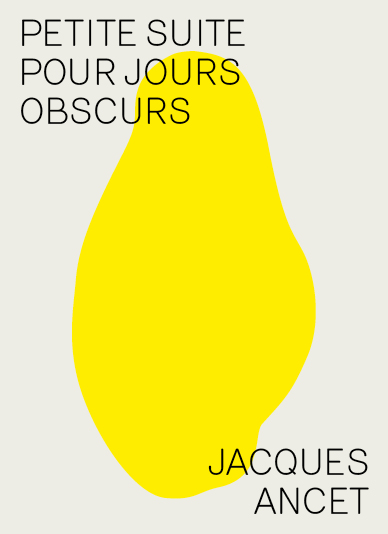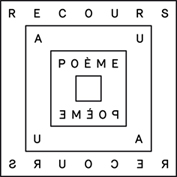-
Recours au Poème affirme l’idée d’une poésie conçue comme action politique et méta-poétique révolutionnaire : et vous ? (nous vous « autorisons » à ne pas être en accord avec nous, ou à être d’accord dans un sens diamétralement opposé au nôtre)
Il me semble tout d’abord, puisque vous m’y « autorisez » aimablement, que mon accord diamétralement opposé tient en ceci qu’idée et poésie ne font pas bon ménage. Oscar Wilde disait, à peu près ceci : qu’une idée qui n’est pas dangereuse ne mérite pas d’être appelée une idée. Il avait diablement raison. Mais, Wilde étant d’une grande légèreté, j’aimerais l’alourdir d’une salutaire mesure de Leontiev : « Toute grande idée, portée avec esprit de suite et partialité jusqu'à ses ultimes conséquences, non seulement peut devenir meurtrière, mais même suicidaire. »
C'est ce que Mikhail Boulgakov souligne si bien dans son admirable pièce Adam et Eve, la meilleure des idées (moralement) trouvera tôt ou tard son savant qui, pour la mettre en pratique, y ajoutera son arsenic...
C’est au nom des idées que Platon chasse les poètes de sa cité « idéale ». Comme le disait si justement Christian Gabriel/le Guez Ricord, le risque du poète c’est d’être nommé poète par ce monde, que le grand ON anonyme et politique dise : celui-ci est un poète, il parle aux oiseaux, il rêve, il divague, ça ne nous concerne pas…
En paraphrasant T.S. Eliot et en le complétant, très humblement, je dirais que : le poète de premier ordre à pour souci l’existence, le poète de deuxième ordre s’en détourne pour la littérature et la politique.
L’action poétique doit faire percer la « voix méconnue du réel » pour reprendre le titre de l’excellent livre de René Girard car, comme l’écrivait Malcolm de Chazal dans La Vie filtrée : « le poète est un réaliste dans le plus haut sens spirituel du terme »… Quand politique et littérature sont deux modes compatibles de fictions, les deux mamelles des civilisations qui s’élèvent sur le corps moribond de la « vie vivante » (le grand poète que fut saint Jean Chrysostome aimait à répéter cette apparente tautologie: « la vie vit » !). Elles forment, selon moi, ce que précisément, vous nommez le « simulacre », en prétendant former le corps ultime et vivant, insurpassable, de la « réalité ». En visite à Paris Anna Akhmatova écrivait alors qu'à l'époque : « la peinture avait écrasée la littérature ». Une large partie de ce qu’on nomme aujourd’hui art contemporain à depuis largement écrasé la peinture. Comme les hommes en politiques ces forfaitures s’écrasent dans une avancée perpétuelle pour s’emparer de la première place et des honneurs. Ce qu’ON nomme le progrès… Or : « si le progrès est la mort de la poésie, quel est donc le poète qui ne se rendrait pas coupable de réaction ? ». Telle est la très pertinente question de Vladimir Weidle dans Les Abeilles d’Aristée.
La poésie écrasée la première continue de vivre, car elle est (a toujours été) la plus proche de la source vive. Et dans les ultimes renversements elle sera à nouveau première, avec tous les derniers. Sans action politique…
Pour ne parler que de quelques uns de ceux pour qui j’ai une grande affection, qu’ont donc gagné ses poètes à leurs rêveries ou actions politiques, Alexandre Blok, Maïakovski, Khlebnikov, Alexandre Wat, Pier Paolo Pasolini… ? Sinon gagner pour certains un supplément d’âme à travers la souffrance…
Et Pound ? Magnifique, poète absolu… Il a choisi un camp, s’est affilié, affidé à une idéologie. Certes pour combattre des idées qui n’était pas moins laides que celles du totalitarisme italien de l’époque mais, ce faisant, il a déchu de « l’état de poésie » qui est réfractaire à tout arraisonnement.
Hölderlin écrivait : « La philosophie est un hôpital pour poète malade ! », littérature et politique en sont d’autres et de nombreux corridors obscurs les relient entre eux…
Et qu’ON ne me dise pas qu’une autre politique est possible ! Parole fausse ! Parole gONflée d’illusions, de couardise et d’hypocrisie.
Le politique gère les nécessités et les contraintes, rien qui concerne la poésie. Là où il y a nécessité il ne saurait y avoir vertu disait saint Jean Damascène. Et, bien sûr, pour le poète il ne peut s’agir de la vertu au sens platement et communément moral. Vertu au sens héroïque d’une métanoïa, d’une discipline ascétique de rédemption :
Garde le grand secret des poètes mon fils : hais la littérature. Ecris pour expier. Ecris pour éclairer. Ecris pour espérer. Ecris pour corriger ta vie. N'aie aucune indulgence littéraire pour tes péchés. Au lieu de pécher, écris. (Lanza del Vasto)
La langue politique est toujours une trahison de la poésie… Les poètes conséquents le savent, la tâche essentielle de la poésie c’est, comme le dit encore de nos jours la poétesse Nadia Tuéni, « à chaque fois recréer le langage ». Non la langue ou une langue mais le langage, le commun langage des hommes ; le divin langage unificateur, une langue universelle pacificatrice, ardemment désirée et recherchée par Khlebnikov, « alphabet de l’esprit », langue stellaire, langage exempt de tout soupçon, le langage qui nous rouvrira à la joie d’une « terre à surréel » (A. Robin) dont nous sommes exilés. Le langage usuel est une mer gelée. La poésie peut être l’art de manier la hache afin de briser cette glace !
Quand au pendant démoniaque du langage édénique ce serait le verbiage dégradé et autoritaire analysé par Zinoviev dans Les Hauteurs béantes : la langue générale universalisée… La parole fausse décryptée par Armand Robin.
Propagande, publicité, communication tous ces langages de la contrainte ont détourné les méthodes poétiques (meta-hodos, haute voie : parabole, oxymore) pour en faire des techniques, des techniques politiques. Nommer ce n’est plus dès lors faire jaillir l’étincelle de l’intelligence sensible, de l’esprit, ce n’est plus illuminer le cœur c’est, au contraire, vampiriser, épuiser la sève, le sang, la moelle… C’est bien ce que Daumal désignait comme « poésie noire ».
Révolutionnaires et contre-révolutionnaires se tiennent aux coins opposés du même mouchoir de poche. Des historiens de la Révolution française ont analysé ce qu’ils nomment les « mots masquant » de la Terreur, une des idées des Lumières étaient de créer à partir d’une langue « épurée » un langage spécifique et technique quand Joseph de Maistre dans Du Pape théorisait, lui, cette idée qui fera florès : avec les mots on peut tordre les faits afin de les conformer à une pensée spécifique… C’est aussi de cette période que date l’idée de littérature au sens moderne. Pierre Michon relève qu’avec les Lumières naît la volonté des écrivains de devenir des « abbés » laïques. C’est là la racine de cette prétention à être « auteur », c’est-à-dire a accaparer une autorité auto-proclamée. C’est un retour à une forme de sacralité, d’intouchabilité supérieure, celle des scribes et des docteurs de la loi qui étaient scandalisés par Jésus, l’analphabète qui « parlait comme ayant autorité ». Ceux-là sont, selon Denys l’Aréopagite, pathologiquement influencés par les lettres de l’alphabet, les lignes et les syllabes sans substance. Or (encore une paraphrase) : « il est vraiment insensé et inqualifiable de vouloir poétiser en prêtant son attention aux seuls mots et non à l’essence et à l’objet des termes» (saint Denys). La poésie est une écriture inspirée, fulgurance et jaillissement qui percent la croûte des récits fictifs et mensongers, elle n’est pas une « langue sacrée » mais elle n’est pas, non plus, une langue « utilitaire ». « Les lettres » ne sont ni du monde des dieux ni du monde des hommes disait encore Guez-Ricord. L’essence des mots se tient dans le monde intermédiaire, « imaginal », ‘alam al-mithâl. C'est aussi ce que la mystique juive nous apprend, le monde angélique est un immense corpus dont les divers organes sont lettres ET anges... Entre le pur alphabet des incorporels célestes (ultrastellaire) et l’alphabet des corps terrestres. Ils sont de nature angélique… Comme les anges ils sont des miroirs noétiques. Ils arpentent dans un circuit spiroïdal les espaces autour du climax divin, ils dansent un ballet de lumière quintessentielle autour du nom primordial (tel que révélé par Dante) : I
« Au pire », si vous voulez, pour être en harmonieux désaccord avec Recours au poème, je dirais que la poésie est une contrévolution angélique ! Ce n’est pas une « idée » c’est une vision (theoria) !
-
« Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve ». Cette affirmation de Hölderlin parait-elle d’actualité ?
Oui. Et plus qu’actuelle perpétuellement vraie. Le poète russe Apollon Maïkov l’exprimait ainsi (et ces vers sont ceux que Dostoïevski, autre connaisseur cordial des ténèbres où luit la lumière, aimait à dire et méditer souvent) :
Ne vois pas à l’entour que malheurs et désastres,
Plus profonde est la nuit, plus brillants sont les astres ;
Au désert est le plus grand danger, y demeurer est le plus court moyen d’être sauvé…
C’est avec des mots et des idées que le père du mensonge tente le Christ. Idées et mots de désir, de pouvoir, de subjugation, de magie, de domination… Regardons bien ce dialogue, le meurtrier depuis le commencement fait œuvre de sophiste et de publicitaire, il vante ses camelotes avec des mots luisants, il donne dans le discours, dans la logique. Les réponses cinglantes de celui qui jeûne dans le silence depuis quarante jours (et qui est LE Logos !!) sont des aphorismes, des mots cinglants, des mots d’humilité et de fidélité, des phrases d’éveil !
Pendant longtemps, pour de nombreux gnostiques, le Christ fut le Christos Angelos, le premier des anges, l’Ange du Grand Conseil, l’Ange de la Face… Alors dans cet épisode biblique nous nous trouvons face à la lutte de l’Ange de Dieu devenu homme avec l’Ange de Dieu devenu diable… Symbolos versus diabolos.
La poésie est un contact avec le cœur d’or des mots, et son expression, si tant est que cela soit possible… Et ceci à tout à voir avec le cœur de l’homme. Car, souvenons-nous bien que ce n’est pas ce qui entre par la bouche de l’homme qui le souille mais toute parole qui monte de son cœur et sort de sa bouche …
Au Ve siècle saint Macaire d’Egypte nous donne la description la plus complète et la plus juste et définitive qui soit de ce champs de bataille internel qu’est le cœur de l’homme : « officine de la justice et de l'iniquité », vase qui contient tous les vices mais aussi « Dieu, les anges, la vie, le royaume, la lumière... »
Les mots, eux, sont des toxiques…
Je connais le pouvoir des mots,
Je sais la toxine des mots.
Maïakovski
Comme tant de toxiques, leur pure essence est salvatrice !
-
« Vous pouvez vivre trois jours sans pain ; – sans poésie, jamais ; et ceux d’entre vous qui disent le contraire se trompent : ils ne se connaissent pas ». Placez-vous la poésie à la hauteur de cette pensée de Baudelaire ?
Je vous renvoie, si je puis me permettre à l’épisode du désert mentionné dans ma réponse précédente… et affirmer que je la place même Au-delà !
Dans la très belle églogue qu’il m’a fait l’honneur d’écrire pour mon premier recueil de poème, Alain Santacreu écrit ceci:
« La poïesis est une pratique d’extraction de la pensée. Son but, l’apathéia, la pureté du cœur, ouvre la voie à la contemplation spirituelle, la theoria. Le poème porte au plus haut avènement de la prière, l’art de se déprendre de cette partie passionnelle de notre âme qui nous empêche de devenir des anges. »
Ceux qui « ne se connaissent pas », les « sages », les philosophes ratiocineurs platement rationalistes nous rétorquerons sûrement par le vieil adage de « ce monde » : « qui veut faire l’ange fait la bête. » Retournons l’un des leurs pour leur affirmer qu’il vaut mieux être « un ange insatisfait qu’un porc satisfait » ! Et leur rappeler qu’ils ont choisi eux aussi l’une des légions « angéliques » puisque, selon la perspicace analyse du père Paul Florensky, Lucifer est « entendement pur »…
Pourtant, il faut l’affirmer avec José Lezama Lima : « Personne, jamais, ne peut se consacrer à la poésie. La poésie est quelque chose de plus mystérieux qu’un métier auquel on se consacre. » Et, ajoutons, plus même qu’un « sacerdoce ». Car, ainsi que le note avec une grande justesse Pacôme Thiellement dans un essai à propos de Lezama Lima : « il y a une poéticité qui dépasse de loin le seul exercice de la poésie, un état pléromatique de la poésie… que l’on ne peut atteindre que dans une rare et précieuse ascèse. En retour cette ascèse ne produit pas du vide, mais une profusion d’images vives et surprenantes. »
-
Dans L'école de la poésie, Léo Ferré chante : « La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe (...) A l'école de la poésie, on n'apprend pas. ON SE BAT ! ». Rampez-vous, ou vous battez-vous ?
Il y a là, à mon sens, un terrible mésusage des mots… Mais, que faire ? Déjà L’Ecclésiaste statut sur le fait qu’il est des domaines où les mots sont usés… Ferré parle ici le langage de l’individu. Or, comme le disait l’excellent Jean Carteret : « l’individu n’est que la constipation de l’être ». T.S. Eliot lui disait, en substance, ceci : la poésie n’a rien à voir avec l’émotion ou la personnalité, elle est un échappement hors de l’émotion et de la personnalité. Aussi n’est-il donné de la connaître qu’à ceux qui savent ce que sont l’émotion et la personnalité et ce que signifie s’en échapper. Aucun lien avec l’individu si ce n’est à l’image du lien entre une matière livrée aux flammes et la fumée qui monte au ciel.
Qu’est-ce donc que la poésie contemporaine ? Contemporaine de qui et de quoi ? Du grand « manie - tout » globalisé, du doux commerce et de son sabir anglo-technique, des guerres « propres » et des alibis écolo-nomiques ? « Le temps ricane entre nos mots, toutes nos paroles s’affolent » disait Armand Robin. Le poète conséquent est bien plus contemporain de Bertran de Born, de Pound ou de Nerval que de « son » époque. Ossip Mandelstam questionnant Dante. Suarès évoquant l’expérience de sa « rencontre » avec Dostoïevski… En « état de poésie » il n’y a ni passé ni avenir mais une éternelle hémorragie de présent pour le dire avec les mots de Christian Bobin.
« Je en suis pas « avant », je ne suis pas « pendant », je ne suis pas « après ». Je suis nomade et non-contemporain. Je suis avec vous tous, mais en nuée » (A. Robin) dit le poète… Et Léon Bloy d’ajouter : « je ne suis pas un contemporain et je n’ai jamais été chez moi. Alors… Zut ! »
Le poète engagé, donc contemporain lui, est déjà littéraire (enragé). Anecdote révélatrice : Sovriémiennik, « Le Contemporain », journal fondé par Nekrassov est sans doute le premier à porter ce titre… En son sein, les poètes engagés ont semé tous les germes de l’alchimie totalitaire, ces trichines microscopiques d’une espèce inconnue jusque là et qui étaient « des esprits doués d’intelligence et de volontés », ainsi que l’intuition le révélait à Dostoïevski. C’est ce mode de contamination qui est également suggéré dans le texte d’une belle et crépusculaire sauvagerie poétique de Witkievitcz, L’Inassouvissement.
Je pourrais renvoyer encore à T.S. Eliot cité plus haut ou bien le dire avec Daumal : « Ici petit poète, évoquant, libéré selon le rythme, là Grand Poète, provoquant, libre selon le Mot Total. »
Il y aurait une « poésie de combat » ? Je crois, malheureusement, qu’il en est alors comme de tous ces ridicules « gouvernements de combat » qui se succèdent et qui, en définitive, ne combattent qu’une seule chose : la vérité.
Et « l’école de la poésie » ? Sise à quelle adresse ? Et contre qui devrions-nous donc nous battre ? Qui désignera l’ennemi à abattre ? Les vertueux professeurs professant doctement ? S’il faut, tout de même, filer la métaphore guerrière suivons donc Daumal, encore :
« Et moi qui n’ai pas d’autre arme, dans le monde de César, que la parole, moi qui n’ai pas d’autre monnaie dans le monde de César, que des mots, parlerai-je ? Je parlerai pour m’appeler à la guerre sainte. Je parlerai pour dénoncer les traîtres que j’ai nourris. Je parlerai pour que mes paroles fassent honte à mes actions, jusqu’au jour où une paix cuirassée de tonnerre régnera dans la chambre de l’éternel vainqueur. » (La Guerre sainte)
Le même écrivait (et incidemment professait qu’il n’y a pas en poésie d’enseignement, si ce n’est intérieur):
« Je ne suis pas venu au monde
Pour combattre mon ombre,
Ni pour trouver un jour mes poings
Becquetés par les faisans. »
(La Nausée d’être)
C’est ce que je poétise personnellement en « bataille internelle » et que j’illustre par les paroles de Carlo Michaelstaeter : « guerre aux mots par les mots » !
Ramper ou se battre ? Y-a-t-il jamais eu poème plus renversant, plus saisissant que la prière de la victime pour son bourreau ? Poème basé sur cet unique modèle : « Père, pardonne leur parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font »… Ce chant psalmique est celui de l’eso-anthropos dans le cœur. L’individu en est incapable.
Là, ça rampe ou ça se bat ?
Sont-ce bien les termes du « débat » ?
Si, en état de poésie le poète se bat, c’est alors, et seulement, le combat avec l’ange…
-
Une question double, pour terminer : Pourquoi des poètes (Heidegger) ? En prolongement de la belle phrase (détournée) de Bernanos : la poésie, pour quoi faire ?
Il semblerait qu'avançant en terme de connaissances et de savoirs purement rationnels et factuels nous ayons perdu de vue le sens de ce qu'est ontologiquement la poésie, aussi subtilement intelligent soyons-nous.
Que la première partie de la question émane d’un philosophe (poète malade selon Hölderlin, « de la peste » selon Haldas) qui s’est accommodé de régimes politiques fort variés tout au long de sa carrière ne me surprend pas et éclaire, partiellement, ce que je tentais d’exposer dans ma première réponse. En forme de boutade je pourrais répondre : « pour désosser les philosophes » (R. Daumal) et retourner la question : désormais, pourquoi des philosophes ? Pour servir d’alibi aux émoluments d’universitaires (populaires, ou pas…) en mal d’audience et pour fourbir les mots ensorcelés de concepts mortifères aux politiques et publicitaires de tout poil ?
Laissons la question s’évaporer dans l’air délétère des vaines cogitations et, sans laisser advenir nulle oiseuse réponse, poursuivons…
Le grec poïesis signifie faire. La poésie est faire, mais un faire qui ne se limite pas à l'acte, qui le précède et l'excède. Le poète est celui qui échappe à l'idolâtrie du faire (comme produire-reproduire), de l'acte, de l'événement. La poésie n’est pas téléologique mais eschatologique. Et l’eschaton est là. Le « changement c’est maintenant » ? Non. Pitoyable ! C’est un retournement ridicule et maléfique de la réalité inscrite dans l’Evangile de saint Jacques : « Le jugement est maintenant. »
La Création appartient à Dieu, qui est le seul « auteur », étymologiquement celui qui à l'autorité. Les scribes et les docteurs, « ceux de la lettre », usurpateurs de l'autorité, sont saisis par la puissance véridique du Verbe de Dieu incarné en un homme qui devait, selon les déterminismes de « ce monde » être un ignorant. Or, il parlait « comme ayant autorité ». Le poète est celui qui remonte à l'arkhei non pour concurrencer Dieu et se faire « dieu » ayant autorité mais pour seconder l'oeuvre, il est, ainsi que l'affirmait Tolkien, « créateur en second ». Le poète est l’ignorant… Le voyant-aveugle, aveugle comme l’est l’amour puisque amor ipse intellectus. Une poésie « révolutionnaire », réellement, c’est celle qui peut faire retour au langage originel, à l’or pur des mots, au dire-de-Dieu. « Le silence est la demeure du verbe. Le silence donne de la force et du fruit au verbe. Nous pouvons même dire que les mots sont faits pour découvrir le mystère du silence d’où ils viennent. » (Henri Nouwen).
Il faut enjamber et Babel et la Chute, échapper à l’épée flamboyante de l’ange et conquérir l’état d’avant le bois de la connaissance… « Le monde défait par le verbe sera aussi sauvé par le Verbe » (Merejkovsky). Il s’agit bien de « salut » : « Dès qu’un mot se révèle cadavre, les hommes qui ne dorment pas doivent se sauver de lui. » (A. Robin), de désenvoûtement, d’échapper au pouvoir ensorcelant de la langue (Wittgenstein).