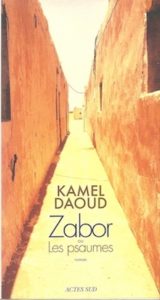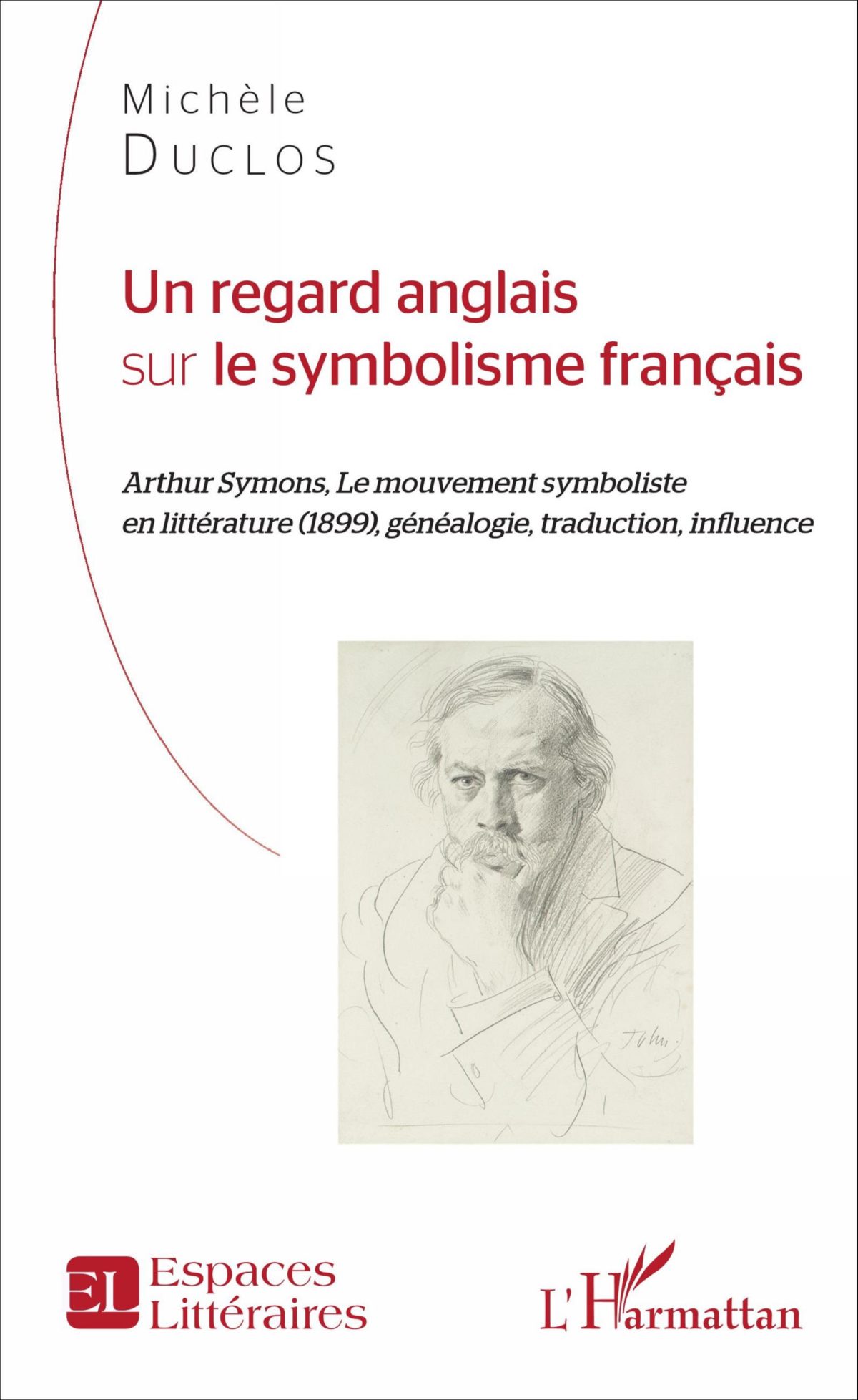Elie-Charles Flamand ! Voici un nom qui n’aurait pas dû passer inaperçu, d’autant plus que Charles Flamand (né le 25 décembre 1928) devenait frère en écriture d’un prophète sensible, à qui Dieu en personne sut manifester sa présence par le murmure du vent. Comme il le rappelle lui-même, le nom d’Elie «exprime le feu divin et l’illumination qu’il confère »[1]. Son nom d’écrivain inclut le feu secret. qui surgit en flammes visibles. Son signe astral le prédispose, en bon natif du Capricorne, à de secrètes et profondes études, creusant seul l’intérieur du minerai. Le jour même de sa naissance, la célébration de l’enfant divin, sauveur de l’humanité, ne laisse pas d’être troublante non plus, pour un être soucieux de ne jamais abdiquer devant l’innommable, habité par une certaine innocence qui le rendait, de son propre aveu, rétif à une prédilection pour le noir et pour le « mal » qui trouvait place dans le groupe surréaliste. Tout au contraire, il semble être resté sensible au symbolisme de l’Etoile qui guide les Rois terrestres, et comme nimbé dans la lumière d’une miraculeuse naissance.
Ce que nous savons d’un tel être d’exception est peu de choses au regard de l’oeuvre poétique, et c’est bien celle-là que nous avons rencontrée en sa personne, quinze ans plus tôt, par le hasard électif d’une fontaine ensoleillée au mois de juin 1990, Place Saint-Sulpice. Entre les baraques peintes en vert et investies par les éditeurs de poésie, non loin du Soleil des Loups de Jean Chatard et des Editions du Soleil Natal, se trouvait Elie-Charles Flamand, qui me fut présenté par Jacques Simonomis. Je ne voudrais pas alarmer sa modestie native, ni extrapoler la réalité du souvenir, mais voici l’un des rares endroits où il m’a été donné de rencontrer le poète à l’air libre. En dehors d’une fugitive apparition dans quelque galerie du VIème arrondissement, en compagnie d’Obéline, qui l’accompagne si bien de ses volutes géométriques, et qui pratique la peinture et le dessin comme un art du perfectionnement intérieur, exactement comme Elie-Charles pratique la poésie, cet endroit merveilleux est bien à l’origine de nos rencontres.
Sa présence là avait pour moi quelque chose de miraculeux qui tenait à la manière digne dont il se tenait dans le flot d’une agitation vulgaire, bloc erratique, monolithe chu comme d’une autre planète et d’un autre temps. Cette impression tenait sans doute à une politesse courtoise qui abolissait les époques, tenait la main à Gérard de Nerval et à Villiers de l’Isle-Adam, et ramenait plus près de nous aux années où André Breton arpentait avec ses fidèles un Paris qui semblait être devenu la chasse gardée de leurs évolutions rêveuses.
Encore récemment, je le rencontrais devant les Editions du Nouvel Athanor de Jean-Luc Maxence, porté par le flot puissant des badauds, non sans quelque pincement de coeur devant sa silhouette reconnaissable entre toutes. Sa voix douce disait la gentillesse d’un accueil qui ne s’est jamais démenti, et j’admirais le naturel avec lequel il savait porter les pierres, non pour le plaisir d’un vain ornement, mais pour la connaissance qu’il avait de leurs propriétés curatives et talismaniques, et aussi pour le symbolisme de leurs formes posées à plat en pendentif autour de son cou, ou montées en broche, brillant aussi d’un feu secret sur ses doigts. Sa pâleur aussi me disait combien cet être était fragile, et sa vie m’est devenue insensiblement précieuse, au fil des rencontres qui eurent pour cadre ses domiciles successifs de la rue de Châtillon, puis de la rue des Annelets. Son premier logement était situé non loin de celui de Pierre-Jean Jouve, sans pour autant rendre les contacts plus aisés. La rue était, en retrait de grands axes routiers, comme un miracle de silence. Le second le place d’emblée dans un cadre de recueillement spirituel, en surplomb de la ville, puisque la rue de Palestine se jette dans la rue des Solitaires, laquelle donne enfin accès aux Annelets :
Nous ne forgerons plus que de fluides anneaux de joie [2]
(Sur une statue oscillante de Takis)
La géographie du Paris des surréalistes, si essentielle pour comprendre l’oeuvre du premier Aragon, celle de Robert Desnos, ou celle d’André Breton, importe moins ici que sa coïncidence avec des strates plus anciennes, parfois éventrées, comme la boutique de Nicolas Flamel, mais parfois encore presque intactes, comme la Tour Saint Jacques, qui dresse encore sa masse d’évidence alchimique au-dessus de territoires urbains trépidants où se négocie la chair, la culture moderne et les mille et un accessoires inutiles de la mode[3]. Aux environs de l’Hôtel de Ville, du quartier de l’église Saint-Merri, certainement, et encore sur le boulevard Saint-Michel, avec ses milliers de livres vendus à l’encan, faute d’être un flâneur accompli, il ne m’a pas été donné de le rencontrer, sinon sur le mode de la rêverie. Avant le changement considérable de la forme d’une ville comme Paris, ce type de rencontre était encore opératoire, et presque le seul valable. C’est ainsi que les Puces de Clignancourt pouvaient réunir, dans une commune passion pour l’objet singulier, des esprits singuliers comme ceux de Breton, Mandiargues ou Flamand. C’était une manière informelle de pouvoir discuter en mouvement.
L’Immuable et l’Envol [4]s’ouvre en frontispice sur la photographie de l’un de ces anciens mascarons du Pont-Neuf scellés dans le muret de soutènement qui ceinture le square du Vert Galant. Cette photographie de l’auteur curieux du Paris secret donne la clé du titre de ce recueil. C’est un bon exemple de l’imprégnation de l’esprit du poète par l’archéologie spirituelle de l’ancienne capitale.
Dans le second numéro de la revue Le Surréalisme, même, c’est du nom de Charles Flamand qu’il signe un bref article sur « l’énigme des plombs de Seine ».
Nous sommes en 1957, et le groupe surréaliste est pleinement ouvert à toutes les aventures de l’esprit, accueillant ici en outre Jean Markale, et une grande curiosité pour le passé de la civilisation occidentale s’y manifeste.
Pour autant, Elie-Charles Flamand n’était pas un parisien au même titre que ses illustres pairs surréalistes. D’origine lyonnaise, il monta à Paris en 1950 non sans quelques allers-retours, et y transféra son existence. Il entre alors dans une vie de bohème décrite non sans humour dans son avant-dernier ouvrage, Les Méandres du sens[5]. Il a vingt-deux ans, et signe, trois ans plus tard, un ensemble de poèmes remarquables à plusieurs égards, intitulés « A un oiseau de houille perché sur la plus haute branche du feu ». Ces poèmes, au-delà de leur dimension proprement spirituelle, nous renseignent précieusement sur l’état d’esprit d’un jeune poète qui vient de rencontrer André Breton après avoir connu de toutes autres expériences.
Parmi celles-ci, l’étude des minéraux, et d’une manière générale, un grand attrait pour les sciences naturelles, vient nourrir l’émergence d’une préoccupation autre, proprement artistique, et poétique. L’étude des pierres et des fossiles conduit sans doute à un souci de précision dans l’expression, et le regard posé sur les objets du monde matériel est tout autre que celui de la plupart des poètes. Pour lui, la poésie ne sera certainement pas un divertissement, mais bien la continuation de ses premières recherches scientifiques par d’autres moyens, dans le souci d’une plus grande connaissance[6]. Ainsi, lorsqu’il évoque le souvenir d’une visite capitale effectuée au musée de Montbrison, et la collection de Jean-Baptiste d’Allard, c’est pour constater aussitôt que cette Wunderkammer, loin d’être un simple musée de sciences naturelles, était « un point d’appui permettant d’atteindre le sacré épars dans l’univers », et qu’en outre, cette collection laissait « une place importante à l’insolite, au mystère, à l’exceptionnel, à l’imaginaire »[7]. Accroître l’acuité de sa perception de l’univers, tel semble être le voeu souvent manifesté dans son oeuvre. Suivant la théorie médiévale d’une corrélation entre microcosme et macrocosme, le souci général de percer à jour une partie du mystère de l’univers rejoint celui d’une meilleure connaissance de soi. Extérieur et intérieur se rejoignent dans le meilleur des cas, suivant une coïncidence des opposés. Et le lieu de cette coïncidence ne pouvait être que la poésie.
Pourtant, la visite inaugurale au Château de la Bastie d’Urfé, dont les étapes rythment les premières pages des Méandres du sens, indique clairement la nature du seuil, qui est alchimique.
Ces deux termes, poésie et alchimie, ont souvent été croisés par les lecteurs d’Elie-Charles Flamand. Sans entrer dans les nuances de cette question, nous pouvons retenir l’idée d’une quête complémentaire, et parfois souvent d’une coïncidence dans l’esprit, qui est celui de la quête, de l’élevation et de la transfomation intérieure. Au fond, n’est-ce pas à cette aune que l’auteur mesure ses relations avec le monde ? Les relations entretenues par la poésie et l’alchimie n’ont rien de normatif, ou de didactique. Hermès guide vers la poésie hermétique, et la rencontre avec les surréalistes dans les années 50 correspond à celle de René Alleau, Eugène Canseliet ou Robert Amadou. Dans les deux cas, le constat est le même : seule une infime partie du réel est perçue et exprimée par les arts. C’est toute la distance qui sépare la Spagyrie (ou ancêtre de la chimie moderne) de l’alchimie, dans les mauvais conseils de Maître Anseaulme à Nicolas Flamel[8]. Finalement, les surréalistes visaient à élargir la perception du réel, par tous les moyens, y compris les moyens traditionnels. Un socle, une base manquait à l’appel, et la vie humaine paraissait singulièrement appauvrie dans la plénitude de ses vocations. Il s’agissait dès lors de signaler les fugitives résurgences du vrai. D’où ce moment capital du surréalisme, et qui a duré quelques décennies tout de même, où une lecture ésotérique du monde était à l’honneur. A cet égard, Elie-Charles Flamand arrivait à point nommé, et dans l’histoire du surréalisme, et dans l’accomplissement de sa propre trajectoire. Le domaine alchimique fut pour l’auteur ce qu’il fut au dramaturge et poète irlandais, W.B. Yeats : un accompagnement quotidien. Il ne nous appartient pas de juger du résultat tangible d’une quête psychique par la voie des mots et des signes. Il ne s’agit pas de comparer Elie-Charles Flamand et Nicolas Flamel , Obéline et Pernelle. Pourtant, une certaine parenté existe entre alchimistes et lecteurs de livres alchimiques. Et d’ailleurs, ne faut-il pas comprendre la transmutation du plomb en or comme le perfectionnement des facultés de son esprit et de son âme ? Naturellement, le poète nous indique quelques représentations symboliques de sa quête alchimique. Le réel est profondément réélaboré, comme il est aisé de le comprendre lorsque parfois le référent réel de tel ou tel poème est mentionné par une date ou par un lieu. Le surréalisme lui rappelle en outre la gravité de l’opération poétique, dont il ne faut pas démériter par un abus d’ornementation ou de frivolité. Pratiquée avec scrupules, la poésie peut devenir au contraire un moyen de libération. Plusieurs types de relation entre poésie et alchimie ont pu être répertoriés[9], mais aucun ne correspond vraiment à la pratique personnelle de notre auteur. En aucune manière la poésie ne saurait être la servante de l’alchimie. Plutôt, la poésie procède de la même manière que l’alchimie : elle permet la transformation de l’être, suivant une voie solitaire et hiérophanique.
Percevoir la poésie comme un emportement spirituel ne fut sans doute pas une attitude complètement en phase avec les fréquents raidissements du groupe surréaliste sur des positions athées, d’une violence à la mesure du danger croissant d’assimilation à diverses doctrines religieuses. En dehors de cet écart croissant entre l’orthodoxie et la pratique individuelle, et avec pour environnement inspirant l’hermétisme alchimique, cette poésie pouvait se déployer dans une certaine indépendance, nécessaire à la beauté authentique :
« ...mon très cher ami Elie-Charles Flamand dont les évolutions au large » sont « toujours si harmonieuses (que je compare à celle du dauphin) »...[10]
Une rupture interviendra par la suite sous forme de lettre collective lui reprochant un goût excessif pour l’ésotérisme, mais cette exclusion, il la prendra avec humour. Elle marque une prise de distance, ou un déplacement solitaire vers d’autres buts qui dépassent l’action collective. Entre 1952 et 1960, la personnalité d’André Breton, et diverses amitiés, dont celle de Toyen, ou d’Edouard Jaguer, entre autres, auront affermi son propre parcours.
Voici un être qui suit les étapes d’un chemin intérieur et sait les décrire dans une langue qui n’est pas celle d’un suiveur de la poétique surréaliste. Il a su rassembler les éléments autrement épars de son itinéraire mental, sans tomber pour autant dans une oeuvre intellectualiste. Elie-Charles Flamand, ce serait la quête métaphysique devenue sensible par la médiation du travail poétique.
Frappant à cet égard est le lexique employé pour décrire une attitude qui serait celle du poète, attitude particulière de celui qui subit une initiation : c’est un mélange de ferveur, de recueillement et de silence, comme dans l’attente d’un événement majeur. Ainsi, le poète doit oublier son propre être, faire le désert en lui, et déchiffrer le réel qui s’offre à lui. Le déplacement, quand bien même il prendrait appui sur des paysages et sur des expériences réelles, reste un déplacement intérieur. Ce qui n’exclut pas la présence de nombreuses descriptions fortement imagées, d’une géographie et d’une météorologie particulières. Un paysage intérieur existe, et ce dernier appelle une navigation périlleuse, comme l’orientation d’un être à l’intérieur du labyrinthe. Dans un entretien donné en 1993[11], l’auteur s’est lui-même expliqué sur les lieux intérieurs sollicités. Il distingue plusieurs niveaux dans la profondeur de la psyché : un inconscient inférieur, primitif et régressif, dit subconcient ; un inconscient supérieur, ou surconscient, qui abrite les énergies spirituelles, et la part du divin en l’homme. La voix spirituelle devra être captée par le poète. Cette sélection parmi les voix internes appellera naturellement une figuration sur le mode de la connaissance par les gouffres, suivie par une difficile ascension. Et c’est peut-être ce mode opératoire dans les profondeurs de l’esprit humain qui est figuré en poésie par un déplacement symbolique qui emprunte aussi à une tradition descriptive venue notamment du moyen âge.
Ce déplacement ne va pas sans danger, mais il possède aussi ses paradoxes, comme celui d’échapper au temps. Le cycle temporel de la mort et de la renaissance, se développe, accompagné par une métamorphose de l’être.
Dans ce mouvement dynamique, le poète n’est pas seul : le lecteur l’accompagne pas à pas. En effet, celui-ci, sans bien mesurer la nature de l’opération en jeu, perçoit intuitivement le déroulement d’une quête, et y participe activement, par ricochet. La transformation n’est pas forcément spectaculaire. Simplement, la perception du réel semble devenir plus intense, plus fine aussi.
Dans la quête de l’unité, la présence de l’unique peut se manifester de manière plus intense, ou bien c’est la réceptivité qui s’est accrue. Un lecteur familier du modus operandi alchimique pourra certainement repérer les allusions à une révélation inscrite dans un langage hermétique.
Différentes étapes du Grand Oeuvre peuvent trouver une correspondance dans les mouvements du poème. Un certain nombre de symboles alchimiques apparaissent, notamment les qualités occultes des pierres. Mais dans l’ensemble, c’est le travail poétique de la matière des mots qui importe plus qu’une révélation cryptée. L’oeuvre alchimique reste hypothétique quand l’oeuvre poétique, la fameuse alchimie du verbe, manifeste très clairement sa présence. A la poésie reviendra la fonction de transmettre une expérience d’ordre spirituel. Et c’est pourquoi l’oeuvre poétique épouse la courbe d’une existence adonnée à un travail opiniâtre : comment faire coïncider la force spirituelle des mots et l’intensité d’une expérience intérieure ? Parmi les mots majestueux, les vocables grandioses que l’auteur convoque parfois, il faudra veiller à retenir ceux qui possèdent un autre sens, précisément dans une dimension alchimique. Le rythme au pouvoir incantatoire, la recherche de métaphores adéquates, entreront à leur tour dans l’opération poétique à laquelle l’auteur voue la majeure partie de sa vie.
Nous voudrions à présent parcourir à grandes enjambées une partie de son oeuvre, qui est d’ordre poétique, afin de mieux percevoir comment se développe une sensibilité sismographique. C’est un parcours biographique autant que poétique que marque, comme autant d’étapes, chacun des recueils publiés.
Le premier recueil, A un Oiseau de houille perché sur la plus haute branche du feu, sera publié en 1957, chez Henneuse, éditeur lyonnais, en grand format de lama bleu, avec en bandeaux des dessins noirs de Toyen. Ce titre, qui pourrait passer pour surréaliste, ne l’est que par accentuation poétique de la chouette noire décrite en 1652 dans le Trésor du vieillard des pyramides. L’ermite est « à flanc de souffrance », pris dans une expérience au noir pour accéder à l’or. Ces cinq poèmes brillent de tous leurs feux dans une imagination née de l’attention portée à la merveille naturelle, comme les inclusions rêvées dans l’agate d’un oiseau, ou comme « la rivière aux galets d’escarboucle ». Le jeune poète n’hésite pas à suggérer la réunion des contraires et la résolution dialectique du réel par une série d’images baroques qui associent feu et glace, descente et montée, lumière et ombre, crépuscule et aube. Parallèlement, un itinéraire initiatique est décrit dans les termes merveilleux du conte de fées ou du roman de chevalerie : passerelle, palais ensablé, tour, château en flammes, grotte, jardin secret, coffre et clé. Le réel est transfiguré par l’association métaphorique d’éléments comme « bec de flamme », « armure de sel », « l’éblouissante goutte de nuit ». En somme, le jeune poète dédouble le réseau d’images baroques ou surréalistes en suivant une trame proprement initiatique. Quel plus beau recueil rêver pour entrer en poésie ?
Un livre récemment édité vient compléter ce moment de son existence. Fait exceptionnel, c’est un récit daté du mois d’août 1958, à Saint-Cirq Lapopie. Sur les pas de la fille du soleil eut pour premier lecteur André Breton lui-même, et finalement, le récit attendra quarante-quatre années pour paraître au grand jour. Non sans quelque hésitation, l’auteur le donna à publier, peut-être en raison d’une profusion d’événements tels qu’on les voit parfois en rêve. En effet, le héros, René Sol, suit les péripéties d’un rêve prophétique, où une simple porte ouvre vers l’inconnu. On y retrouve un trajet dans l’obscur, et l’alternance d’une voix intérieure avec une voix narrative plus objective en apparence rend compte des péripéties du voyage, descente à l’intérieur de la terre à la manière sublime des héros de E.P.Jacobs perçant l’énigme de l’Atlantide à partir d’une mine d’orichalque. Cette référence, qui pourrait sembler hors de propos, était, sans que je le sache, l’une de celles de l’auteur, admirateur d’un E.P. Jacobs curieux des énigmes de l’univers et tournant un esprit scientifique vers les hypothèses les plus audacieuses. Ce récit, qui abonde en trouvailles narratives, comme une clé révélée à l’intérieur d’un brasier, ou une pierre qui devient une « lampe perpétuelle », est tout entier centré sur la figure séduisante d’une fugitive, que le héros finit par rejoindre, au terme d’une ascension, comme s’il se brûlait au feu du soleil et dans l’ardeur de son propre amour. L’importance du thème de l’amour comme transmutation du corps et envoûtement de l’esprit, rendant l’être audacieux, et insouciant de sa propre sécurité, durent séduire le maître du surréalisme, tout comme la confiance accordée à la voix de l’inconscient. Dans ce récit fondé sur un rêve, la part belle est faite à une poésie visuelle, à un art visionnaire qui sera la marque de très nombreux poèmes.
La dimension érotique de l’oeuvre de cet auteur n’est pas directement perceptible, puisqu’il s’agit le plus souvent d’un amour sublimé, où le charnel produit du spirituel. Cependant, la question de l’érotisme est bien au coeur de l’alchimie, dans sa symbolique des couleurs, passant par le rouge, dans les opérations même de combustion, ou de fermentation dans le coït philosophal. Elie-Charles Flamand a d’ailleurs publié une Erotique de l’Alchimie par la suite, qui associe gravures et portraits d’alchimistes dans leur relation à l’érotisme.[12].
Curieusement, l’auteur publiera peu jusqu’à la réédition de ce coup d’envoi sous un nouveau titre, La Lune feuillée, contenant de nombreux autres poèmes, en 1968...Etonnant livre encore que celui-là, préfacé par André Pieyre de Mandiargues qui louangeait parallèlement la simple franchise d’Alba de Cespèdes, laquelle publiait des poèmes du mois de mai qui chantaient la révolution des enfants de la bourgeoisie française. L’histoire semble comme au dehors, chute de neige derrière la vitre, tandis qu’Elie-Charles Flamand se dédiait à de longs travaux sur la peinture de la Renaissance. « Instants miroirs ardents de l’éveil », « Vivier des signes décisifs », « Pierre de vérité » s’ajoutent comme le résultat de ces dix années.
La perspective d’une « internelle navigation » se précise, suivant une route qui conduirait au « noeud des mondes ». Le poète est un vigile, attentif au monde, « éternisant en nous le chant de la matière pensive »[13]
Certains de ces vers sonnent familièrement comme des sentences, qui sont autant des mots d’encouragement adressés à soi-même, en chemin, que des injonctions qui conduisent le lecteur à entrer par empathie dans la perspective de l’auteur, qui est celle d’une transfiguration :
« Changez votre âme contre celle de l’agate
Alors vous pourrez goûter au pollen des étoiles
Et dénouer les boucles du mandala »[14]
Le lexique employé renvoie au monde de l’alchimie, ou de l’ésotérisme au sens plus large, mais recomposé suivant les lois de la poésie, transformé en métaphores comme « les chenets des arcanes », « le chas des grimoires », ou le « revif ». Ces poèmes donnent la preuve d’une étonnante plasticité des images, éluardiennes ou rappelant Edmond Jabès, comme « la nuit potable ». L’expression devient inventive et ailée pour suggérer une expérience hors du commun, avec néologismes singuliers comme « la chair s’illimite », ou bien « Je remontais vers l’anti-présence ». Le poète semble alors bien avoir appliqué sa méthode de connaissance par le subconscient, de lente émergence vers le spirituel, en s’arrachant « à la succion des fonds originels »[15].
Cette lune feuillée, cette lune talismanique est une des très belles pierres de son lapidaire. Il s’agit certainement d’un recueil plus « profane », jouant de claviers depuis abandonnés pour une quête plus resserrée sur elle-même. Ces poèmes s’imposent à tout lecteur sensible à une grâce hermétique parente des neiges, du miroir et de l’acier.
Ce sont des « roses très austères » qui préfigurent un autre ensemble de poèmes parus en trois volumes d’un étonnant format carré aux Editions Le Point d’or (Michel Landier) entre 1982 et 1988. Entre-temps, dans la décennie soixante-dix, trois nouveaux recueils ont paru, qui nous renseignent amplement sur la vie intérieure de l’auteur, dans la poursuite de sa quête spirituelle.
Attiser la rose cruciale, paru en 1982, et tiré à 350 exemplaires, sonne comme un recueil rosicrucien. La gravure en frontispice semble garder le seuil, comme l’ange porteur d’une épée. Le titre superbe vient détourner une référence ésotérique trop explicite et pourrait conduire à bien d’autres lectures. L’ouvrage semble décrire la lutte du solitaire impétrant contre les forces multipliées de l’univers, encore vaudrait-il mieux dire une étreinte, un corps à corps entre la volonté de nomination poétique et le silence, et une communauté de nature entre ferveur poétique et prière. Un « point d’or » est rejoint, celui « d’une parole prête à fructifier dès que le ciel pénétrera les pierres fastes »[16] . Jamais la vertu théologale d’espérance ne fait défaut, et celui qui cherche finit par voir : « Quelquefois j’ai vu ma nuit intérieure se parer d’une rayonnante déchirure »[17]. Une image se manifeste déjà, qui trouvera à s’exprimer plus largement dans un recueil, sous le titre Pacte avec la source[18]. En effet, apparaît ici « la source de mutation », soit une piscine probatique, ou le moyen de changer le mal en bien. Un « ressourcement » au sens fort peut enfin s’effectuer. Au fond, l’efficacité de la quête est fonction d’une qualité de ferveur, capable à elle seule de saisir « le vivifiant secret du matin »[19].
Petit à petit, un thème émerge qui ira crescendo, celui de la « lumière sans ombre », soit une illumination, un « jour aurifère », ou bien encore des « lueurs habitables ». Surtout, la quête ésotérique prend une importance croissante et devient un thème majeur de nombreux poèmes, dans une langue de plus en plus codée : « éloignons-nous du noir cristal adombrant le temple inachevé, afin d’aller nous enfouir dans l’athanor d’une solitude baptismale »[20]. Ce recueil est précédé d’une essai sur la poésie hiérophanique intitulé « La Quête du Verbe » qui pose les principes nécessaires pour un art poétique : la parole est enfouie au fond de nous. Il faudra donc devenir le démiurge de sa propre parole poétique et trouver les images qui manifestent au mieux les archétypes et les signes sacrés.
L’Attentive lumière est dans la crypte est un second recueil illustré par le sculpteur Gaetano di Martino suivant des formes symboliques de grande puissance. C’est un recueil intermédiaire qui parachève un mouvement d’amour et d’adoration : « l’amour affleure avec ses voix stellaires... »[21]
Les acteurs de ce théâtre intérieur grandissent en abstraction jusqu’à devenir pure lumière : « Je vois là s’affiner tempétueusement / Le devenir de la lumière/ Qui s’ouvre sur la blancheur du Vide »[22].
Transparences de l’Unique paraît enfin en 1988, illustré magnifiquement par le peintre-calligraphe Chu Teh-Chun, et s’ouvre par « Héritant ces galets de clarté ». Ce dernier ouvrage témoigne d’une victoire sous forme de « renouveau », ou d’« embellie » : l’être entre en pleine possession de lui-même, à condition ici encore de passer par des épreuves dont le cadre matériel est minutieusement décrit, mais suivant non pas le réalisme descriptif, mais un détournement radical des propriétés de l’espace, des « arcs ironiques » à un « paysage minéral », « sous les méandres des intrigues stellaires »[23]...
Le ton devient parfois sentencieux, détournant parfois certains proverbes, dans une inventivité heureuse du langage : « Tant va la chance méconnue qu’elle finit par rejoindre la courbe unique »[24]. En dépit de la longueur du trajet, c’est la confiance et une tonalité heureuse qui dominent ce recueil, comme si la lumière trouvait enfin à s’accomplir.
Ces trois recueils, unis par une présentation similaire, semblent parcourir un arc qui va d’une laboratieuse initiation visant à approfondir la dimension spirituelle de l’être jusqu’à une certitude visionnaire.
Ce qui s’ouvre à la pierre du matin et L’immuable et l’envol paraissent à deux ans d’intervalle aux Editions du Soleil Natal. Ces deux recueils illustrés l’un par des emblèmes du XVIIème siècle, l’autre par des compositions d’Obéline, précèdent Les Chemins embellis et Au Vif de l’abîme cristallin, ce dernier ayant été publié par les éditions Tarabuste, en 1996. L’hypothèse serait que chaque recueil coïncide avec un trajet dont le support est matériel - ce sont de vrais escarpements, de vrais soleils - vers un espace rare et peu accessible, image transparente d’une transmutation. Une odyssée intérieure est relancée de poème en poème, en un précipité verbal nullement gratuit et jamais seulement esthétique. Le poème serait ici l’alchimie en acte et le baromètre de l’âme. Avec plus ou moins d’assurance, le poète peut annoncer le frémissement d’une délivrance. Mais nul ne peut affirmer si l’embellie sera durable, dans le dialogue de forces contraires. Et c’est ce dialogue, maintes fois relancé, qui se poursuit sous nos yeux, avec les recueils suivants, Les Temps fusionnent , qui associe oeuvres d’art et objets de tous les temps, par une transfiguration poétique, Pacte avec la source, Vers l’or de nuit, et le tout dernier, Distance incitative, qui associe poèmes et photographies par Obéline des grèves de Varengeville, sur la Manche[25].
Inlassablement, Elie-Charles Flamand extrait, d’un livre à l’autre, la ferveur d’un soleil noir.
Marc Kober
Cet article est paru dans la revue LA SŒUR DE L’ANGE N°3
Editions A CONTRARIO.
Copyright : la revue et l’auteur.
[1] Les Méandres du sens - Retour en Forez, retour sur moi-même, Editions Dervy, 2004, p. 29. Cet ouvrage est capital pour la mise en perspective d’une existence passionnée suivant divers moments de création et de réflexion. L’ouvrage est si divers et si surprenant que les libraires ne savent pas dans quel rayon le placer, et c’est là toute sa force !
[2] La Lune feuillée, préface d’André Pieyre de Mandiargues, Pierre Belfond, 1968, p. 43. Ouvrage épuisé.
[3] Elie-Charles Flamand, La Tour Saint-Jacques, Editions La Table d’Emeraude, Paris, 1991. Les oeuvres de Nicolas Flamel ont été préfacées par ce même auteur aux Editions du Courrier du Livre, en 1989.
[4] L’Immuable et l’Envol, Editions du Soleil Natal, 1993.
[5] Les Méandres du sens, op. cit. , p. 85 et sq.
[6] Dans le registre de l’essai, l’auteur a publié une belle étude sur les minéraux : Les pierres magiques, Le Courrier du livre, 1981.
[7] Les Méandres du sens, op. cit. , p. 113.
[8] La Tour Saint-Jacques, op. cit. , p. 24.
[9] Yves-Alain Favre, Alchimie et poésie dans l’oeuvre d’Elie-Charles Flamand, Deuxième colloque du Centre de recherche sur le merveilleux et l’irréel en littérature, Université de Caen, début septembre 1989.
[10] André Breton , en 1957. Le mot est souligné par André Breton.
[11] Entretien réalisé par André Lagrange, été 1993, Jointure n°34.
[12] Erotique de l’alchimie, Le Courrier du Livre, 1989. Avec une préface d’Eugène Canseliet.
[13] « Sur une statue oscillante de Takis », La Lune feuillée, op. cit. , p. 43.
[14] « Itinéraire du peintre », idem, p. 45.
[15] « Cérémonial de l’abandon aux métamorphoses », idem, p. 81.
[16] Attiser la rose cruciale, « Prendre appui », Le point d’or, 1982, p.33.
[18] Pacte avec la source, La Lucarne ovale, 2000.
[20] « Dépouillement », idem, p. 66. Il s’agit d’un poème en prose.
[21] L’Attentive lumière est dans la crypte, Le Point d’or, 1984, p. 17.
[23] Transparences de l’Unique, «Rétrospectif », Le Point d’or, 1988, p. 23.
[24] Idem, « Secours de l’envers », op. cit. , p. 28.
[25] Tous ces recueils sont parus aux éditions de la Lucarne ovale (21, La plaine du Jarrier, 77720, Saint-Ouen-en-Brie) entre 1998 et 2005.