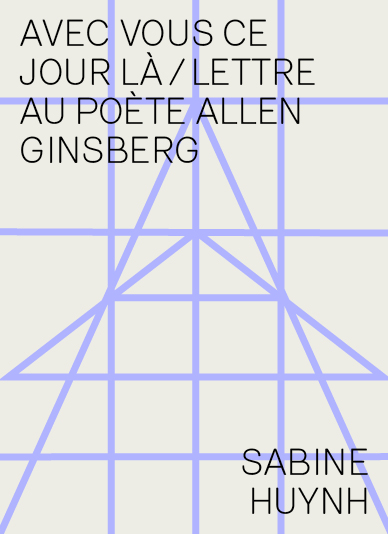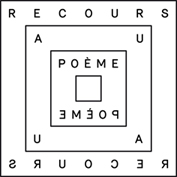RESPECT HUMAIN
Monsieur le Directeur, je renonce à enfler,
j’abandonne les attitudes, car maintenant
il faut se contenter de postures.
Je renonce à m’affirmer sur des cartes de visite.
D’ailleurs
tout mon corps proteste contre la station
verticale.
Je suis sollicité de tomber.
Soudain
le mot PESANTEUR gagne en agrément
et je lui cède et me voici à terre.
Mais quelle étrange loi
me remet sur mes pieds malgré moi
et me fait solliciter
de Votre Haute Bienveillance
une distinction honorifique ?
Paul Morand souffre comme Céline, mais de manière plus doucereuse, du syndrome de la conjonction de coordination : « C’est un grand écrivain, mais… ». Conjonction de coordination qu’on aime abouter aux personnages trop épicés politiquement. Morand-Céline, l’estime fut de haute lisse. Le premier disant du second : « Sa vie fut un don continuel, plus total que toutes les vies du Curée de campagne », le second du premier : « C’est lui le premier qui a écrit en jazz, un authentique écrivain, la très rare espèce ». On se soucie de littérature.
C’est par le biais de mon ami, le poète, essayiste et romancier Frédéric Musso que je vins à la poésie de Paul Morand : l’émission Apostrophes de Bernard Pivot, en 1983, à laquelle il participait et que je pus visionner sur le site des archives de l’Institut national de l’audiovisuel, vingt-cinq ans plus tard. Deux poètes sur le plateau, Frédéric Musso et Kenneth White, tentant sous couvert d’exercice de l’effacement (il mentionnait allègrement le « zen ») de démontrer la supériorité de la poésie face au roman. Frédéric Musso affirma qu’il appréciait la poésie de Kenneth White mais beaucoup moins la manière dont celui-ci l’envisageait, semblant la souhaiter pure et presque produit d’une distillation. Musso mentionna deux poètes français du XXe siècle, Larbaud et Morand, issus selon lui d’une même tradition, et proches des présocratiques par la fulgurance de leurs images, poètes capables de décréter à la manière d’Héraclite d’Ephèse : « Le soleil, large comme un pied d’homme ».
Poésie non distillée, non rectifiée (comme on le dit de l’alcool), et postérité du soleil ; il ne m’en fallut pas plus et je décidai d’aller voir.
De Paul Morand j’avais lu peu, cela me suffisait. Tendres Stocks, Lewis et Irène. Il demeurait pour moi l’auteur de quelque quatre-vingts volumes de nouvelles, romans, chroniques, essais ou récits. Morand commença pourtant par le poème, quatre recueils publiés chez l’éditeur des surréalistes, Au Sans Pareil : Lampes à arc en 1919, Feuilles de température en 1920, qui augmentés de Vingt-cinq poèmes sans oiseaux formeront les Poèmes (1914-1924). Suivra le recueil USA-1927, Album de photographies lyriques. Puis plus rien, hormis cinq poèmes épars intégrés à l’ouvrage Papier d’identité en 1931. La poésie pesait peu au regard de tout ce fret de proses. Je le tenais, outre le style qu’on aime à qualifier d’aride et dont on vante la sécheresse et le télégraphique novateur, pour un maître de l’attaque et de l’ouverture, possédant cette science du doigté, cet art du toucher multiple qu’on ne peut demander précisément dans une indication de nuance, le staccato et son avatar louré ; le piqué-lié qu’on ne réalise pleinement qu’en le contournant après avoir pris la mesure de son absurdité fondamentale. Morand possède l’art de faire « chanter le meuble » comme on le dit dans le jargon pianistique, allié à un sens exacerbé de la trouvaille dont on mésestime la richesse aujourd’hui, à l’ère de l’écriture blanche et du mot censé, par nature, et particulièrement dans le poème, dire plus que lui-même. Il n’est que d’ouvrir au hasard un ouvrage de Morand pour saisir au vol une multitude de taons rhétoriques. Ici dans Lewis et Irène : « L’oisiveté est la mère de tous les vices, mais le vice est le père de tous les arts », ou là, dans Fin de siècle : « Elle portait sa quarantaine comme on porte un empire », ou encore dans New York : « Je débouche sur une place dont les efforts qu’elle fait pour être un parc ont quelque chose d’attendrissant », encore là au détour d’un poème de Lampes à arc :
« Cloches. Klaxons.
Enveloppé dans des linges sales
un soleil tombe.»
Cette crépitation permanente a le don de faire jubiler tout autant qu’elle peut irriter : gardons-nous cependant de médire d’un fastueux qui peut se révéler salvateur : si la pie s’excite à la vue du brillant, elle semble aussi, lorsqu’elle jacasse, nouveau-né en pleurs. En littérature, il faudrait toujours réprouver plus l’indigence que l’ostension.
BAISERS
Un baiser
abrège la vie humaine de 3 minutes,
affirme le Département de Psychologie
de Western State College,
Gunnison (Col.).
Le baiser
provoque de telles palpitations
que le cœur travaille en 4 secondes
plus qu’en 3 minutes.
Les statistiques prouvent
que 480 baisers
raccourcissent la vie d’un jour,
que 2360 baisers
vous privent d’une semaine
et que 148 071 baisers,
c’est tout simplement une année de perdue.
Le baiser qui abrège la vie. Beauté froide et presque parnassienne dans son esthétique droite. Caricature lyrique de la tonalité du Reader’s Digest (le premier numéro fut publié en 1922), qui préfigure celle des slogans et des magazines d’aujourd’hui : « Manger cinq fruits et légumes par jour » ; « Fumer peut nuire aux spermatozoïdes » ; « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ». Ce poème d’USA séduit par son approche moderne et sa contemporanéité. On le cantonnerait avec trop de promptitude au cynisme ou à l’ironie. J’y goûte du propitiatoire et j’aime à y traquer du tragique et de l’absurde : jouissance de ce qui est. On n’en finirait pas de pleurer. Platon déplorait déjà la disparition des chênes autour d’Athènes. Dans New York, Morand fera quant à lui l’éloge des gratte-ciel : « Ce matin, à mesure que j’avance dans Broadway, je pense qu’un homme d’aujourd’hui doit les approuver comme un Grec, le Parthénon ». On aurait tort de n’y percevoir qu’un éloge du « progrès », Morand se fait avant tout chantre du « vivant » comme dans le poème Boulogne :
« Tout va quelque part,
assidûment,
et veut vivre,
et prendre la place de ce qui n’est plus. »
« Progrès ». Le poème Peaux-rouges précède Baisers dans le recueil USA. On y retrouve la minutie et l’exactitude du trait. Un lyrisme sans pathos. Poésie anthropologique sans souscription à l’air du temps et dépouillée des maniérismes contemporains.
PEAUX-ROUGES
Ils ont tracé des cartes sur des peaux de bœufs,
où des pieds vermillon indiquent les pistes et le sens de la marche à suivre,
pour traverser le désert du Colorado
et aller chercher l’or californien.
Ils donnent chaud et froid
avec leur buste nu
hors d’une fourrure de renard blanc.
Ils entendent tous les bruits,
et sentent,
avec leur nez maigre, en bois dur,
la nationalité, l’âge et le sexe des étrangers.
Ils vivent au-dessus des églises et des banques,
et l’on ne sait pas quand ils dorment ;
ils pagayent, les paumes
le long de leurs hanches étroites.
Des siècles de privations
les ont affinés.
Ils vont nus,
sans poches ;
ceux qui acceptent des cadeaux
ont les mains immobilisées :
ils ne peuvent plus chasser, ni manger, ni se défendre,
et ils meurent.
Morand eût certainement souri doucement aux controverses contemporaines concernant le vocable utilisé pour qualifier les arts « ethniques ». « Art premier » ou « Art primordial » plutôt que « primitif » qui évoque par trop le colonialisme. Le Musée du quai Branly a opté pour « premier » et l’année 2014 a vu la réalisation d’une exposition consacrée aux cultures des Indiens des Plaines sur une période s’étendant du XVIe siècle au XXIe siècle. Dans le poème Peaux-rouges, les cartes sont tracées sur des peaux de bœufs, non de bisons ou de cerfs comme dans la tradition. Licence poétique visant à dissonance ou approximation littéraire ? Morand connaissait son Amérique. Peut-être avait-il eu le loisir de contempler les calendriers d’hiver réalisés par les peuples indiens pour archiver à l’aide de cryptogrammes et de dessins les événements d’une année, de « la première neige à la dernière neige ». Comme les baisers, les cadeaux tuent. Le potlatch avec le colon immobilise. Point de misérabilisme chez Morand. Quand il exprime la douleur, « Des siècles de privations », le lyrisme est contrebalancé dans l’instant par la coupure du vers et sa résolution sur le suivant, « Des siècles de privations/les ont affinés ». De même que dans « Ils vont nus, /sans poches », la délicate tautologie et le pléonastique de l’image contrecarrent le dévoilement du corps. Lyrisme de constat. Des siècles de privations ne les ont pas amaigris mais affinés. La mort c’est l’immobilité. Plus que le cadeau, ce qui a tué l’Indien, chez Morand, c’est l’acceptation de ce cadeau.
Paul Morand qui disait souhaiter « vivre sur un paquebot qui ne prendrait jamais la mer » a dû trouver son bonheur dans la locomotive américaine. Dans New York, à propos des gratte-ciel : « Ces falaises, droites comme des cris, rejetées en arrière par une perspective outrée, doit-on les appeler des maisons ? Elles ne grattent pas le ciel, elles le défoncent. » La locomotive ne traverse pas le territoire, elle l’incise à même le sol.
SOUTHERN PACIFIC
L’express de luxe Coucher-de-Soleil
lace le pays
d’est en ouest.
Quinze wagons blindés,
pareils à des sous-sols de banque
dans lesquels circulent les nègres amidonnés,
avec des plateaux pleins de glace,
frères des nègres qui portent des sorbets
sur les fresques de Tiepolo.
Quand le train passe,
l’on comprend tout le chagrin
que les maisons
ont
à être des immeubles.
Le wagon traverse des déserts rouges
et des déserts blancs
parsemés de cactus turgides
comme des asperges de cinq mètres, cannelées,
poilues,
quelquefois même avec des bras.
Il perfore des villes de zinc
et des villes de bois
tiré par la grande locomotive qui sonne
la cloche.
En entrant dans les gares
elle a un cri de la gorge
que Proust eût aimé,
avec son goût pour les voix enrouées.
Est-ce cela,
ou ce glas,
ou la pensée que l’automobile de l’amoureux,
n’ayant pas vu la tête de mort du passage à niveau,
s’est écrasée contre le chasse-pierres,
ou simplement
leur puissance en chevaux-vapeur
qui donne envie de pleurer
quand s’avancent
les locomotives du Southern Pacific ?
Elles ont des perles au cou ;
des mécaniciens gantés
les caressent.
Les machines sont les seules femmes
que les Américains savent rendre heureuses.
Si l’Histoire est un grand fait divers, elle n’en est que plus cyclique, les esclaves antiques sont les affins des Afro-Américains des années vingt. Poésie anthropologique, encore, dans l’expression imagée des phénomènes d’assimilations et de dominations culturelles. Le choix du vocable fouette et coupe court au développement que Morand tenait pour négligeable. Ici dans le Journal inutile, 1973-1976 : « Je déteste cette habitude scholastique de développer - comme on l'enseigne à Normale. Seuls les bavards traitent le sujet. Quand je veux traduire une impression vive, mon premier mouvement n'est pas de laisser aller ma plume, comme disent les sots, mais un réflexe de contraction, de gêne, de refus, comme l'huître qui souffre sous la morsure du citron. ».
Les nègres amidonnés, tout comme les dominants, font partie de l’histoire et de sa grande fresque séculaire, celle de Tiepolo, ou celle de Morand : calendrier d’hiver d’un attaché d’ambassade sur vélin blanc de Hollande. L’Afro-Américain de 1928, comme l’Indien, Morand l’intègre au grand cycle historique en pratiquant ce que je nommerai une « poésie murale ».
Synecdoque et personnification : la locomotive a des cris de gorge, elle balaye l’Histoire au chasse-pierres comme une femme bat des cils. Le lyrisme est encore abîmé par la retombée du constat. Les américains ne savent rendre heureuses que les machines qu’ils ont auréolées de colliers de perles. Morand connaissait son anglais, mais avait-il eu vent de l’expression consacrée lors d’un coït interrompu : si l’amant bornoie haut et pare de semence le buste de sa partenaire, on utilise l’expression pearl necklace. Fin de l’exégèse. Dix ans auparavant dans Lampes à arc, le poème Soir de Grève, composé en 1917, attribuait déjà une voix d’homme à la locomotive :
« Rumeurs…
On entend un train qu’on égorge.
Mais ce ne sont que des permissionnaires.
Ce n’est encore que du vin rouge. »
On a parlé pour certains auteurs du début du XXe siècle de style ou d’esthétique photographique. Cette qualification peut s’appliquer à la poésie de Valéry Larbaud ou à celle de Blaise Cendrars dans ce qu’elle a de cru, une expressivité figurative qui dénude le réel et dans laquelle l’objet, pourrait-on dire, semble nécessiteux. Plus difficilement à la poésie de Paul Morand. Le recueil USA-1927 est sous-titré Album de photographies lyriques, mais Morand, qui semble s’adonner à une poésie du témoignage, transfigure le réel plus qu’il n’en témoigne, l’informatif semble cureté par la dissonance et le frottement. C’est un album d’images gondolées, à combustion lente, l’inverse de la notion d’instantané dont on se plaît à le qualifier. Le réel et sa restitution poétique ne sont pas isomères. Il y faut le temps, l’attente et le décentrement du regard. Miroirs déformants comme dans Beauty-Parlor :
« Bleu, blanc, rouge,
ces couleurs m’exaltent, car
ce sont celles des coiffeurs américains.
Il y a des glaces partout ;
elles ne renvoient jamais la même chose ;
c’est bien plus fort que Giotto.
Dans ce paysage de nickel et d’émail blanc,
il arrive au cuir chevelu,
aux ongles,
à l’épiderme,
des aventures atroces.
Sous les faisceaux de projecteurs de cuirassés,
derrière ces vitrines,
il y a des opérations dont dépend la vie même de la beauté ! »
Il s’agit d’un réel récalcitrant et c’est précisément par la tension et le frottement qu’on peut accéder à la juste expression du dehors. Dans Descente vers la côte :
« Les paysages enfermés comme la viande
sous la toile métallique.
Piste apache.
Des neiges poignardent le ciel ;
je pense à Mallarmé qui jamais ne peut se retenir
de faire rimer glacier avec acier.
Les Indiens se parlent la nuit,
de cent miles en cent miles,
avec des feux,
Comme des génies au-dessus de l’humanité. »
Marcel Proust et le cri de gorge d’une locomotive. Ayant entendu dire que Morand tenait Swann pour « ce qu’il y a de plus important depuis L’Education sentimentale », Proust voulu le connaître. La rencontre eut lieu en 1915. L’amitié durera jusqu’à la mort de Proust en 1922. Dans un numéro spécial de la NRF de 1922 Morand confiera : « Au moment où quelqu’un écrit de moi que « je sais congédier toute peine », la plus grande peine de ma vie vient d’entrer. » Dans le poème Ode à Marcel Proust, Morand lui rend hommage :
« Votre voix, blanche aussi, trace une phrase si longue
qu’on dirait qu’elle plie, alors que, comme un malade
sommeillant qui se plaint,
vous dites : qu’on vous a fait un énorme chagrin.
Proust, à quels raouts allez-vous donc la nuit
pour en revenir avec des yeux si las et si lucides ?
Quelles frayeurs à nous interdites avez-vous connues
pour en revenir si indulgent et si bon ?
et sachant les travaux des âmes
et ce qui se passe dans les maisons,
et que l’amour fait si mal ?
Étaient-ce de si terribles veilles que vous y laissâtes
cette rose fraîcheur
du portrait de Jacques-Émile Blanche ?
et que vous voici, ce soir,
pétri de la pâleur docile des cires
mais heureux que l’on croie à votre agonie douce
de dandy gris perle et noir ? »
Proust y vit une allusion inélégante à ses mœurs et écrivit une lettre de remontrances à Morand : « Le sacrifice de toute préoccupation étrangère et notamment des devoirs de l’amitié à la littérature est un dogme que je ne pratique pas [...] je ne suis pas timide, mais vraiment je n’aurais pas affronté d’éprouver ou de causer une douleur pareille [...] à un ami désarmé par sa tendresse.» Ce malentendu ne les brouilla pas et Proust réalisera la préface (essai libre sur le style plus que préface dédiée à Morand, mêlant des réflexions sur Baudelaire, Sainte-Beuve, Stendhal, Renan, ou Boileau) du recueil de nouvelles Tendres stocks, publié en 1921. Il y loue la singularité du style de Morand : « Mon cher maître, Anatole France, que je n’ai pas revu hélas, depuis plus de vingt ans, vient d’écrire dans la Revue de Paris, un article où il déclare que toute singularité dans le style doit être rejetée. Or il est certain que le style de Paul Morand est singulier. Si j’avais la joie de revoir M. France dont les bontés pour moi sont encore vivantes sous mes yeux, je lui demanderais comment il peut croire à l’unité du style, puisque les sensibilités sont singulières. Même la beauté du style est le signe infaillible que la pensée s’élève, qu’elle a découvert et noué les rapports nécessaires entre des objets que leur contingence laissait séparés. » On songe à la pensée analogique des surréalistes. Surréalisme qui teinte parfois la poésie de Morand où les cactus turgides sont comme des asperges de cinq mètres. En guise de conclusion, Proust, dans un accès de magnanimité lucide pondère : « Le seul reproche que je serais tenté d’adresser à Morand, c’est qu’il a quelquefois des images autres que des images inévitables. Or, tous les à-peu-près d’images ne comptent pas. L’eau (dans des conditions données) bout à 100 degrés. A 98, à 99, le phénomène ne se produit pas. Alors mieux vaut pas d’images. »
Je songe que Morand tente uniment dix manières de dire. Esthétique du divers au profit d’un chant solitaire, d’une mélodie non accompagnée. Un style qui fourmille de tropes et de catachrèses, qui fleure la tapinose. Multiples éclats qui ne manquent pas la cible. Morand possède une science de la chute et du vers conclusif. L’à-peu-près retombe sur ses pieds, c’est dans la pétarade qu’il ajuste son tir avec précision. Il distille la trouvaille qui en devient plus éclatante ; ainsi du hasard dans le dernier vers d’une strophe du poème Saint-Sébastien :
« Saint-Sébastien tend son corps basque
aux flèches des vieilles joueuses
avides d’un numéro plein
(mais qui nous rendrait 35 fois notre mise sinon les Saints ?)
La bille se déroule comme une bande mitrailleuse,
chantant cette fausse berceuse qui est le hasard. »
Claudel dans Positions et Propositions soutenait que « la rime est comme un phare à l’extrémité d’un promontoire ». Chez Morand, c’est La Plaque indicatrice qui a remplacé le phare, et le promontoire a sauté. Les vers sont comme des courants, « Un lierre ignifugé/met sa poésie sur les électricités./ », le poème est semblable à un « orage domestique ». En 1927, Claudel est nommé ambassadeur de France aux Etats-Unis, Paul Morand et son épouse Hélène Soutzo y séjournent. Rencontre. Dans le poème Paul Claudel au grand Cañon, mi-moqueur mi-admiratif, Morand en dresse le portrait:
« Soudain,
l’ambassadeur de France aux Etats-Unis
parle de Bach,
puis des derniers quatuors de Beethoven
qui ont certainement un sens
qu’on n’a pas encore découvert.
Il enfonce sur sa tête son petit chapeau
et plein d’une excitation silencieuse,
napoléonien, optimiste, naturel,
il nous quitte pour marcher tout seul dans la neige,
attaquant la route
comme il fonce sur les gens ou les idées,
en taureau de bas en haut.
Rien ne peut plus avoir raison de lui
que l’heure du déjeuner. »
Style et trouvaille. Pierre Louÿs – mort en 1925, un an après la parution de l’ensemble Poèmes (1914-1924) de Morand – en vantait les vertus et mettait les poètes en garde contre le vice qu’on pouvait y instiller. Dans Poëtiques : « La trouvaille est poésie. Coup de génie par excellence, que le pressentiment d'Alexandre : le coup d'épée. Ainsi vers et style se résolvent. La rhétorique du mouvement, science naturelle, principe révolutionnaire, tranche les cordes grammaticales et grave la parole future. C'est la liberté des muses première que d'élever leurs bras blancs qui brandissent les tropes, de se faire passage à travers l'école et de sceller une trace en terre vierge. Mais, apprentis sorciers, gardez-vous des forces ! Aux imprudents l'ellipse casse. Rien de plus leste que la syllepse, ni de pire escalade que la gradation. Peintres, poëtes ou musiciens, tout art émane de l'hypallage, alternance où l'idée prend forme et d'où la matière prend vie. »
Poème, c'est-à-dire objet, aire de jeu qui semble comme irréductible à autre chose qu’à elle-même. Morand n’use jamais du vers fixe, dit « régulier ». Pas de poèmes en prose non plus. Vers libres plutôt qu’irréguliers, il conserve un découpage simple qui souscrit à la seule logique de la syntaxe, sans souci de la distorsion. « Prose coupée », dit-on désormais pour qualifier la facilité de la production contemporaine, facilité dépendant moins d’un découpage simpliste du vers que de son manque de tension et de sa faiblesse d’oscillation. La distorsion syntaxique étant considérée comme garante de complexité, on ne se soucie plus du « contenu » mais essentiellement d’anguleux « à la ligne ».
Déjà, Paul Claudel dans sa Remarque sur l’Enjambement faisait entendre sa voix : « On a souvent parlé de la couleur et de la saveur des mots. Mais on n’a jamais rien dit de leur tension, de l’état de tension de l’esprit qui les profère, dont ils sont l’indice et l’index, de leur chargement. Pour nous le rendre sensible il suffit d’interrompre brusquement une phrase. Si par exemple vous dites : « Monsieur un tel est une canaille », j’écoute dans un état de demi-sommeil. Si au contraire vous dites : « Monsieur un tel est un… », mon attention est brusquement réveillée, le dernier mot prononcé, et avec lui toute la rame des vocables précédents qui y sont attelés, devient comme un poing qui heurte un mur et qui rayonne de la douleur… »
Paul Morand sait bander l’arc quand d’autres se soucient d’en faire sécher le bois, recherchent encore la juste inclination devant la flamme. La Plaque indicatrice, en guise de manifeste, clôt le recueil Lampes à arc :
« Il ne faut pas mettre les mots en colonne par quatre,
la rime ne doit pas être l’élection des pensées
par des mots riches, nés d’un suffrage censitaire,
elle doit être rare, c'est-à-dire employée rarement.
Tout ce qui a le droit d’aller et de venir
doit aller et venir librement.
Il ne faut déclarer l’état de siège chez personne,
ni chez soi.
Un libre et sérieux dessin de sa pensée,
une simple effusion de soi-même,
avec plus de bonté et une entière bonne foi. »
Prose ou vers, vers ou prose, c’est avant tout la gestique et la forme du bagage qui vont dicter. Abolition de l’esclavage et de la distinction. Stéphane Mallarmé en 1891, s’exprimant sur l’évolution littéraire dans l’Echo de Paris, avait déjà résolu de manière définitive l’équation des futures avant-gardes : « Le vers est partout dans la langue où il y a rythme, partout, excepté dans les affiches et à la quatrième page des journaux. Dans le genre appelé prose, il y a des vers, quelquefois admirables, de tous rythmes. Mais, en vérité, il n’y a pas de prose : il y a l’alphabet et puis des vers plus ou moins serrés : plus ou moins diffus. Toutes les fois qu’il y a effort au style, il y a versification. »
La prose et le vers du Bourgeois gentilhomme se craquellent…
En guise de coda, un morceau de prose lumineux de la nouvelle Clarisse, qui scintille, enserré dans le récit. Extrait de l’ensemble on aboutit encore aux atours définitifs du poème en prose : « Sur un tertre de gazon bleu des jeunes femmes à chandails cerise, jaune, vert, cerise s’assemblent autour du thé, servi sur une table en rotin. Et le centre de toute clarté, de cette joie lustrée, l’essieu lumineux du cercle des femmes qu’encadre celui, plus vaste, de la campagne et du ciel, c’est la théière d’argent qui chante comme les guêpes sur la tarte : les reflets de son couvercle renvoient l’image convexe du ciel, l’ombre des arbres ; son corps côtelé, les lignes amenuisées des figures et, en stries étroites, les chandails, cerise, jaune, vert, cerise. »