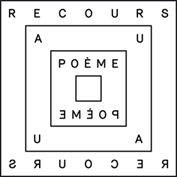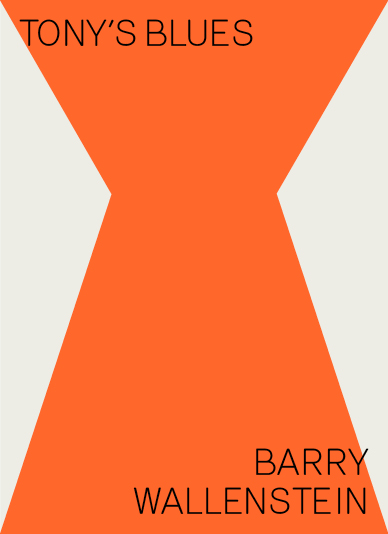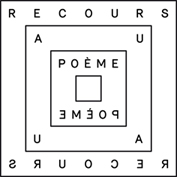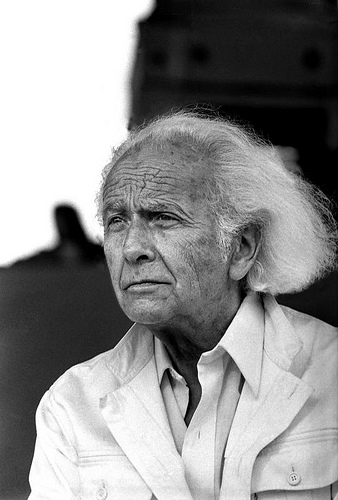Cadou : un poète « grégorien »* au coeur étoilé
* Le chant grégorien : ce genre musical appelle au calme, au recueillement, à la contemplation, il est interprété par un chœur ou un soliste.
Mort très jeune à trente et un ans, le 21 mars 1951, un jour du printemps, René Guy Cadou, contrairement à la majorité des humains qui sont dans l’incapacité à être vivants, a été cet homme « vivant » dont parle Maurice Zundel : « La plupart des hommes meurent avant de vivre et c’est cela la vraie mort (…) Nous existons très rarement. Le plus souvent, nous sommes en attente, en capacité d’existence : nous n’existons pas. » (1)
Cadou, homme et poète vivant car la poésie fut pour lui, au creux de sa solitude, dans la douleur de l’absence des parents, elle fut dans le silence d’avant Hélène : « Une parole inouïe, la levée d’un souffle vif au creux de l’Absence. » (2)
La poésie se fera le reflet de sa quête intérieure et d’une Présence rencontrée. Elle nous dit, ce qu’il a perçu, ce qu’il a reçu de : « Cette respiration du silence même, comme l’ont expérimenté les mystiques et aussi les poètes. » (3)
Il a su donner à son silence forme et limites car il a pu se mettre à l’écoute de la nuit, en cette chambre d’école à Louisfert, où, après la classe, il entrait en écriture.
René Guy Cadou est un veilleur dans la nuit et il a su en voir la splendeur, comme le dit si bien le poète et mystique Angelus Silesius dans son œuvre : La rose est sans pourquoi
« L’éclat de la splendeur apparaît dans la nuit qui peut le voir ? un cœur qui a des yeux et veille. »
La poésie de Cadou, nous éclaire sur sa vérité intérieure, il n’a pas menti, ni aux hommes ni à Dieu. Il n’a cessé de s’interroger, d’interroger l’Autre et de le chercher. Il n’a jamais osé affirmer : « Je crois », ni aux hommes ni à Dieu. Il a eu l’honnêteté de dire ses doutes ; sa vie comme ses textes illustrent cette belle et cinglante réflexion de Kant : « Qui dit à Dieu « je crois », sans avoir peut-être jeté un seul regard sur son for intérieur pour voir si vraiment à quelque degré, il a conscience de cette conviction, cet homme commet le mensonge non seulement le plus inepte à l’égard de celui qui sonde les cœurs, mais encore le plus criminel. » (4)
Il a cependant, timidement osé dire : « Je crois en Dieu parce qu’il n’y a pas moyen de faire autrement. » (PVE, p.318)
La rencontre avec le Tout Autre, peut-elle, doit-elle se dire ? être révélée, même dans le poème ? Doit-on garder le silence sur cette lumineuse expérience avec la « Face rayonnante ».
« Je monte dans ma chambre et prépare les feux, j’appareille tout seul vers la face rayonnante de Dieu. » (PVE, p.319)
Il y a donc bien eu ce face à face et pour cela il a fallu se retirer, il a fallu la solitude surtout celle de Louisfert que l’ami poète Michel Manoll qualifie de « haut lieu où souffla l’Esprit ».(5)
La poésie est état de grâce, quand elle est contemplation, tendresse, humilité : « Le poète sera toujours cet égaré sublime qui porte en lui-même sa bergerie. » ( PVE, p392) ; quand elle est aussi rencontre avec : les amis, les poètes, et Jésus- Christ .
Il le dit à Pierre Yvernault, curé de campagne dans un poème lettre qu’il lui adresse :
« Cher ami
Sans doute êtes-vous comme moi dans un village
Encadré par des candélabres de la pluie
Recevant à dîner d’inquiétants personnages
Comme Rimbaud ou Max Jacob ou Jésus-Christ… » (PVE,p.338)
Ce n’est pas un hasard si des hommes de foi sont à ses côtés Pierre Yvernault, mais aussi Max Jacob et Pierre Reverdy.
Avec Max Jacob, il partage une certaine expérience de la Rencontre, Max poète et converti pour avoir vu le visage du Christ dans sa chambre.
Dans la lettre du 23 janvier 1940, Max Jacob conseillera le jeune poète pour des méditations, afin qu’il s’agrandisse philosophiquement et spirituellement et donne plus de profondeur à son œuvre. René un peu plus tard lui répondra : « Je suis sûr que tu dis vrai cher Max… »
À la mort de Max, si douloureuse pour lui, qu’il la compare à celle de ses parents, le maître ne disparaîtra pas de la vie de René, Max sera le passeur, Cadou ne cessera de s’adresser à celui qui est toujours : « Vivant comme lys dans le cœur des poètes. »
Cette évocation du lys désigne bien Max comme guide spirituel, le lys est ici fort de son symbole religieux, de pureté, il est la fleur mariale. Le lys est souvent présent chez les mystiques, Marie étant l’intermédiaire entre les hommes et le Christ. Max Jacob est bien devenu le médiateur entre ce monde et l’autre.
« Et ne songes qu’à Dieu en toi-même invisible
Vingt fois plus invisible qu’aiguillée de fil
Tellement merveilleux et tellement présent
Que sans cesse tu nais de ce rapprochement
Et la lampe qui fait bouger ta maison rose
Nous accueille et nous ouvre à ta métempsycose… »
(En liaison avec Max PVE, p.294)
L’occurrence du lys dans l’œuvre de Cadou a chaque fois valeur symbolique ; l’image est forte dans le poème où il évoque sa volonté de vivre loin de Paris, du bruit, de l’agitation et donc du « divertissement ». L’odeur des lys symbolise bien ce lieu de méditation, Louisfert , dont il a besoin pour créer.
Citons aussi ces vers où le lys évoque, Passion et Résurrection :
« Ton sang est beau comme les lys. »
(Les lilas du soir ,PVE, p.82)
« Ah ! quelque part ! là-bas être à genoux tout seul dans la crypte !
Linge blanc !lys !odeurs !fraîcheur ! »
( Nocturne PVE, p.325)
Il associe aussi le lys aux asters, symbole de la fidélité en amour, dans Mon enfance est à tout le monde : « On fait le tour de la chapelle. Mais par la porte entrebâillée, quelle fraîcheur ! les lis et les asters ont mangé les statues ».
René Guy Cadou s’adressera aussi au poète retiré à Solesmes, Pierre Reverdy :
« Je t’aperçois
Tirant vers la nuit ton échelle
La boucle de ton sang s’accroche à la tonnelle
Et tu dis
Suppliant les autres d’avancer
Regardez
C’est la vie qui vient de commencer. » (PVE,p.159)
Pour René Guy Cadou, Pierre Reverdy est un modèle pour aller à la rencontre de soi-même, le plus intéressant des voyages :
« Je ne fais pas de différence entre Reverdy, sans cesse immergé au plus profond de son être et un Cendrars à l’affût de lui-même au détour d’un pays. » (Les liens du sang, PVE, p.406)
René Guy Cadou aimait les hommes qui comme lui s’étaient retirés, loin de la ville et de ses divertissements, ces ermites en quête de leur vie intérieure, la meilleure et la plus exaltante des aventures.
Le sculpteur Jean Fréour est l’un d’eux, il viendra se réfugier pendant la guerre à Issé près de Louisfert. L’œuvre de cet artiste traduit sa quête spirituelle voire mystique, une mystique qui s’incarne dans son art, les deux retables de l’église Sainte - Thérèse à Nantes en témoignent, il a prêté ses traits à Saint Joseph et ceux de sa femme à Marie. Jean Fréour que Hélène et René appelleront « l’ermite ». Lui aussi se retirera du monde et choisira de vivre à Batz-sur-Mer où il réalisera l’essentiel de son œuvre. Jean Fréour était si proche du poète qu’ à la mort de celui-ci, il sculptera sa main. Cette main faite pour l’écriture, la fraternité et l’amour, est aussi une main consolatrice.
Cette main dit cette fulgurante révélation mystique , le poète appelé à consoler Dieu : « Tu souffres, mon Dieu, la plaie s’est rouverte. Garde ma main, garde-là. Elle est douce comme les feuilles de figuier. (PVE,p.79)
« Douce comme des feuilles de figuier. », l’arbre choisi pour cette comparaison est un arbre messianique ; Jésus dit à Nathanaël : « Quand tu étais sous le figuier je t’ai vu. » (Jean ch 1v. 43à 51), Nathanaël méditait sur la parole de Dieu et était dans l’attente du Messie.
On retrouve cette main consolatrice dans cet autre poème :
« Mon Dieu cela m’arrive de penser à toi
Comme à un survivant (…)
Je me mets sous la lampe et je te dis Raconte
………………………..
Et celui que je vois et que je crois tout près
Est quelque part sur un rivage crucifié
Mais pas si loin mon Dieu que je ne puisse joindre
Mes deux mains sur ton front comme des térébinthes. » (PVE, p.228 )
Les deux mains posées en signe de bénédiction, la couronne d’épines de la Passion est remplacée par les mains du poète devenues feuilles de térébinthe, l’arbre de la force, de l’endurance et de la longévité dans la Bible.
Le poète ne demande pas à Dieu de le consoler, bien au contraire c’est lui le si faible avec ses doutes, ses deuils, ses souffrances morales et physiques qui est appelé à aider Dieu !
« Laisse-moi te porter, Seigneur, tu n’en peux plus. Couche –toi dans mes bras. » (PVE, p.80 )
« Je marche près de Toi
Ta croix est plus légère… » (PVE, p.108 )
Une jeune juive mystique, Etty Hellisum, plongée au cœur des ténèbres de l’holocauste, va elle aussi vivre cette expérience et écrire : « Une chose cependant m’apparaît de plus en plus clair : ce n’est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t’aider et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes. »
Etty Hellisum, René Guy Cadou, deux vies qui entrent en communion spirituelle.
La poésie de René Guy Cadou se fait souvent prière, demande de pardon
« Pardon Seigneur !pardon pour vos églises
Et si j’ai galvaudé dans les champs
Si j’ai jeté des pierres dans vos vitres
C’est pour que me parvienne mieux Votre Chant… » (PVE, p.345-346 )
Dans la bibliothèque de René Guy Cadou se trouvait une partie de son héritage spirituel : des écrits de grands mystiques :
- Le cantique du soleil et les Fioretti de Saint François d’Assise
- Glose et château intérieur de Sainte Thérèse d’Avila
- Le Cantique spirituel de Saint Jean de la Croix
On retrouve d’autres figures de cet héritage dans le poème rédigé en 1948 Saint Antoine et compagnie (PVE ,p. 302-305 ) entouré de Saint- Thomas, Sainte Madeleine, Sainte Véronique , toutes des figures marquantes de la spiritualité catholique.
Comme Saint François, le poète a besoin de la nature, des arbres, des fleurs et des animaux, cette nature où se côtoient fragilité et permanence, cette nature qui comme dans les textes de Saint François donnent le sentiment d’éternité.
Certains poèmes de R G Cadou sont proches de psaumes où la fragilité de l’homme est montrée mais toujours une fragilité qui devient force et se change en espérance :
« Pieds nus dans la campagne bleue comme un Bon Père
Qui tient sa mule par le cou et qui dit des prières
Je vais je ne sais rien de ma vie mais je vais
Au bout de tout sans me soucier du temps qu’il fait… » ( Le cœur définitif 1948 )
Les psaumes disent aussi l’homme dépouillé, rejeté, l’homme soumis à l’affrontement du mal ; ils disent les corps souffrants, la peur de la mort, la détresse de l’angoisse et du doute. « Le psaume est une parole dite par quelqu’un avant d’être un écrit par quelqu’un ; l’écrit est là comme une cicatrice. Il y a toujours une raison au cri poussé. Dieu m’abandonne, je suis malheureux, je vais mourir. Alors, je crie vers Dieu et parfois même je crie contre Dieu. » Didier Rimaud (6)
« Mon Dieu! je crie le jour, et tu ne réponds pas; La nuit, et je n'ai point de repos ».Ps 22.3
« Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. »Ps 88.7
« Le cœur me bat, la force m’abandonne
Et même la lumière de mes yeux. » Ps 38.11
« Tu éloignes de moi amis et familiers
Ma compagne c’est la ténèbre. » Ps 88.19
Le psaume c’est se tenir debout devant Dieu, en toutes circonstances. Il y a donc, même dans la ténèbre une prière possible et R G Cadou le sait qui « Adresse à Dieu » celle du 20 juin 1948 :
(…)
Accueille-moi si tu le veux comme on respecte
Le combat terminé un blessé de la tête
Je t’ai trouvé je t’ai perdu je t’ai caché
Comme un billet galant à un autre adressé
Q’on déchiffre en tremblant dans le gel de la chambre
Et qu’on relit avant de le réduire en cendres
Tu ne peux rien pour moi maintenant que je suis
Fané par ton soleil comme une fine pluie
Venue d’un nuage bas qui mettait sur la terre
Quelques larmes de trop au bord de tes paupières
Tu peux bien m’accueillir et m’ouvrir tes palais
Tu ne me rendras point cet amour que j’avais
De la vie ni ce doute inné de Ta Personne
Qui fait que je suis là et que tu me pardonnes.
(Adresse à Dieu)
Au côté nuit du psaume, il y a le côté jour de la louange, le spectacle de la nature élève l’homme.
« La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite; La terre aussi, ses mains l'ont formée. » Ps 95.5
« C'est là que les oiseaux font leurs nids; La cigogne a sa demeure dans les cyprès. » Ps 104.17
La poésie de R. G. Cadou se fait aussi louange cosmique comme celle de Saint François se faisait louange au Créateur, dans Le cantique des créatures.
Pour R. G. Cadou, comme pour François d’Assise « le cosmos est d’abord épiphanie de la lumière. » Eloi Leclerc (7)
Lorsqu’il évoque la nature, c’est un homme pacifié qu’il nous montre comme dans la cantate de la forêt ( 1944) tout à fait dans l’esprit franciscain ; les voix de la biche, de l’oiseau , de l’eau se font entendre, toutes louent Dieu, la forêt toute entière abrite Dieu. Elle est son refuge , de la naissance à la croix :
« Tu loges Dieu dans tes étages
…….
Tu sers de crèches aux nouveau- nés
……….
Je te salue dernière incarnation divine
Je reconnais la croix sanglante et les épines
Largement disposées sur le front du couchant
On dit c’est la forêt
Aussitôt c’est l’image
De Dieu qui déambule…
………….
Ô forêt tu fais merveille
Pour les oiseaux pour les abeilles
Pour ceux qui cherchent leur trésor
Tu es la lampe de mes veilles
Et la lumière de mon corps. » ( 8)
« Cadou est un poète qui a su se « dépouiller » de lui-même, accueillir le monde, le saisir, le posséder le rendre ductible , intelligible aux sens , au cœur , à l’esprit, à l’âme, en exprimer enfin les harmoniques. » Yves Cosson (9)
Le recueil Hélène ou le règne végétal est dans l’œuvre de Cadou l’apothéose de cette épiphanie cosmique.
Hélène est bien proche de la Bien- Aimée du Cantique des Cantiques :
« Que tu es belle ma Bien Aimée
Que tu es belle
Derrière ton voile, tes cheveux comme un troupeau de chèvres
Tes dents, un troupeau de brebis tondues qui remontent du bain
Tu es une grande plaine parcourue de chevaux
Un port de mer tout entouré de myosotis. »
(Cantique des Cantiques)
« Tu es l’algue marine et la plante sauvage
Comme l’arnica
Tu es pleine de poissons dans ta chevelure
Tu es belle figure
Plus belle que toi- même
Tu es celle que j’aime
Davantage que le pain. » (Toi PVE, p.262)
Hélène la « Bien Aimée » par qui le divin s’incarne, elle donne chair à ce mystérieux paradoxe : l’amour réconcilie René avec la mort. Parce qu’il a aimé Hélène, il va accepter sa mort et en quelque sorte en faire don et parce qu’elle l’a aimé, il est certain que l’amour se prolonge, elle est celle qui le fait entrer en communion avec la création toute entière . Avec elle, tout est là, dans la lumière de l’évidence ; Être enfin !
« Que m’importent les fleurs et les arbres, et le feu et la prière, si je suis sans amour et sans foyer ! Il faut être deux ou , du moins hélas ! il faut avoir été deux, pour comprendre un ciel bleu, pour nommer une œuvre ! les choses infinies comme le ciel, la lumière, la forêt ne trouvent leur nom que dans un cœur aimant. » Gaston Bachelard
Hélène fut témoin privilégiée du voyage intérieur que parcourut René. Elle a su regarder, écouter ce tête à tête avec Dieu, hors des dogmes et des églises ; mais bien présent dans le pain rompu avec les amis, dans le vin partagé avec eux. Elle a aimé cet homme qui savait louer la terre pour se rapprocher du ciel et faire de la poésie une « religion » au sens étymologique de religere : relier.
La poésie de R G Cadou, relie la terre au ciel, la présence à l’absence. C’est bien cette poésie qui reliera, au-delà du temps terrestre partagé, Hélène à René. Le poète l’a su et l’a dit :
« Le temps qui m’est donné
Que l’amour le prolonge… »
« Sans rien dire je pris rendez-vous dans le ciel
Avec toi pour des rencontre éternelles. » ( 17 juin 1943)
17 juin 1943, le jour de leur rencontre à Clisson.
Le poète et moine Gilles Baudry, ami de Hélène, témoigne de cette union possible malgré l’absence : « L’éloignement physique ne divise pas, car l’union des êtres entre eux s’accomplit en dehors du monde des apparences. » (10)
Le dialogue entre Hélène et René s’inscrit dans la permanence de l’Amour et de la parole poétique partagée.
Dans les derniers mois de ce qu’il appela « sa passion » René lisait : Le mendiant ingrat et Le Pèlerin de l’absolu de Léon Bloy.
« Tu lèves les yeux, me citant de temps à autre quelques passages. Tu lis Léon Bloy… » (11)
Léon Bloy et Anne-Marie Roulé, un autre couple, un autre amour, une autre aventure mystique…
Durant les derniers mois, Cadou lira aussi Francis Jammes et Paul Claudel.
Hélène et René, une vie en poésie, une vie en communion essentielle, à la lumière de l’amour qui donne sens à l’univers. Cette lumière de l’Amour traverse son œuvre, faite : d’humilité, de recueillement et de contemplation. Ces mots de l’écrivain Petru Dimitriu auraient pu être prononcés par René Guy Cadou comme testament spirituel :
« Mais c’était cela le sens de l’univers : en arriver à l’amour. Voilà où m’avait mené les étapes de ma vie. Tout était maintenant simple, limpide, et se découvrait à mes yeux comme en un éclair qui illumine le monde d’un bout à l’autre, mais sans que la nuit puisse jamais revenir. Pourquoi avais-je tant cherché ? Pourquoi avais-je accepté un enseignement venu du dehors ? Pourquoi avais-je attendu que le monde se justifiât devant moi, qu’il me prouve son sens et sa pureté ? C’était à moi-même de le justifier, en l’aimant et en pardonnant, à moi de lui donner son sens par l’amour et de le purifier par le pardon. » (12)
1 Maurice Zundel : À l’écoute du silence Téqui (1995)
2 – 3 Sylvie Germain : Quatre actes de présence DDB
4 Emmanuel Kant : Considérations sur l’opposition et autres textes
5 Michel Manoll : préface des œuvres complètes Poésie la vie entière ed Seghers
6 Didier Rimaud : Les psaumes , poèmes de Dieu et prières des hommes ed Vie chrétienne
7 Eloi Leclerc Le Cantique des créatures ed Desclée de Brower
8 René Guy Cadou : La cantate de la forêt 1944 inédit , revue Signes N°12-13 René Guy et Hélène Cadou (p.89) ed du Petit Véhicule
9 Yves Cosson :revue Signes N°12-13 René Guy et Hélène Cadou (p.97) ed du Petit Véhicule
10 Gilles Baudry : revue Signes N° 12-13 René Guy et Hélène Cadou (p.23) ed du Petit Véhicule
11 Hélène Cadou : C’était hier et c’est demain ed du Rocher (p.25)
12 Petru Dimitriu : Rendez-vous du jugement dernier Seuil 1961
Extrait des actes du colloque René Guy et Hélène Cadou poésie et éternité des 20,21 et 22mars 2014 organisé par l’Université Permanente de Nantes et les Cahiers des Poètes de l’École de Rochefort .
On peut se procurer l’ensemble des actes : les Cahiers des Poètes de l’École de Rochefort-sur-Loire N°4 éditions du Petit