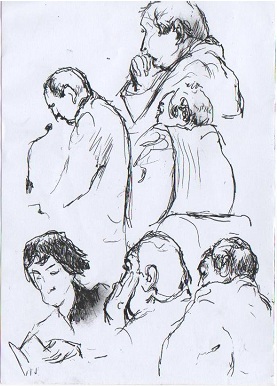Un pétrarquiste sicilien méconnu
Giovanni Di Michele
Pétrarque, on le sait – et non Dante – a dominé les Lettres européennes pendant deux bons siècles, avant d’être exténué et de finir par lasser, aux derniers feux et excès d’un maniérisme post-baroque. Dans les marges frontiere également, et en des langues bientôt minorées, son influence a été partout sans conteste ; ainsi dans la déjà provinciale Sicile – en dépit de la renommée du « Pétrarque sicilien » Antonio Veneziano –, à partir du grand répertoire des Muse Siciliane de G. Galeano (1647-53, puis 1662) : en anthologies donc, peut-être parce qu’aucun auteur ne parvenait là à une suffisante affirmation personnelle. Forme de résistance, du moins langagière, mais presque en tout dépendante des modules toscans dominants, à l’influence espagnole par ailleurs omniprésente (du reste, au positif, les rapports entre Veneziano et Cervantès furent notables et féconds). Ailleurs, dans les Italies de ces siècles sombres, les mêmes stylèmes se retrouveraient sans solution de continuité (un exemple suffira : « Era la donna mia pensosa e mesta », incipit de Pic de la Mirandole, récemment mis en français par François Turner – mais aussi Renaud passant une nuit « pensosa e mesta » dans la Jérusalem délivrée, XVIII). Notre auteur s’insère parfaitement dans ce cadre général, pour ainsi dire avec résignation ; il s’en distingue par une plus grande variété (y compris çà et là non lyrique), une richesse d’intérêts et de style, aux côtés de quelques autres poètes intéressants tels Mighiazzu et Scimeca.
Dans le ms. 603 (1658) de la Bibliothèque du Musée Condé de Chantilly – objet de la thèse soutenue par Tobia Zanon en 2008 (cotutelle CIRCE - Univ. de Vérone) –, un élégant in-12 oblong de plus de mille pages, soigneusement écrit et intitulé Scelta di Canzuni siciliani, deux auteurs au moins ont été de véritables découvertes, Giuseppe Durazzo (Durazzu) et Giovanni Di Michele. Mais c’est ce dernier, Giuanni Di Micheli, qui a retenu aujourd’hui notre attention, d’abord par le sens de révolte et l’amertume (amoureuse, mais surtout sociale et politique) de ses vers, ensuite par le caractère moins convenu ou occasionnel du petit ensemble des poèmes choisis par le compilateur de ce Choix ancien. Il n’est pas étonnant que deux de ses canzuni (des ottave siciliennes écrites dans une langue quelque peu adoucie de toscanité commune), Chist’è lu locu… et Cui trasi ’ntra st’orrenda sipultura, aient été attribuées par Giuseppe Pitrè au poète (et ecclésiastique) engagé Simone Rau ; et, de là (pour la seconde) reprise par Sciascia au début de Morte dell’Inquisitore, 1964, comme graffiti extrême d’un condamné au bûcher après question (voir ci-dessous, 63 : Cui trasi ’ntra st’orrenda sipultura / undi regna la stissa crudeltati, truvirà scrittu a li tartarei mura / «Nisciti di speranza, vui ch’intrati !» / tantu s’agghiorna ccà quantu si scura, / sempri si trivulia, stenta e pati / perchì non si sa mai lu iornu e l’hura / di la sua disïata libertati.). Et l’on pourrait penser encore à certains sonnets un peu mieux connus de Tommaso Campanella, lui aussi enfermé et atrocement torturé non loin de là, à Naples.
Voici donc, dans l’ordre où les compositions apparaissent dans le volume manuscrit (cf. éd. Zanon, dans le tome II de sa thèse : Le ms. 603 de la Bibliothèque du Musée Condé, 2008, p. 169-90) :
Comme brillante sphère en limpides ondes
qui diffuse là ses rayons dorés
et aux endroits obscurs, tristes et profonds
fait parvenir son or ensoleillé,
tel je me sens sous tes regards où je fonds
alors qu’ils se portent de tous côtés,
faisant resplendir le ciel et mille mondes,
et moi, taupe, ouvre les yeux et mourrai.
Comu lucida sfera… [Zanon 21]
La prison est une école d’ignorants,
bêtise pour les sages avisés,
enfer de pauvreté, misère et effroi
de la plèbe enfermée, des pauvres gens,
guerres continues, confusion, et des saints
fort peu de dévotions et presque rien,
tracas d’étrangers, deuil et lamentations,
repaire de traîtrise et tromperies.
La carzara è una scola... [Zanon 34]
De temps à autre dans cette sépulture
ma mémoire se met à naviguer
du lever du jour jusqu’à la nuit obscure
sur une mer de songes, de pensées,
car il se peut que ma dame, d’aventure
par l’éloignement rendue dépitée,
change son désir et que pour mon malheur
je meure ici d’extrême jalousie.
Di quandu in quandu… [Zanon 55]
Qui entre dans cette horrible sépulture
où règne une pérenne cruauté
trouvera écrit sur ces murs du Tartare :
‘Laissez l’espérance, vous qui entrez !’
Il fait jour ici autant qu’en nuit obscure,
toujours à souffrir, supporter, peiner,
car on ne sait jamais ni le jour ni l’heure
du retour à la chère liberté.
Cui trasi ’ntra st’orrenda… [Zanon 63]
Du lever du jour jusqu’à l’obscurité
je fais de ma mémoire un labyrinthe
tel que qui veut en sortir et mesurer
se trouve plus que moi las et contraint :
je le mure et tisse, et le défais sans cesse,
et toujours suis empêtré dans ses rets,
et quand je me crois sur le point d’en sortir,
c’est alors que j’y suis plus prisonnier.
Di quandu agghiorna… [Zanon 76]
___________________
(Sur les langues minorées de la Péninsule italienne voir ma rubrique ‘Frontiere, Marches’ dans : http://nositaliesparis3.wordpress.com )