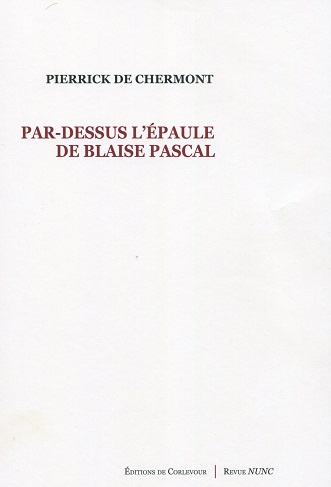Quand sera brisé l’infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle par elle, l’homme, jusqu’ici abominable, - lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi ! La femme trouvera de l’inconnu !
Arthur Rimbaud
Dans ses Mémoires, François Augiéras confie qu’il conserve de Paris un souvenir horrifié. Jusqu’à l’automne 1933, cette ville fut le théâtre des huit premières années de sa vie, atrocement tristes, près de sa mère veuve. (Son père, pianiste de concert, est mort aux États-Unis, peu avant sa naissance.)
L’évènement déterminant de ma petite enfance est le fait que mes yeux se sont ouverts sur une civilisation dégradée.
La seule image digne d’être conservée est celle, fantastique, d’un énorme dirigeable : le Graf Zeppelin argenté, irréel, traversant, très bas, le firmament. Il le contemple, d’un toit. Dans son imaginaire enfantin, ce monstrueux astronef, étincelant sous le soleil, est peut-être envoyé par une autre planète. En mai 1937, le dirigeable allemand Hindenburg, fierté des Allemands, s’enflammera en atterrissant, près de New-York. Sur cent passagers, trente-trois périront. Ce sera la fin du luxueux transport de passagers en paquebot volant.
Sa vie durant, Augiéras clamera son aversion pour la capitale et pour le roman français contemporain. Dès ses premières contemplations nocturnes du ciel, dans la campagne du Périgord, le jeune garçon est ébranlé par le caractère religieux et aphrodisiaque de l’infini qui aspire son âme. Plus tard, il n’en parlera jamais sans susciter vertiges et frissons. Au ciel sont liés les premiers émois. Sa semence tachera souvent ses draps ; ses rêves d’enfant sont des voyages peuplés de feux d’artifices stellaires. Des tourbillons de plaisir l’entraînent vers les plus lointaines nébuleuses, comme autant de prairies d’où jaillissent des pluies de fleurs inconnues. A qui confier cet insondable mystère ? Certainement pas à sa mère indifférente, neurasthénique, ni à son adorable tante Germaine, châtelaine trop mondaine. Ses compagnons d’aventure, tournés vers le monde extérieur, ne le comprendraient pas davantage. Chaque acmé est un nouveau Big Bang. De plus en plus, firmament, orgasme océanique et ‘âme éternelle’ sont liés, dans la pureté d’un opéra de l’espace. Avec un parfait naturel, il dit aimer son âme. Il s’entretient avec elle.
Secret dialogue avec mon âme éternelle, immuable et solitaire, comme Dieu, cachée derrière les incarnations et les masques…Le son infini, toujours audible dans mon cœur.
Chargé de garder jusqu’à l’aube une voie ferrée, pendant la guerre, il dialogue avec la nuit. Il scrute sans fin le cristal des cieux, le plus vertigineux temple du monde, dont la beauté le subjugue.
Est-ce ma vraie patrie, le pays de mon âme ? Un invincible appel auquel je me promets, ma vie entière, de répondre !
Ainsi naquit le corps subtil de François qui ne cessera de s’affiner, jusqu’à lui conférer de puissants pouvoirs psychiques. Il refusera toujours de les cultiver. Pourtant, au-delà des prédictions personnelles, il nous laisse de brûlantes prophéties. Elles se réalisèrent toutes. Citons, entre autres, le retour à une vie écologique, le déferlement des premiers Tibétains au Périgord, après l’invasion de leur pays par les Chinois, le sanglant printemps arabe, la guérilla qui s’étend sur le monde, les révolutions informatiques et quantiques, la conquête spatiale, etc. On n’en finirait pas d’énumérer les phrases du genre :
France appauvrie, future province de l’Asie ; Europe en ruines, plus envahie qu’on ne le croit. (Les barbares d’Occident).
Je scrute souvent le ciel nocturne, en évoquant l’‘âme éternelle’ d’Augiéras qui scintille plus que les autres étoiles. Une âme pour laquelle, depuis son adolescence, tout est zone érogène : l’aura des êtres, les prés odorants, les falaises, les sources, les ondes qui nous entourent et la voûte céleste, surtout. Peu importe pour ce panthéiste si l’amour fou est humain, animal ou divin, minéral, végétal ou galactique. C’est à cette force de la nature que semble dédié Le sacre du printemps d’Igor Stravinsky, l’ami de feu son géniteur musicien,
Ma trajectoire assez désinvolte dans le monde des lettres relève, pour une bonne part d’une gaieté très slave, sauvage, un peu dansante : un côté Parade et Ballets Russes. (Lettre à Jean Chalon, 3 mars 1968. Le diable ermite. Éditions de la Différence, 2002.)
L’œil candide, il déploie les filets de son érotisme en tous sens. Est-ce sciemment ? Parfois, des astéroïdes semblent tourbillonner dans son sang. Ses amours portés au paroxysme ne font que refléter ses progrès spirituels. En 1960, dans Combat, Jacques de Ricaumont célébra Le voyage des Morts. «Étant, selon son expression, ‘antérieur au christianisme’, Augiéras se sent couvert par une sorte d'immunité édénique, car il tient pour licite tout ce qui est naturel, et il ne suit en chaque occasion que son instinct. De là, l’idée que la perversion est étrangère à ce pansexuel et que le mot ‘pur’ est l’un des leitmotifs de son récit. S’il pratique sans la moindre honte toutes les formes de voluptés, et s’il les décrit sans la moindre gêne, c’est parce que non seulement il n’a pas conscience d’offenser Dieu, mais il est convaincu de rendre ainsi hommage au Créateur.»
Augiéras vénère les solstices. Surtout la porte du solstice d’été, inaugurant la phase d’obscurantisme du soleil qui va décliner. Il aime aussi la lumière va croître à la sombre porte d’hiver. Décembre est toujours très ancien. C’est le seuil de la voie des ancêtres, celle du Pays des Morts et de leur renaissance. La lumière des cieux est l’élément premier. Submergé de lumière astrale, à l’âge d’Arthur, Augiéras en sera toujours bouleversé, comme au premier soir.
Le chanoine qui fait travailler le fugueur dans les champs le surprend chez lui, penché sur son manuscrit, à quatre heures du matin. Le brave homme en pyjama ne peut comprendre que ce garnement a déjà saisi, à dix-sept ans, ce pourquoi il vit. Le discours halluciné du fils de Pan l’épouvante. Il n’est question que des étoiles et de la métamorphose de l’homme en Dieu, que l’ « illuminé »voit. Il est missionné, affirmera-t-il dans ses Mémoires.
-« Vous écrivez ! Et quoi donc, je voudrais le savoir ? »
Je lui explique que je sors souvent la nuit pour regarder les astres, qu’une mutation de l’homme me semble très probable, que je veux aller vers l’avenir, que c’est le récit de mes courses nocturnes.
Mis à la porte, l’écrivain en herbe travaille à ses Noces avec l’Occident jusqu’à l’aube, dans une tour de château périgourdin ; c’est chez la sœur du colonel, dont il veut conquérir le cœur. Noces d’un garçon précoce, gorgées de sucs amoureux. Un désir incarnat irrigue puissamment les scènes très brèves, dans la nature transfigurée. Les adolescents défaillent de plaisir, sous l’édifice des étoiles qui flambent.
Ils crurent rouler entre les astres incandescents au plus noir du ciel, dans la nuit criblée de soleils tournant à une vitesse prodigieuse. Eux mêmes, changés en flammes, se traversaient dans leur course sans se briser, animés d’un mouvement circulaire qui forgerait leur unité, transfigurés de joie, éternels musiciens et danseurs. (Les noces avec l’Occident. Le texte initial de 1943 envoyé aux Cahiers du Sud, à Marseille, s’égara. Éd. Fata Morgana, 1981). Augiéras sait ce qu’est l’amour avec les filles et avec les garçons. Il creuse les racines du désir qui fouaillent les étoiles. Dépositaire d’une mémoire traversant les corps et les âges, il pose là les bases de son mythe fondateur, celui du passeur entre l’homme et l’univers. Puis il oublie son manuscrit en partant en Afrique. En 1950, il en confie un double, complété, au peintre Marcel Loth ; il sera retrouvé dix ans après son départ vers d’autres cieux.
Elle était prédestinée, la rencontre avec un autre adorateur fou des étoiles. Oncle, père rêvé, amant, démon divinisé, dieu. Le destin d’Augiéras prend corps d’une manière brutale, sur un toit saharien, avec les lamentations hypnotiques et triomphales d’Abdallah Chaamba, son nouvel avatar.
L’ébauche du récit, Le Vieillard et l’enfant radical et foudroyant, éblouit André Gide. « L’intense et bizarre joie que je prends à la lecture (et relecture) de ces pages remarquables entre toutes. »
Le Voyage des Morts contient quelques lignes des Noces avec l’Occident. En mars 1950, seul dans sa chambre de Périgueux - comme le précisent ses Mémoires - Augiéras commence à rédiger son journal. Il a eu tout le temps de revivre ses deux premiers séjours chez le colonel, en 1947 et en 1948. Mais sa plume ne l’a pas encore vengé publiquement du tyran. Il a déjà travaillé, armé, dans le chantier d’une route en construction, près de l’oasis de Ghardaïa. Il décrit l’immense carrière de pierres, ainsi qu’une rencontre amoureuse avec un berger de dix-huit ans. Sans doute Abd Allah - ou son double passionnément aimé. Là, nous sommes encore près de l’accent juvénile des Noces avec l’Occident.
Rien n’est plus beau que l’amour ; rien ne s’élance plus loin, non pas l’amour de tous les hommes, mais celui des compagnons d’aventure, l’amour né près des feux.
Ce sont sans doute les premiers passages du singulier Voyage des âmes. Reprenant cinq vers du début de « l’hymne à l’amour » des Noces, ils comportent une variante, à la fin. « L’amour né dans les bois et dans les camps de travail de ce siècle » devient « l’amour né près des feux ».
À Agadir, épuisé par son travail de pêcheur, le petit voyou des faubourgs s’abat sur le dos, à même le ciment, et il mange la lumière, pensant aux êtres qui se nourrissent de lumière.
Recherchai-je le plaisir dans ces rendez-vous d’amour sur les rochers, au clair de lune ?... Certainement pas, mais la rencontre avec le Sacré, au péril de ma vie. (Lettre du 14 mars 1969 à Pierre-Charles Nivière. Nouvelle NRF. 556. Janvier 2001.) Que de fois décrit-il, comme dans ses Mémoires, le « rituel de la montée vers les astres »… Après s’être assouvi chez les filles du quartier réservé, il retrouve un berger berbère de son âge. Il cherche un dernier assouvissement, mais de l’âme...Cet amour-là satisfait le meilleur de moi-même. Que faisons-nous ? Ça reste extérieur, manuel… C’est cela qui m’émeut ; ce dialogue avec tous mes masques possibles… Je suis heureux seulement sur les dernières dalles éclairées par la lune, sur le seuil de mon temple infini brillant d’astre et des constellations, mes lèvres contre les siennes, au bord de ma maison du ciel.
Cet animiste appartient à la tradition solaire. Les rayons du soleil sont des milliers de caresses sur sa peau nue, libérant d’infimes étincelles de volupté. Mais si l’astre des Hespérides, cher à Rimbaud, est son père désiré, la lune, divine Mère, est son « épouse » incestueuse. Ce grand luminaire blanc, calciné par le brasier du soleil, est une divinité qu’il sied d’adorer à genoux en effectuant mille offrandes. Surtout lorsqu’elle est enceinte : encens, méditations, feux de joie, thés bouillants, chants, danses, transes - sans jamais omettre le don de sa sève ou de son sang, à la fin du rituel. Le sommeil dans la nature érotisée lui est dédié, comme beaucoup de songes, pages et peintures d’Augiéras. Rarement les phases lunaires jouèrent un rôle aussi essentiel chez un artiste.
Les pluies d’étoiles filantes lui procurent un plaisir électrisant. Il les décrypte comme un message personnel, en exultant ; destinées aux papilles sensuelles de l’esprit, elles figurent l’éclatement d’un millier de groseilles dans un firmament de gourmandise. Après s’être prosterné en pleurant de joie, il traduit comme personne les affres du plaisir, dissous avec lui dans l’immense féérie changeante du clair de lune.
Il décrit ses saisissements devant cette lune, déité de la volupté, surtout lorsqu’elle apparaît lentement dévêtue, ou se cache derrière une éminence. L’antique culte païen est pieusement préservé dans maintes contrées retirées, en Orient. On peut encore assister, par exemple, à l’extinction de toutes les lumières et de tous les sons, le temps que la lune disparaisse derrière une montagne C’est le triomphe de l’érotique sacrée, depuis des temps sans commencements.
Il suffit de peu à cet être éveillé pour s’approcher du nirvana, l’état naturel vers lequel il tend en permanence - un nirvana qui n’est pas le vide, mais le plein, l’énergie à l’état brut. C’est l’homme le plus religieux qui soit, au sens propre de religare, constamment relié aux forces du cosmos. Il vit dans la vénération de l’énergie divine, l’adoration perpétuelle « de l’Univers qui est Dieu ». Par d’autres chemins, il rejoint Proust, qui avait l’intention d’intituler le dernier volume de son œuvre L’adoration perpétuelle. (Les souvenirs de Jacques Benoist-Méchin contiennent un extrait de lettre de Marcel Proust, qu’il connut. « La Recherche du Temps perdu, comme son nom l’indique, est un long voyage. Non point à travers l’espace ou le temps, mais à travers l’âme humaine, une plongée vers cette zone où tout serait communicable, où nous pourrions voir non point un autre monde - car je ne suis pas certain qu’il existe - mais ce monde-ci avec les yeux d’un autre, de cent autres, voir les cent univers qu’est chacun d’eux. Nous entrerions alors dans un état ineffable, semblable à celui que les Pères de l’Église appelaient « la Communion des Saints »… J’ai pensé tout d’abord achever mon œuvre par un volume qui se serait appelé L’Adoration perpétuelle.»)
Au Sahara, le jeune Augiéras passe des heures, allongé sur le dos, sous un véritable "ciel de lit", le visage face au spectacle de l'univers en expansion. Elle est prédestinée, la rencontre avec un solitaire, adorateur fou des étoiles. Oncle, père rêvé, amant, démon divinisé, dieu. D’où le thème obsédant du lit de fer sous des marées d’astres, où jouissance et douleur sont indissociables des constellations de l’Afrique, dans Le Vieillard et l’enfant.
Je volais jusqu’à lui, acceptant de voir face à face ma nuit éternelle que j’avais voulue dans les bras d’un vieillard...
Le Voyage des Morts paru en 1959, deux ans après le lancement du premier satellite artificiel, permet de comprendre la relation scandaleuse entre Augiéras et son oncle explorateur, son père du désert : ils sont du même sang, et ils ont des constellations dans les veines.
Qu’il eût été séduit, au sens sexuel du mot, par le ciel étoilé, au point de ne pas souhaiter l’amour (et l’amour des garçons) ailleurs que sur un lit de fer, sur une terrasse, signifiait beaucoup dans une époque qui allait être hantée par les étoiles. (Le Voyage des Mort. Éd. La Nef de Paris, 1959).
Le chagrin du jeune homme tombé en esclavage est abyssal. Mais il se soumet à la volonté du monstre sacré qui lui dicte L’éternité et le cosmos, fruit de quarante ans de solitude. Il maintiendra toujours sa ligne de conduite : une abstraction qui tienne face aux astres. « Mon équation sous le ciel étoilé ». Ce qui stupéfie le neveu du scientifique n’est pas le viol, mais le fait que son parent pratique aussi la religion des astres, océans de feu. Âgé de soixante-deux ans, le colonel Augiéras, retraité de l’armée française, règne en ermite de légende, en mage chaldéen sur le royaume intemporel qu’il a fait bâtir, près de son mausolée pyramidal. En sabots de bois, l’astronome qui perd la vue est souvent nu sous sa cape de soldat, écarlate comme la cour de son domaine. Pour la « montée vers les astres », le militaire gravit parfois à genoux les marches, jusqu’au lit de fer de sa terrasse.
Qu’un Français eût bâti, cela n’avait rien d’étonnant ; que ce fût le premier sanctuaire au vingtième siècle l’était. Mon oncle, qui trouva sa survie sur mes livres, comme si les étoiles m’eussent prié de m’aimer. (Le Voyage des Morts.) En 1958, juste après la mort de son « oncle des sables », ce veilleur de naissance monte la garde d’un fort isolé, aux confins de l’Empire qui s’écroule. Il écrit Zirara.
Un véritable amour, une véritable religion... J’aime la lune comme on aime une femme. Dès qu’elle brille sur les palmeraies, je file doucement vers les hautes herbes de la brousse, je m’avance jusqu’aux rives du lac ; à proximité du désert, un poignard au travers de ma ceinture, j’adore la lune, et sans vouloir m’expliquer, tu peux deviner ce que je peux faire. Quelle fille connue dans un bal serait aussi belle, aussi douce que l’Astre des Nuits ! (Lettre à Paul Placet, Zirara, 30 juillet 1958. Ed. Fanlac. 2000.)
Les astres défunts, dont nous sommes venus, devraient conférer un ton dramatique à sa voix, en ces temps où la mort joue sur tous les tableaux. Non. La transhumance des âmes n’est pas, pour François, une éternelle tragédie. Elle est joyeuse. Le ciel est beau comme l’orgasme d’une fée ou d’une nova, dans les abîmes de la vacuité. A l’instar d’Anaxagore, Augiéras aurait pu affirmer qu’il était « né pour contempler le soleil, la lune et les étoiles. » Son audacieuse modernité donne un singulier relief à des codes désuets, comme à sa délectation d’étreindre en dansant de vieilles lunes aux baisers d’argent. Chorégraphie d’un plaisir aussi ralenti que violent. Divine lenteur de la foudre. Les extrêmes se touchent souvent chez cet être libre, sur tous les plans. Dans L’Apprenti sorcier, il avoue ne plus savoir s’il est magicienne, animal, divinité, Homme, Femme ou Nymphe.
Que ses amours soient physiques, telluriques ou célestes, son comportement amoureux est toujours lié à la splendeur du ciel. Averses d’étoiles ou innocence de l’azur. Cet azur, il l’aime tant qu’il parvient à en discerner l’éclat dans un braséro éteint, au fond de l’obscure chambre d’amour d’une bergerie de montagne algérienne. Dans Le Voyage des Morts, cet azur est Dieu répandu dans l’espace. Et si la nuit était l'azur des amants ? La lueur sur les tisons morts était bleue, un azur parfait.
Toute nuit est lumière. Ainsi se résume la pensée d’Héraclite, vingt-six siècles avant lui. Très tôt, il veut relier ses deux passions dans ses toiles.
Mes amours et le ciel étoilé, je voudrais les peindre. Mais dans quel style ? Cela m’obsède aussi.
Des critiques ont fait remarquer que la nature était le personnage principal de ses livres. C’est plutôt le firmament, en toile de fond, sur lequel règne la divinité de la Nuit. Omniprésente, surtout dans le silence primitif du désert. C’est là qu’Augiéras découvrit vraiment son ‘âme éternelle’, en méditant, jusqu’à en être drogué, sur les poussières vivantes d’étoiles dans le ventre céleste.
Pour bien comprendre ce migrant, il faudrait se situer à la même altitude mentale que ce lui. Comprendre aussi qu’il possède une fantastique vitalité surpassant celle de son oncle, célèbre chasseur de fauves. Foncièrement libre, il est et demeurera Homme debout parmi les hampes de roseaux.
Tenter de traduire l’amour, tel fut le premier élan de François-Verge-d’Or, sur la terre des Grands Ancêtres primordiaux qui entretenaient une relation religieuse avec l’univers. Pour lui, toute chose est d’essence divine ; une multitude de lettres en témoigne. Tout se passe comme s’il pressentait que l’éblouissante lumière de l’Éveil surgirait lors de la transmutation de l’énergie. La clé de son œuvre, c’est qu’à partir de huit ans, il vit l’expérience de l’illumination. Sans le savoir, il réinvente les techniques chamaniques de l’extase. Il contemple éperdument les étoiles qui, elles aussi l’observent, surtout les nébuleuses, qui sont des accoucheuses d’univers. Il entend la musique des sphères. Il fait l’amour avec le monde. Il le fera jusqu’à la fin de ses jours. Il fusionne avec l’espace, comme s’il étreignait tous les corps. Tel un yogi, il n’a pas besoin de support physique. Dans son ascension vers la voûte céleste, sa quête consiste à saisir la nature de l’esprit, immuable comme le ciel.
La violente expérience orgasmique du corps et de l’esprit, loin de le dissoudre, lui fait atteindre des états supérieurs de conscience. Vénus veille sur lui, miroir de la déesse de l’amour et de la connaissance par l’intelligence des sens et du cœur. Conscience cosmique et sens aiguisés. Il s’évapore dans l’espace. Mais plus il se dissout dans une autre dimension, plus il se trouve. Très jeune, à l'opposé de l'onaniste, il fait jouir son partenaire, le Monde, excellente école avant la découverte du désir démesuré pour l'Autre, pour l’Ailleurs.
Plaisir extrême, sans support, spontanément accordé au désir des étoiles - deux termes, on le sait, dérivant de sider. Son désir est sidéral, sidérant. Désir provient du verbe latin desiderare, dérivant de sidus, sideris, désignant l’étoile, et signifiant « regretter une étoile disparue». Le désir est foncièrement source de Connaissance ; François est un « homme de désir », dans la mesure où ce désir ardent est quête d’amour, de création, de sacré, c’est-à-dire de ce qui relie à l’univers. Il plonge dans le supplice des « braises de satin » cher à Arthur Rimbaud, son poète préféré. Celui de L’Éternité :
«Puisque de vous seules,
Braises de satin,
Le Devoir s’exhale
Sans qu’on dise : enfin.
Là, pas d’espérance,
Nul orietur.
Science avec patience,
Le supplice est sûr.
Elle est retrouvée.
Quoi ?- L’éternité
C’est la mer allée
Avec le soleil. »
François se ressource en puisant dans l’Énergie du Vide céleste. En cas de danger, ses amies les étoiles le protègent. Le rameur immobile, de crainte de chavirer, regarde les étoiles. (Inédit cité par Paul Placet. Vézère, toison d’or. Ed. Des Pêchs. 2013.) Il ne cesse de renouveler son pacte avec les forces élémentaires de la nature. Il recouvre, d’instinct, les gestes des premiers âges. Ébloui par la splendeur de la vie, aussi dépouillée que la voûte céleste, il lui arrive souvent de tomber à genoux et de tendre les paumes vers le ciel criblé d’astres.
Sur un toit, la nuit, rêver en paix était ma vraie vie. De gratitude, j’ouvris mes mains vers les étoiles. (Le Voyage des morts).
Les dieux de la Grèce antique ne choisirent-ils pas souvent la Terre pour abriter leurs ébats sublimes avec de simples mortelles ? Avant le grand saut dans l’inconnu, Augiéras a déjà la sensualité primitive d’un jeune berger nomade et le mysticisme d’un anachorète. Sachant que la brillance du monde se confond avec la divinité, il a le rare privilège d’aimer pour l’amour de l’amour. Son ami et biographe, Paul Placet, bien placé pour en juger, a toujours dit que François Augiéras n’est pas homosexuel ; il ne fut pas et ne sera jamais un sodomite. Dominique Fernandez s’en porte garant. Il écrit qu’Augiéras, « tout en prenant librement son plaisir avec de jeunes garçons, a ressuscité rien de moins que le cérémonial et le faste de l’amour courtois.» (Une aristocratie morale. Europe. N° 931-932. Novembre-décembre 2006.)
Dans Augiéras, le peintre (Ed. de la Différence. 2001), le peintre Jean-Joseph Sanfourche, proche d’Augiéras, jadis, confirme : « Il fut un amoureux de la beauté, de la jeunesse, de l’enfance qui porte en elle tous les espoirs, toutes les interrogations. Je ne crois pas du tout à cette homosexualité. Il était probablement l’homme de tous les amours.» Pour ce fils de Pan, l’amour pour toutes les créatures, émanations divines, constitue un acte de purification. Dédaignant les conventions de son pays, il est fier de sa virilité. Avec un tranquille orgueil, il n’hésite pas à le faire savoir, dans ses lettres, ses livres, de vive voix. A propos des jouvencelles à séduire, il écrit à Paul Placet: J’ai essayé de cacher ma sauvagerie, de faire l’homme du monde aimable en dissimulant mes oreilles et ma longue queue de loup.
Dans Le Voyage des Morts, il confie : Entre ses cuisses sombres, je glissai ma belle queue pointue, après l’avoir graissée avec un beignet doré.
Du Maroc, il arrive un soir à la maison sans prévenir, tel un orage de chaleur. Comme chaque fois, avec un naturel déconcertant, il éprouve le besoin de d'évoquer ses débordements dans les petits bordels d'Afrique du Nord. A table, il parle crument de son zob, « beau, long et dur », à la troisième personne. Il décrit sa jouissance volcanique, qui l’électrocute, infailliblement. Si violemment que c’est toujours comme la première fois. Si bien qu’il ne songe qu’à recommencer. Ce qu’il fait - même en rêve, ajoute-t-il, où l’attend son âme immortelle, dans les galaxies. Une impudeur magnifique, géante. Jean Genêt sur le divan, déchainé. Mais un Genêt angélique, céleste, qui tutoie aussi bien la mort que les anges et les démons. La « Mère terrible » - mère de mon compagnon de l’époque, chez laquelle nous habitons, dans le Tarn - ne sort jamais de son antre, au rez-de-chaussée. Qualifiée de « sorcière préhistorique » par François, elle se dit traumatisée d’héberger à l’étage « un sale type qui fait le trottoir à Alger. Si les voisins savaient çà !»
Augiéras parvient parfois à l’orgasme, sans le chercher, en se laissant flotter parmi les fleurs aquatiques constellant la Vézère incendiée par le soleil. Pour lui, la rivière (ma seule épouse) est Femme. Elle renvoie à son élément aquatique, à la salive de son coquillage, à sa rosée voluptueuse. Sa partie féminine, dit-il, a besoin d’être fécondée par la puissance infinie des cieux. Il prend avec les yeux. Il est capable de provoquer d’étranges phénomènes dans la moelle épinière d’autrui, par la grâce du regard et du mental.
Les jouissances de François, peuvent avoir lieu sans qu’il ait besoin du sens du toucher, de la vue, de l’odorat ou des autres sens. Il lui suffit de s’abandonner à certaines visions, sans relation apparente avec ce que l’on nomme les plaisirs des sens, mais qui les contiennent tous. Des images de l’infini céleste, des explosions d’étoiles colorées, des sensations à l’état brut, de l’énergie à l’état pur. Il s’identifie à une femme qui jouit, ou plutôt à un androgyne, ce qui le relie au cosmos. Il vit l’amour cosmique au sens fort du terme. Si le plaisir est solitaire, il ne culpabilise pas. Il le décuple en le partageant, religieusement. « Celui qui jouit le plus est celui qui prie le plus » écrit Büchner dans La mort de Danton. François Augiéras est capable de retenir sa semence à volonté. Il est tantrique de naissance ; il n’a jamais reçu d’initiation à des techniques exigeant une longue ascèse. Une de ces initiations permet de pratiquer le yab-yum, l'union parfaitement immobile avec une partenaire, aussi bien de chair que de pur esprit. Chez cet exilé sur terre, il ne s’agit d'une tendance naturelle à transformer l'énergie sexuelle en énergie spirituelle. Et l’on sait que plus la première est puissante, plus la seconde en bénéficie. Pour s’élever, dans le tantrisme, encore faut-il avoir une passion à transmuter. La jouissance d’Augiéras est parfois comparable à celle d’une femme fontaine, lorsque les écluses sont lâchées. Une de mes relations, authentique hermaphrodite, m’affirma en secret qu’elle pouvait choisir de jouir, à volonté, comme un homme, comme une femme ou, parfois, comme les deux à la fois. L’honnêteté de la personne incite à le croire.
La solitude de François est de plus en plus fondamentale, jusqu’à son dernier souffle. Cette solitude est le prix de la liberté. Son œuvre n’émergera, bien après sa disparition, que s’il va jusqu’au bout de son grandiose isolement. Cet exilé sur terre le sait.
Je suis seul…Je suis quelqu’un qu’on ne peut jamais aider.
Sa solitude constitue l’ostinato musical de tous ses ouvrages
L’édifice admirable des étoiles brillait sur les roseaux, sur les eaux : au loin, le musée de mon oncle… A l’écart des autres hommes, une pensée dont je comprenais enfin la valeur inestimable : la solitude.
( …) La fin du siècle verra la victoire de l’opinion des solitaires. (…) Rien ne se fait de grand que dans le silence et dans la solitude.
Mais pour cet affectif, l’Autre est ce qui importe le plus au monde. L’autre devient lui. Il a besoin de se séduire, de se surprendre, de s’inventer tous les jours, non par narcissisme mais pour DONNER, à voir, à lire, à méditer, de la manière la plus intense qui soit.
Quand vient le soir, la magie du crépuscule, j'entends l'appel vers la musique, vers la littérature, vers les aventures ... vers l'amour. Mais le matin ! Face au réel, j'éprouve terriblement le besoin de fabriquer, au cœur même du réel, des objets qui soient beaux. (Lettre à Jean Boyé, 8 mars 1957. Augiéras le Peintre. Éditions de la Différence, 2000.)
Un seul ciel ne lui suffit pas. Comme Giordano Bruno, il croit en la pluralité des mondes. Dès le début des années 60, il a étudié Les Somnambules d’Arthur Koestler, analysant l’œuvre des astronomes dont le génial précurseur est Giordano Bruno. (Éditions Calmann-Lévy, 1960.) Il ne lira que des extraits de l’auteur des Fureurs héroïques, puis l’essai d’Émile Namer sur le philosophe napolitain de la Renaissance (Bruno, Éditions Seghers, 1966). Il en fut profondément troublé.
« Ainsi, il n'existe pas seulement un monde, une terre, un soleil, mais autant de mondes que nous pouvons voir de lumières briller autour de nous, qui ne sont pas plus dans un seul ciel, un seul espace, un seul contenant sphérique que notre terre ne se trouve dans un seul univers, contenant un seul espace ou un seul ciel.» (Giordano Bruno. De l’infini, de l’univers et des mondes. 1584). Lui-même n’est-il pas inscrit dans le ciel ?
Il me semble être parfois une lointaine étoile (…) Disons, si tu veux, un quasar, ces étoiles difficiles à situer, aux signaux très énigmatiques et sur le compte desquelles toutes les hypothèses sont possibles. (Lettre à Jean Chalon. 29 mars 1970. Le diable ermite. Éditions de la Différence, 2002).
Le nomade sait, depuis toujours, visualiser les univers en cascades. Domme ou l’Essai d’occupation est, comme les précédents, un livre de survie du Grand Vivant. Son testament. Augiéras offre ici le secret de son androgynie spirituelle, dans une nuit de fête et d’amour.
Ce soir du solstice d’été, j’aime les astres plus qu’à l’accoutumée. C’est un appel amoureux, sexuel, à un niveau de conscience ignoré des humains ; je ressens l’infini qui émane des astres. Ils sont la beauté même. Ils flambent. Ils sont l’Énergie Primordiale incarnée dans les espaces et les temps. Avec une joie sauvage, la part féminine de mon âme se laisse pénétrer par la force du ciel ; elle s’abandonne aux hasards et aux métamorphoses ; elle accepte de vivre éternellement dans un demi-sommeil, aimée, rêvée par les étoiles, tandis que le côté viril de mon caractère tend à voir l’Univers, à participer à son existence dans un état de pur éveil, à l’aimer en toute lucidité.
Vers la fin de sa vie, dans le dénuement grandiose de sa grotte, il retrouve le temps d’avant la rupture entre les humains et les dieux. Il appelle de toutes ses forces la Femme et l’Homme futurs, tournés vers les grands Anciens. Chacun de ses tableaux, chacune de ses pages est un pont de verre entre les galaxies. Sur la grande acropole de Domme, l’anachorète est devenu un yogi sauvage. Il quitte son corps à 46 ans. Certains lecteurs ne parlent de lui qu’au présent. Il nous livre une discrète clef :
Ma faculté de voir l’Énergie à l’état pur n’est pas humaine.
BIBLOGRAPHIE SOMMAIRE
Le Vieillard et l'enfant. (Sous le nom d'Abdallah Chaanba, 1949 - Chaamba avec un « n » - 225 exemplaires, « Imprimé en Belgique ». Éditions de Minuit, 1954. 1963. Précédé de « Zirara », Minuit, 1985).
Revue Structure. Pierre Renaud, Paris. (Dans les cinq numéros, 1957-1958).
Zirara. Récit. (Sous le nom d'Abdallah Chaamba, éd. Structure, 1958).
Le Voyage des morts, Journal de bord. (Sous le nom d’Abdallah Chaamba, La Nef de Paris, Collection Structure, 1959. Sous celui de François Augiéras : Fata Morgana, 1979. Grasset, « Les Cahiers rouges », 2000).
L’Apprenti sorcier, roman. (Sans nom d’auteur : Julliard, 1964 - sous celui de François Augiéras : Fata Morgana, 1976. Grasset, « Les Cahiers rouges », 1995).
Une adolescence au temps du maréchal. Récit (Christian Bourgois, 1968 ; Fata Morgana, 1980 ; sous le titre voulu par l’auteur, La Trajectoire, Fata Morgana, 1989 ; sous le titre Une adolescence au temps du maréchal et de multiples aventures, La Différence, 2001).
Un voyage au mont Athos. (Flammarion, 1970, 1988 ; Grasset, « Les Cahiers rouges » 1996).
Les noces avec l’Occident (Abdallah Chaamba. Fata Morgana, 1981).
Domme ou l’Essai d’Occupation (Fata Morgana, 1982 ; édition intégrale, Le Rocher, 1990 ; Grasset, « Les Cahiers rouges » 1997).
Les Barbares d’Occident (Ed. Fata Morgana, 1990 ; La Différence, 2002).
Lettres à Paul Placet (Fanlac, 2000).
Le Diable ermite. Lettres à Jean Chalon, 1968-1971 (La Différence, 2002).
Paul Placet. François Augiéras, un barbare en Occident (Fanlac, 1988).
Serge Sanchez. François Augiéras, le dernier primitif (Grasset. 2006).
Olivier Houbert. Butins. (La Part commune, 2014).
De nombreuses peintures de François Augiéras furent souvent exposées. En 2000, à la Mairie du 6°, à Paris ; au Festival de Venise, en 2006, etc.
Film hispano-suisse : Los pasos dobles. Isaki Lacuesta, avec Miquel Barcelo. 2011. (Prix de la Coquille d'or au festival de Saint-Sébastien).