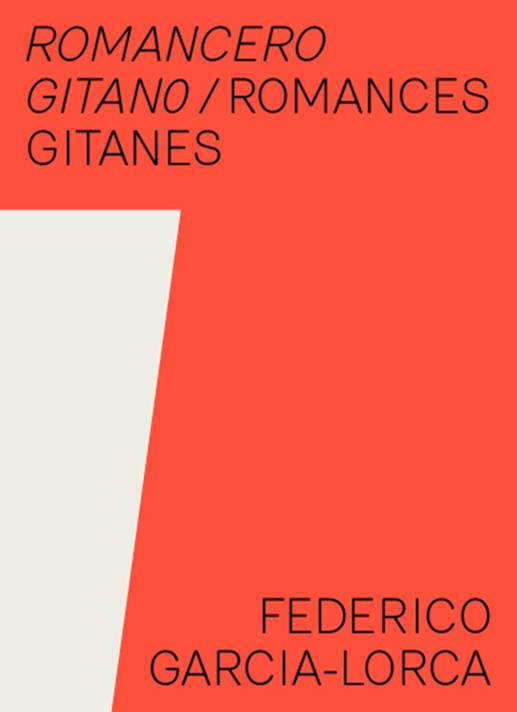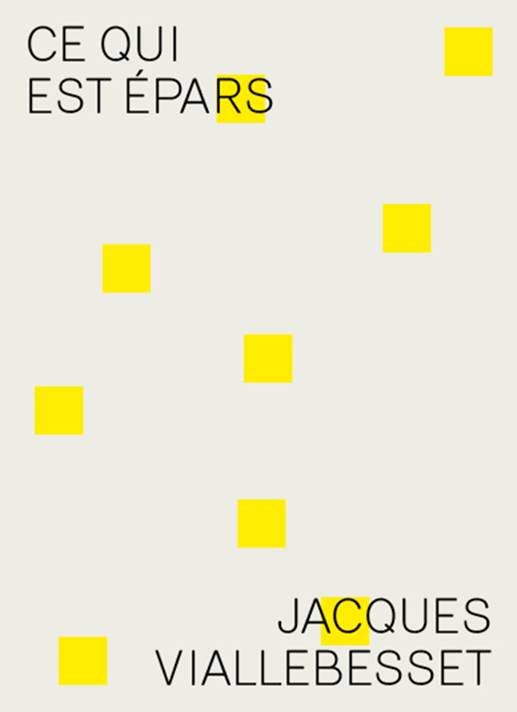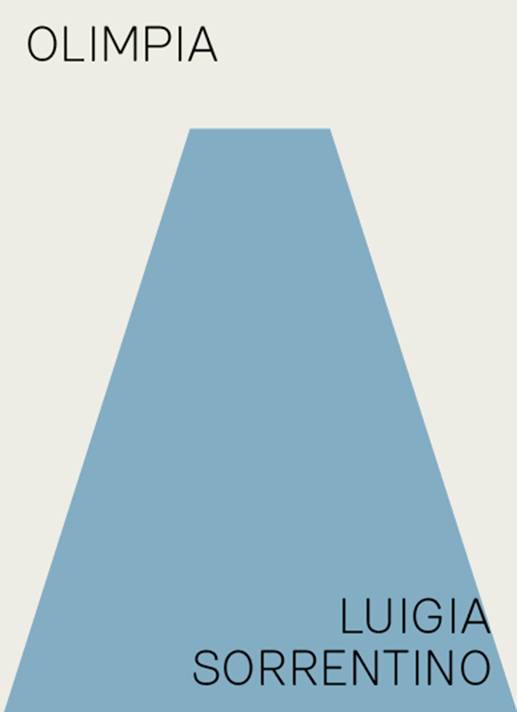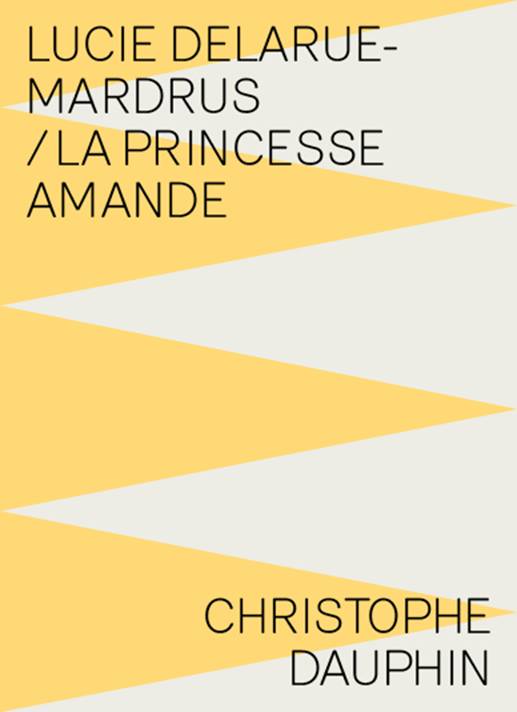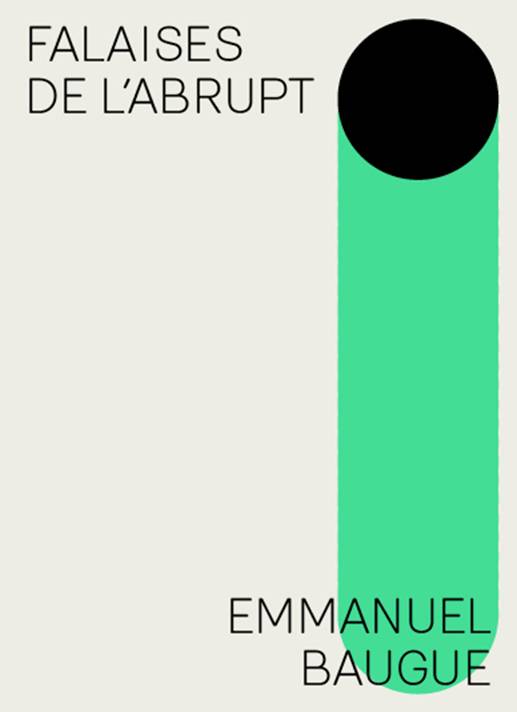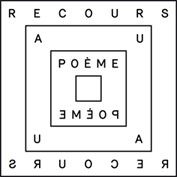Au bas des ombres, une lueur veille…
Pourquoi un tel poète reste-t-il sur sa réserve d’ombre ? Pourquoi se présente-t-il comme habitant exilé de la morsure des villes ? Pourquoi est-il témoin d’hommes figés dans une vie qui ne leur apparait plus ? C’est que pour Didier Manyach écrire consiste à regarder le monde depuis l’abîme afin de dire l’agressivité des hommes et l’angoisse qu’ils suscitent, afin d’éviter les sourires calcinés, les corps fanés, les traces fantomatiques, puis chercher néanmoins dans cette désespérances les régions nomades de la mémoire. Ainsi Manyach cartographie un monde d’individus soumis, aveuglés et éperdus que son geste poétique inscrit entre lyrisme impétueux et révolte lucide, non pas en effusions personnelles et engagées, mais à contre-sens des habitudes, en contre-plongée du monde, donc paradoxalement en hauteur de ton et de vue :
Se rapprocher de l’abîme, de la putréfaction, du marasme
comme une conscience dévastée
enfermé dans le labyrinthe.
S’avancer les mains clouées aux linteaux de chaque porte
en piétinant la pourriture.
Accéder au chaos
pénétrer dans le calme, le déferlement lointain et régulier
des fleuves.
Offrir l’aurore engloutie devant des éclats de vitre
Être transfixé au sein des mille-voiles.
Apparaître dans le blanc d’une pensée
vécue au monde autre
se croiser d’un rêve et rendre à l’espace
la terre lunaire terminale.
S’échapper des mouroirs, monter dans la lumière
traverser les espèces
& vivre face au vide, face à l’Inconnu
qui va naître...
extrait d'Impacts de Foudre.
On comprend alors qu’Expérience Blockhaus ait accueilli en son antre sulfureuse le diamant noire du poète, cette écriture toute de déchirures, d’explosions, de chaos, de lignes de failles, d’instants fissurés et d’élans que l’on brise; la parole du poète due à un phrasé indivisible -chaque recueil étant l’écho d’un autre- trouble la quiétude des lieux communs, il n’est pas de paix absolue avec Manyach, toute son œuvre au noir est onde de choc dont personne ne peut se garder. Et si pour la fraternelle cause poétique qu’est Expérience Blockhaus, la réalité oppresse, qui n’est plus que décomposition, craquements ne laissant guère refleurir des espoirs de chair sensible, abandonnant davantage des corps muets et pétrifiés dans les murs de leurs édifices, chez Manyach, s’écoule cependant un véritable sang d’encre arraché au crépuscule -fût-il de blessure- un sang qui finit toujours par rejaillir des interstices de la vie, sans doute afin d’être au rythme du monde avant d’appartenir aux mots. L’écriture épouse alors les palpitations vitales des arbres, les flux débordements des eaux, la poésie devient aussitôt “violente nuit de pluies”, non pas un nostalgique miroir avide d’illusions dans un voyage aux contours oniriques, mais des crues de géométries exotiques, désireuses de s’abreuver à la source du monde ; il faut également accepter de découvrir les glissements de terrains, les gouffres, les éparpillements, les ravins et avalanches, là où tout semble disparaitre dans l’émerveillement et le désordre du désastre naturel :
Un chemin délavé que mes yeux accompagnent dans la
solitude
aujourd’hui repris en sens inverse
et qui mène à l’Observatoire : ici j’étudie le chaos
les migrations, l’apparition de nouveaux climats...
C’est sur ce chemin de poussière que j’ai voulu disparaître
tout en haut il fallait se jeter dans le vide
& tout en bas il n’y avait que le néant
extrait Impacts de Foudre
Reste cette civilisation portée en langue amère, qui blesse l’œil et l’aveugle alors même que l’écriture fuit la vague nausée de l’immobilisme et une nature trop contemplative, Didier Manyach préfère en ce sens entrer en communion avec la flamme du Commencement, de l’Infans, cette aube brûlée de nostalgie adulte ; le poète laisse ainsi apparaitre, au cœur de l’Obscur, la brûlure de la clairvoyance, délaissant aussi les signes fallacieux d’une langue qui ne serait que rempart. Voilà donc Manyach tenu à pétrir la malléabilité des ombres, à cracher les mots qui apprennent le décillement du réel. Terrifié à l’idée de voir coaguler ses jours, le poète laisse son écriture déborder au rythme des saisons les plus violentes, en des poèmes bouleversants de puissance et de dissidence. S’élançant, par intermittences, en cris vibrants puis danses primitives, les mots se trouvent délivrés de tout ornement, mots frémissants de vie, mots où circulent des formes aussi proches que lointaines, mots qui retiennent l’instant, mots nés de la terre et de ses éléments, des arbres aux « bras d’écorces et de cendres », mots majuscules qui résonnent des tréfonds de l’abîme en des constructions amples et infatigables ; sortes de rhizomes enfin qui s’enracinent dans le monde car le dedans de l’homme est au dehors. Sous la variation de la prose, la langue donne vie à des questions sans réponse et à des suspensions étirant le quotidien jusqu’à le faire claquer au vent d’allitérations et d’assonances incantatoires, de timbres inattendus, et cela dans un superbe battement de phrases.
Didier Manyach compose certes un grand poème du désarroi existentiel et de la lutte artistique, mais l’on retient davantage encore « ses mots » qui ont le goût du vent filant, son écriture qui ouvre au respire des choses les plus sombres, sans jamais perdre de vue la trace sensible des visages croisés. Sa parole procède, ce faisant, par éclats de voix, orchestrant des silences puis de brusques et longs passages vers des territoires profonds. Et au cœur de cette marée tumultueuse surgissent, dans la fonte du réel, des lumières convulsées, des figures déjà brouillées par la « vitesse noire » de l’écriture, des paysages dépeuplés au grand rythme élémentaire, parfois troués obscures ou vertiges ravinés, à moins que le poète ne nous invite à passer à travers des forêts déchirées, tortueuses, recouvertes d’encre phosphorescente. Surgissent alors des noms frappés à même la forge qui, dans la pierre millénaire, ont scellé « l’éclair de l’Aigle » et « le galop de l’antilope noire » ; scandant ainsi l’obscure clarté du Verbe et rappelant l’immensité de provinces originelles. L’ailleurs est en effet un ici, l’extérieur est une intimité, tout chemin souterrain révèle l’ensoleillement des profondeurs perdues ; voici l’être lié à la marche du temps et seuls les climats donnent la sensation de se décliner comme des excroissances natives de la vie, s’arc-boutant au silence pour faire jaillir un chant primitif. C’est ainsi que le poète chante l’invisible, non pas la voie lactée mais le paysage du vent, l’éternité passagère, et le chemin sans fin, constellé de divers seuils, il balaye les larges rivages de la terre et interroge l’unité perdue et l’arborescente beauté de l’être-monde :
Nous naissons avec le soleil
Mais nous venons des étoiles
Des algues
Et du souffle
Qui ne tient qu’à un fil:
Celui que la lampe tisse
Dans la grammaire de nos veines
Avec le sang du verbe
Le vent
Qui fait trembler la flamme
Et le feu
Ou le silence
Des astres.
Alors toutes les pensées chavirent dans l’impensable
Puis dans l’écume ruisselle
Le matin du monde …
extrait d'Onde Invisible, Piraterie, Migration et Merveille de Grâce
La langue tente sans cesse d’échapper au sol qui pourrait se dérober sous elle, s’engage dans une course afin d’attraper la vie au vol, chaque passage poétique est une hurlerie qui crépite de vie et de sa soudaine disparition. Didier Manyach saisit en ce sens le jaillissement intense d’une saison en enfer ou d’une illumination ; ses vers se traversent en cisailles, en fragments du monde, en « alphabets de cendre »: on y devine toujours l’appel de la mémoire lié au désir d’enjamber le temps, d’aller vers une possible luminescence, vers cette lueur qui veille toujours…. Et pour être en partie perçue, cette clarté a besoin de s’unir à l’ombre, sans quoi l’espace alentour serait noyé par un flot de lumière.
L’olivier dans le champ de pierres sèches :
laves nouées, flammes autour des corps
crevasses, huile verte dégoulinante au long des branches
des troncs mutilés
ce feu pétrifié sur les écorces.
Recouverts de ce qui obscurément les hante, crucifiés
couchés, abattus, sans pouvoir se résigner
à s’écrouler tout à fait
une plaie au travers du flanc.
L’eau qu’ils n’ont jamais trouvée
les olives qu’ils ne produisent plus
cette obstination pourtant à durer...
Leurs mains sont bleues comme la nuit :
on dirait qu’ils se dressent
que la lumière de l’Été les transfigure
extrait d’Impacts de Foudre.
Il n’y a certes pas d’ombre sans lumière, et inversement. Par-là, l’ombre rend possible la vision du poète, elle fait renaitre des formes et laisse la vie s’y manifester, hâtivement. Mais la lumière doit rester lueur chez Manyach, un faisceau fragile qui n’hésite pas à s’engager dans l’obscurité du réel. Il ne s’agit donc pas d’une lumière qui éblouit, ni de lumière sacrée, ni de plein soleil, le poète privilégie les levers d’aubes pluvieuses ou les couchants apocalyptiques, c’est là que la vraie lumière est la plus énigmatique et la plus ambivalente. En effet, l’œil capture ainsi le paysage à travers une variété infinie de teintes, de nuances que le poète retranscrit en mots. Les changements perçus sont rendus visibles grâce aux rapports qui s’établissent entre apparition et disparition de la Vie, glissements, mutations et mouvements de va-et-vient. Ainsi, les premières lueurs du Poète font que l’Obscur de la nature se relève autant qu’il se délite, comme écarté par une conscience de l’évanescence des choses. Les branches sont alors nues, la terre prend la couleur des forêts et les arbres celles de la pluie. L’écriture devient mouvement de renaissance autant que de solitude et de désordre :
Je voudrais dire la Cité mythique après sept jours de
marche entre ciel et terre. Puis cette solitude dans
la brousse proche, il y a quelques années de cela, en
suivant les baobabs, comme des ponts de lumière, pen-
dant que les femmes revenaient en courant sur le sentier
boueux. Je voudrais dire le monde de l’Origine comme un
placenta enterré dans la forêt, là-bas ... à quelques mètres
de moi, comme un marigot sous l’orage.
Extrait de Sous les pluies des mangues
La lueur originelle et scripturale du poète révèle donc ce qui n’est pas immédiatement perceptible, une fois que toutes les illusions sont tombées, que l’esprit voit aussi clair que le monde qui le dépasse ; Manyach tente alors de retenir cette lumière singulière qu’est la Vie, ainsi que le sentiment de traverser certains jours plus pleinement que d’autres. Ces moments sont presque toujours associés à une tension, une lueur dans l’impermanence, ce que l’on nomme, à l’instar de Jaccottet, « l’étincelle de vie ». L’espace du poème est donc le lieu où la parole accueille l’expérience du monde dans son mouvement perpétuel. En définitive, la poésie de Manyach parle du monde sans jamais l’expliquer, ce serait le figer et le nier, alors même que le poète lui donne raison dans son refus de répondre ; l’éveil passant aussi par l’oubli des vies antérieures :
J’habite la déchirure des régions disparues
les drailles et les frontières
le fleuve tumultueux
les cendres encore tièdes...
La Vie reviendra t’elle ?
Je gis, au milieu du Temps, dans son devenir...
Extrait de L'Ensoleillade. Piraterie, Migration et Merveille de Grâce
. Mais L’écriture, ombre parmi les ombres, permet de briller, de retenir des instants de vie immédiate, ces moments qui font craquer les contours du temps à la lueur d’une veilleuse, une lueur qui fait également trembler les apparences et montre à l’œil que toute chose vivante de ce monde n’est jamais circonscrite à sa limite visible, mais bien au contraire, qu’il y a toujours une part accordée à l'insaisissable. Manyach s’inscrit bel et bien dans la lignée, entre autres, de Bonnefoy, de Pierre-Albert Jourdan, dans ce désir éperdu de s’unir à la terre et à ce qui lui est au-delà ….. Cet insaisissable est un souffle qui permet ne pas arrêter sa course, de ne pas être sclérosé par de fausses assurances, de ne posséder aucune certitude, de savoir en bout de course que l’homme ne sait que peu de choses et que la terre en rien ne lui est due !
Alors quoi de mieux que d’apprendre à apprivoiser l’étranger, l’inconnu, l’incertain ? Quoi de mieux que d’énumérer le grand foisonnement d’une vie enfouie sous les décombres de l’illusion ? Climats Forêts…..Visages, Didier Manyach se sert du poème comme d’un grand journal de fragments, de voyages, de notes de vies éparses, le poète y dépose en jets de liberté, comme dans un herbier vivace, un éclat de la splendeur du monde. Défilent sous nos yeux étonnés et ravis les plénitudes végétales, le passage des saisons, les traumatismes et crevasses de la terre, les ciels orageux aux nuages translucides, le précieux secret de toute une vie. L’érotisme vital de la nature est donc la seule religion reconnue ; courbures sensuelles, généreuses ou effrayantes, ces formes apprennent à mieux nous déplacer afin de nous replacer humblement, dans le chant et la saveur des mots poétiques. Manyach sait cependant s'émanciper de cette saveur, étymologiquement du savoir, de la rhétorique, il parvient à s’éloigner de la pesanteur des idées trop abstraites qui encombre le monde des vivants. Le poète lucide est aussi vaste que la marche du ciel, le voilà donc glaneur de beautés tremblantes, rassemblées au hasard de courants climatiques. En effet, Manyach dit le grand frisson de l’existence autant qu’il conjure « le grand Tout » de l’éphémère. Le poète transmet des vertiges au lecteur qui, avec lui, parvient à voir l’Etrangeté dans chaque brin d’herbe et se contente de ces royaumes éphémères, de ces petites parcelles d’éternités, autres silences éventrés de beauté qu’il découvre dans le secret du geste poétique. En effet, l’écriture du poète porte toutes ces présences, embrassant tantôt des couleurs, tantôt des formes, comme si la terre n’avait plus besoin d’aspirer au ciel mais l’aspirait avec elle. Manyach parvient à mettre en relief l’émanation de la matière, la texture de la glace, la couleur des marécages, la frondaison des arbres, le parfum des saisons, l’approche de la pluie, le cycle des vents, la disparition ou course folle des animaux, le chant de la lumière et les derniers regards étoilés :
L’instant surgit
Sur un lit d’étoiles
Et de pierres plates..
Limpide origine perdue
Rendue au langage qui s’y incruste
Pour ouvrir la voie
Du vivant.
Extrait d’Onde invisible.ID
On redécouvre enfin notre silhouette d’humain, simple trait dans la magnitude du paysage, là où « le vent oblige le corps à se souvenir de la terre ». "Je ne cherche pas un paradis, mais une terre" écrivait Le Clézio et Didier Manaych lui emboite le pas, à moins qu’il ne le précède depuis toujours, pour affirmer en de véritables épopées de mots que « la vie terrestre est plus surprenante que n'importe quel rêve" (JML). A travers feuilles et pierres boueuses, les pas du poète sont des orages aigus, chaque enjambée rallie la pensée à la mousse, gangrène le trop-visible, desquame toute identité et pousse le voyageur à s’enfoncer au cœur de la sauvagerie et à laisser irrémédiablement son « empreinte dans le chaos ». Seule compte la voix d’une unité retrouvée, celle qui décline la rumeur des lichens, l’odeur des saisons, la présence des ombres ; vivant de cette source d'émerveillement autant que de vertige, le poète errant sait qu'il n’est qu’une forme parmi les autres, son écriture est en conséquence rendue attentive à la quantité des éléments qui le bouleversent. En somme, « le monde » en lui-même est dans l'homme plus humain et bien plus vivant que lui.
J’étais roche d’étoile, poussière du grand-mouvement
non dissocié, absolument vide.
La lumière ruisselait...
Je fermais les yeux & la terre intérieure m’apparaissait.
J’étais eau et plante dans le fleuve et le sol
j’étais neige et soleil en fusion sur les cîmes
boue et sang, écume avant de naître…Extrait d’Impacts de foudre
Mais Ce monde serait-il d’une espèce autre ? N’est-il pas à la lisière de l’homme ? N’atteint-il pas, par la poétique de Manyach, des strates bien antérieures ? L’enfance de la terre en quelque sorte, des époques de reptation et de faiblesses, des époques de proies dissimulées dans les sables autant que des périodes de beauté sauvage et mystérieuse comme « la vague qui s’élève derrière l’apparence, s’enroule puis ruisselle sur le sable » ? Ou bien ce même monde « poétique » n’est-il qu’un parfum de cette forêt matricielle qui peine à le recracher de ses entrailles, syntagme prisonnier d’un texte à la luxuriance formidable? En fait, perdue dans les matrices originelles et liquides de cette nature indomptable, l’écriture-monde de Manyach relève de tous ces espaces hétérogènes, riche de mille pièges de ronces, écorces et racines, que de temporalités en devenir. La lueur nait donc aussi de ce coin de magie fiché dans le temps qui préfigure une naissance, et à des rites qui marquent le cycle vrai des jours.
Fouissant la terre, pour chercher dans ses entrailles, creusant le silence rageur du ciel, excavant sa mémoire pour y chercher la frontière entre nature et humanité, Manyach livre une écriture fougueuse, unissant ses pas et son Verbe, expirant des phrases haletantes d’impatiences. L’auteur dit ainsi son identité plurielle, sa perception de l’épiderme des choses et sa pleine appartenance à un univers infini, espace qui parfois l’engloutit et finit par le recracher, mais espace où le regard se déploie comme une beauté arachnéenne ; branches inextricables dessinant des lignes labyrinthiques, sols jonchés de feuilles brouillant les possibles chemins, ciels bouffés par les cimes, rivières aux brumes fantastiques et couleurs obscures, la vision de Manyach finit par proposer un hors temps, une mémoire universelle en devenir; et voici l’arbre solitaire qui ouvre sur la trouée d’un œil-flaque, il faut le « receVoir » pour croire à tant de beautés….Et si on finit par ne plus savoir qui, du texte ou de l’image, a, le premier, surgi, envahi et façonné ce monde, c’est que telles sont les choses, il faut prendre parti pour elles en portant sur chacune le regard stupéfait qui la recommence.
Les journées sont de plus en plus longues. Dès que la lumière décline, les Formes se recomposent. Cela commence à l'intérieur de certaines parties du corps : l'Infiniment petit y résonne comme dans un sarcophage.
Extrait de Tous les points constituent la figure, partie II. Géométrie de la mort
La langue du poète s’épanouit alors entre ombre et lumière, Didier Manyach voit plus loin que le bout d'un monde qui sans cesse pourtant lui échappe. Entre le regard et les choses, entre les mots comme entre les pierres du torrent, le poète recueille des figures éparses du monde, les rendant un instant solidaires. De telle sorte que recouvert, effacé par l’afflux de mots, la vie finit par y renaître, surgissant de ce mouvement même qui d’abord l’a annulée et qui, maintenant lui offre cette vivacité, dont jusque-là elle paraissait privée. Ecrire ce serait avant tout cela : s’asseoir pour voir se lever le monde dans le jour du langage et offrir au lecteur une écoute attentive des bruits secrets de ce dernier, une langue capable d’évoquer l’écho du temps, la beauté secrète et tragique de chaque ombre et les lèvres écorchées par la vision des voyages.
Derrière chaque ligne, chaque ombre, chaque
visage, une lumière chimérique, infinie et fragile,
précède les voix errantes, blanchies qui vont se
perdre au milieu du galop des mirages
puis se dissoudre sur les pals d'une terre sans mémoire
Extrait de Géométrie de la mort
Témoin d’une photographie déchirée du réel, le poète révèle, dans une langue brûlée d’images hallucinantes, une nuit qui angoisse autant qu’elle s’irise en lueurs libératrices, l’auteur dessine enfin l’homme qui rétrécit, celui qui retourne à sa place originelle, à l’ombre d’une herbe. Et c’est grâce à cette expérience poétique que Didier Manyach, arpenteur des ombres, sait reconnaitre l’étincelle qui fait d’un seul jour, une longue saison de migrations.