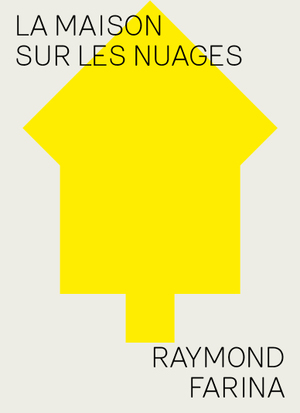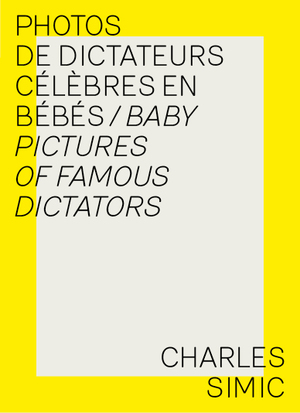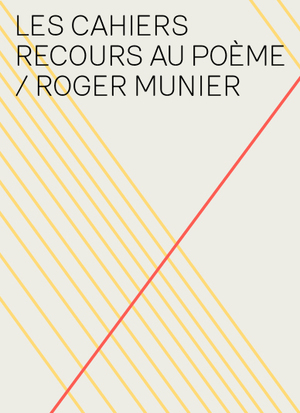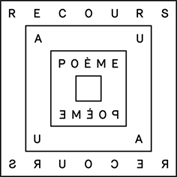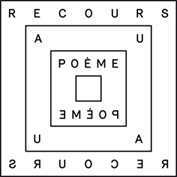יְהוָה בְּצֵאתְךָ מִשֵּׂעִיר בְּצַעְדְּךָ מִשְּׂדֵה אֱדֹום אֶרֶץ רָעָשָׁה גַּם־שָׁמַיִם נָטָפוּ גַּם־עָבִים נָטְפוּ מָיִם
הָרִים נָזְלוּ מִפְּנֵי יְהוָה זֶה סִינַי מִפְּנֵי יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל *
5, 4-5 שירת דבורה, שופטים
I
Il était une fois, dans les temps arriérés, des animaux hominidés : Le peuple élu d’amis, en errant, extravagant, perdit son élection.
Dès que l’un avait faim, il s’empiffrait de chocolats, de cafards, de boas, de métaux, de cornes de taureau. Dès que l’autre, mâle, avait le sexe remuant, il le fourrait dans trente vaches d’affilée, dans le cul d’éléphants, dans la bouche d’enfants ; femelle, s’empalait sur des pieux, des trompes d’éléphants, des bras d’enfants.
Tout le peuple d’amis, moins amis, était loin de son lieu, de son centre et moyeu ; et sans lieu n’avait pas de loi propre, sans son centre faisait l’excentrique, sans moyeu perdait tous ses moyens.
Plus aucun n’excellait dans sa voie où le vouait sa vocation qui lui ouvrait la voie, et les multiples voies s’étaient fermées, et sans but tous erraient : affaiblis, sans vigueur ni rigueur de la vie. Et plus aucun n’était meilleur que son prochain, mais chacun était pire. Et plus aucun n’agrandissait ses connaissances, qui donc rapetissaient, et avec elles ses puissances.
L’élu déçoit ? l’élu déchoit : De peuple élu qui a déçu qui l’a élu, il n’était plus : que déchu.
Quand on déchoit, on déchoit avec légion d’autres déchus qui vous enchaînent. Et le peuple d’amis, en errant, se fit soumis, vingt ans, à un peuple excentrique – soumis en ceci à ’Îzèbèl.
’Îzèbèl violentée, asservie, dominée, pervertie, blessée, trahie, violée, salie, viciée, noircie, souillée, tarie, par des mâles – était amère, stérile. Sa vengeance aujourd’hui s’accouplait à son don mal acquis de voyance, qui lui servait à asservir.
Or son peuple asservi souvivait dans la ville extensive nommée Thiatiros, déformée par des cubes statiques agités de l’extérieur – non agissants de l’intérieur – par des rouages machiniques.
Et cette ville Thiatiros était peuplée de deux milliards de fanatiques – Nicolaïtes – qui avaient massacré tout autre peuple de leur terre, qui conquéraient avec la ruse, la séduction et la violence, les autres peuples de la terre.
Extravagants, sans chemin, excentriques, sans centre, ils suivaient l’errement d’’Îzèbèl – subjugués par elle, sous son joug à elle, car sans joug à soi, joug centripète, seul joug poète des chemins menant chacun au même point.
Face au peuple soumis, le temps était venu pour le peuple d’amis. C’est pourquoi sur le mont ’Èphraïm, la Juge Debôrâh, qui sommeillait sous son palmier, jugea bon de s’éveiller et se lever. Elle elle est celle : qui répond à l’appel, à l’appel du tout autre, à rien d’autre qu’au tout, au tout autre que rien.
Si tout avait été pour le mieux, elle se serait éveillée et levée pour le bien. Mais comme en ces temps sombres, tout était pour le pire, elle se réveilla et se leva pour le meilleur – le bien, on verrait ça après ; après, on verrait mieux le bien.
II
Debôrâh se hissa sur le Mont ’Èphraïm, sous son palmier où chaque jour elle rendait justice, à qui l’avait perdue elle la lui rendait, et le Mont ’Èphraïm était couvert par les amis, dix mille amis, couvert par un murmure, plus aucune surface de silence ne restait.
Debôrâh se dressa, sa hauteur augmenta jusqu’au sommet de son palmier trois fois plus haut, déboussola les erratiques, et boussola les sans-boussole qui cherchaient le double sol : de terre, de ciel.
Debôrâh déclara : « Et maintenant écoutez-moi, écoutez bien, pas mal, ni entre deux, je n’irai pas par les quatre chemins, horizontaux, mais par un seul, le vertical à la croisée. Et attendez de voir demain, vous n’en reviendrez pas, vous resterez dans ce demain promis ce jour.
Je vous dis ce qu’on dit, ce qu’on m’a dit de mieux, et ce qui est utile au dit du mieux pour qu’il devienne fait, vrai fait, et ce qui peut servir à ce mieux dire à devenir vrai faire.
Et je ne vois que ce qu’on voit, qu’on m’a fait voir de mieux, à vous de voir : ce que je vois de mieux – je ne veux pas être suivie, ne suis pas ’Îzèbèl, ne suivez surtout pas ’Îzèbèl, ’Îzèbèl asservit qui la suit, voyez ce que je vois de mieux, puis je m’en vais : voir ailleurs, voir l’ailleurs. »
Debôrâh se tenait sur le mont ’Èphraïm, et Debôrâh se tenait droite tout en haut, et sa hauteur ne mentait pas, par Debôrâh l’esprit soufflait : des mots, qui tous chutaient, qui chuchotaient dans les oreilles des amis, tous pressentaient : une existence pas encore ici, plutôt en germe ici, bien plus tôt, on était loin du là-bas las qui préjugeait : que les faits étaient vrais, que l’effet était vrai, cause.
Le feu de Debôrâh, lancé depuis là-haut, s’alluma jusque dans la plaine, alors la plaine, en flamme et joie, enflammée par la joie, trouva son cœur dans son courage, et redevint un haut sommet, qu’elle avait oublié qu’elle était.
Debôrâh déclara : « Ils interdisent notre rêve en ricanant, lui interdisent de créer, et de naître à nouveau, de renaître nouveau comme nous sommes nés, comme un nous nouveau-né.
Nous devons pétrifier leurs regards qui pétrifient nos mouvements – nos mouvements, qui n’étant pas à l’unisson mais produisant une harmonie de divers sons, créent un seul mouvement de grand bond – en avant – soutenu dans le temps, car fidèle à l’avant et la hauteur d’où nous venons. »
Et parmi les amis, Debôrâh appela : Bârâq, qui parmi les amis se leva, alla vers Debôrâh, qui dit : « Toi, tu n’es pas en forme, et tous ici voient mal ta forme. Tu la retrouveras. »
Informé par ces mots, Bârâq revigoré lui dit : « Pour nous tous tu es tout le nouveau, et je veux embrasser le nouveau, à nouveau. » Et il embouche, bouche sa bouche, avec vertu et virtuosité, l’une empêchant nullement l’autre, mais l’une inspirant l’autre, et elle dit : « Nous verrons, nous ferons, le reste après. »
« Maintenant trêve de paroles, actons le rêve des paroles qui transportent notre mieux. Les mots multipliés, sans acte avec, démultiplient les maux en acte. Ami Bârâq, réunis nos amis, dix mille amis, et va combattre l’ennemi, l’armée conduite par Sîserâ’ aux ordres d’’Îzèbèl, et l’ennemi, je te le donnerai. »
« Mais Debôrâh ! dit Bârâq, cette armée pue et porte la mort ! ils sont légion ! deux milliards ! surarmés ! Nous nous sommes bien moindres, tout petits et à pieds, désarmés, et moi seul j’ai l’épée, minuscule l’épée, si minuscule, que j’ignore souvent où j’ai pu la ranger. »
Debôrâh déclara : « Si notre mort catastrophique est assurée, il est et temps et nécessaire d’espérer, de supprimer la mort, et d’exiger la vie nouvelle. » Et Bârâq : « Si tu viens avec moi, j’y vais ; sinon, non. » Et Debôrâh : « Je viens, et la gloire viendra – d’une femme. »
III
Quand le peuple sans arme avança, l’armée, armée, attaqua : avec épées, fourchettes, lances, roquettes, chars d’assaut, gaz chimiques, biologiques, kamikazes chargés de grenades, avions de chasse, forces navales, forces sous terre, deux milliers de millions d’hominidés motorisés.
Le peuple à pieds, sans autre arme qu’une épée, espère, et exige la fin de la mort. Il recule d’un pas, organique, quand l’armée fait un pas, mécanique, en avant dans le vide.
Et l’épée de Bârâq, comme guidée d’ailleurs, mène la guerre à elle seule, Bârâq ne fait que la porter, et ne pas l’égarer, elle qui coupe les épées, les fourchettes, l’élan des lances, des roquettes, et assaille tout char, et aspire tout gaz, charge tout kamikaze, et chasse les avions, et affaiblit les forces.
Les deux milliards ennemis furent tous détrônés de leur machine meurtrière, tous finirent à pieds, puis sans pieds, tous coupés par l’épée, puis sans jambes, coupées toutes par l’épée. Et deux milliards de troncs hurlaient à l’unisson les bras tendus vers le ciel vide – pour eux.
Seul le chef Sîserâ’, tombé, s’enfuit à pieds, il courut paniqué, piqué en profondeur par une peur, qui courut elle aussi, derrière lui, mais plus vite que lui, et il courut, le vide au cœur, et essoufflé il se fit sourd à ses erreurs, lesquelles tues, non reconnues, dégénérèrent en terreurs.
Sîserâ’ vit une tente, et c’était celle de Yaël, quatre bougies l’illuminaient, il avait soif et demanda de l’eau à boire, plutôt que l’eau elle offrit mieux, du lait, elle éteignit une bougie et la lumière s’amoindrit, il but le lait, et demanda à se cacher, Yaël offrit sa couverture, le rassura en le couvrant : Tu ne crains rien. Elle éteignit une bougie et la lumière s’amoindrit.
Sîserâ’ dit à Yaël d’aller dehors devant la tente, et dire à qui le chercherait : qu’ici pas trace d’ennemi, Yaël alla, elle éteignit une bougie et la lumière s’amoindrit, pendant que lui endurait dur la longue attente, elle saisit un pieu fixant la tente, saisit sans mot un gros marteau, retourna vers Sîserâ’ au corps caché, que l’angoisse glaciale seule trahissait, Yaël posa le pieu sur la tempe ennemie, le marteau l’enfonça, brisa le crâne, elle éteignit une bougie, la lumière amoindrie jusqu’ici s’abolit, et le Sîserâ’ crâne brisé s’agenouilla devant Yaël entre ses jambes, le crâne en sang mouillait de sang Yaël dressée entre les jambes, l’homme vaincu et à genoux devant la femme bien debout – comme une mère protectrice devenue la meurtrière destructrice du guerrier. Elle dit à son mort : « Tu te laveras les cheveux demain ; et moi, je verrai les chemins de vœux. »
Pendant ce temps, une mère attendait le retour de son fils, et regardait l’horizon vide : « Où est Sîserâ’ ? » Et les femmes de Sîserâ’ la rassuraient : « Il doit être vainqueur, notre Sîserâ’, et il doit profiter du butin, avec ses hommes, et des femmes faites putains. »
Et Bârâq arriva devant la tente de Yaël, essoufflé, souffle coupé devant après les deux batailles, et la bataille de l’épée et la bataille de Yaël, et Yaël lui livra le meneur ennemi, comme avant son épée la légion ennemie.
Au loin, on entendit ’Îzèbèl qui hurla, se tua et se tut.
IV
Debôrâh se dressa, somptueuse de blanc, surplombant : ses amis, et sa voix héroïque : les rendaient héroïques, et les cyniques, et les sans-cœur, les sans-courage, et les tristes figures, soit moururent, soit sourirent, revécurent. Parmi les ennemis, ceux des troncs qui écoutent la voix de Debôrâh se relèvent, rejoignent les amis.
Près d’ici, l’antilope à ressort s’élança à cent vingt kilomètres à l’heure, Debôrâh déclara :
« Écoutez maintenant ce que moi maintenant j’écoutai : Ici et maintenant, nous supprimons la mort, nous augmentons la vie, avec la mort domptée tous nos obstacles sont levés, sont des chances, vers notre vie accrue. Ici et maintenant, dans le cœur de la nuit, les ennemis dorment sous terre, nous nous veillons, restons levés sur terre.
Nous ne nous contentons pas : du réalisé, du fait faux, factuel, factice, facticiel. Nous nous sommes contents : de l’irréalisé, à réaliser, de l’acte de réaliser, qui recommence avec chacun, et chacun sait que la réalité attend d’être réalisée. »
Près d’ici, l’antilope à ressort fit le bond de cinq mètres de haut, Debôrâh déclara :
« Je vous donne mon chiffre – afin que vous déchiffriez : Mon chiffre baisse pour que monte le Nouveau, et le niveau – de fluidité. Plus mon chiffre est petit, plus la matière est fluide. Soyons petits pour que le monde coule.
Nous voulons modifier la matière du monde. Jouons avec le temps, et avec la chaleur. Dans le présent des lendemains, nous voyons maintenant notre mieux pas encore visible, et nous sommes ardents, jaloux de notre mieux, dans nos mains la matière s’écoule.
Laissons le temps à la matière la plus dure de couler. Comme l’eau, les montagnes s’écoulent, mais lentement. Accélérons le temps, par la chaleur ! Par la chaleur de l’espérance, sa patience, tout s’amollit et se modèle ! Les montagnes ruissèlent, se déplacent, devant notre espérance !
Le monde est comme en verre. Notre espérance le réchauffe, jusqu’à incandescence, son temps d’écoulement de long se fait instant, nous l’informons, de notre mieux nous lui donnons la forme : de notre mieux. »
Près d’ici, l’antilope à ressort fit le bond de vingt mètres de long, Debôrâh déclara :
« Nous libérons ci-maintenant ce qui avant n’avait pas pu devenir soi ! libérons maintenant l’opprimé ! libérons maintenant l’avenir opprimé, prisonnier du passé, auquel seul le présent donne à chaque moment l’occasion de surgir ! faisons fleurir, et fructifier ce qui germine !
Les épées se transmuent en charrues, les fourchettes en fourchettes, les lances en faucilles, les roquettes en roquette, les chars d’assaut en véhicules collectifs, les gaz en parfums, les kamikazes mortifères en humains vivifères, les machines de guerre en machins prolétaires, sans mot, qui redonnent le mot aux anciens prolétaires, abolis aujourd’hui, devenus comme tous maîtres neufs.
Qui devine ce qui vient, devient ; qui devine le mieux, devient meilleur ; qui devine un bien meilleur, devient bien meilleur. Le repos d’aujourd’hui – l’histoire en suspension, interruption, par irruption d’éternité – est la source du monde à venir. »
Et une fois le Nouveau né, Debôrâh se retire et retire son chiffre, retourne à son palmier.