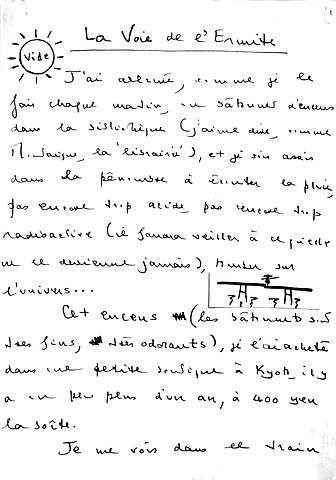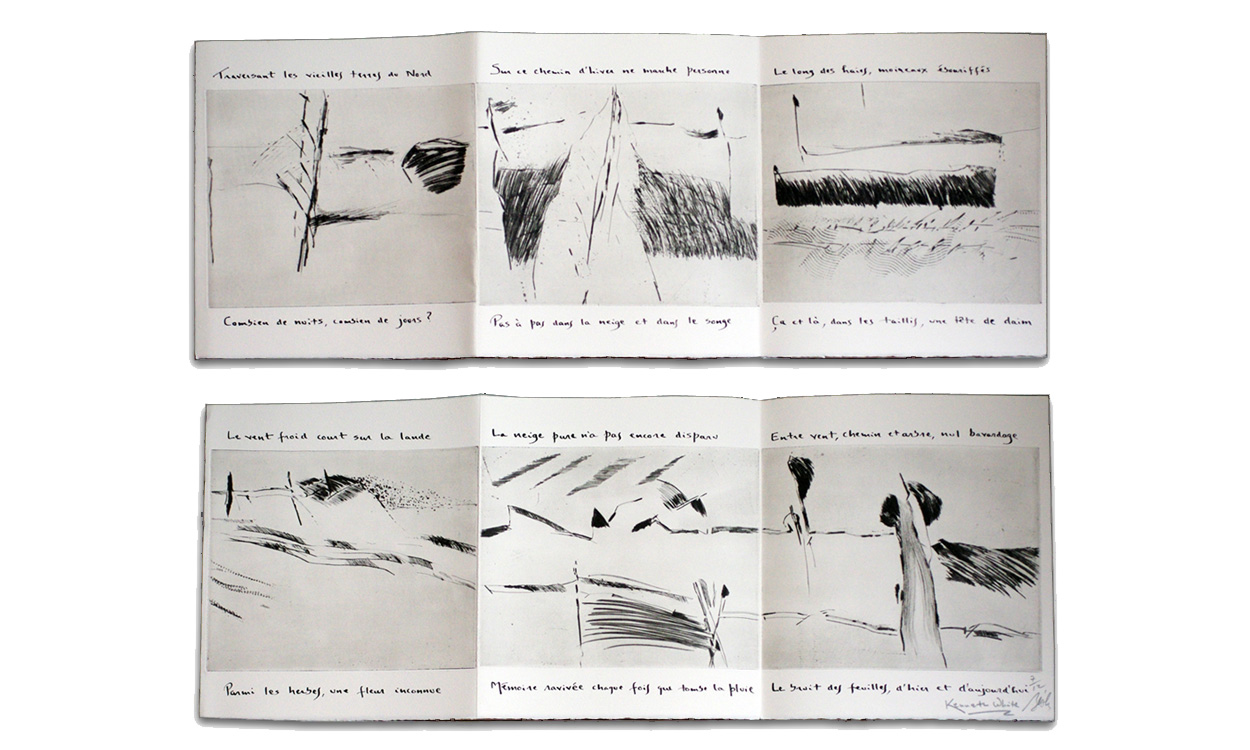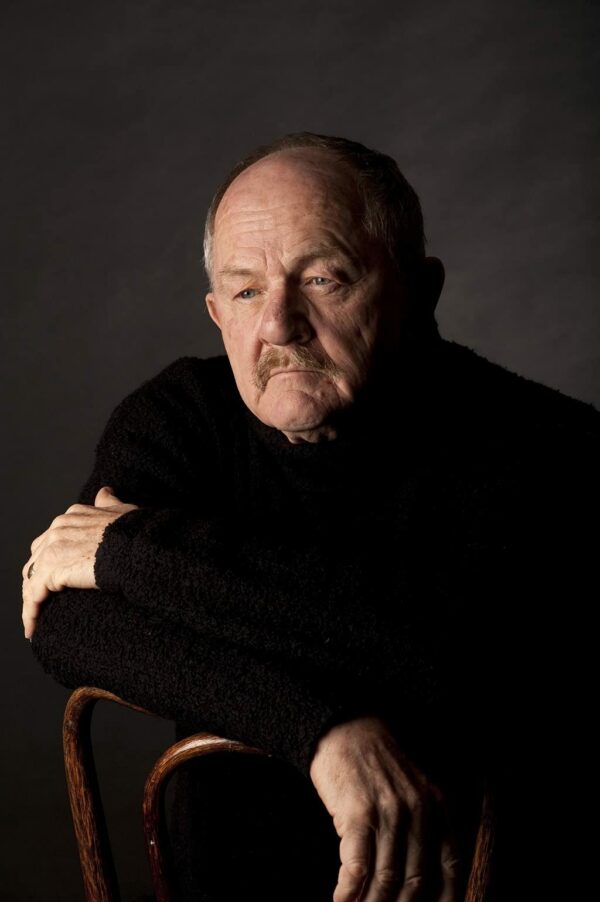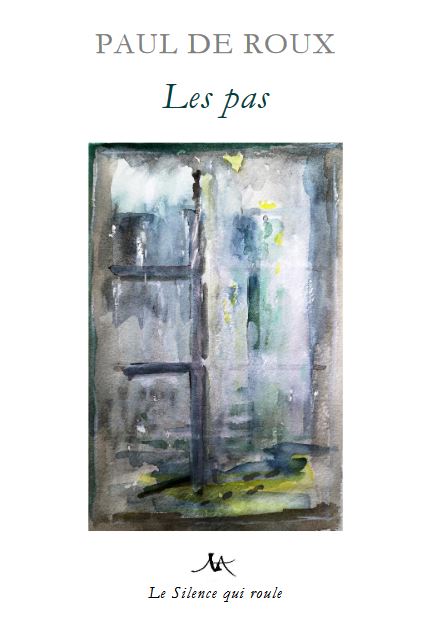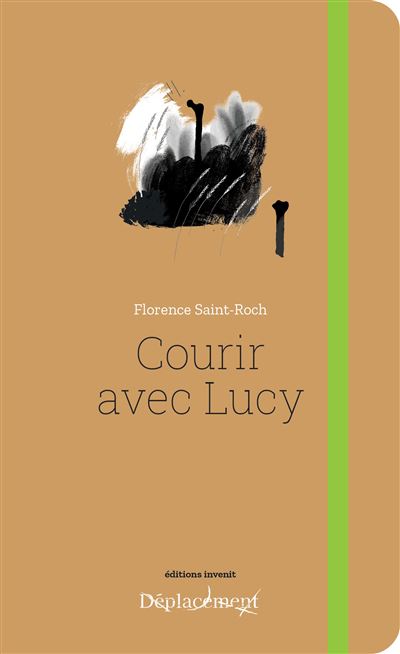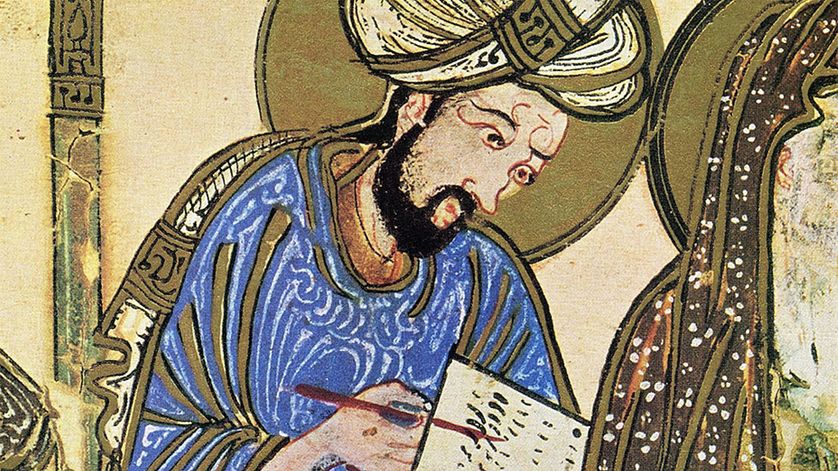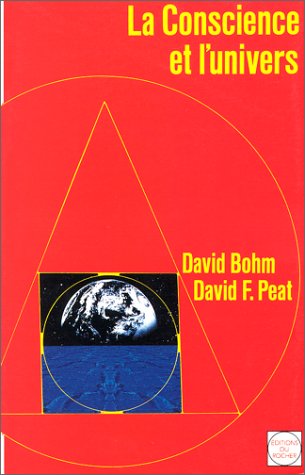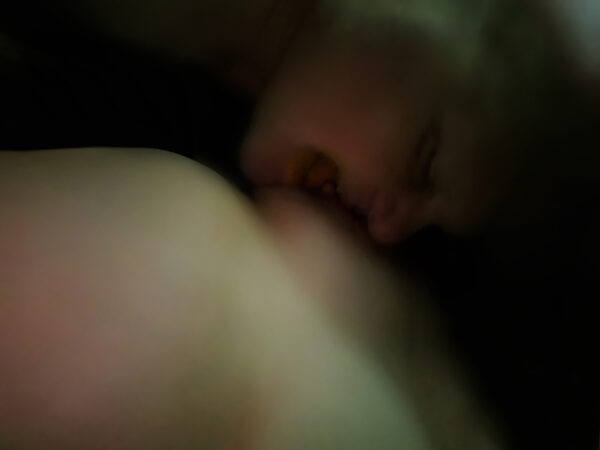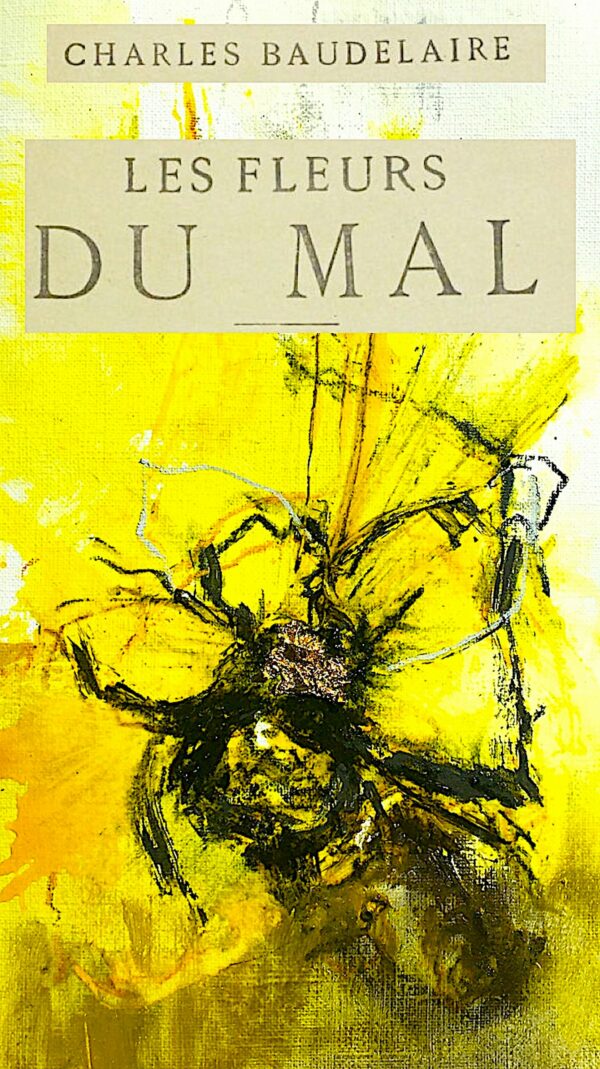Regard sur la poésie des « Native American » : Gwen Westerman, ou comment simplicité plus humilité mènent à une éclatante reconnaissance
Est-ce un effet de la nomination par Joe Biden de Deb Haaland (Laguna Pueblo) au ministère de l’intérieur ? Peut-être ! La nomination a été annoncée le 9 septembre 2021 au centre des humanités du Minnesota, à Saint-Paul la capitale de l’état, ville collée à Minneapolis, de l’autre côté de la rivière Minnesota (Mnisota Wakpa en langue Dakota) qui est un affluent du Mississipi.
L'artiste et poétesse Ribbonwork Gwen Westerman partage ses expériences en tant qu'artiste en résidence amérindienne (NAAIR) à la Minnesota Historical Society.
Lors de la célébration virtuelle, An Evening Celebrating the Mississippi River : Our Healing River, le 30 septembre 2021, le Dr Gwen Westerman, poète officiel du Minnesota, a partagé ce poème.
Une grande part de ce qui fait qui nous sommes vient des arts, de nos paroles. C’est la poésie. C’est de raconter des histoires. C’est cela qui fait ce que nous sommes en profondeur. Je suis très heureuse que les citoyens du Minnesota aient la chance de faire connaissance avec Glen Westerman qui sera leur poète : une femme Dakota qui montrera le chemin». Quant à Gwen, elle a déclaré vouloir : “ as a Dakota woman, to be a presence for healing and understanding and sharing more knowledge and information about our people, all of our people, in the state of Minnesota because we all love this land.” (En tant que femme Dakota, être une présence de guérison et de compréhension, partager plus de connaissances et d’informations au sujet des habitants de notre état du Minnesota, tous nos habitants car nous aimons tous cette terre.) Lors d’une lecture en 2018, en l’honneur du fleuve Mississipi, elle a aussi déclaré : Je me tiens ici aujourd’hui en tant que femme Dakota, au 21ième siècle. Je ne devrais pas être ici. Nous avons survécu à la tempête, aux feux de prairie, aux guerres, aux déclarations d’Alexander Ramsey selon lesquelles nous devrions être tous exterminés ou conduits en dehors des frontières de cet état pour toujours. Mais je me tiens ici aujourd’hui devant vous en tant que femme Dakota. Ces propos illustrent parfaitement les thèmes chers aux auteurs Indiens d’Amérique : ils célèbrent la survie et veulent transmettre leur histoire, leurs cultures, aux générations qui suivront ainsi que leurs ancêtres l’ont fait, malgré les épreuves et les drames. C’est une force extraordinaire qui les anime et les rend résilients, qui les rend comme invincibles face aux politiques d’anéantissement qui continuent encore de les menacer, eux et leurs terres. Son rôle en tant que poète lauréat sera de sensibiliser à la poésie les jeunes, les populations défavorisées et marginalisées, leur offrir la possibilité d’apprécier la poésie, les inciter à la lecture, d’ouvrir des chemins intérieurs, d’y puiser des enseignements, de s’exprimer à leur tour, mais aussi de faire éclore des talents, de mettre en avant d’autres auteurs dans l’état du Minnesota.


Gwen dit qu’elle écrit depuis aussi longtemps qu’elle peut en avoir le souvenir, qu’elle est toujours en train d’observer ce qui se passe et ce qui l’entoure, qu’elle adore raconter des histoires et que c’est ce qu’elle fait fondamentalement, que la poésie est pour elle la façon la plus directe et la plus facile de le faire. Elle n’a pas de routine d’écriture, elle écrit quand quelque chose la frappe, des brouillons griffonnés sur des bouts de papier, des enveloppes trouvées dans son sac. Comme beaucoup d’autres auteurs Indiens Contemporains, elle manie l’humour et l’ironie afin de montrer et dénoncer les pratiques colonialistes, des dérives de la société américaine qui veut se donner bonne conscience mais n’en continue pas moins d’exploiter tout ce qui est exploitable pour en tirer profit, continue de méconnaître l’histoire et les droits des Nations Indiennes, continue d’être aveugle, inconsciente du mal et de l’agression constante qu’elle inflige aux populations « indigènes ». En voici un exemple, poème inclus dans l’anthologie New Poets of Native Nations, intitulé Dakota Homecoming.
Retour à mon pays Dakota
Nous sommes tellement honorés
que tu sois ici, dirent-ils.
Nous savons que c’est
ton pays, dirent-ils.
Le prix d’entrée
est de cinq dollars, dirent-ils.
Voici ton badge
pour l’évènement, dirent-ils.
Cela compte beaucoup pour nous que
tu sois là, dirent-ils.
Nous voulons écrire
une lettre d’excuse, dirent-ils.
Dis-nous ce qu’il faut dire.
Gwen pratique une poésie sans prétention, directe, adressée et désireuse de partager les valeurs de sa culture, les traditions, afin qu’elles soient comprises par les non-Indiens. Poésie engagée et sans détour, elle n’hésite pas à mêler anglais et Dakota, et le lecteur alors peut expérimenter ce que les Indiens savent : l’énergie, la vibration des mots en langue Dakota et toute différente, et cela apporte une autre dimension au poème, en plus d’affirmer que les langues Indiennes ne sont pas mortes et qu’il convient d’honorer la beauté de ses langues. Voici un poème intitulé « reliés », qui donne un aperçu du rapport au monde et aux autres qu’entretiennent les Indiens d’Amérique :
Reliés
Voici mon give-away—
non parce que je ne le veux
plus,
pas parce que c’est démodé
ou
cassé ou
inutile parce qu’ayant perdu
son couvercle ou l’un de ses boutons,
pas parce que je ne comprends pas
la « valeur » des choses,
ceci est mon give-away—
parce que j’ai suffisamment
pour partager avec vous
parce que on m’a tellement
offert
santé amour bonheur
douleur chagrin peur
à partager du fond du cœur
dans un monde où les mots peuvent être
sans signification quand ils viennent
seulement du mental.
Ceci est mon give-away —
pour toucher ce qui est bon en toi
avec des mots que ton cœur peut entendre
comme des vaguelettes quand un caillou est
jeté dans l’eau
elles se dirigent vers l’extérieur grandissent
plus larges et en rejoignent d’autres.
Tu es fort.
Tu es gentil.
Tu es beau.
Ceci est mon give-away.
Wopida ye.
Wopida ye.
Wopida ye1.
Une autre façon de penser et de visualiser l’interdépendance et les réseaux qui constituent les sociétés Indiennes, pour dire leur relation et leur connaissance étroite de leur environnement, et ce au-delà de leurs territoires ancestraux, nous est offerte dans le poème qui suit dont le titre original est De Wakpa Taŋka Odowaŋ / Song for the Mississippi River.
De Wakpa Taŋka Odowaŋ / Chant pour le fleuve Mississipi
20 Septembre 2018
Bien avant Femme Louisiane et Homme Mississipi.
Avant Vieil Homme Rivière.
Avant Barbotte dans l’Eau.
Bien avant Schoolcraft2 et verItascaput3.
Avant frère Hennepin et St. Anthony,
Avant Misi Ziibi.
Bien avant Hernando de Soto.
Otakaheya
Au commencement,
Dakota Makoce
c’était un lieu Dakota.
L’eau était pure.
L’eau était wakaŋ.
Sacrée.
mni
pejuta tokaheya heca.
L’eau était
L’eau est
notre premier remède.
L’eau faisait partie du territoire.
Et donc partie des gens.
Et à cet endroit,
Nous avons prospérer.
Depuis Bdote,
où le Mni Sota Wakpa se jette
dans le Wakpa Taŋka,
nous avons suivi les rivières,
les voies d’eau connectées,
les modes de vie connectés,
Itokaġa
au sud vers ḢeMniCaŋ et
Bde Iṡtamni, le “Lac des Larmes.”
Waziyata
Vers le nord la Grosse Rivière
nous emmenait à Owamniyomni
le tourbillon créé par ḢaḢa Wakpa
les eaux courbes des chutes.
Nous connaissions l’élévation et la chute de la rivière,
les canaux et les gorges,
chaque méandre, chaque zone inondable,
depuis Bde Wakaŋ jusqu’à Mniti
Mille Lacs jusqu’au Lake of the Woods,
Rainy Lake jusqu’à Thunder Bay,
où nos tumulus funéraires demeurent.
Wiyoḣpeyata
vers l’ouest jusqu’au Saskatchewan
le début de la Churchill River,
au long de la Ballantyne River,
nommée Puatsipi par les Crees—
rivière Dakota.
Vers Bdote, le commencement
du Mississippi du Nord
et du Little Minnesota.
Là se trouvaient nos voies d’eau
et nos modes de vie.
Notre médecine.
Et nous aussi, voulons chanter
un chant pour l’eau,
un chant pour wakpa taŋka
alors nous écoutons
nous écoutons
écoutons
et puis
sur le bord d’un rêve
les chants arrivent.
Condensés de brouillard
comme des gouttes de rosée sur les roseaux,
ils se forment très clairement.
Murmurant au travers des feuilles,
des voix hautes s’élèvent,
dérivent au-delà de la nuit
jusqu’à l’aube silencieuse,
et chantent.
Hekta ehaŋna ded uŋtipi.
Heuŋ he ohiŋni uŋkiksuyapi kte.
Aŋpetu dena ded uŋtipi.
Heca ohiŋni uŋdowaŋpi kte.
Mni
Mni pejuta
Mni wiconi
Mni wakaŋ
Sur l’air immobile du matin,
ils arrivent,
connectés reliés par
les souvenirs
connectés par
l’eau.
Dans son recueil Follow the Blackbirds (Suis les étourneaux) Gwen construit, reconstruit avec des mots, un monde qui reflète le passé, le présent et le futur des Indiens Dakota. Le langage employé est simple mais sensible, émouvant. L’auteure écrit depuis le monde Dakota, mêle son expérience personnelle, singulière, avec le sentiment collectif de nostalgie, d’attente, d’aspiration. Elle évoque les problèmes familiaux, d’environnement, la communauté Dakota et parfois elle se permet un humour tranchant afin de critiquer avec acuité et mordant, les travers de la société dominante. Elle n’évite pas de parler du passé douloureux, non plus que l’avenir qui sera ponctué de luttes et de combats pour conserver les territoires Dakota, ceux qui restent après colonisation, à la communauté, ainsi que leur culture. Ce livre fait la part belle à la notion de place dans le monde, au sentiment d’appartenance, à la relation entretenue avec une terre de naissance, elle célèbre les plaines, leurs hautes herbes, elle exprime, explique comment la vue de celles-ci la connecte à quelque chose de puissant qui va au-delà de l’histoire et de la mémoire. Utilisant l’anglais comme le Dakota, elle montre combien la force du langage est un élément clé de la survie et elle chante la puissance des sons et des mots.
Comme dit en introduction, Gwen Westerman en plus d’être poète est une artiste plasticienne qui utilise les traditions du quilt pour réaliser de grandes pièces exposées dans des musées. Voici quelques poèmes accompagnant ses œuvres plastiques de tissu (broderie, tissage, perlage, couture) exposées au musée d’arts de l’université Gustaphe Adolphus en 2021. Cette exposition porte le titre de From This Hands (Fait de ces mains).
La première pièce est intitulée Wiyohpeyata / To the West
Nous sommes
porteuses de rêves
nous portons les enfants
ces fardeaux portés
avec espoir
et recueillement
sous la gravité
de la responsabilité
histoire et
amour
pas culpabilité
amour
et espoir
pour ceux qui
rêverons
et partagerons
ces fardeaux nés
nous n’abandonnons pas
de bon gré
mais attirons et repoussons
équilibre et partage
plus forts
par ce lien
d’amour
Voici un deuxième poème, intitulé 38
38
Nous nous levons
ensemble
chantons
nos prières
à l’unisson
écoutez-nous
nous sommes
ici
debout
au centre
regardez-nous
nous faisons
ceci
aujourd’hui afin que
notre peuple
vive encore
demain
nous offrons nos
mains
d’êtres humains
souvenez-vous
de nous
Le troisième poème, Wicaŋhpi Heciya Taŋhan Unhipi / We Came From the Stars (Nous arrivions des étoiles) nous montre combien les Dakotas, et avec eux les Indiens d’Amérique, se sentent reliés au cosmos :
La nucléosynthèse stellaire
qui explique
d’où toute chose
dans notre univers
est venue selon les astrophysiciens qui
ne découvrirent que récemment la constante cosmologique permettant
l’explication
de notre univers
Notre histoire de la création nous dit que nous sommes venus des étoiles en cet endroit : Bdote4, où le Minnesota et le Mississipi convergent,
ce fut notre voyage le long de Wanagi Caŋku5,
dans notre univers,
que des astronomes plus tard appelèrent la voie lactée qui maintenant disparaît
dans la lueur excessive de millions et de millions de lumières urbaines.
Nous les premiers habitants de cet endroit
dans notre univers,
sommes les Wicaŋhpi Oyate, Peuple des Etoiles
et nous resterons ici aussi longtemps que
nous pourrons nous reconnaître
dans les étoiles
Voici un autre poème, faisant partie de cette exposition From his Hands, intitulé Hena uŋkiksuyapi (nous sommes le peuple des étoiles) et qui complète ce sentiment fort d’identité et d’appartenance à un ordre plus grand que le terrestre, à savoir le cosmique.
Nous sommes le peuple des étoiles, Wicaŋhpi Oyate heuŋtaŋhaŋpi
Notre héritage est aussi varié aussi présent, aussi absent, que
les étoiles au ciel. Dans la lumière vive du jour, nous ne
voyons qu’une étoile, notre soleil, mais les autres
ne sont pas parties. Au crépuscule, elles
réapparaissent. Les lumières de la ville
peuvent les obscurcir mais elles
ne sont pas parties.
Notre point de
référence
voile
ou
éclaircit
notre vision.
Pour créer de la beauté
à partir de la tragédie, guérir
du trauma n’est pas une lutte pour
la suprématie d’une histoire unique
mais un procédé de nouvelles compréhensions
qui évolue comme nous évoluons. Car où réside
« la vraie mémoire » ? Notre passé est enregistré dans
notre mode de vie, dans nos traditions et dans les cœurs
battants de notre peuple. Nos histoires brillent comme des étoiles
et nous nous en souvenons.
La poétesse Gwen Nell Westerman lit des extraits de son livre Follow the Blackbirds, We are Star People, au centre Wisdom Ways le 6 avril 2018.
Pour finir avec l’exposition, en regard d’une œuvre plastique intitulé Tree of life (arbre de vie) composée de mains dessinant une sorte de cactus ou d’arbuste, voici un poème intitulé Root Words (mots racines), poème qui fait partie du recueil Follow the Black Birds.
Mots racines
La prairies
les herbes
ont des
racines
deux fois
plus longues
qu’elles ne
sont hautes
profonds
ancrages
qui les stabilisent
contre les vents incessants
balayant les plaines. Leurs racines
s’enfoncent sous la terre
desséchée par chaleur et froid
et se nourrissent des restes d’une
vaste mer intérieure
qui grouillait des sons de
la vie il y a longtemps.
Notre langue
est comme les herbes de la prairie
survivant aux feux des
missionnaires et leurs dieux,
aux flots de mots anglais,
à la sécheresse, grandissante
en des lieux inattendus
comme si elle
n’était jamais partie.
Makoce kiŋ etaŋha
uŋhipi ikce
wicasta tehikapi
Dakota iapi
teuŋhiŋdapi
Voici à présent un poème récent que Gwen a lu lors d’un passage sur la chaîne de télévision Indian Coubtry Today à l’occasion de sa nomination de poète lauréat de l’état du Minnesota, elle était interviewée par Mark Trahant, le rédacteur en chef de Indian Country Today, d’origine Shoshone-Bannock :
Respire profondément et chante
Nous chantons pour les moules
nous les loutres et les castors,
les grenouilles et les libellules
les oiseaux aquatiques et les locustelles
les coyotes aussi.
Nous respirons profondément
et nous chantons pour les moules.
Nous sommes les poumons du Mississipi
notre fleuve, pollué par les égouts
et les eaux usées,
asséché et endigué,
grêlé de zones mortes à cause de produits chimiques et teintures,
bordé par les rives de la destruction,
notre fleuve :
une voie de migration majeure,
il coule jusqu’à nos cœurs,
les a traversés pendant des siècles et des siècles
bien au-delà de la mémoire
au travers de terres marécageuses et de bras morts
de communautés et d’économies
ravagées par des espèces invasives
des humains envahissants.
La dégradation de l’environnement
a coulé jusqu’à nos cœurs
notre fleuve
il vient à nous
il nous fait signe
nos rêves coulent et le suivent.
Donc nous chantons pour les moules
nous les loutres et les castors,
les grenouilles et les libellules,
les oiseaux aquatiques et les locustelles,
les coyotes aussi.
Nous respirons profondément
et nous chantons pour les moules
qui sont les sentinelles silencieuses de notre fleuve,
elles retiennent nos histoires et la douleur
de notre fleuve
celles d’il y a quarante, soixante-dix, deux-cents ans
comme les arbres au-dessus d’elles sur les rives
de notre fleuve
les anneaux des coquilles de moules sont les
archives de notre environnement
et de notre fleuve
ils enregistrent la résilience et les luttes
la restauration des plaines inondables et
des fonds du fleuve
la restauration de la santé et des cœurs.
Comment guérir notre fleuve
sans nous guérir nous-mêmes ?
Notre fleuve
nous fait écho
nous soutient
nos rêves coulent et le suivent
ses eaux nous façonnent
nous étreignent
et sont notre principal remède.
Donc nous chantons pour les moules
nous les loutres et les castors,
les grenouilles et les libellules,
les oiseaux aquatiques et les locustelles,
les coyotes aussi.
Respire profondément et chante avec nous
pour les moules
et nous chanterons pour toi.
À la fin de cet exposé, vous aurez compris que Gwen Westerman incarne parfaitement les valeurs de sa communauté Sioux Dakota, comme celles plus largement des Indiens d’Amérique. Tout en restant humble et simple, sans artifices spectaculaires, sans arrogance, sans tapage médiatique, elle s’engage à faire du monde un endroit où vivre en harmonie, sans oublier ce qui nous lie à la terre et au cosmos, et pour cela qu’elle soit remerciée.
Notes
- Give-away, (parfois aussi nommée cérémonie du Potlatch), est une cérémonie traditionnelle pratiquée dans les tribus Indiennes, cérémonie de remerciement parce que bénéficiant d’une relative abondance, cérémonie de redistribution puisqu’abondance non égale pour tous, symbole de solidarité et d’entre-aide, elle vise également à faire que les humains se détachent des biens matériels, se suffisent d’un minimum vital. Ce rituel à visée de croissance spirituelle, permet de faire grandir les personnes afin d’un jour mériter l’adjectif d’humain, conscient de son interdépendance avec la création entière. Wopida signifie merci en langue Dakota, le suffixe ye ponctue les phrases est employé quand c’est une femme qui parle. (N.d.T.).
2. Henry Rowe Schoolcraft, né en 1793 et mort en 1864, était un géographe, géologue et ethnologue américain qui étudia les Indiens d’Amérique et « découvrit » la source du Mississipi à savoir le lac Itasca. L’épouse de Schoolcraft était férue de légendes amérindiennes et c’est grâce à ces légendes partagées avec son mari qu’est né le poème épique de Longfellow, The song of Hiawatha. Misi Ziibi : nom donné à la partie supérieure (nord de l’état du Minnesota) par les Indiens Ojibwa.
3. verItascaput (latin) : True Head, terme qui désigne le début d’une rivière ou d’un fleuve, ici en l’occurrence le lac Itasca. Mni = eau, Mni wiconi=l’eau c’est la vie Mni Wakan=l’eau est sacrée Mni pejuta=l’eau noire, le café.
4. Pour les Indiens Sioux Dakota, le mot Bdote signifie confluence, et par extension c’est l’endroit où rivières et humains sont venus ensemble depuis au moins dix mille ans. Bdote est une étendue, un paysage central pour l’identité des Dakotas et est considéré comme un lieu sacré. Cette zone appelée Bdote contient plusieurs endroits importants pour les Indiens Dakota tels que Wakan Tipi (Carver's Cave, la grotte Carver), Mni Owe Sni (Coldwater Spring, Source d’eau froide), and Oheyawahi (Pilot Knob, poignée de pilote).
5. Caŋku Wanaġi, “the spirit road,” c’est-à-dire en langue Dakota, (comme Lakota et Nakota), le chemin spirituel. Il est dit que les esprits des Indiens Dakotas descendirent de la Caŋku Wanaġi, qui fut créée à partir des étoiles de la voie lactée et quand ils arrivèrent sur terre, le créateur façonnant le premier humain avec l’argile de Maka Ina, la Terre Mère. Les humains alors formaient le Oceti Ṡakowiŋ, The People of the Seven Council Fires, le peuple des sept feux du conseil, une société organisée de façon à refléter son origine sacrée. Les Indiens Dakota pensent que l’embouchure de la rivière Minnesota est le centre de la terre et que les Dakotas occupent la porte qui ouvre sur le monde de l’ouest. (À l’échelle du continent nord-américain, ils n’ont pas tort !).