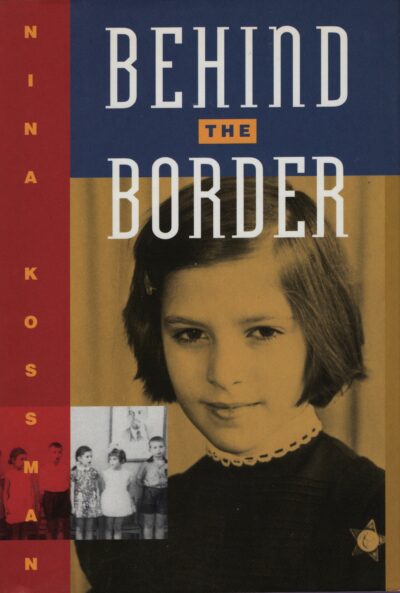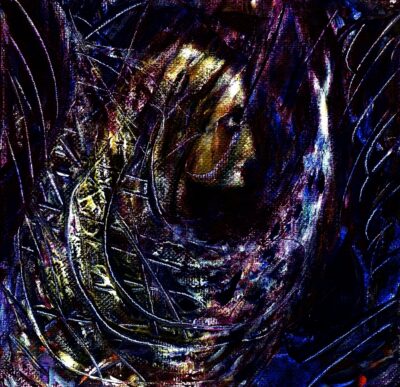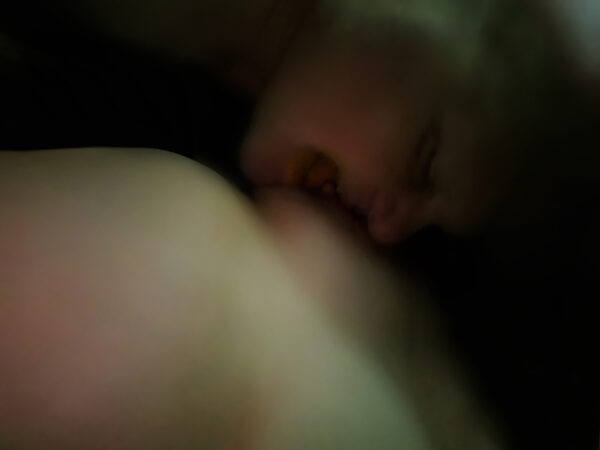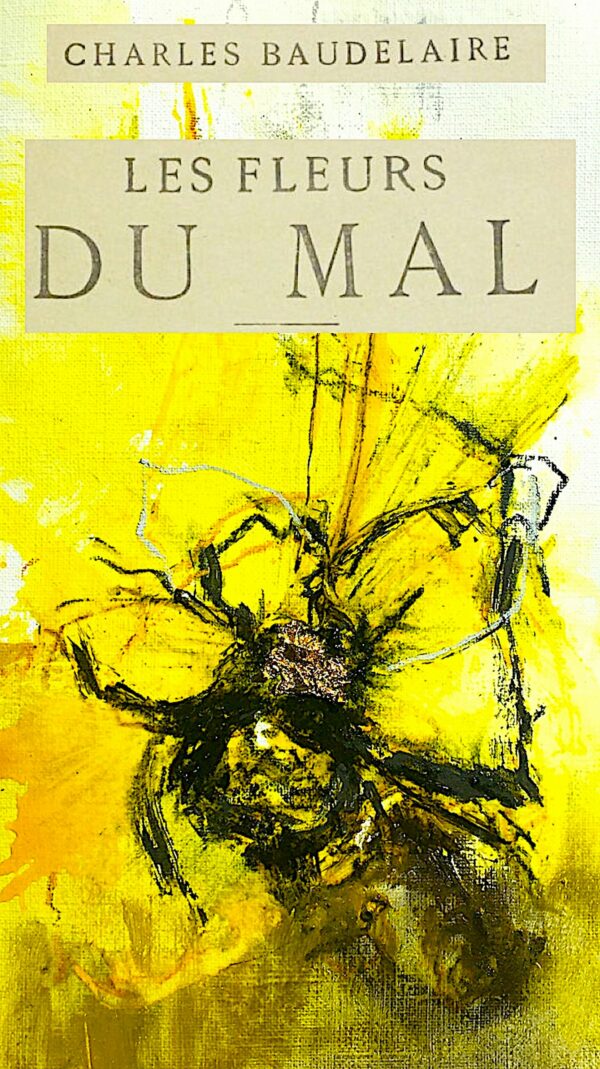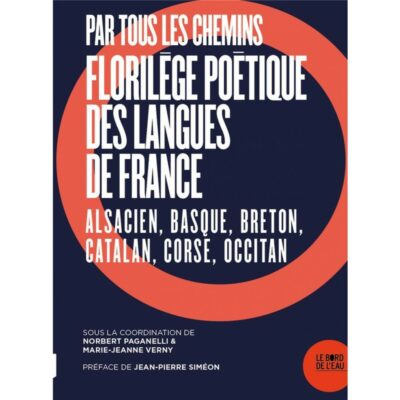Marc Tison : Sons et poésies qui s’enlacent
Cela fait des années que Marc Tison porte la poésie ailleurs, là où elle dévoile ce qui de la banalité de notre quotidien a été enseveli sous les habitudes. Il emmène le poème jusqu'au creux des jours, le rend audible, perceptible. Il rend audible cette dimension vibratoire qui fait de toute poésie l'instrument d'un lien entre nous tous, humains, par-delà le langage. Il fait de la poésie une expérience sensible qui emporte le lecteur/auditeur dans des univers à chaque fois renouvelés. Entre chant et diction, ce cadeau reproductible à volonté grâce au 33 tours qu'il vient de produire avec pour l'accompagnement musical Marc Bernard et pour la mise en œuvre graphique Jean-Jacques Tachdjian, est la suite logique de sa démarche, qui est celle d'un poète qui restitue l'épaisseur acoustique et vibratoire du poème et l'emporte dans l'univers de ceux à qui elle est ainsi offerte, pour que le partage soit consubstantiel de l'édification du sens, et au-delà, pour qu'elle atteigne à l'essence de toute poésie, la fraternité.

Marc Tison, 4 phonations flexibles, vinyle, poésie musique et livret image ; musique de Marc Bernard, graphisme JJ Tachdjian, Mtmgmt, 2021.
Oui bien sur, il y a que je vis très simplement -je peux dire naturellement- l’émotion quotidienne à travers, par exemple, l’odeur de la pluie sur l’herbe coupée comme aujourd’hui, une rencontre de hasard, un fait social signifiant, ou l’arrangement heureux d’une chanson, ou encore la vue d’un paysage. Le poème est là.
Ces propositions sont autant de souhaits qu’elles rencontrent la matière sensible des gens, « les autres », dans des savoirs lire ou entendre les poèmes différents.
Même si les poète-esse-s aiment à être lus et entendus par leurs pairs, et les initiés, l’origine du poème n’est pas là, et ne peut jamais être légitimement là.
D’ailleurs, plus je me pose la question moins je sais, et moins cela m’occupe de savoir pourquoi j’écris, je fabrique, des poèmes qu’ils soient à lire, à entendre ou à voir.
C’est la vie « merveilleuse » comme ça, c’est le « ça qui est ça », des objets de l’émotion du quotidien. C’est surement en parti pour cela que je suis ailleurs des cercles habituels de la poésie.
Mes poèmes, et moi aussi, humblement cherchons surement et éternellement ce que Ferlinghetti nommait « The rebirth of wonder » - « La renaissance des merveilles ».
Contre la mort
Je me battrai contre la mort
Toutes les morts
A mains nues rouges
Armées du soleil fou des solitudes célestes
Je me battrai contre la mort
Jusqu’à effacer les disparitions
Dans la persistance sidérale
Extrait du EP "4 phonations flexibles" Textes voix -Marc Tison / Sons musiques Marc Bernard / Réalisation Pascal Gary.
Je t’aimerai comme avant la curée
Avec la sauvagerie des perdants
La peur en gorge ficelée des cris
Tes sudations déversées dans mon ventre
Seront mes psychotropes mes euphories
Ma bouche écorchée embrassera à pleines dents
La nuque des bâtisseurs de ruines
Tes ennemis se videront de leurs sangs
Rendus blêmes
Tu auras le mien embrasé en recours
Je t’offrirai le si peu que j’ai de précieux
Mes organes vitaux
Mon sexe
Mon cœur
Mes poumons
Et le mystère de la raison
Je deviendrai quelqu’un de bien mieux
∗∗∗
L’affolement des courbes
Ce sont les mains
Les mains
Les mains suivent la ligne
Elle paraît
Sur l’univers blanc
Et au dedans
La métaphore du cœur
Le battement
On ne sait pas où
On ne sait pas où se trouve l’émotion
L’organe qui envahit l’ensemble
Ce sont les mains
Les mains
Qui le disent
En dessin dans l’air
L’affolement des courbes
Un contre-jour
Des bouches se frôlent
La jambe enlace une taille
Le cou une paume les doigts
Et les yeux
Le long des horizons s’étreignent
En échange les traits de contraste
∗∗∗
Il n’y a pas d’autre que moi
Il n’y a pas d’autre homme que moi
Il n’y a pas d’autre homme que moi
Il n’y a pas d’autre homme que moi pour nourrir les oiseaux du jardin
Il n’y a pas d’autre homme que moi
Il n’y a pas d’autre homme que moi pour causer à mon voisin
Il n’y a pas d’autre homme que moi pour sauver le monde
Il n’y a pas d’autre homme que moi
Il n’y a pas d’autre homme que moi pour combattre l’obscurantisme trier les déchets
Il n’y a pas d’autre homme que moi
Il n’y a pas d’autre homme que moi pour faire le ménage et advenir la paix
Il n’y a pas d’autre homme que moi
Il n’y a pas d’autre homme que moi dans la volition d’être un homme
Extrait du EP "4 phonations flexibles" de Marc Tison distribution numérique Absilone. Sons et poésies qui s'enlacent.
∗∗∗
Pierre
Pierres qui calent mesures d'usines
imbriquent des briques de terre de
pierres pierres rouges les murs des
maisons ouvrières des ouvriers
effacés dans le canton de Denain
désintégrés statistique sociale
troisième page des misères du
journal rouge maisons barricades
planches aux fenêtres et les murs
désertés rouges de pierres
s'effritent sans fin recyclées et
d'autres écrasées sans fin tapis des
sols d'autoroutes sacrifices des os
d'anciens locataires sidérurgistes au
RSA offerts à la condition de
poussières
Extrait de la lecture performance de Marc Tison textes et Raymond Majchrzak sons à Bereldange Luxembourg le 06 février 2019. Texte extrait du recueil "Des nuits au mixer" édition de "lachienne".