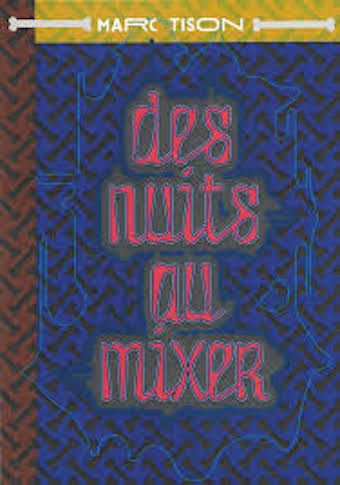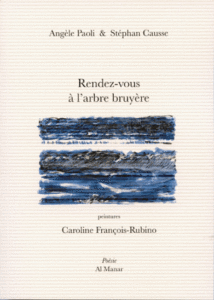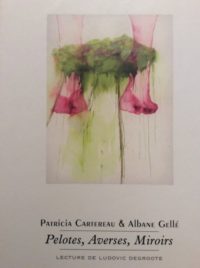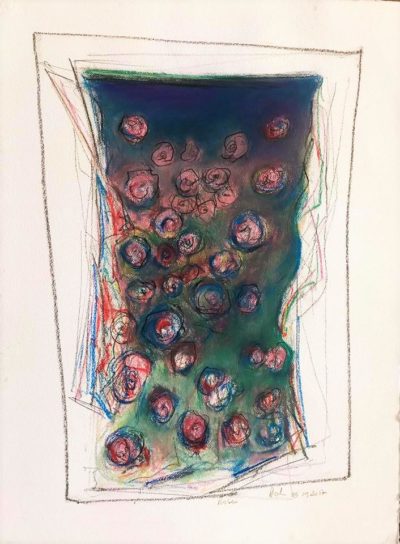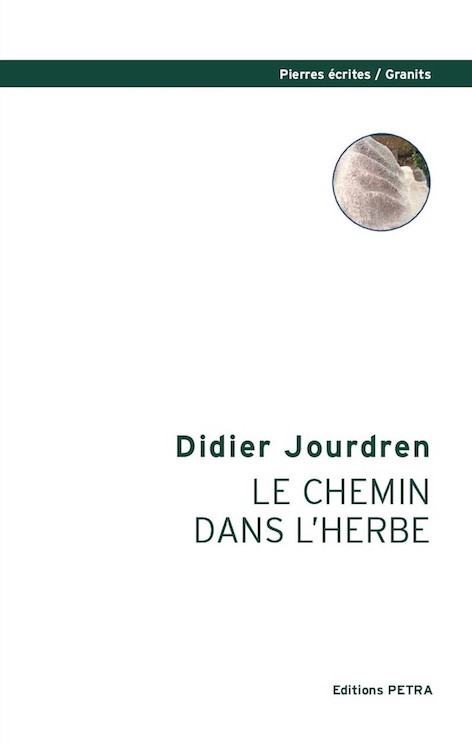Elyssa Leydet Brunel, Goodbye Pénélope (extraits)
Le monologue de Pénélope est extrait d'un spectacle mettant en scène quatre jeunes femmes dans leurs activités quotidiennes. Elles évoquent l'histoire familiale, leurs mères et grand-mères, leur identité... et naît en Pénélope (celle qui a tant attendu, tant répondu aux attentes de la société, tant remisé ses propres désirs pour seconder ceux des autres) la conscience d'elle-même, et le désir d'être enfin maîtresse de son destin : mais peut-on jamais partir - et comment?
Elyssa Leydet-Brunel explique son projet dans les vidéos qui accompagnent les deux longs extraits que nous publions.
début du texte
le choeur des femmes
je pense qu’avant c’était plus simple de partir c’était plus simple
parce que la mer était complètement desséchée et qu’on pouvait
s’en aller à pied spontanément
pas de traversée à préparer
pas de bateau à prendre
on pouvait partir quand on voulait à pied juste traverser la mer comme une vallée
mais ça c’était il y a longtemps ça
oui peut-être mais enfin
vraiment longtemps
exactement c’était au début du Messinien alors tu vois
Messine c’est une ville en Sicile Messine c’est le détroit de Messine
c’est là où Ulysse doit passer dans l’Odyssée à un moment l’épisode
de Charybde et Scylla
non pas du tout
c’est une ère c’est l’ère du Messinien
c’était y’a longtemps tu vois
des mouvements tectoniques ont partiellement voire totalement
fermé le détroit de Gibraltar
ce qui a réduit l’apport d’eau venant de l’Atlantique
et comme l’évaporation est très forte
à cause du climat sec et pauvre en pluie
la Méditerranée s’est asséchée doucement pendant plusieurs
milliers millions?
milliers ?
milliers voire millions d’années
et là on pouvait allègrement tout traverser à pied effectivement c’est
vrai
alors on prenait une valise en carton comme ça
simplement
et puis à la limite Miocène Pliocène
le détroit de Gibraltar s’est effondré, et les eaux de l’Atlantique ont
envahi le bassin, d’un coup, les eaux ont déferlé
j’aurais voulu voir ce moment
ça devait être quelque chose
les eaux ont déferlé et la Méditerranée a retrouvé son état normal de
mer en quelques dizaines d’années
tu te rends compte la rapidité
la rapidité du remplissage
et tant pis, maintenant il faut prendre le bateau
partir est devenu plus compliqué
c’est une décision
c’est certain
c’est quelque chose
ça se prépare maintenant
c’est moins facile
les pays ne sont plus voisins
ils ne suffit pas de marcher
les pays sont séparés maintenant par la mer qui s’est remplie
alors c’est vrai, ça rend les relations moins fluides
disons que ça se prépare
on doit prendre un bateau
et naviguer quand même pas mal
c’est une décision
c’est certain
c’est quelque chose
tu n’es jamais partie toi
arrêtez avec ça
c’était plus simple quand il n’y avait pas d’eau dans la mer
on pouvait partir à pied
même pour les adieux on aidait à porter les valises en carton
pendant les premiers temps de la marche encore quelques pas
ensemble et puis on faisait demi-tour quand le temps était venu
en partant à pied on rencontre des gens qui marchent dans l’autre
sens
c’est beau
et quand il y a eu à nouveau de l’eau dans la mer
il y a eu les langues
les terres se sont séparées
il y a eu les langues
moi je suis née dans la mer
moi ma mère
moi je suis née dans la mer et c’est là que j’ai attrapé mon
polyglottisme
dans la mer
car c’est dans la mer que se meuvent toutes les langues c’est dans
la mer qu’elles sont enfermées mêlées engluées toutes les langues
les mortes et les vivantes la mer est bleue molle et paresseuse
couchée dans le port en bas comme un animal dompté la mer a
porté tous les bateaux toutes les histoires toutes les traces tous les
contes toutes les musiques tous les airs de guitare la mer a porté les
hommes d’un bout à l’autre les espoirs et les mythologies toutes les
origines toutes les traductions elle est fatiguée maintenant elle s’est
couchée dans le port langue bleue lisse et épaisse tous les
messages ont été délivrés toutes les lettres dans les bouteilles la
mer n’a plus rien à dire elle voudrait que nous comprenions
maintenant elle s’est couchée dans le port en bas
Fin du texte
faut-il toujours partir
est-il toujours question d’un départ
ce qui est intéressant c’est comment décider
quel choix faire
et comment être sûr
ce qui me fascine c’est cette décision
tout le processus de cette décision
vous savez je me rends compte combien j’ai peur
je voudrais changer d’espace et je me sens
bloquée sans comprendre mon coeur étouffe et se
serre de contrariétés mon coeur demande de
l’espace pour battre et s’exprimer dans la boue
des chemins s’ébattre dans l’immensité des
champs à perte de vue la mer mon coeur a besoin
d’espace pour battre de tout son saoul battre tant
qu’il veut en faisant du bruit sans déranger
personne pourquoi dois-je étouffer les battements
fougueux de mon coeur ce cheval débridé qui
dégringole dans mon ventre et crie et réclame et
trépigne à l’intérieur de mes organes et auquel
toujours je dois dire non me fatiguer à lui dire non
dépenser tant d’énergie à lui dire non pas
maintenant non
et aujourd’hui le jour se lève
et avec lui tant de vies possibles encore
ce cheval fou c’est moi
voilà
toujours je pensais le cheval fou c’est les autres
les autres sont plus fous que moi les autres bien
sûr les autres peuvent se permettre c’est eux c’est
normal ils s’en vont ils partent ils reviennent c’est
normal
et je ne voyais pas que le cheval fou à qui je disais
toujours non cet enfant sautillant toujours
contrarié le cheval fou résidait en moi aussi
en moi aussi
en Pénélope
et Pénélope c’est mon nom
il est à moi ce cheval fou
il s’appelle Pénélope
et Pénélope c'est moi
que va-t-on faire de notre vie ?
la lune il me semble veut me dire quelque chose
je veux parler de ma joie
il y a tant d’élan en moi que mon corps marche
vite dors peu avance rigole s’en va se perd
et mon regard toujours ailleurs loin vers l’avant
il y a tant d’élan en moi que je monte les escaliers
d’un pas qu’il me semble que j’ai maigri que je
voudrais embrasser les autres me rouler dans les
draps du jour et du matin
mon coeur est fou il s’emballe il me dit qu’est-on
en train de vivre Pénélope
qu’est-ce qu’on va faire de notre vie ?
me voilà à la croisée des chemins, gonflée de vent,
comme une voile
Pénélope
attendant de choisir mon
inclinaison la juste inclinaison pour moi et
le bon vent fera le reste
awake my soul
éveille mon âme
show me the way
il n’y a qu’un pas
ce qui est intéressant c’est le choix que l’on va
faire
et alors
regardez
l’horizon calme limpide déposé là comme une
ligne bleutée sans heurts tout est évident clair et
tranquille
et il ne reste qu’à marcher
j’ai de l’énergie
j’ai de la vaillance
je me lève toujours plus tôt me couchant toujours
plus tard
il me semble que la lune veut me dire quelque
chose
c’est de cela dont je voudrais parler
je veux parler de ma joie
je veux parler de mes doutes
je veux parler du courage qu’il faut
mes sœurs, je dois vous dire, peut-être que
maintenant je vous verrais moins, ce sera plus
difficile vous comprenez, je continue de vous
aimer, mais je m’en vais et là où je vais, c’est un
peu loin c’est vaste, alors peut-être qu’à cause de
ça on se verra moins, mais on s’aime toujours très
fort, et jamais je ne vous oublierai, je serai auprès
de vous, comme la lionne que je suis parfois
quand on vous fait du mal, mes sœurs, je continue
de vous protéger, je suis la Pénélope de l’histoire,
et mon coeur vous restera terre d'accueil, comme
la lionne que je suis parfois quand on vous fait du
mal, mais peut-être que, peut-être qu’on se verra
moins maintenant, peut-être que, c’est vrai, peut-
être que je vous ferais moins souvent rire, et que
je ne partagerais plus vos secrets, vos yeux
chiffonnés du matin, pardonnez-moi, je m’en vais
et c’est un peu loin, vous savez comme je vous
aime, pardonnez-moi si je ne peux, comme avant,
vous regarder partir et écouter toutes vos
histoires, il est temps, j’ai compris, et c’est une
fulgurance, ne m’oubliez pas, je serai loin, gardez
ma place au chaud, gardez là bien vide, n’invitez
personne, gardez ma place vide, à la table dos à la
porte-vitrée à côté de la commode de la machine à
café, n’invitez personne, dites que c’est pris que
c’est déjà pris, qu’on attend quelqu’un d’une
minute à l’autre, car je reviendrai, gardez s’il vous
plait, la place vide, promettez, il y a des retours,
les histoires finissent parfois comme ça, et peut-
être qu’un jour je serais moi aussi de retour
comme d’un beau voyage, ça se peut.