Le Bruit des mots n°4 : Regrd sur la Poésie Nativ American — Entretien avec Béatrice Machet
Le Bruit des mots n° 4 à l'Atelier Matresleva, le 24 mars 2024, avec Béatrice Machet et Carole Mesrobian.
Le Bruit des mots n° 4 à l'Atelier Matresleva, le 24 mars 2024, avec Béatrice Machet et Carole Mesrobian.
Présentation de Gabrielle Sava - traduction Gabrielle Danoux
Emil Iulian Sude est né le 6 septembre 1974, à Bucarest. Il est l’un des premiers poètes primés d’origine rom en Roumanie. Il travaille actuellement de nuit, en tant qu’agent de sécurité dans une école publique tout en poursuivant ses études en romani et en roumain, à l’Université de Bucarest.
Il a fait ses débuts littéraires avec le recueil de poésie Scărarul [Le Confectionneur d’échelles], Éd. Grinta, 2014, avec des références critiques de Nora Iuga. En 2016, a été publié le recueil de poèmes Chiar nu [Vraiment pas], Éd. Eurostampa, avec des critiques d’Al. Cistelecan, Gabriel Nedelea, Nora Iuga, Ciprian Chirvasiu. Il a été invité à de nombreux festivals et événements culturels organisés par l’Association Direcţia 9. Ses poèmes ont été publiés dans l’anthologie Moștenirea Văcăreștilor [L’Héritage des Văcărești], (2013), ouvrage couronnant le concours éponyme, ainsi que dans des périodiques culturels prestigieux. Les critiques et références dans : Viaţa românească, Steaua, Contemporanul, Vatra, Mozaicul, participation au festival de littérature religieuse de Caraiman, organisé par le journal Ziarul Lumina.
Commémoration en mémoire de l'Holocauste, 2 août 2021.
En 2018, est paru le recueil de poésie Povești [Histoires], suite à sa participation au concours de manuscrits organisé par le Centre national de culture rom Romano Kehr. La même année lui est décerné le diplôme d’excellence pour sa « contribution remarquable au développement et à la promotion de la culture et de l’identité rom ». Après Rapsodiile unui gelos [Les Rhapsodies d’un jaloux], éditions Rafet, 2022 (le prix du manuscrit et le deuxième prix lors du festival national Alexandru Macedonski), son dernier recueil, paru en 2023, s’intitule Paznic de noapte [Veilleur de nuit].
∗∗∗
Poèmes d'Emil Iulian Sude
Aujourd’hui j’ai fait un malaise dans le tram 21
une torpeur s’est comme ça emparée de moi et ce mal(être) m’a cloué débout.
là-bas à mi-chemin du tram 21. où se scinde en
deux la vie. là-bas tandis que je prenais appui sur la barre latérale de moi
s’est emparé ce mal(être).
si je me souviens bien c’était à mi-chemin du tram
où se tiennent les petits balanciers. les grands balanciers sont
plus proches du conducteur. nul besoin d’avoir un certain âge
pour les balanciers on peut même n’être qu’un enfant si l’on veut,
pour les balanciers. ceux qui passent dans l’autre moitié du tram
reçoivent gracieusement un balancier pour s’y balancer.
et tandis que je comptais les arrêts jusqu’à piața obor. c’est comme ça
qu’un mal(être) s’est emparé de moi et m’a ramolli les genoux. le noir
devant mes yeux. petit ou grand mal(être) je n’en sais rien puisque je ne suis pas encore mort
tout à fait. juste la mollesse de mes genoux et la voix
familière criant emil emil. étendez-le par terre il a quelque chose
comme un mal(être). et laissez-le respirer tout seul. criaient les voyageurs.
forts aimables les passagers du tram 21.
l’un m’a offert sa place. un autre a ouvert la fenêtre.
fort aimables les voyageurs après tout j’étais l’un des leurs.
juste mon front en sueur et mes mains moites et froides. seul le mal(être)
s’amenuisait lentement et ma colère noire dans le tram 21 ne me lâchait plus.
de ma prière vers dieu je ne me souviens plus guère.
seule de la voix féminine attendue toute ma vie
à l’arrêt perla pour prendre ensemble le tram 21 qui était en fait
le tram 46. je m’en souviens. qu’il nous emmène
qu’il nous emmène à ce marché obor pour l’agneau de Pâques.
*
Près de nous de la place pour tout le monde
personne ne vient nous ressusciter. nous avons de la place
pour les mariées pour les mariés
dans les recoins
pour dire vous êtes trop nombreux. personne.
aucune complainte pour la foule.
trop indulgents avec les choses de la vie
nous nous multiplions comme des lièvres
au mètre carré nous inspirons le même air.
couronnes de virus. de lointains empereurs
quand nous rêvons avec mille yeux
mille pieds. qui aurait pu imaginer
de ce que nous fûmes nous serons utilisés
contre nous-mêmes
seule la terre bombe ses extrémités.
les uns sur les autres nous faisons l’amour sous pression
dans toutes sortes de positions ignorées par le kama sutra.
on se liquéfie on coule par tous les trous du sirop de pissenlit.
parfois il nous semble que nous nous brisons dans des
fleurs de chanvre indien perlent nos visages
nos bouches s’assèchent.
et nous rions à rompre nos diaphragmes.
*
Cigarettes café promenades comme chez les fous
un véritable esclandre
ici nous sommes tous amis. ici nous sommes tous sains d’esprit.
personne ne reconnaît. les regards perdus parlent de nous.
les détournements de la réalité immédiate
auraient été notre seule réalité.
disaient ceux qui pensaient contrôler la réalité.
l’infirmier a dit je suis nouveau. une fleur
un jour de mai. je suis tout juste bon. pour les pilules
probablement une dépression, j’ignore si je suis guéri ou
si j’ai jamais été déprimé.
je fus interrogé par un collègue si je me suis acclimaté.
trois mois qu’il pêchait délicatement les plantes dans la rigole.
regarde comme elles sont belles. j’avais envie de rire.
sans raison. tel un fou. il a été conduit
à l’hôpital par un temps hivernal.
on ne nous a jamais donné de fourchettes pour manger.
Ils disaient qu’on allait se crever les yeux fixant le vide.
le premier jour, nous avons mangé le plat de résistance avec les mains.
aucun de nous n’avait assez de cigarettes. le
nec plus ultra était de fumer et d’observer la lune.
aucun espoir que les amoureuses ou les épouses nous cherchent. si
toutefois ça leur arrivait de passer en coup de vent as-tu apporté des cigarettes
pour observer la lune. on demandait.
j’ai quitté cet endroit. je n’ai pas découvert ce dont je souffrais.
d’un hôpital à l’autre. que dira
le monde. le pauvre habite sous les combles.
bien sûr, ils m’ont demandé comment je
me sentais. l’éternelle bienveillance.
cela peut arriver à tout un chacun. disait-on.
(poèmes extraits du recueil Paznic de noapte [Veilleur de nuit] et traduits du roumain par Gabrielle Danoux)
Ce recueil se présente comme une longue lettre adressée au père disparu, un long poème ininterrompu, écrit d’un seul souffle.
Claude Gobet « revient sur les lieux », comme on dit. Dans une écriture poétique incisive, concrète et sans complaisance aucune, il ré-ouvre les forces puissantes de l’indicible, celles qui écrasent, figent et éteignent toute vitalité. Il refait le chemin, pour mettre à vif la blessure, en affronter les ombres, de façon centrale l’ombre du père. Aveux difficiles et déchirants, d’une profonde sincérité, qui laissent filtrer la lumière d’une espérance, d’une création de soi qui m’a profondément touchée.
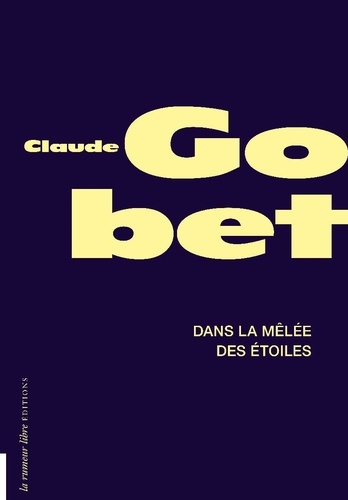
Mon ami poète et romancier Nourredine Ben Bachir a donné un sens différent du mien à ce titre. Et tant mieux ! Il en a fait sa propre lecture et elle est pleinement judicieuse par rapport au livre dont la figure du père est centrale, et par là incontournable.
Pour ma part, je suis parti de l’idée que lorsque nous regardons le ciel étoilé, étrangement, nous regardons le passé. C’est lié aux distances prodigieuses qui nous séparent des étoiles et à la vitesse de déplacement de la lumière. Dès lors, on sait que certaines étoiles continuent de briller dans le ciel bien longtemps après qu’elles se soient éteintes. Un peu comme nos ancêtres qui continuent leur vie en nous à travers les legs conscients et inconscients qu’ils nous ont laissés.
Extrait Live Ginkgo Music Composition de Claude Gobet guitare chant Lead guitare : Olivier Thévenin Basse Ambroise GLD Percussions : Jimmy Lops.
Claude Gobet, Ambroise et Alex au STAQ, novembre 2023.
Écrivant un poème, nous nous tenons au plus intime de nous-mêmes, sommes-nous seuls pour autant ? Nous pouvons nous adresser à quelqu’un, nous pouvons lui répondre, mais le dialogue a lieu dans l’espace intérieur. Magie renversée, le livre que publient Isabelle Lévesque et Sabine Dewulf, renouvelle les perspectives.
On a parfois nommé les ouvrages qu’un artiste et un écrivain réalisent en commun « livres de dialogue », il en existe également lorsque deux poètes s’associent.
De notre élan caché
nous ferons la colonne
du ciel : les pointillés rejoignent
la ligne continue.
Quand tu la coupes je lis
le hiéroglyphe inédit
du vers tu [.]

Isabelle Lévesque et Sabine Dewulf, Magie renversée, peintures de Caroline François-Rubino, préface de Florence Saint-Roch, non paginé, Les Lieux-Dits, 2024, 20 €.
Isabelle Lévesque envoie ces lignes à Sabine Dewulf dans les premières pages. Deux poètes ayant reconnu leurs affinités et leurs différences décident d’un même « élan » de partir à l’aventure pour la joie d’être et de faire ensemble, de s’ouvrir, de découvrir. Que ce soit en solo ou en duo, écrire ne réclame que l’élan initial, mais certains ont besoin de se donner au préalable un thème, voire un sujet, ils s’imposent aussi une forme générale. Peu importe, à vrai dire, si l’élan est profond, s’il se régénère, les règles ne deviendront pas des contraintes stériles.
Dès l’origine Isabelle Lévesque et Sabine Dewulf ont défini ce que seraient le domaine de leurs explorations et le protocole de la composition. Sans doute est-ce Sabine Dewulf qui a tenu à ces exigences, on les trouvait dans Tu dis délivrer la lumière (éditions Pourquoi viens-tu si tard ?, 2021) qu’elle a composé avec Florence Saint-Roch, la préfacière justement de Magie renversée. Ce nouveau livre se présente en 15 séquences, de 4 poèmes chacune. (Quatre, un bon chiffre, « [c]ompte rond », dirait Isabelle Lévesque.) Une séquence est engendrée par une photographie, laquelle inspire un premier poème, celui-ci appelle l’intervention de la partenaire, qui fermera la séquence, mais c’est elle qui commencera la suivante. À une exception près le passage de relais sera respecté à travers tout le livre.
Cette rigueur de la construction néanmoins n’entraîne aucune monotonie, et peut-être était-elle nécessaire sinon pour canaliser l’animation générale qui conduit les auteures de surprise en surprise, mais pour la valoriser. Nous sommes ici, une fois pour toutes, dans l’univers enchanté des fées et des sorcières, le titre immédiatement nous avertit, ou bien dans le poème initial le mot « conte ». Faut-il distribuer les rôles ? Isabelle serait la fée, Sabine la sorcière. Les allusions à leurs livres précédents sont nombreuses. Philtre, chaudron, brouet, baguette, talisman, pentacle, hiéroglyphe, grimoire, etc., tout le champ lexical de la magie se déploie.
Rien n’est stable, tout change à chaque instant. Le mouvement qui caractérise la magie et celui qui emporte la poésie ne font qu’un. Isabelle Lévesque et Sabine Dewulf sont par vocation actives : « nous avançons », « nous courons », « nous volons »… On assiste même à une accélération, due à l’allégresse ou à l’ivresse. L’écriture leur semblerait vaine si elle se bornait à constater, elle est dans ce livre synonyme de « métamorphose » (le mot est répété) : « la clef du poème », dit Isabelle Lévesque, « la métamorphose ». Le connu devient l’inconnu. C’est en permanence la quête de l’inconnu qui exalte Isabelle Lévesque et Sabine Dewulf, elles parlent encore, l’une comme l’autre, d’« alchimie ». En les lisant, comment ne pas penser au Rimbaud des Illuminations, « Conte », « Enfance » ? Le conte et le poème sont indissociables, l’esprit d’enfance y règne.
Sauf la noire, la magie a toutes les couleurs, elle est tour à tour blanche ou bleue ou rouge ou jaune, jaune d’or. Une analyse serait possible de leurs apparitions selon le processus alchimique. Les fleurs sont de préférence évoquées, du bouton d’or aux crucianelles. (Les lecteurs de Chemin des centaurées d’Isabelle Lévesque ne seront pas dépaysés.) Ce sont leurs couleurs que naturellement, bien qu’elles ne lui soient pas habituelles, Caroline François-Rubino a choisi de mettre en valeur. Les photographies qui avaient déclenché l’écriture n’ont pas été reproduites, elles ont été remplacées par ces merveilleuses images d’un kaléidoscope d’encres et d’aquarelles dont les fluides se répandent, se fondent, rayonnent, éblouissent, refusant de cerner des frontières comme de distinguer le haut du bas. Certaines fleurs, par exemple, ont leurs têtes renversées. Nous voici en présence de cette « [t]able d’orientation » ou de cette « table ronde », c’est-à-dire de la table d’émeraude chère à Sabine Dewulf où le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement. Tout est sens dessous-dessus :
Si c’est une onde
l’éternité s’enlace au temps :
une pincée d’écume
donne goût à l’azur.
Si elle est particule,
elle émerge au zénith
sur la plus fine pointe du présent,
comme le point du i.
Et Sabine Dewulf ajoute ces deux vers : « Nous apprenons / à ne rien retenir. »
Tel est l’enjeu de ce grand livre, il correspond à une initiation, une libération simultanément. Cercle après cercle, à l’image des ondes, le livre s’élargit, il se dégage des sortilèges qui entravent nos démarches, l’appât du gain, le désir de possession, il lève des censures, il détruit l’armature des concepts et des contraires, et peu à peu s’effectue la genèse du poème. Magie renversée nous charme intensément parce que les auteures ne prétendent ni à la victoire ni à l’assouvissement, « nous écrivons », disent-elles, « nous vivons ». Sabine Dewulf, citant Isabelle Lévesque, rappelle que « ce qui cesse commence » (une phrase décisive du Fil de givre), et les deux dernières pages (quinzième séquence, « Ailé ») ne concluent pas : « L’amplitude / nous embrasse », dit Sabine Dewulf, « le livre n’est pas fermé », dit Isabelle Lévesque.
Nous les reconnaissons, elles n’ont pas perdu leur identité, ce n’était nullement leur intention : Isabelle Lévesque garde « la fougue de [sa] phrase », ses vers sont fréquemment heurtés, alors que la voix de Sabine Dewulf « chemine », elle est dans sa métrique soucieuse de mesure. Pourquoi dissimuleraient-elles ou atténueraient-elles leurs différences ? Celles-ci ne s’opposent pas, elles se conjuguent et se complètent. C’est cela, l’œuvre commune portée par le dialogue, le jeu des questions que les réponses relancent. Le dialogue n’est possible que par la grâce de l’attention à l’autre. « Suis-je l’écho ou l’écoute ? » L’écho par miracle invente, l’écho multiplie, et le livre qui ne cesse de s’élaborer nous communique sa vivacité, nous partageons le plaisir qu’ont éprouvé à l’écrire les magiciennes.
Le recueil de Giorgi Lobzhanidzé est une tentative éminemment empathique de partager l'expérience d'une vie libre dans la Géorgie d'aujourd'hui ; défi de chaque instant. L'individu y est broyé sous les difficultés matérielles, la pauvreté, la violence sociale, les propagandes politiques de tous bords, le carcan des différents dogmes religieux... Marginal et funambule, le poète renvoie dos à dos toutes les chapelles et préfère ne se fier qu'à ses propres vérités. Pamphlétaire, rêveur, il sera notre professeur surréaliste d'une langue nouvelle qui puise aux sources inédites d'un Coran secret et d'une conjugaison ré-imaginée, aventureuse, nomade, sans passé ni avenir.
Docteur en philologie, Giorgi Lobzhanidzé enseigne actuellement à l’Université d’État de Tbilissi. Il a traduit des œuvres médiévales et modernes importantes de la littérature arabe et persane. Il est l’auteur de la nouvelle traduction géorgienne du Coran, présentée et annotée par lui-même, pour laquelle il a reçu, en 2008, le Prix littéraire Saba dans la catégorie « Meilleure traduction de l’année » et le Prix d’État du « Livre de l’année » de la République islamique d’Iran. En 2010, Giorgi Lobzhanidzé a de nouveau reçu le Prix Saba pour sa traduction de Golestan de Saadi, éditée chez la Maison caucasienne, dans la catégorie « Meilleure traduction de l’année ». En 2020, il a publié aux éditions Sulakauri la traduction présentée et annotée par lui-même du premier des six livres du Masnavî de Djalâl ad-Dîn Rûmî, pour laquelle, en 2021, il a une troisième fois reçu le Prix Saba dans la catégorie « Meilleure traduction de l’année ».
Extrait du poème « Les martyrs » de Giorgi Lobzhanidzé en géorgien et en français, lu par le traducteur B. Chabradzé, du recueil "Le professeur d’arabe", éditions Les Carnets du Dessert de Lune, la nouvelle collection de poésie contemporaine européenne cofinancée par le Creative Europe Programme, 2023. Pikis Saati, émission radio publique géorgienne, 14.07.2023.
Ses poèmes sont traduits dans plusieurs langues et sont inclus dans diverses anthologies, notamment dans Le train de Koutaïssi : Vingt poètes géorgiens (traduction de Boris Bachana Chabradzé, éditions Caractères, Paris, 2022). En 2020, la maison d’édition lituanienne Kauko Laiptai a publié son recueil de poèmes « La phobie des saints » (traducteurs : Nana Devidzé, Viktoras Rudianskas et Jonas Liniauskas) qui a été nommé, en 2021, parmi les quinze meilleurs recueils de poésie de l’année par l’Association des éditeurs et critiques lituaniens. En 2022, son recueil de poèmes Nelle rovine del sogno (« Dans les décombres du rêve ») est paru, dans la traduction de Nunu Geladzé, en Italie, aux éditions Giuliano Ladolfi Editore.
Giorgi Lobzhanidzé
Traduit du géorgien par Boris Bachana Chabradzé
Faire connaissance
Bonjour,
J’ai déjà pataugé dans cette eau
Et je ne crois plus en rien,
Ni à l’amour
Ni à la tendresse juvénile,
Ni à la pudeur.
Je crois en un coup de poing dans la mâchoire,
En une rage de dent,
En un cadavre enfin redevenu
Ce qu’il était en réalité.
Partout où je vais, les loups hurlent après moi,
À mon tour, je hurle à la lune
Non pas comme un amant fou
Mais comme un loup
Affamé et souffrant d’une rage de dent,
Sans-abri,
Traçant son chemin dans la neige
De la forêt au village.
Bonjour,
J’ai déjà fleuri,
J’ai traversé tous les fleuves,
J’ai suivi tous les vents,
J’ai enfreint les dix commandements
Jusqu’à ce que je redevienne enfin
Ce que j’étais en réalité :
Un défunt heureux
N’ayant plus besoin d’amour,
De l’argile nue
N’ayant plus besoin de préservatif,
Ne pouvant plus m’accoupler qu’avec la terre.
Fais-moi faire connaissance avec qui tu veux,
Présente-moi des âmes sœurs plus belles les unes que les autres :
L’amour finit toujours de la même façon,
Il ne se suffit pas,
Il doit se déverser dans quelqu’un.
La prière de l’homme avec des sacs de courses
Merci mon Dieu !
Jamais tu ne m’oublies,
Pas même dans une telle tempête.
Elle aurait pu m’emporter,
Me porter au ciel,
Chez toi
S’il n’y avait eu ces sacs de courses
Chargés de nourriture pour deux ou trois jours,
Juste assez pour préparer
Quelques déjeuners
À condition de ne pas manquer d’imagination culinaire.
Merci mon Dieu
D’avoir créé,
Dans chaque quartier de notre capitale
Où j’ai vécu
Au moins un magasin
Où je peux,
Certes avec un sentiment de gêne,
Récupérer de la nourriture à crédit,
Où les vendeurs me font généreusement confiance
En notant néanmoins mon nom sur leur ardoise,
Tout en indiquant la somme à régler -
Le mois prochain, quand j’aurai touché mon salaire.
Sur ces ardoises, à côté de mon nom,
Ils ajoutent mes caractéristiques
Pour ne pas me confondre avec d’autres clients du même nom.
Auparavant, ils notaient : « chétif »,
Maintenant, ils notent : « Professeur ».
Or, moi, je suis l’homme
Avec des sacs de courses dans la tempête.
Quand j’écarte les bras
Afin de conjurer le vent
Pour qu’il ne m’emporte pas brusquement chez toi,
Je te ressemble soudain,
Tel que tu étais
Quand tu devenais Dieu…
Telle est la crucifixion des sacs de courses,
Avec deux poissons
Et cinq pains.
Le retour de Pénélope
Ici tout se passe à l’envers :
C’est Pénélope qui rentre à la maison.
Elle suit sa propre tapisserie
Telle une araignée,
Entrelace maille par maille
Les sentiers sortant de son ventre
Et avance ainsi
Vers son unique UlysseQui a pris le large
Depuis déjà si longtemps
Et a forgé sa propre histoire…
Tandis qu’elle, femme,
Est une Pénélope active,
Elle tisse et s’englue dans les mailles de sa tapisserie
Telle une araignée
Et son ouvrage
Pour lequel elle use de bleu
Se répand sur toute la terre
Comme l’eau de mer
Et fait déferler ses espérances comme des vagues.
Mais pourquoi « comme » ?
Cette tapisserie est une véritable mer
Salée par les larmes
De Pénélope esseulée.
Elle pleure…
Elle tisse…
Et au bout de la mer,
Ulysse.
Arrivée jusqu’à lui,
Elle déploiera à ses pieds
Son ventre lassé d’avoir tissé
Et lui dira :
« J’ai suivi ma tapisserie,
Je t’y ai tissé comme trame principale
Et puisque je suis
Une Pénélope active,
Je suis venue moi-même…
Cette tapisserie est notre progéniture ».
Ma voisine
Ma voisine est une vieille femme,
Avec une vie de galérienne derrière elle,
Asséchée par le labeur
Comme l’herbe des champs…
Alors que dans mon enfance
Elle était belle comme une immortelle d’Italie.
Maintenant, elle a tout oublié.
Dans son esprit, le passé a entièrement recouvert le présent,
S’étant peu à peu emparé, tel un marécage sans vie,
De l’espace vital de sa pensée
Où seuls les souvenirs glougloutent désormais,
Quelques souvenirs marquants,
Nénuphars flottants,
Étendards blancs sur les remparts de l’oubli.
Sa maison d’enfance
Est l’un de ces nénuphars…
Tandis que la maison qu’elle s’est construite,
Où elle a élevé cinq enfants,
Où elle a labouré toute sa vie,
Lui est étrangère.
Dès que les membres de sa famille s’absentent,
Elle se précipite dehors,
Verrouille soigneusement le portail derrière elle
Et remonte la rue vers l’autre bout du village,
Vers chez elle…
À quelques pas, il y a un carrefour,
Elle s’y arrête
Et s’apprête à crier de désespoir,
Or, n’en ayant pas la force,
Au lieu d’un cri, un râle pitoyable sort de sa gorge :
« Je veux rentrer à la maison !
Ramenez-moi chez moi ! ».
Tous ses souvenirs ont coulé dans le marécage.
Sur les décombres de son esprit
Entièrement effondrés sur son passé,
Un seul arbre a poussé :
« Ramenez-moi chez moi ! » –
Seule son âme se souvient de sa vraie patrie
Et tourne en rond…
Mais pour l’heure, elle ne peut aller nulle part.
Et, du carrefour,
Ses voisins la ramènent
Chez elle,
Jusqu’à son portail verrouillé.
Au revoir
Je t’ai dit au revoir
Comme
Un arbre à ses feuilles
Après les avoir serrées dans son cœur
Toute l’année.
L’amour
Exige toujours
De nouveaux habits
Et c’est le supplice des arbres :
Voir
Leurs feuilles choir
Et devoir leur dire au revoir,
Branches tendues vers elles,
Afin de pouvoir accueillir
Des feuilles nouvelles…
Recueil de poèmes de Giorgi Lobzhanidzé "Le professeur d’arabe", traduit du géorgien par B. Chabradzé, a été édité par Les Carnets du Dessert de Lune dans la nouvelle collection de poésie contemporaine européenne cofinancée par le Creative Europe Programme. L'auteur et le traducteur parlent du recueil dans l’émission radio publique géorgienne "Pikis Saati". Source : https://1tv.ge/audio/pikis-saati-14-0...
L’histoire commence au Canada, chez les Indiens Cree et les Indiens métis constitués en peuple, unis autour de Louis Riel, métis lui aussi, qui voulait pour eux un état Indien démocratique indépendant de la couronne d’Angleterre et du gouvernement Canadien (territoire faisant partie de ce qui est aujourd’hui l’état du Saskatchewan). Les ancêtres de D’Arcy McNickle, du côté maternel, membres de la famille Parenteau installés dans une « ferme » à Batoche, avaient joué un rôle non négligeable dans la rébellion.
The Surrounded, de D'Arcy McNickle
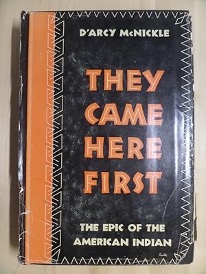
En 1972, il contribua à la création du centre pour l’histoire des Indiens d’Amérique à la célèbre bibliothèque Newberry de Chicago. Ce centre porte toujours son nom. La bibliothèque de l’université Salish Kootenai sur la réserve Indienne de Flathead dans le Montana porte également son nom.
Dans son poème Man Hesitates but Life Urges, William D’Arcy McNickle exprime le sentiment de perte, de nostalgie. Perte d’identité, perte de repères, perte du sentiment de réalité, désorientation : c’est n’avoir plus de pays, voir le territoire s’évanouir, devoir fuir, mais aussi savoir que la vie est là qui n’attend pas. Et pourtant elle offre toujours cette même expérience puisque le monde pour les Indiens d’Amérique a radicalement changé et que rien ne leur permet de s’y trouver accueillis, acceptés, ainsi leur quête se poursuit interminablement, faisant d’eux des sortes de fantômes errant sur une terre avec laquelle il est désormais difficile de se connecter. Ce poème a été publié pour la première fois dans la revue The Frontier (vol. 6, en mars 1926). Jennifer Elise Foerster (poète, membre de la nation Indienne Muskogee), lors d'une lecture et d'une réunion autour du livre When the Light of the World Was Subdued, Our Songs Came Through: A Norton Anthology of Native Nations Poetry (W. W. Norton, 2020), réunion organisée par l'Institute for Inquiry and Poetics, au Poetry Center de l’université d’Arizona, a qualifié le poème de : « exemple de la liminalité du langage et de la façon dont le langage peut nous ramener à un sentiment de patrie en tant que lieu intermédiaire », ajoutant que le pays ayant subi nombre de violences en termes d’environnement et de suppression des langues, « la poétique, je crois, peut devenir un moyen de recartographier. [. . .] Dans le poème de D’Arcy McNickle, nous pouvons voir le poème embrasser le fait de ne pas savoir, d’être perdu, mais de trouver une patrie intérieure, dans le voyage même de la recherche. » (pour en savoir plus sur Jennifer Foerster : https://www.recoursaupoeme.fr/un-regard-sur-la-poesie-native-american-16-la-poesie-de-jennifer-elise-foerster/)
There is this shifting, endless film
And I have followed it down the valleys
And over the hills,—
Pointing with wavering finger
When it disappeared in purple forest-patches
With its ruffle and wave to the slightest-breathing wind-God.
There is this film
Seen suddenly, far off,
When the sun, walking to his setting,
Turns back for a last look,
And out there on the far, far prairie
A lonely drowsing cabin catches and holds a glint,
For one how endless moment,
In a staring window the fire and song of the martyrs!
There is this film
That has passed to my fingers
And I have trembled,
Afraid to touch.
And in the eyes of one
Who had wanted to give what I had asked
But hesitated—tried—and then
Came with a weary, aged, “Not quite,”
I could but see that single realmless point of time,
All that is sad, and tired, and old—
And endless, shifting film.
And I went again
Down the valleys and over the hills,
Pointing with wavering finger,
Ever reaching to touch, trembling,
Ever fearful to touch.
L’homme hésite mais la vie le presse
Il y a ce film interminable et changeant
Que j'ai suivi au long des vallées
Et par-dessus les collines,—
Un doigt hésitant pointé
Quand il a disparu fondu dans les zones de forêt violettes
En une ondulation de vague au moindre dieu-vent qui respire.
Il y a ce film
Vu soudain, au loin,
Quand le soleil, marchant vers son coucher,
Se retourne pour un dernier regard,
Et là-bas, dans la très lointaine prairie
Une cabane solitaire endormie capte et retient une lueur,
Pendant un moment d’éternité,
Dans une fenêtre qui regarde, le feu et le chant des martyrs !
Il y a ce film
Qui est passé entre mes doigts
Et j'ai tremblé,
Effrayé de toucher.
Et aux yeux d'un
Qui avait voulu donner ce que j'avais demandé
Mais qui avait hésité—essayé, et puis
Avait conclu par un "Pas tout à fait" âgé et fatigué,
Je ne pouvais que voir ce seul moment détrôné,
Tout ce qui est triste, fatigué et vieux—
un film interminable et changeant.
Et j'y suis retourné
Au long des vallées et sur les collines,
Pointant d'un doigt hésitant,
Toujours essayant de toucher, tremblant,
Toujours effrayé de toucher.
Le poème The Mountains, Les Montagnes, est apparu pour la première fois dans The Frontier : A Literary Magazine,(vol. 5, en mai 1925). Dans « American Indian Poetry at the Dawn of Modernism » (Poésie amérindienne à l’aube du modernisme), article publié dans The Oxford Handbook of Modern and Contemporary American Poetry, (Oxford University Press, 2012), Robert Dale Parker, professeur d'études anglaises et amérindiennes à l'Université de l'Illinois, écrit : « Les Montagnes de D'arcy McNickle ne font aucune référence directe à quoi que ce soit d'Indien, mais les lecteurs de son grand roman The Surrounded (Harcourt, Brace and Company, 1936) reconnaîtront le décor montagneux du roman. Ils se rappelleront également comment, pour les personnages salishs de The Surrounded, les scènes de montagne résonnent avec la mémoire et la tradition salish et avec le sentiment d'espoirs persistants, mais finalement déçus, d'un refuge possible contre les colons blancs agressifs et les fonctionnaires fédéraux. En ce sens, un contexte plus large issu des écrits de McNickle contribue à alimenter les significations localement indiennes du paysage montagneux de son poème ».
THE MOUNTAINS
There is snow, now—
A thing of silent creeping—
And day is strange half-night . . .
And the mountains have gone, softly murmuring something . . .
And I remember pale days,
Pale as the half-night . . . and as strange and sad.
I remember times in this room
When but to glance thru an opened window
Was to be filled with an ageless crying wonder:
The grand slope of the meadows,
The green rising of the hills,
And then far-away slumbering mountains—
Dark, fearful, old—
Older than old, rusted, crumbling rock,
Those mountains . . .
But sometimes came a strange thing
And theirs was the youth of a cloudlet flying,
Sunwise, flashing . . .
And such is the wisdom of the mountains!
Knowing it nothing to be old,
And nothing to be young!
There is snow, now—
A silent creeping . . .
And I have walked into the mountains,
Into canyons that gave back my laughter,
And the lover-girl’s laughter . . .
And at dark,
When our skin twinged to the night-wind,
Built us a great marvelous fire
And sat in quiet,
Carefully sipping at scorching coffee . . .
But when a coyote gave to the night
A wail of all the bleeding sorrow,
All the dismal, grey-eyed pain
That those slumbering mountains had ever known—
Crept close to each other
And close to the fire—
Listening—
Then hastily doused the fire
And fled (giving many excuses)
With tightly-clasping hands.
Snow, snow, snow—
A thing of silent creeping
And once,
On a night of screaming chill,
I went to climb a mountain’s cold, cold body
With a boy whose eyes had the ancient look of the mountains,
And whose heart the swinging dance of a laughter-child . . .
Our thighs ached
And lungs were fired with frost and heaving breath—
The long, long slope—
A wind mad and raging . . .
Then—the top!
There should have been . . . something . . .
But there was silence, only—
Quiet after the wind’s frenzy,
Quiet after all frenzy—
And more mountains,
Endlessly into the night . . .
And such is the wisdom of mountains!
Knowing how great is silence,
How nothing is greater than silence!
And so they are gone, now,
And they murmured something as they went—
Something in the strange half-night . . .
Il y a de la neige à présent—
Une chose qui rampe silencieusement—
Et le jour est une étrange demi-nuit. . .
Et les montagnes sont parties, murmurant doucement quelque chose. . .
Et je me souviens des jours pâles,
Pâles comme la demi-nuit. . . également étranges et tristes.
Je me souviens des moments passés dans cette pièce
Quand, à jeter un coup d'œil à travers une fenêtre ouverte
elle se remplissait d'une merveille éplorée sans âge :
La grande pente des prés,
La montée verte des collines,
Et puis au loin, des montagnes endormies—
Sombres, craintives, vieilles—
plus vieilles qu’un vieux rocher rouillé s’émiettant,
Ces montagnes. . .
Mais parfois il arrivait une chose étrange
leur jeunesse était alors celle d’un petit nuage qui volait,
Côté soleil, clignotant. . .
Et telle est la sagesse des montagnes !
Ne sachant rien d'être vieux,
ni rien d’être jeune !
Il y a de la neige, maintenant—
Un rampant silencieux. . .
Et j'ai marché dans les montagnes,
Dans des canyons qui m'ont rendu mon rire,
Et le rire de l’amante. . .
Et à la tombée de la nuit,
Quand notre peau se crispait sous le vent de la nuit,
Elle nous faisait un grand feu merveilleux
Et je me suis assis tranquillement,
En sirotant soigneusement un café brûlant. . .
Mais quand un coyote a offert à la nuit
Un gémissement fait de tout le chagrin sanglant,
Toute la douleur lugubre aux yeux gris
Que ces montagnes endormies avaient toujours sues—
A rampé près de chacun de nous
Et près du feu—
À l’écoute—
Puis à la hâte j'ai éteint le feu
Et les poings serrés
je me suis enfui (donnant de nombreuses excuses).
Neige, neige, neige—
Une chose qui rampe silencieusement
Et une fois,
Par une nuit de froid hurlant,
Je suis parti escalader le corps froid si froid d'une montagne
Avec un garçon dont les yeux avaient l'aspect ancien des montagnes,
Et dont le cœur est la danse balancée d'un enfant qui rit. . .
Nos cuisses nous faisaient mal
Et nos poumons étaient enflammés de givre et d'haleine haletante—
La longue, longue pente—
Un vent fou et rageur. . .
Alors—le sommet !
Il aurait dû y avoir . . . quelque chose . . .
Mais il y eut seulement le silence—
Calme après la frénésie du vent,
Calme après toute frénésie—
Et encore plus de montagnes,
Sans fin dans la nuit. . .
Telle est la sagesse des montagnes !
Sachant combien est grand le silence,
Comme rien n'est plus grand que le silence !
Et donc ils sont partis, désormais,
Ils murmuraient quelque chose en marchant—
Quelque chose dans l'étrange demi-nuit. . .
Si les montagnes décrites dans le poème sont celles de son enfance sur la réserve Salish, si The Surrounded est un roman autobiographique, alors il faut imaginer l’auteur, métis qui ne trouve pas de « chez lui », ni dans les pensionnats, ni sur la réserve une fois revenu après ses études ; pas d’autre « chez lui » que dans l’écriture. Il faut comprendre la vie de William D’Arcy McNickle comme celle d’un homme luttant pour vivre, « entouré », ou bien comme assiégé, prisonnier entre deux mondes irréconciliables. Mais malgré cette ombre terrible portée sur sa vie, elle fut un exemple à suivre dont d’autres auteurs et poètes amérindiens s’inspireront. Il a laissé la mémoire du premier universitaire à écrire et à témoigner depuis le point de vue Indien. Et jusqu’au prix Pulitzer obtenu par le Kiowa Norman Scott Momaday en 1969, aucun autre écrivain Indien n’avait encore eu un impact aussi important que William D’Arcy McNickle.
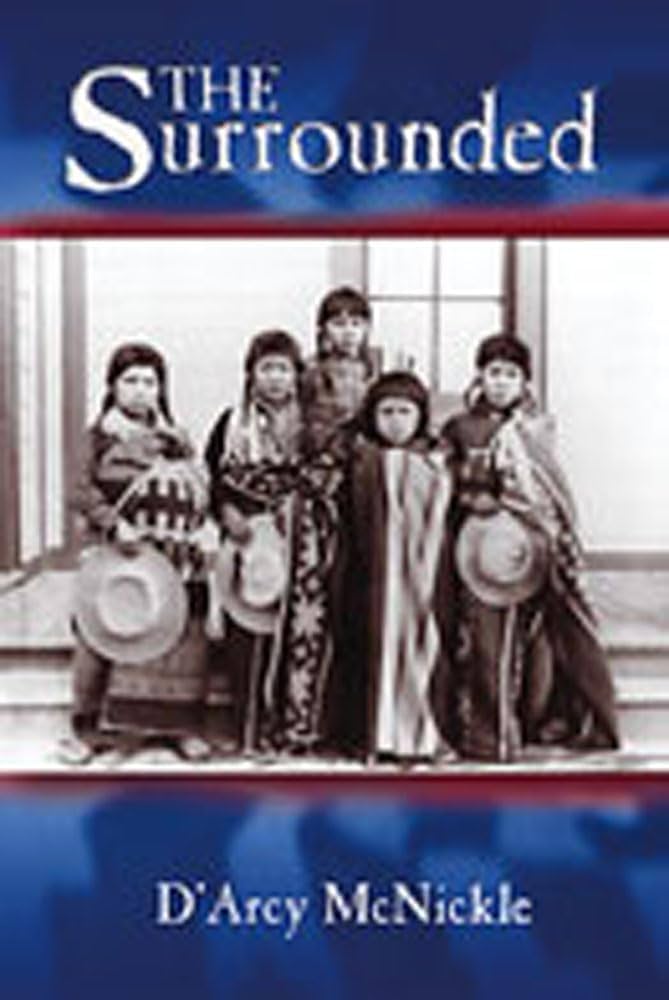
Je laisserai le mot de la conclusion au poète et romancier Choctaw Louis Owens, spécialiste des nations Chocktaw et Cherokee, pour qui le roman The Surrounded a contribué au lancement d'un mouvement littéraire autochtone comparable au renouveau de la culture afro-américaine entre les deux guerres mondiales, mouvement appelé Renaissance de Harlem. De même un tournant s’opère dans la littérature autochtone américaine grâce au roman et à la vie de D’Arcy McNickle, vie dédiée à la reconnaissance et à l’amélioration des conditions de vie des amérindiens en Amérique.
Comment parler à la Terre, évoque sa lutte contre la diminution, le déchirement, la disparition qui rendront toute vie méconnaissable ? Nous glissons vers les trous noirs des désastres planétaires dont il n'y a aucune certitude de continuation. Dans ces cinq poèmes je parle à la Terre, ma sœur, ma compagne, mon autre, miroir et reflet, mirage et mystère insondable. Toutes les légendes de naissance et de perte, de douleur et de joie se confondent dans notre échange. Nous sommes de la même matière, de la même nuit, de la même aube. Notre sang se fait parole et silence, attente et affirmation.
Le velours de tes mots, le sang qui te couvre
comme une neige rouge sans fin
des flocons le long de tes bras
ton ventre rose en fleurs,
quand je te parle tu ne bouges pas
tu respires la lune et la poussière des étoiles
perdue sous la blancheur sans limites
tes voyages s’accélèrent
tes paupières lisses ne répondent
qu’à la douceur de l’aube
et la présence d’un hiver éternel.
∗∗∗
La topaze de ton cœur si fragile
brille parmi la paille et la cendre
elle absorbe les rayons du soleil
mêlant sang et hydrogène
et le son de ton nom
si délicatement prononcé
au soir de ta mort
lentement doucement
presque sans respirer.
∗∗∗
Un feu au centre des pierres
des cicatrices, des fuites
dans la mémoire
de nos conversations,
la peau ne connaît que la surface
de la parole, le frémissement
entre les mots,
flammes vertes de mémoire
flammes d’acier et de charbon
au moment où tu entres dans le feu
encore crépitant
les braises collées aux lèvres.
∗∗∗
Visage qui tremble en regardant
ce qui n'est plus
ce qui frétille dans l'eau,
visage qui se détourne
en sentant le feu des nuages
le frémissement de ta voix
quand tu sors des ténèbres
un bâton de neige et de glace
entre tes mains,
des flammes des dents des pas
leur lumière de pierre et d'oxygène
heurte contre ma poitrine
quand j'essaie de comprendre
ce qui n'est plus
ce qui se noie sans tourment.
∗∗∗
L'hydrogène de ton sang
Tu passes à travers
les parois poreuses,
tu ne connais que les mots invisibles
des mourants et des nouveau-nés
des tripes et des veines soyeuses,
tu passes par les flammes de certains métaux
aux risques de perdre ta connectivité
ton lien précieux avec l'oxygène
léger et incolore
comme la conscience éblouie
au seuil de la naissance.
Traduit du polonais par Michał Grabowski avec la collaboration précieuse de Nicolas Bragard
Urszula Honek débute en poésie à l’âge de 28 ans lorsqu’elle présente le recueil Sporysz (« l’ergot », 2015). Sorti en 2021, Zimowanie (« Hivernage ») dont proviennent les poèmes présentés ci-après est son troisième ouvrage et aura valu à la jeune poétesse originaire de la région des Carpates polonaises le prix Bourse Stanislaw Baranczak et deux autres nominations pour des prix poétiques en Pologne (Orphée et Gdynia).
Le style poétique d’Urszula Honek la place en marge des tendances actuelles dans la poésie contemporaine. L’autrice renoue avec l’esthétique romantique, tout en adoptant un registre très sobre, presque dépourvu de figures de style. Elle place au centre de son intérêt poétique une collection d’histoires avec des personnages qui lui sont familiers, limitant son rôle à celui d’une tendre observatrice, pour paraphraser Olga Tokarczuk, sa compatriote nobélisée. Elle n’est cependant pas tentée de créer des romans-poèmes comme l’ont fait avec succès Laura Vazquez ou Marie Testu. Honek propose plutôt des miniatures narratives composées d’images incomplètes, recousues et à nouveau déchirées, accrochées aux détails insignifiants qui font revivre les souvenirs.
Urszula Honek, Ami, Przyjaciółka, extrait du recueil Zimowanie.
La référence à l’esprit romantique passe par une aura de mystère omniprésent. Celui-ci se décline à travers les éléments de la trame narrative (« j’essaie de me rappeler son visage ou sa manière / de prononcer mon nom (sz sonnait comment dans sa bouche, déjà ? »), dans la frontière floue entre le ici et le là-bas (temporels, spatiaux, réels ou non : « je me réveille avant l’aube et je ne sais toujours pas / si je suis ici ou là-bas »), ou encore dans la référence à la mort qui revient sans cesse et se mêle à l’histoire (« on a retrouvé le petit garçon des P. dans un silo à grains » ; « le dimanche, nous allions nous promener là-haut. à droite, / le cimetière » ; « les cheveux d’Eleonora ont pris feu en premier »). La mort, par ailleurs, ne touche pas uniquement les humains mais s’étend à une maison à qui on coupe l’eau comme on couperait l’oxygène. Elle envoie des animaux comme messagers (des chiens apportant des jouets au moment du sommeil dans le souvenir de l’autrice, ou des renards dans un autre poème de ce recueil, non traduit dans cette sélection). Nous sommes au cœur d’un conte fantastique. Le rythme des poèmes n’est pour autant guère tumultueux. Honek propose une ambiance apaisée, muséale et douce, pour appuyer une fois encore le fait que les souvenirs de son village natal qu’elle tente de sauver de l’oubli font partie d’un passé révolu auquel l’accès n’est possible que par l’exercice de l’écriture.
Prix Conrad 2023, Urszula Honek. La cérémonie de remise du prix de la meilleure première œuvre en prose a clôturé le 15e festival Conrad. La statuette a été remise à Urszula Honek, pour White Nights. (Maison d'édition Czarne).
La poétique d’Urszula Honek se trouve aux antipodes d’une poésie herméneutique, au point où la simplicité des phrases et l’économie des moyens employés interrogent. Sommes-nous toujours dans la poésie, ou s’agit-il déjà d’une prose stylisée ?
Plus que de répondre à cette question, il semble intéressant de souligner quelques éléments supplémentaires. Le rythme de la phrase est précis, lent, comme dans Dead man de Jim Jarmusch, et le décor utilisé par la poétesse reste très chargé.
Le choix de la forme n’est pas anodin non plus. Parallèlement au développement de Hivernage, Honek écrivait des micro-récits, compilés en 2023 sous le titre de Białe noce (les nuits blanches) et qui développent certains thèmes de son recueil sous une forme nouvelle. Dans cette optique, Hivernage n’est pas une publication d’esquisses mais un format réfléchi qui permet de présenter certains aspects dans leur volatilité, dans leur caractère éphémère.
C’est une poésie vue comme une mise à l’épreuve, comme l’avance le chercheur en littérature Oskar Czapiewski en déclarant que « la lecture de son recueil est un test de tendresse et d’empathie plus qu’un test d’érudition ou d’orientation dans la littérature contemporaine ». Urszula Honek elle-même revendique sa poésie comme « compréhensible pour tout le monde, autant pour les universitaires que pour le maire ou le curé de [son] village de naissance ».
Urszula Honek sur la poésie dans la forêt.
uciekinierzy
chłopca od P. zasypało w silosie zboże.
próbuję przypomnieć sobie jego twarz albo sposób,
w jaki wymawiał moje imię (jak brzmiało w jego ustach sz?).
tak samo, jak próbuję przypomnieć sobie twarz Janka
i Mirka, których nie ma, a z którymi podpalam puszki z
karbidem i kruszę lód na zamarazniętym stawie.
les fugitifs
on a retrouvé le petit garçon des P. dans un silo à grains.
j’essaie de me rappeler son visage ou sa manière
de prononcer mon nom (sz sonnait comment dans sa bouche, déjà ?).
j’essaie aussi de me rappeler les visages de Janek
et Mirek qui ne sont plus là, mais avec qui je fais toujours
sauter des pétards et casse la glace sur l’étang gelé.
z oddali
w niedzielę chodziliśmy na spacer w górę, po prawej
był cmentarz. w marcu zawsze brakowało słońca, zniszczone kwiaty i
przewrócone znicze zbierali grabarze, rozmawialiśmy tylko o szczęściu, ale
gdyby przysłuchać się naszym rozmowom, mogłoby się wydawać,
że są o czymś innym.
psy niosły w pyskach zepsute zabawki: gumowe maskotki i piłki wyprute z powietrza. sierść jeżyła się od mrozu albo podniecenia,
choć po latach trudno rozpoznać, co bardziej kłuło w serce.
od czasu do czasu budzę się nad ranem i ciągle nie wiem:
jestem tam czy tu.
de loin
le dimanche, nous allions nous promener là-haut. à droite,
le cimetière. en mars, il faisait toujours gris. les fossoyeurs ramassaient
les fleurs délavées et les bougies renversées. nous parlions du bonheur mais,
à nous écouter, on aurait pensé
que nous parlions d’autre chose.
les chiens avaient dans la gueule des jouets en caoutchouc cassés et des ballons éventrés. leur poil se hérissait, de froid ou d’excitation :
après des années, il est difficile de retrouver la vraie cause de cet émoi.
de temps à autre, je me réveille avant l’aube et je ne sais toujours pas
si je suis ici ou là-bas.
letnicy
co sobotę chodziłyśmy z Marią do państwa L.
w suterenach pachniało kwaśnym mlekiem i szarym mydłem.
Maria liczyła w kącie drobne i chowała do reklamówki
zawinięty w pieluchę ser. teraz dzieci państwa L. przyjeżdżają
tu tylko na wakacje. dom ocieplono z zewnątrz i ktoś regularnie
strzyże trawnik. na zimę zakręca dopływ wody.
les vacanciers
avec Maria, on allait chez les L. tous les samedis.
leur sous-sol sentait le lait fermenté et le savon noir.
dans son coin, Maria comptait sa monnaie puis cachait dans un sac
le fromage emballé dans du linge. aujourd’hui, les enfants des L. ne viennent
que pour les vacances d’été. on a refait l’isolation de la maison et quelqu’un
tond régulièrement. l’hiver, on coupe l’alimentation en eau.
Eleonora
musiała być piękna.
wyobrażam sobie, jak trzyma sztućce i
w jaki sposób patrzy na mężczyznę, którego kocha.
w sierpniowy dzień kołysze śpiące niemowlę.
nie może doczekać się wieczora. spadł drobny deszcz
i zamknęła okna. burza nadciągała od zachodu.
pies obszczekiwał każdy grzmot.
łuna ognia rozświetliła całą dolinę.
Eleonorze najpierw zapaliły się włosy.
Eleonora
devait être jolie.
je l’imagine tenir ses couverts et
regarder à sa manière l’homme qu’elle aimait.
bercer la petite endormie un jour du mois d’août.
s’impatienter en attendant le soir. une pluie fine est tombée
et elle a fermé les fenêtres. la tempête venait de l’ouest.
le chien aboyait à chaque coup de tonnerre.
un halo orangé illuminait toute la vallée.
les cheveux d’Eleonora ont pris feu en premier.
Helenka
śpi w upalne sierpniowe popołudnie.
obok kołyski kot bawi się młodą martwą myszą.
jest tak cicho, że słychać jego zadowolone pomrukiwanie
i uderzanie łapą w deski podłogi.
dziewczynce śni się malinowy ogród i buczenie owadów,
które ją przebudza.
kot drapie w zamknięte drzwi, gdy ogień zwala strop.
La petite Hélène
sommeille un après-midi étouffant du mois d’août.
près du berceau, le chat joue avec une jeune souris morte.
le silence est tel qu’on entend ses ronronnements satisfaits
et les battements de sa patte contre le plancher.
la fillette rêve d’un jardin, de framboisiers et du bourdonnement des insectes
qui la réveille.
le chat griffe la porte fermée au moment où les poutres tombent sous les flammes.
Source : Urszula Honek, Zimowanie (fr. hivernage), éditions WBPiCAK, Poznań 2021.
Remerciements à l’autrice pour son accord gracieux à la publication.
Urszula Honek - Effraie
uma aldeia por entre a névoa
da madrugada
a luz do poste elétrico
fundida
diante da paisagem
repouso o meu peito
espreitando à janela
as figurações
dum quase morte em chama
do que ainda tem pulsação
à procura do que é seu
ou dum
alguém
(difuso
etéreo)
só pó
só recordação
un hameau dans la brume
à l’aurore
la lumière du poteau électrique
en fusion
dans le paysage
j’apaise ma poitrine
penchée à la fenêtre
la figuration
d’une quasi-mort en flammes
où bat encore une pulsation
à la recherche de ce qui est soi
ou d’un ailleurs
(diffus
éthéré)
à peine poussière
à peine souvenir
∗∗
luzinhas brilham intermitentes na noite
sinalizam a solidão
dessa aldeia pessoal e intransferível
quantos milénios foram precisos
para acharmos o nosso lugar
o pedaço de terra que é nosso por inteiro?
lá
habitamos uma casa
com grandes sacadas
para outras casas
les clartés clignotent dans la nuit
égrenant la solitude
de ce hameau personnel et intransmissible
combien de millénaires furent nécessaires
pour rencontrer notre place
le morceau de terre qui est nôtre en intégralité
c’est là
que nous habitons une demeure
aux vastes balcons
ouverts sur d’autres demeures
∗∗
há morte muita morte
nos gestos
no ventre
na fundura
que não alcanço
porque me detenho dobrada
sobre a infância
todos os dias
rememoro o estio
combatemos sempre
donde desertámos
o corpo é o caudal
nas minhas mãos
as fissuras
il y a abondance de mort
dans les gestes
dans le ventre
dans l’abîme
auquel je n’accède pas
parce que je me fige repliée
sur l’enfance
chaque jour
je me remémore l’été
nous combattons toujours
là où nous désertons
le corps est le torrent
dans mes mains
les crevasses
∗∗
ousara ser simples
como o vento
que passa pela árvore
e a agita suavemente
insondável é
o movimento dela
adentrando no real
talvez eu habite
no interior do tronco
e me vá alteando
sem ciência
e assista ao baile de duas vespas
ao acasalamento de dois pirilampos
à maternidade do ninho
à multitude da cor
ao voo sem retorno
à beleza
por si só
osera-t-elle être simple
comme le vent
qui caresse l’arbre
insondable demeure
son mouvement
s’incrustant dans le réel
peut-être habité-je
au cœur du tronc
et vais-je me hissant
pauvre de science
et assisté-je au bal de deux guêpes
aux noces de deux vers luisants
à la maternité du nid
à la pluralité de la couleur
au vol sans retour
à la beauté pour elle-même
∗∗
volta um pensamento de amor
ao coração cansado
num corpo que não recorda
a sua eternidade
o homem que sonha
extravasa as costuras
resvala sobre outro corpo
sutura e perscruta
é o vento
caminha até à fé
e cimenta a beleza,
volta um pensamento de amor
que fixa sobre o cume
o nome que damos às coisas
sombrio e intocável
à margem do que suspeitamos
ser ainda mais belo
ressurgit une pensée d’amour
dans le cœur épuisé
qui a oublié
son éternité
l’homme qui rêve
déchire ses coutures
dévale sur un autre corps
suture et scrute
il est le vent
il marche dans la foi
et cimente la beauté,
ressurgit une pensée d’amour
qui projette à la cime
le nom que nous donnons aux choses
sombre et intouchable
en marge de ce que nous suspectons
être encore plus beau
∗∗
os corpos se atraem
antes de qualquer sabedoria
os sentidos se apuram
para a grande madrugada
mas a mente trai
e o medo trucida
todo e qualquer pensamento de amor
somos menores
não nos atrevemos
perante o precipício
as máscaras não nos permitem voar
les corps s’attirent
précédant toute sagesse
les sens s’apurent
pour la grande aurore
mais l’esprit trahit
et la peur assassine
toute et chacune pensée d’amour
nous sommes mineurs
et n’osons défier
le précipice
les masques nous empêchent de voler
∗∗
a vénus faz dançar as labaredas
sobre o corpo amado
a vénus faz reverberar as ervas
e espraiar o espanto
a vénus faz parecer simples
amar
a vénus funda uma alegoria
de vida após vida
– o que pode uma vénus
rodeada pelo (próprio) fogo?
ninguém sabe
mas o desejo sempre inventa
um porto
onde ancoram muito barcos
milhares de almas
Vénus fait danser les flammes
sur son corps aimé
Vénus fait réverbérer les herbes et répandre l’horreur
Vénus fait croire qu’il est facile
d’aimer
Vénus fonde une allégorie
de la vie après la vie
– mais que peut une Vénus
encerclée par le feu même?
personne ne le sait
mais le désir toujours invente
un port
où ancrer nombre vaisseaux
des milliers d’âmes
∗∗
os pés pisam a erva
e o meu olhar se espraia
num tempo dobrando o tempo
sou uma criança que perscruta
a pulsação do ínfimo
agrego-me multiplico-me
à agitação dos animais e das crianças
caio de amores pelo indivisível
aproprio-me da fragância das flores
e parto em busca do vento
que me traga de novo
a esta imagem
que eu sei de cor
les pieds foulent l’herbe
et mon regard s’éparpille
dans un temps pliant le temps
je suis une enfant qui scrute
la pulsation de l’infime
je m’agrège me multiplie
dans la turbulence des animaux et des enfants
je meurs d’amour pour l’indicible
je m’approprie la fragrance des fleurs
et pars en quête du vent
qui m’offre à nouveau
cette image
que je sais par cœur
∗∗
o azul das tardes
remonta ao oriente
dum pensamento
sou toda escuta e visão
a minha cabeça é um cosmos
dos olhos escorrem-me
possíveis sinais de infinito
não quero ser excelsa
mas transbordam em mim
as cores que ainda não vemos
ainda assim pressentimos
estou no meio dos homens
– sou o silêncio
l’azur des après-midi
s’affiche à l’orient
d’une pensée
je suis pure écoute et vision
ma tête est un cosmos
de mes yeux coulent
des signaux possibles de l’infini
je ne veux pas être sublime
mais débordent en moi
les couleurs que nous ne vîmes pas encore
bien que nous les pressentions
je vis au milieu des humains
– je suis le silence
Au rythme des poèmes de ce magnifique recueil, Marc-Henri Arfeux nous convie à une longue marche initiatique depuis la terre jusqu’au « ciel veiné d’étoiles ». Il s’agit d’une marche intime, qui trace les seuils, les élans et les chants d’une poésie méditative et qui sonde les intériorités de l’être.
Dans l’avant-propos de son recueil, il nous donne quelques éclairages afin que nous puissions l’accompagner et partager avec lui le cheminement d’un désir poétique qui murit depuis fort longtemps : « depuis ma jeunesse, le fil du sens poétique, sensible et spirituel n’a cessé à mon insu de guider et d’unir ma vie à l’énigme essentielle ».
Improvisation on three synthesizers : Virus TI, Minimoog Voyager Electric Blue and Little Phatty, by Marc-Henri Arfeux, 2009.

Marc-Henri Arfeux, L'Homme fil, éditions unicité, 2023, 90 pages, 13 €.