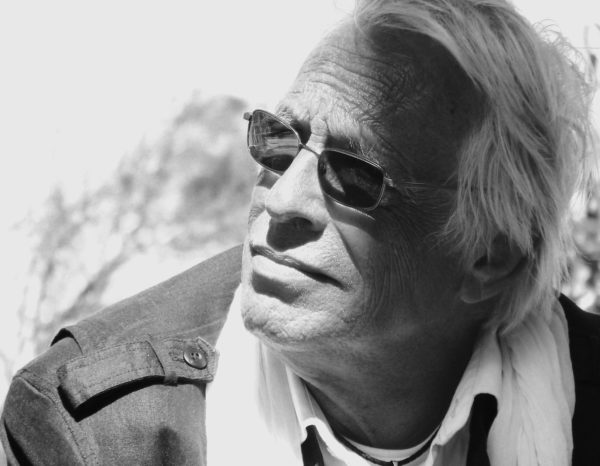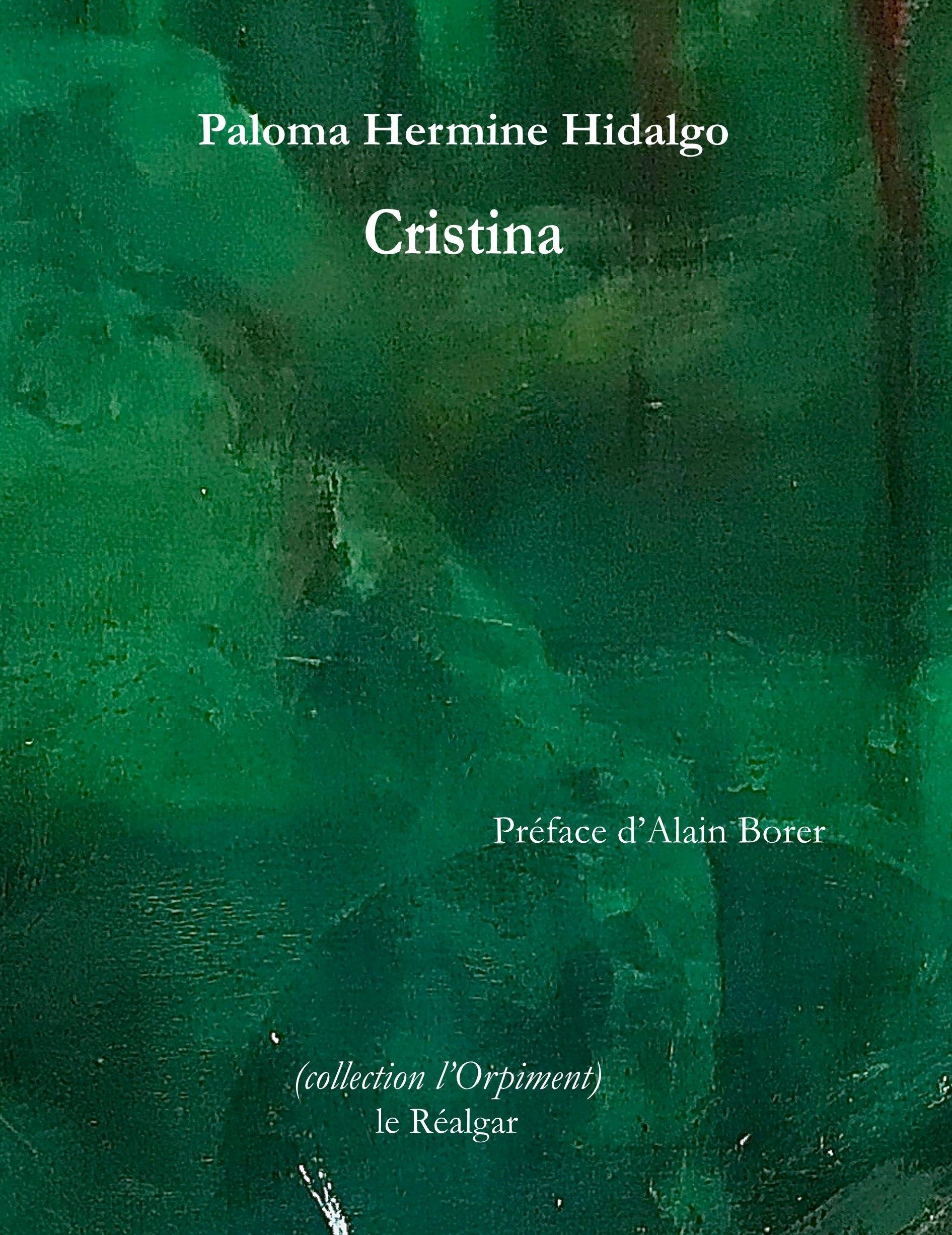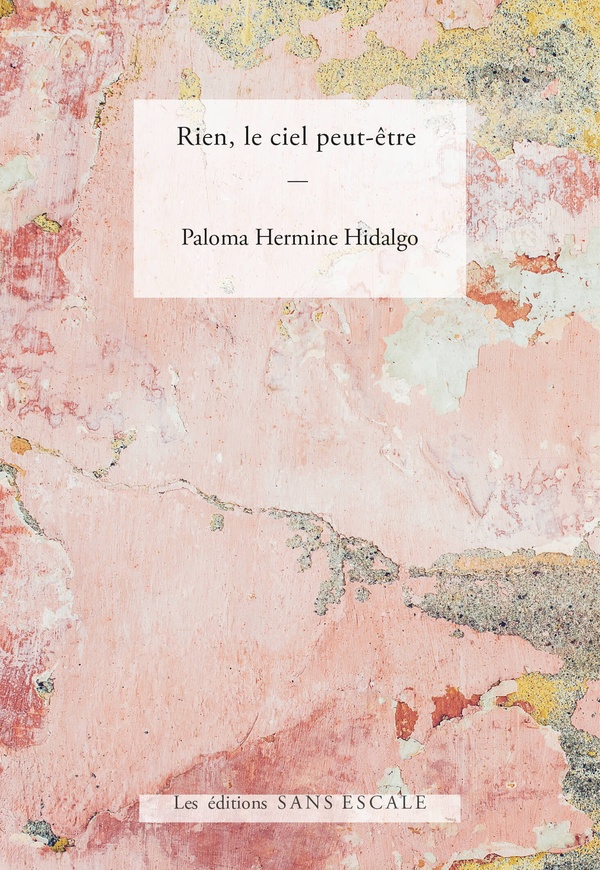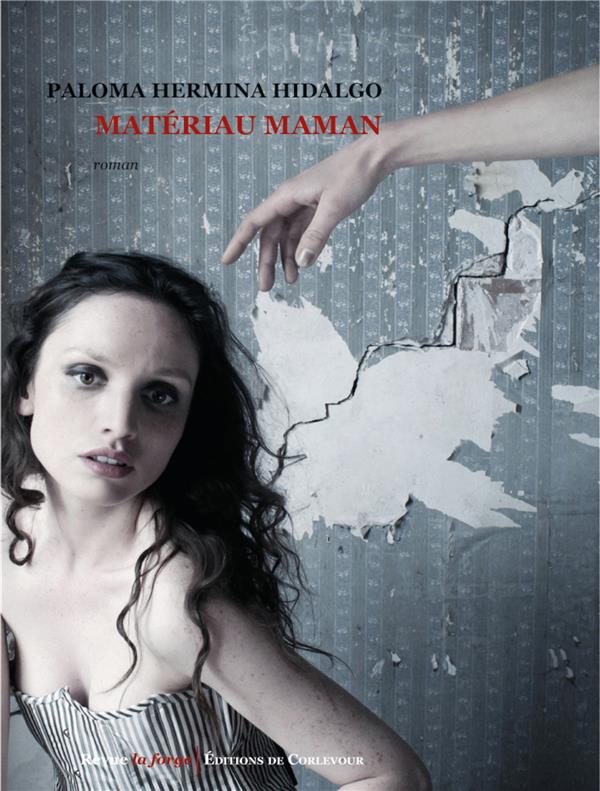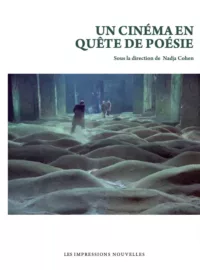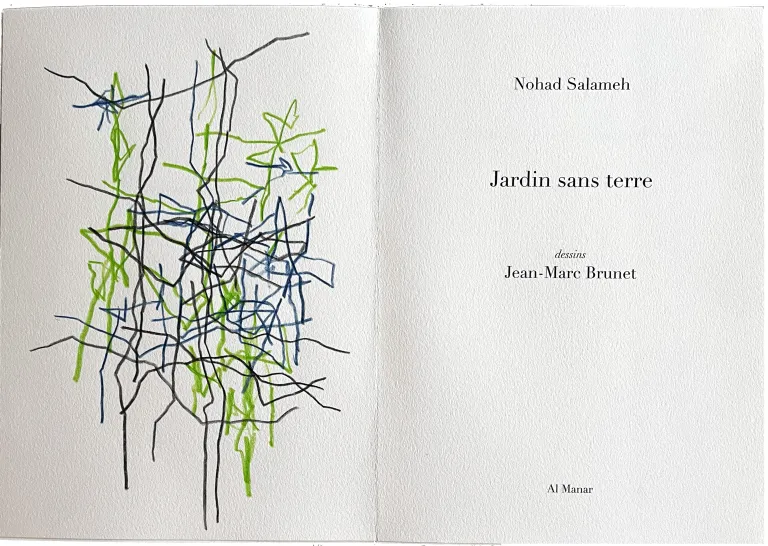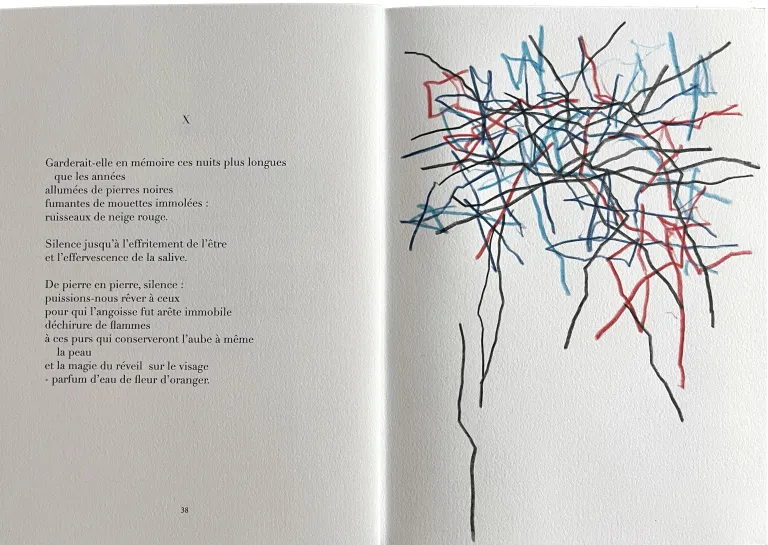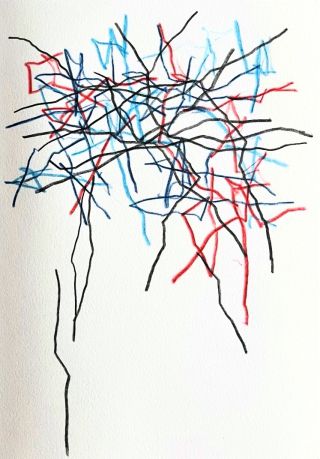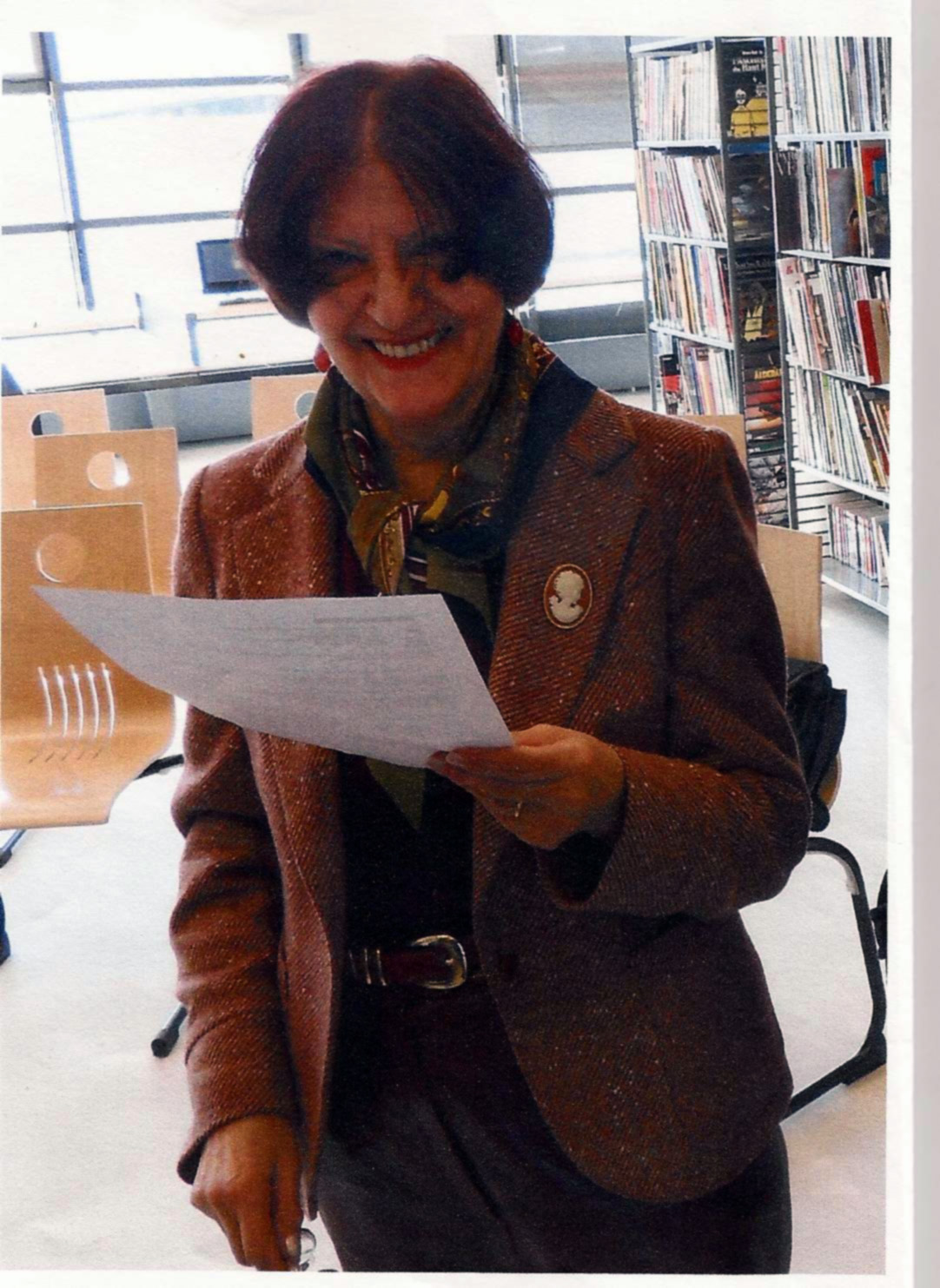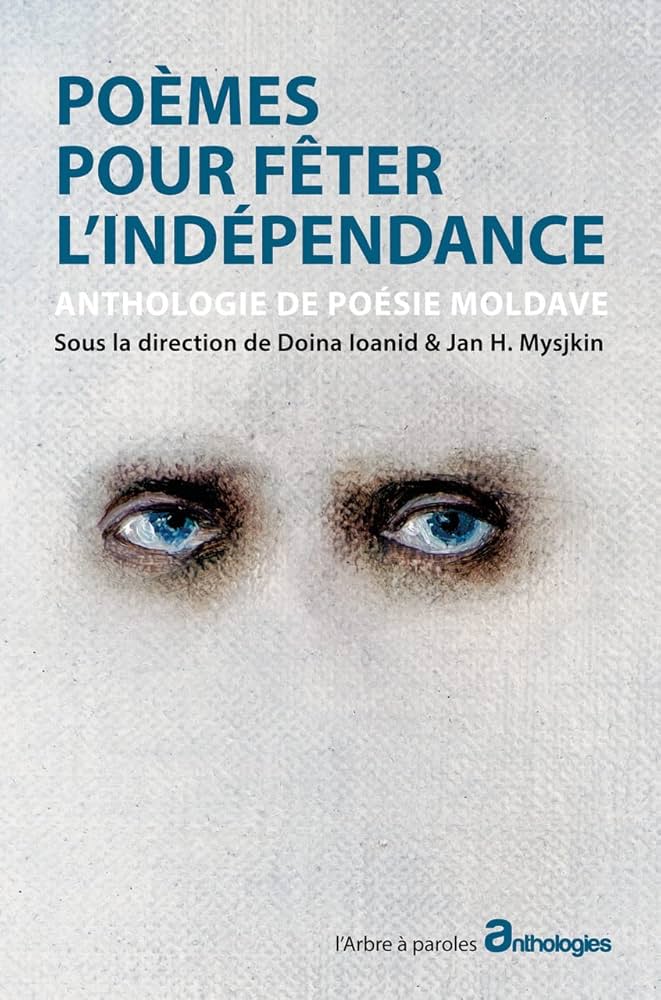Théâtre/poésie….Quel PENSER pour un jugement de goût ?!
Depuis le 20è siècle, consécutivement à la rupture brechtienne opérée avec l'héritage aristotélicien, le théâtre, s'interpelle lui-même dans son rôle, sur sa propre scène à propos du rapport de l'Homme à la parole, à la langue qu'il profère. Le théâtre confronte ainsi l'idée d'Homme, avec la représentation qu'il s'en fait et l’offre à la communauté des témoins-spectateurs.
A l'heure de l'hybridation des genres, non moins que du mêle plus ou moins heureux des arts dans une postmodernité du théâtre, il peut être important de considérer les termes de la relation-violence (au sens étymologique) entre le théâtre de représentation et l'irreprésentable rébellion de la poésie.
Les questions que nous voudrions évoquer ici surgissent principalement de notre expérience de création poétique, en tant que poète-chercheur, travaillant particulièrement sur l'oralité poétique. Nous envisageons la relation théâtre/poésie du point de vue de la théâtralité du poétique plus que de toute théâtralisation du poème.
ONE POEM / Philippe Tancelin : Ceux-là* de la lumière dans l’obscur des temps… Un clip de Reha Yünlüel.
Le « ET » en question
Lorsqu'on assemble les deux termes théâtre et poésie, n'ouvre-t-on pas aussitôt la scène d'un drame, le drame du « ET » car n'est-ce pas dans cet intervalle des deux termes et avant toute confrontation entre eux et leur lien, que se joue la poésie comme scène de bouleversement, et ce qu'elle écrit du drame de l'Homme en sa parole de libération.
Qu'entend-on de qui parle?
Que voit-on de qui se met en regard depuis sa parole?
Qu'est-ce qui est mis en question relativement au voir et à l'entendre? Nous pourrions commencer par citer cette anecdote qui frôle l'allégorie et qui nous fut rapportée à la fin des années 1970 par le poète dramaturge Kateb Yacine1 lui-même.
Tandis qu’il se rendait avec ses comédiens dans un « bled » pour y représenter sa pièce « Mohamed prends ta valise », Kateb Yacine nous raconte comment la représentation à peine commencée sur la place du village, le public se tourne dos aux acteurs. Ceux-ci désappointés, n’osent s’interrompre et poursuivent le spectacle jusqu’à son terme. Quelques instants après la fin, le public se retourne face aux acteurs, les applaudit chaleureusement.
Alors interrogé par Kateb sur un tel comportement, le public répond : « Nous nous sommes retournés car avec la poésie de la pièce, on ne pouvait pas voir et entendre à la fois ».
Cette saisissante anecdote, suscite une question: Quand on parle dans la langue du poème, qu'advient-il de la parole de la scène ?
Maeterlinck en son temps et dans son théâtre, invitait déjà à la prise en considération de cet "ailleurs" qu'ouvre le poème dans l'ici-même de la représentation théâtrale ainsi que de ce que voile le visible (cf. pièce « les aveugles ».) Il insistait sur la "présence" comme convocation urgente devant l'irreprésentable. Nous citerons à ce propos la poète Geneviève Clancy2 "Il y a ces alertes brusques qui suspendent le pas, détournent la tête comme si nous étions suivis par un sens informulé/ Est-ce la présence....Il y a cette surprise éclair de voir derrière les choses....quand le regard quitte les reflets et se lève pour calmement les traverser, il découvre cette terre allongée en nous où l'on cesse d'avancer pour s'avancer....la présence...passeur traversant les formes pour délivrer les profondeurs qu'elles retiennent"( Chemin du regard. )
Depuis ce drame du « ET » de théâtre et poésie, sont interpellés les concepts d'espace et de temps, leur rapport asservissant ou de libération de la scène « postmoderne ».
La poésie n'a d'espace que celui de l'intériorité qu'elle crée et elle n'a de temps que celui de sa parole. On peut constater que cette parole interroge les lieux où elle se tient. La poésie fait ainsi entendre que toute assignation à un lieu est sans doute l'enjeu de sa perte compte tenu du nomadisme qu’elle implique depuis l'échange des profondeurs de méditation de chacun avec lui-même et avec l'autre.
Un des foyers du drame entre la scène de l'Ouvert du poème au sens de Rainer Maria Rilke et la scène du théâtre, ne tiendrait-il pas en ce qu’on s’attend à l’une tandis que l’autre est inattendue. Ne découvre-t-on pas alors, la puissance de la parole poétique au lieu même où on ne l'attend pas ? Elle interroge la liberté de notre accueil de l'in-ouï autant que de l'in-vu (ce qui n'est pas entendu, n'est pas vu et ne relève pas de l’invisible ou de l’indicible)

CAPHARNAÜM - POÈME THÉÂTRAL, Valérian Guillaume - Cie DÉSIRADES, © Illus Franeck, TNg de Lyon, https://www.tng-lyon.fr/evenement/capharnaumpoeme-theatral/
La scène-poème
Si l'espace poétique comme nous venons de le suggérer est celui de l'intériorité, il s'ouvre depuis une écoute qui se tend et devient une scène active que l'on pourrait appeler la scène-poème: quand l'écoute du verbe poétique déchire l'écran d'obscurité de la représentation et permet d'entrevoir, d'entre-entendre la voix nue des espoirs possibles, les espoirs qui ne souffrent aucune représentation mais sont autant d’incantes.
La scène-poème profère une pensée de résistance qui permet à chacun.e de se convoquer à la fidélité ou non qu'il entretient avec lui-même dans l'espace de son intériorité profonde.
C'est selon nous la voix de la présence, celle du témoin lorsqu’il interroge la clarté de l'eau aveuglant ses fonds, ce même témoin appelant dans l'histoire, au partage entre sens et silence.
On pense à la voix de Manouchian3 le résistant étranger, expulsé de l'espace d'audibilité (le terroriste de l'affiche rouge) qui au moment d'être fusillé crie à l'amante, par la voix d'Aragon, "Ne pleure pas, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses" malgré les temps d'horreur, de détresse. On pourrait dire aujourd'hui, ces temps de misère obscure pour lesquels la lucidité du poète demeure « cette blessure la plus rapprochée du soleil » (R. Char).
Au long de ce drame du ET entre théâtre et poésie. Que convoque le théâtre? Qu’invoque toujours le poème?
La scène du théâtre tente de réaliser l' "avec" : l’assemblée des Hommes dans leur « vie en commun », selon l’expression brechtienne.
La scène-poème invite l'"en" (intériorité) de chacun.e grâce à qui tous.tes peuvent se mettre en résonance?
La scène-poème est ainsi le signe d’une alchimie entre la réalité prisonnière de la représentation et l’imaginaire de libération dans son exigence urgente de beauté à laquelle l'Homme s’accueille aux frontières du réel.
La scène-poème deviendrait alors cette ouverture sur l’ « IMAGINAL »…. au sens où Henri Corbin4 l'entend c'est -à-dire ce lieu d'accueil d'une spiritualité sous forme d'intangibles mais de pure présence, là où sont déposés les paysages, les faces de ce que nous exigeons de beauté pour éprouver le monde dans sa robe stellaire.
La scène du théâtre-poème
La scène-poème peut-elle être contenue sur la scène de la représentation théâtrale?
Si elle est y est convoquée ou invitée, en tant que scène de l'Ouvert, que bouleverse-telle du continuum de l'existence, du cours des représentations ?
La scène -poème est scène d'utopie, non pas au sens d'un « topos » inaccessible mais auquel on n'a pas encore accédé et qui offre à la voix, la porte du souffle. Elle ouvre par élans fondateurs notre être sur ses profondeurs. Ce sont des élans qui chaque fois qu'on cherche à les représenter, perdent leur nature de fondation.
Cette ouverture de la conscience aux autrement possibles, à tous les ailleurs d'un monde que le théâtre cherche, n’est-elle pas le fruit de la scène-poème ?
…Comme un cri avant la chute, quand est pressenti le sentier invisible de la source en son revenir…
La scène-poème émancipe le regard du témoin. Elle le libère de son arrestation par le représenté, et l'invite à aller regarder de l'autre côté, "dans l'au-delà du contour des choses comme le fait le nouveau-né autant que le mourant, afin de déceler ce qui monte de derrière les figures", (G. Clancy :"le chemin du regard")
Rappelons-nous la question de René Char dans « Au-dessus du vent », " La réalité sans l'énergie disloquante de la poésie, qu'est-ce ? »
On a trop souvent coutume de penser que l’essentiel de la poésie se tient pareillement à la saxifrage, comme une force d'éclats, de mise en lézarde de son support qui se développerait en archipel et se projetterait dans l'avenir.
Mais de quel support s'agit-il sinon celui qu'on appelle communément l'image poétique ? Cette force d'éclat, de mise en dispersion dont parle Char, ne s'applique-t-elle pas à la dissolution même de toutes formes de représentation dont l'image théâtrale ferait encore partie?
Il faut envisager que la scène-poème vient là pour arracher l'imaginaire aux images.
Un tel arrachement, ne s'effectue pas sans difficulté bien au contraire, car il doit tenir compte de la résistance sans relâche contre la tentation de la picturalité, c'est à dire de l'image avec ce que celle-ci d'emblée représente, raconte, ne veut pas rompre de la quiétude narrative.
En ces jours d’invasion de l’IA, des tempêtes d’images médiatiques toutes aussi homogénéisantes les unes que les autres, quelle fausse assurance veut-on entretenir contre la poésie, en l'instrumentalisant selon une syntaxe d'images qui dénaturent profondément son essence, la réduisent à une embellie.
Quelle scène du théâtre comme scène de penser poétiquement ce monde peut-être envisagée ?
Nous ne chercherons pas à répondre à cette question mais plus modestement nous référerons à des expériences entreprises dans le siècle précédent (Artaud, T. Kantor5, C.Bene6) qui relèvent de « La déconstruction du théâtre », à savoir le rejet de la volonté de vérité, le refus de la représentation, la mise en exergue des intensités, des potentialités pour un théâtre des devenirs...
Révolte contre la poésie, une lecture d'Arnaud Carbonnier du texte d'Antonin Artaud illustré par Claire Malary . Livre d'artiste publié en janvier 2022 dans la Collection "Vu par" (édition Aux Cailloux des Chemins)
Déconstruire pour à nouveau créer.
Au départ, pour Artaud, Kantor et Bene, toute interprétation est une trahison et nécessite donc une variation avec tout ce qu’elle fait exploser de fidélité au texte et par voie de conséquence le texte lui-même.
La représentation est considérée comme un occupant, un colon de l'imaginaire, un territoire d'enfermement auquel est opposé un théâtre de la non représentation en tant que scène ouverte à l'Irreprésentable de ce qui est vécu, senti ; ce que d’aucuns ont pu nommer le dépassement du théâtre par un agir de sa destitution, de son identité même, fondée sur l'affirmation de la représentation.
Contre une pensée de la scène close en sa forme même, ces recherches théâtrales suscitent une scène ouverte par une pensée en mouvement, c'est-à-dire traversée des multiples passages, métamorphoses, transformations, variations permanentes qui font éclater les concepts de temps et d'espace au profit d’ un hors temps de tous les temps, un hors lieu de tous les lieux, espace-temps des intervalles, pensée intervallaire…
Ceci conduira à un bouleversement de la notion même du théâtre comme faiseur d'images et leur substituer des effacements successifs jusqu'à la transparence comme on peut le relever autant chez C. Bene que chez T.Kantor, lequel mettra en jeu les structures de la mémoire en tant que magasins d'accessoires et de fragments de clichés éparpillés, au profit d’une puissance de la fabulation propre à l'artiste qui opte pour sa vérité contre la vérité.
Cette fabulation permet de multiplier les masques et de devenir sans cesse un « Autre » sans quête d'une identité fixe ; d’où cette importance de la superposition pour une transparence, vers une présence pure dans et par les mouvements incessants de changements au sein même de la répétition.
Ce qui est intéressant dans la poïétique des œuvres de ces artistes, c'est qu'elle invite simultanément à plusieurs créations selon le mouvement d’une scène nouvelle de pensée à laquelle les œuvres participent non plus séparément mais mêlées et superposées.
Eu égard à la recherche théâtrale de C. Bene, l'important n’est plus de donner une réflexion mais de donner à voir que quelque chose est réfléchi, ce qui interpelle non pas la réflexion mais son objet, et fait surgir toutes ses potentialités.
C.Bene, s'attaque au pouvoir de représentation des textes dans l'histoire de la littérature dramatique, textes qu'il ampute sans cesse pour se situer dans l'écart entre le fragment qu'il extirpe et la totalité. Ainsi il n’y a plus de lien entre le drame et l'histoire comme il n’y en a plus dans le drame entre les actions et l’histoire. Tout est empêché de se lier pour qu’existe le seul lieu d'une scène qui elle-même se destitue comme temps et lieu de l'autorité.
Plus qu'une crise du théâtre de la représentation, c'est une destruction de la Trinité aristotélicienne et la multiplication à l'infini des points de vue qui deviendront des points de voir, des visions incessantes, ces in-vus, in-dits que nous évoquions plus haut à propos de la poésie.
De cet irreprésentable surgi dans l'intervalle entre la scène à accomplir et une scène accomplie, de cette scène en devenir où tous les genres ont été pulvérisés, qu'en est-il encore de l'usage historique du concept théâtre ?
On peut à fortiori se le demander quand C.Bene lui-même abandonne le terme d'acteur au profit de « machine actoriale » et d'amputation incessante d'elle-même ou de tout ce qui la rendrait majeure, afin qu'émergent des mineurs virtuels comme différence contre l’invariant des pouvoirs quels qu'ils soient. Ces mineurs sont ceux du labyrinthe intérieur de l’être en son devenir.
Il n’est pas difficile de relever les grandes résonances entre certaines démarches de poésie contemporaine et ces précédents théâtraux qui comme en poésie, mettent en place des méthodes d'empêchement, d'obstacles, d'obstruction, de handicaps à l'accomplissement du dire et de l'action en tant que forme aboutie de la pensée (G. Luca7, parmi d’autres).
Un théâtre radical ?
C’est à travers les créations d'un théâtre dit de la « non représentation », que la scène théâtrale nous semble pouvoir être directement interpellée par le plan poétique depuis l’état poétique du langage.
Pourquoi?
Parce que la poésie ne dit pas ce que nous ne voyons pas, mais que quelque chose n'est pas vu, que quelque chose n'est pas entendu, n'est pas inventé dans ce que nous percevons du monde à travers les représentations y compris imaginaires que nous nous en faisons.
La matière du poème ne raconte aucune histoire. Elle ne représente que son propre mouvement, le mouvement de sa pensée. Elle rassemble des éléments radicalement étrangers en une seule intensité continue. En cela, elle résiste farouchement contre toutes les mémoires pâles du souvenir, de la commémoration qui tentent de piéger le devenir dans des valeurs normatives, celle du désastre, de la catastrophe...depuis des images qui s'enlisent dans le regard inhabité du miroir.
Or comme l’écrit René Char, " Nous errons auprès de margelles dont on a soustrait les puits".
L’art du théâtre tend à représenter la pensée au sein du réel. La pensée quant à elle, ne représente pas le réel, elle s’y représente elle-même par crises successives où la notion même de crise de la représentation est régulièrement mise en avant tantôt pour annoncer une mort prochaine du théâtre, tantôt sa renaissance imminente.
Depuis ses origines antiques jusqu'à aujourd'hui, le théâtre occidental a fait l'objet d'une succession de provocations de pensée sur ce qu'il devrait être, pourrait être, fut et sera.
Une nouvelle pensée-théâtre émerge sans doute. Elle se rapproche de ce que nous évoquions plus haut d’un état poétique du langage. En effet elle propose dans nombreux cas sinon la désertion, du moins le retrait de la parole en invoquant la nécessité d'une expression autonome de la scène de la pensée, c'est-à-dire un langage scénique susceptible de faire émerger une pensée où le spectateur ne se positionne plus par rapport à un donné là du sens, mais devient faiseur de sens par lequel l'œuvre est créatrice.
C'est ce faire sens propre à la poésie qui semble permettre aujourd'hui d'aborder nouvellement la relation poésie-théâtre- selon cette scène-poème qui est un faire signe d’un autrement voir.
La poésie-le théâtre d’un éclair.
Mais quel est donc cet autrement ? Comment le trouver parmi ces images toutes faites qu'on nous livre du monde, comme s'il n’y avait quelles, comme si le monde n'avait pas d'autre visage que ces images chocs ou non chocs, oniriques ou technologiques, virtuelles ?
La poésie nous dit qu'on ne peut qu’entrevoir les profondeurs du monde, voir entre... Mais pour voir entre, faut-il encore ouvrir, faire écart entre les choses les unes les autres, investir leur intervalle.
C'est un éclair dans la nuit, tout s'illumine soudainement le temps d'entrevoir, puis la nuit se referme sur ce qu'on a entrevu. Mais on a entrevu, comme entre les lèvres d'une plaie, entre les bords d'une fissure.
Le poète Hölderlin écrit dans les hymnes : « La poésie fait signe d'un éclair des dieux, un éclair qui se voile aussitôt dans les mots par lesquels il apparaît".
On entend mieux la complexité de la relation théâtre/poésie car ce ne peut être que dans un agir radical du théâtre que la lumière entrevue ne serait plus voilée par ce qu’elle éclaire. On peut à ce sujet se remémorer le travail théâtral singulier d’un metteur en scène comme Claude Régy8 qui sut en son temps proposer à des écritures relevant de la poésie, des dispositifs scéniques prenant en compte les interrogations que nous avons ci-avant proposées.
Aucune conclusion ne saurait s’avancer plus avant dans la relation théâtre et poésie, nous lui préférerons cette citation extraite des « cahiers de la nuit » de G. Clancy : L’essentiel n’est plus à dévoiler mais à regarder par l’émanance de la nuit au-delà de l’image sensible, son double de lumière » (Cahiers de la nuit)
février 2025
Notes
1) Kateb Yacine 1929-1989, Poète Dramaturge Algérien
2) G.Clancy 1937-2005, Poète Philosophe Française
3) Henri Corbin 1903-1978 Philosophe Français
4) M. Manouchian 1906-1944 Résistant antifasciste Fusillé
5) Tadeusz Kantor 1915-1990 P weintre metteur en scène Polonais
6) Carmelo Bene 1937-2002 Acteur, réalisateur, écrivain, metteur en scène Italien
7) Gherasim Luca 1913-1994 poète Roumain
8) Claude Régy 1923-2019 Metteur en scène Français
Entendre des mots..*
ce qui de leur intériorité
résonne en nous
nous accueille
nous enveloppe d’une danse accomplie
pour dieux tourneurs
Ne sachons vivre qu’en la croisée
des désirs souterrains
sous les formes qu’elle improvise
jusqu’aux visages éclos sur un nuage
Soyons les enfants des labours de la langue
quand aspirent les printemps à grandir dans les failles
à lancer la pierre tombée en travers du rêve
à inscrire dans le ciel l’épigraphe de la terre
pour une étoile
Accueillons sans trêve le voyageur
portant légende d’un miel antérieur à toutes plaies
lorsque la conscience inaugurale surgit
contre le visage remontrant de la fatalité
dresse cette partition soudaine
d’une main dans la main
pour qu’adelphité advienne
Ainsi peut-être l’homme serait à l’Homme
tel qu’en lui-même
délivré d’une existence où il n’est plus visible
qu’à travers le souvenir lointain
de son étoile éconduite
Nous sommes en la posture
de l’oiseau confondu
devant l’appel de sa couvée
au nid violé
Nous voulons entre les pierres sèches
dételer l’ombre qui les mure
déborder la mémoire qui les met au secret
ruiner les silences qui dorment le plus en elles
Des savoirs enchaînés à la peur de l’inconnu
nous briserons les lignes de partage
qui courent le long des in-penser la guerre
Le jeu cruel de plusieurs fois mentir
à ses fonds d’enfance
de toujours dessiner la porte étroite entre tous
tient visage de crime d’humanité
Nous serons ce cheval de traie
affectant son courage
au labour de nos rêves
Nous voulons qu’il en soit de nos pas
comme une fidélité à ce qui les excède
plutôt qu’à leur empreinte
au dernier clair de lune
*extrait de A contre-jour le jour recueil à paraître février 2025