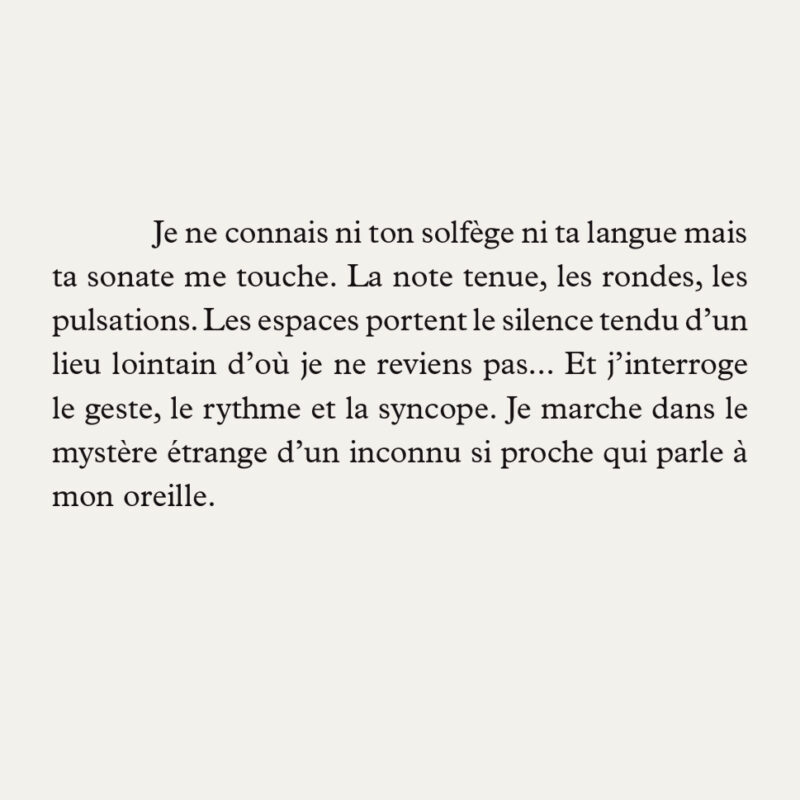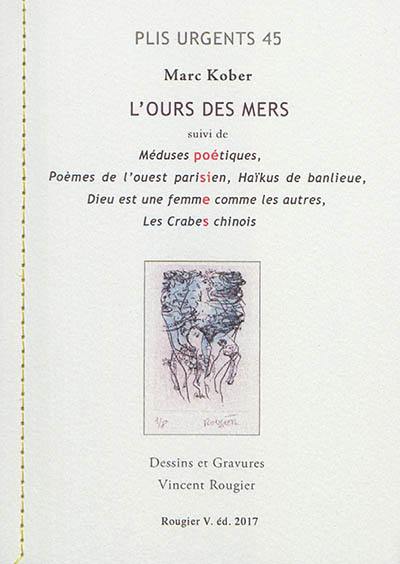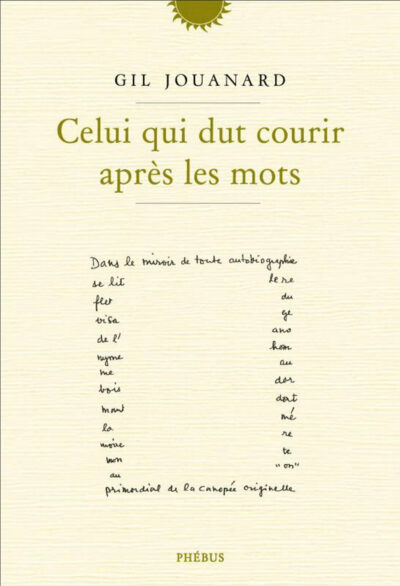Un article paru en mars 2014, signé par le fondateur de Recours au poème, Gwen Garnier-Duguy.
∗∗∗
A l'occasion de l'anniversaire des soixante-dix ans de la Libération, le Ministère de la Défense, l'un des nombreux (et surprenant) soutiens du Printemps des Poètes, a demandé à ses organisateurs de republier L'Honneur des Poètes, recueil de poèmes paru en 1943 aux éditions de Minuit alors clandestines. Ce livre n'était plus disponible, et ce sont les éditions Le Temps des Cerises qui le remettent dans le circuit.
L'Honneur des Poètes rassemblait, par l'entremise de Paul Eluard, des poèmes signés par des noms inconnus : Jacques Destaing, Louis Maste, Camille Meunel, Lucien Gallois, Pierre Andier, Jean Delamaille, Roland Dolée, Daniel Thérésin, Serpières, Jean Silence, Malo Lebleu, Benjamin Phélisse, Paul Vaille, Jean Fossane, Jean Amyot, Anne, Robert Barade, Roland Mars, Ambroise Maillard, René Doussaint et Maurice Hervent.
Dans le livre consacré à la Résistance et à ses poètes, Pierre Seghers écrivait : "En dépit de l'initial et modeste tirage de l'Honneur des poètes (qui sera très rapidement plusieurs fois réédité), le retentissement est immense".
Effectivement, on savait que derrière ces inconnus se cachaient des poètes à la parole féconde, que l'époque d'alors savait lire et réclamait. C'était Eluard, Aragon, Seghers, Desnos, Jean Lescure, Vercors, Tardieu, Guillevic, Lucien Scheler, Georges Hugnet, André Frénaud, Loys Masson, René Blech, Pierre Emmanuel, Edith Thomas, Charles Vildrac, Francis Ponge et Claude Sernet.
L'Occupation privait les poètes du droit à la parole, et cette action relevait de l'acte de Résistance. Un poète comme René Char avait fait le choix de ne rien publier pendant la guerre, déplorant "l'incroyable exhibitionnisme" dont faisaient preuve "trop d'intellectuels", nourrissant depuis les replis du maquis, masqué en Capitaine Alexandre, ses Feuillets d'Hypnos, parole inépuisable pour comprendre le rapport réel entre ce que représente l'acte de Résistance et le Poème, c'est à dire pour comprendre le principe du vivant.
Remettre L'honneur des poètes entre nos mains, c'est bien sûr réveiller un pan de notre Histoire douloureuse et montrer aux jeunes générations à qui on reproche de ne pas savoir s'indigner comment peuvent être utilisés l'acte et la parole lorsque le péril menace.
Cet honneur auquel les poètes avaient recours représentait un chœur français, où une parole de colère, de fraternité, de dénonciation, de soutien, de soin, se murmurait dans l'ombre et fédérait les cœurs. Les consciences étaient au travail, en prise avec la volonté de demeurer libres, en proie à la peur, à la néantisation d'un peuple. Seghers précise : "A Londres, aux Etats-Unis, au Québec, partout dans le monde libre l'Honneur des poètes est un événement."
Il faut lire cet Honneur des Poètes pour comprendre ce qui menaçait les êtres et la parole, pour entendre le soulèvement de tout le corps menacé, supplicié, torturé, organisé pour résister.
Il faut le lire et se demander quels seraient les actes de Résistance face à la guerre aujourd'hui en cours, cette guerre qui ne dit pas son nom, cette guerre répandue sur tout le territoire planétaire, cette guerre où les ennemis ne sont plus distinguables des alliés au regard de l'interdépendance des intérêts communs, orchestrée par une finance ayant semé la confusion économique et l'avilissement de la personne humaine privée de projets et de sens. Cette guerre fait de beaucoup un collaborateur en puissance, obligé d'obéir à un système ultralibéral capitaliste devenu totalitaire, et ne permettant pas de s'engager aussi distinctement qu'en 1940 dans le camp de la Résistance. Cette guerre pourrait bien faire de nous de potentiels schizophrènes, jouant le jour le jeu qu'on nous demande de jouer avec le sourire, et détissant la nuit ce jeu mortifère avec les armes de la ferveur et du désir de vivre, dans les nouveaux maquis. Cette guerre nous demande de penser comme nos ennemis, sous peine de disqualification, de condamnation, et d'assumer nos différences pourvu que l'on se fonde dans le modèle imposé. Cette guerre idéologique, cette guerre matérielle, cette guerre soumettant la plus grande part de l'humanité aux intérêts de quelques uns, cette guerre du nihilisme totalitaire va à l'encontre de la vie.
Sous quelle forme s'organiserait aujourd'hui l'Honneur des poètes ? Des lectures, les pieds dans l'eau ? Des rassemblements militants et laïcs où les gens vont lire des poèmes dans la rue ? Des randonnées poétiques ? Des bouteilles contenant des poèmes lancés à la fureur des vagues ?
Imaginez-vous Char, rassemblant ses feuillets sortis de l'enfer, s'avançant vers un auditoire assis sur des chaises pliantes et couvert de chapeaux de pailles, et disant sa parole face à un public pieds nus, dans la rivière ?
Imaginez-vous Robert Desnos récitant J'ai tant rêvé de toi en chaussures de randonnée, avec un sac sur le dos et son sandwich dedans, accompagné par une flopée de rebelles New Age ?
Ces poètes de la Résistance, dépassant les clivages politiques d'alors, se réunissaient dans un patriotisme et ce patriotisme leur tenait lieu d'honneur. Ils chantaient en français. Ils chantaient pour crier leur assentiment à la liberté, à la dignité de la personne humaine, au merveilleux contenu dans la grâce d'exister sur Terre. Ils disaient "oui", "oui" à la France, "oui" à la liberté, "oui" à la vie, contre le "non" qui s'abattait sur eux.
Or ce "non" est devenu le grand projet actuel, que l'on propose au monde ainsi qu'aux jeunes générations à travers l'unique réalisation sociale. Mais cette jeune génération n'est pas aveugle devant le Simulacre qu'on lui propose et comprend que cet accomplissement social fait fructifier le chômage, l'exclusion, l'appauvrissement, la misère humaine. Le "non" généralisé a congédié l'extase d'être en vie, le miracle d'exister, de respirer, de parler, de penser, de rêver, de composer, et de tendre toutes ces lignes de forces pour composer l'or intérieur, celui de l'œuvre qu'il est possible à chaque être humain de proposer en réponse et en remerciement à la vie, d'affiner son corps mortel, d'affiner la matière humaine par l'aventure qu'offre l'esprit, c'est à dire par le sésame que donne le spirituel. Ce chant commun, interrogeant les étoiles, sondant le cosmos qui n'a pas livré tous ses secrets, n'aimante-il plus les Résistants de maintenant ?
Car où se cachent-ils ? Ont-ils trop honte d'avoir reçu le français pour langue mère ? Sont-ils dissimulés derrière la culpabilité et la mauvaise conscience qui partout se sont dilatées dans le pays ? Sont-ils tétanisés par le déni de soi au point de renier ce que représente la force de Résistance du Poème, qui est égal à la vie comme le disait Baudelaire, qui est atteint dans son cœur et dans son esprit, à qui on a demandé d'abandonner l'évidence d'être ?
Il serait intéressant de voir comment les Aragon, Eluard, Desnos, Char, Seghers, aujourd'hui, organiseraient cette Résistance et revendiqueraient cet honneur des poètes.
Il y a fort à parier qu'ils rassembleraient leur parole et leur action dans le maquis de la toile. Il y a fort à parier qu'au sein de ce lieu stratégique, où la liberté et la menace coexistent, ils verraient une brèche. Nous mettons notre main au feu qu'ils organiseraient un réseau de Résistance pour conjurer les attaques permanentes du nihilisme contre la pulsion de vie. Nous mettons notre main au feu qu'ils verraient là une possibilité de recours. Un recours à l'honneur. Un recours au Poème.
Cela se passerait des ministères.