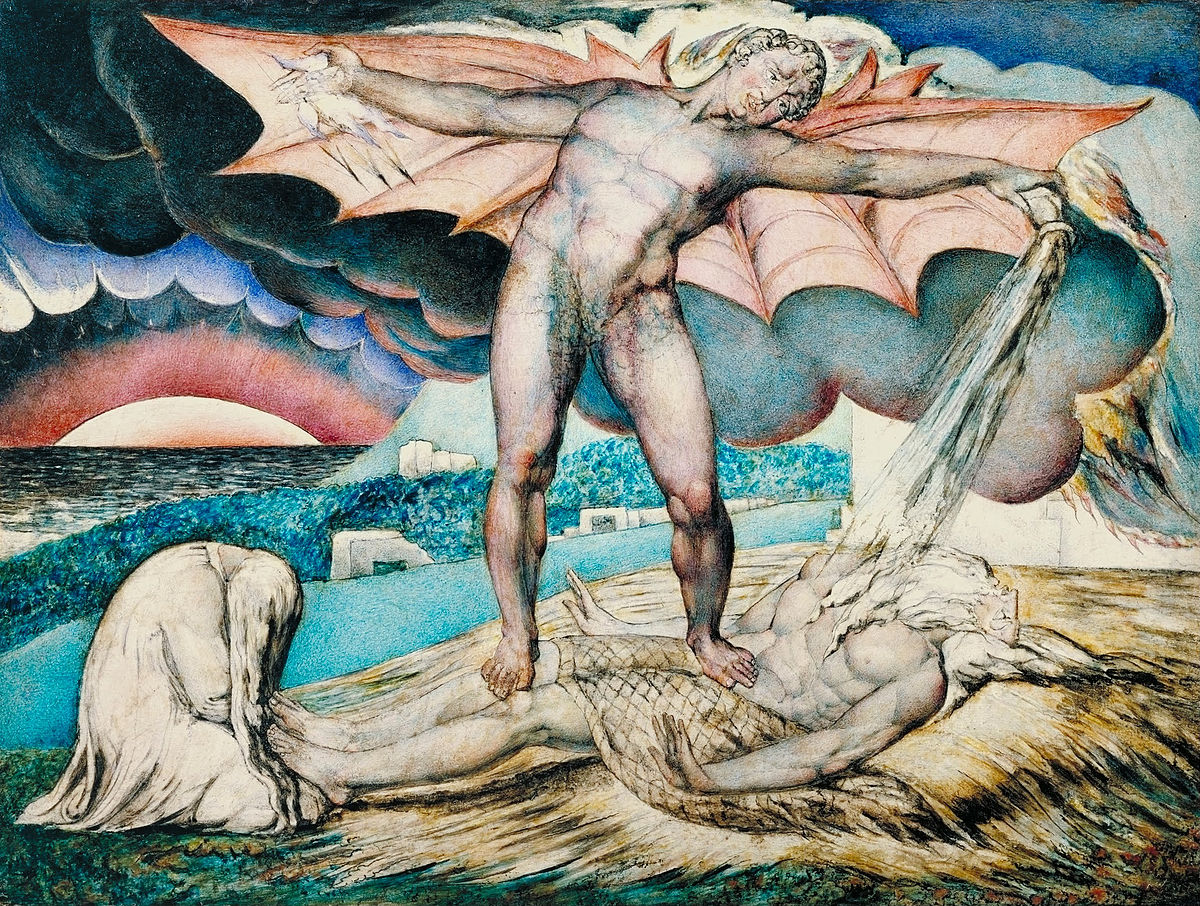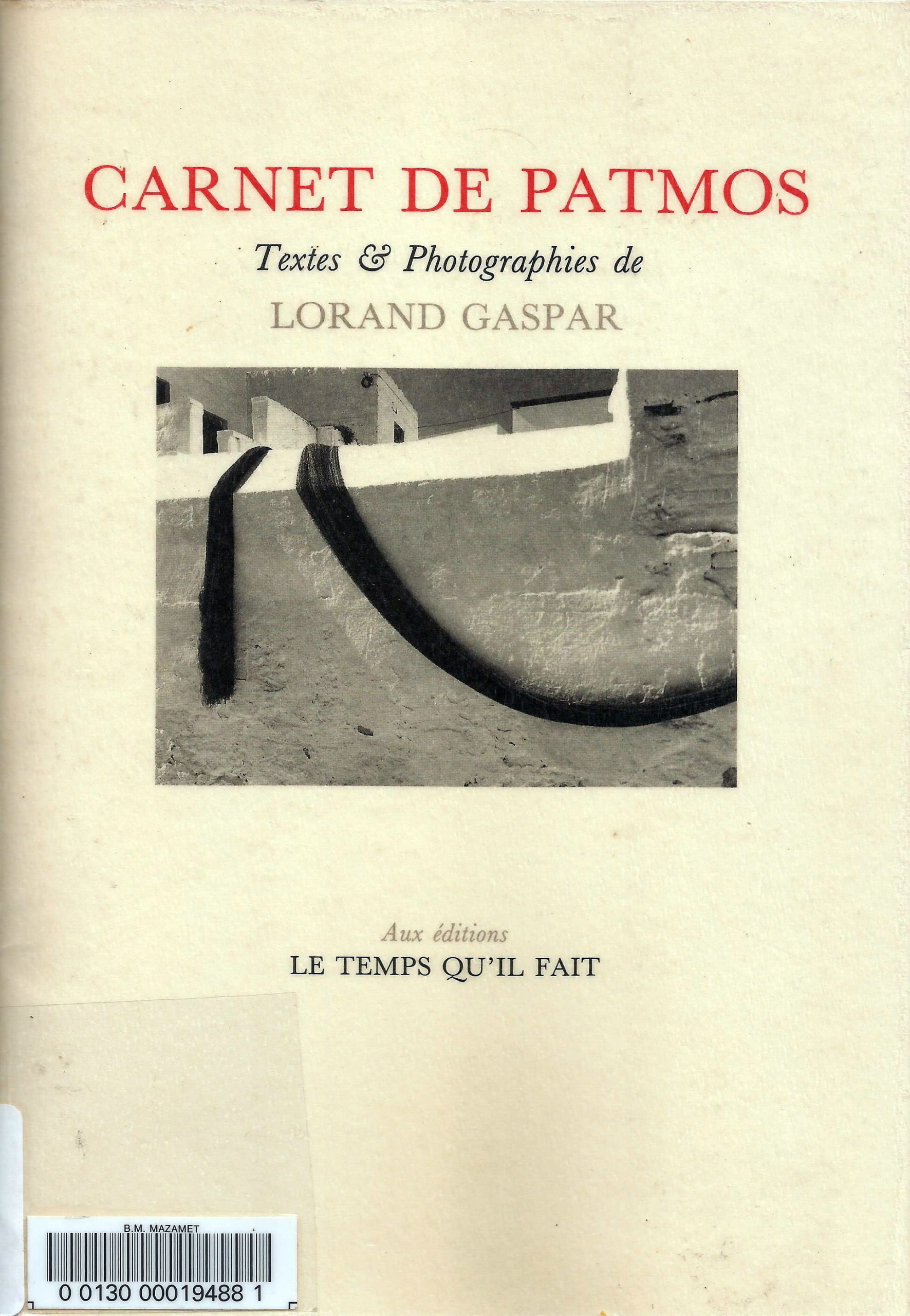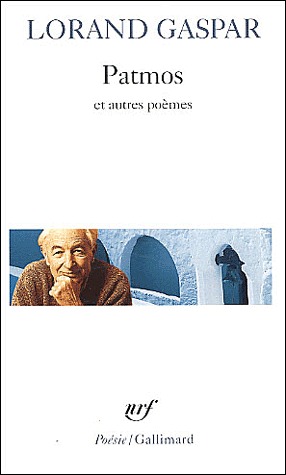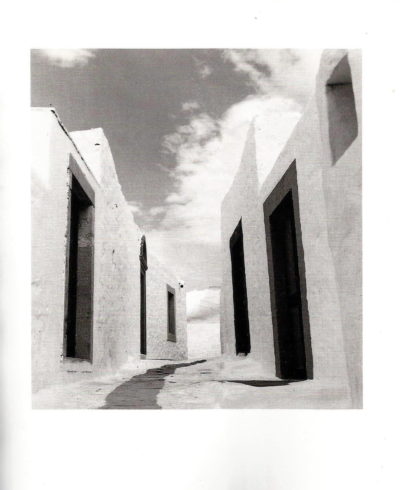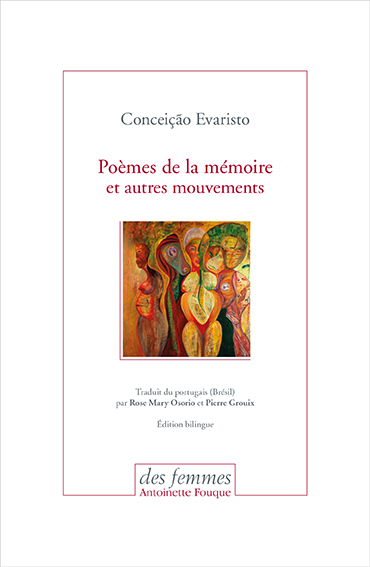Comment vivre en poète, lettre à Éric Poindron
En manière d'introduction, cette lettre-mail qui explique la genèse du dialogue entre Éric Poindron et l'auteur.
Louvigné-du-Désert le 24 novembre 2020
Bonjour Maryline,
En accord avec mon ami Eric, je te joins ce texte : Dialogue avec Eric Poindron (ou Lettre à Eric Poindron, tu jugeras, à l'occasion, du meilleur titre à lui donner). J'espère qu'il te plaira.
Il s'agit d'un jeu de questions/réponses entre l'auteur et moi. Au crayon à papier, comme c'est mon habitude, j'ai directement écrit sur le livre que je lisais. Il s'agissait de son ouvrage (inclassable mais poétique sûrement) Comment vivre en poète paru en février 2019 au Castor Astral.
A la réécriture, je me suis astreint, pour un maximum de sincérité, à reprendre le plus possible le premier jet très impulsif. On y trouve donc nombre d'imperfections, mais je l'assume, et pour Eric Poindron, et pour toi, et pour la nécessité du ressenti, si j'ose dire.
Techniquement, le livre de Poindron est tout fait de citations d'auteurs entre guillemets, de réflexions en police grasse, ou majuscule, ou plus habituelle Times New ROMAN… J'ai ajouté une note de départ expliquant tout cela. Pas facile à suivre peut-être. J'espère que le lecteur s'y retrouvera.
J'ajouterai qu'il n'y avait aucun projet de publication dans l'écriture de cet échange. Juste l'envie d'un partage avec le poète.
Par la suite, l'ayant joint au téléphone, nous avons ensemble évoqué cette éventualité de publier dans ta revue en ligne.
Tu en jugeras.
Dans l'amitié des mots.
Serge Prioul
Vaucluse 18 octobre 2019 - Louvigné-du-Désert 1 janvier 2020
Salut Eric,
Je te connais peu ; j'ai seulement remarqué un type pas comme les autres - poètes - la sincérité de ta présence quelquefois sur Facebook, et ça me faisait du bien.
Alors quand j'ai trouvé ce livre dans le rayon poésie - encore trop modeste à mon goût ! - de la librairie Le Bleuet à Banon, je l'ai acheté sans hésiter (Du coup, double effet du plaisir, j'en ai même déposé deux des miens !).
Comme la poésie, ce livre convie des poètes à prendre place en ces pages, écris-tu.
L'invitation était trop belle : le crayon à papier, léger ; du genre à effleurer sans effeuiller, sans affirmer surtout. Je t'ai photocopié deux pages de mes notes directement sur ton texte, juste pour montrer l'effleurage - et c'est illisible ! Alors, il m'a fallu tous ces mois pour reprendre mes petites réflexions (pardonne-moi d'avoir été si long - je suis très mauvais écrivain !)
Non pas que je ne croie pas en la valeur de mon texte, de ma critique, mais souvent j'écris péniblement, et j'avais l'impression de ne rien dire d'intérêt, de m'être attelé à trop gros, de m'être attaqué à… le siège m'épuisait.
Pourtant je n'ai quasiment pas changé les mots couchés lors de cette lecture d'octobre. Et je te les restitue tels quels.
Je le répète, ce n'est guère une critique, plutôt un dialogue avec un ami poète dont j'aime lire les textes. Sans doute un peu ce que tu espérais en écrivant.

Eric Poindron, Commet vivre en poète, préface de Chalélie Couture, Le Castor Astral, 2019, 137 pages, 15 €.
Voilà donc ce regard sur… du "lecteur moyen" que je suis qui n'apporte pas de réponses aux questions ; l'impression plutôt d'y accoler une nouvelle question, siamoise !
Et des réponses à double sens (tu l'auras compris) comme doit être la poésie, comme j'essaie en tout cas de l'écrire. A quoi bon écrire un vers s'il n'a qu'un seul sens de lecture ? Travail de poète, donc ! - tu vois j'avance comme en mathématique : argumentant la démonstration. Et pour moi-même.
Comme la poésie, ce livre convie des poètes à prendre place en ces pages, tu l'écris donc à la page 34. Je n'avais pas attendu d'être arrivé là pour griffonner régulièrement mes notes à la suite des passages qui me parlaient. Parfois ils laissaient un blanc sur la page, comme pour proposer une suite, parfois il fallait se contenter d'un bout de marge et d'un commentaire laconique, et c'est bien ainsi !
A 17 ans, fauché comme un fils d'ouvrier, j'ai volé à un libraire le Baudelaire de la Pléiade. Comme sur ton livre, j'ai écrit contre chaque poème. Ce que je comprenais, ce que je ne comprenais pas aussi, et c'est régal à relire ces notes intimes du garçon qui découvre ! Le Baudelaire m'accompagne toujours, il est là près de moi, sur le siège du camping-car. Le tien le rejoindra sûrement. Belle compagnie !
Et tout cela restera entre nous. En noir et blanc. Comme les photos de mes amis du Trás-os-Montes. Existe-t-il ce « lecteur moyen » ? Lire et en parler me semble toujours assez exceptionnel. On ne te parlera pas de ton livre m’avait dit Sylvie Durbec, lorsqu’elle m’avait mis le pied à l’étrier de l’édition.
Bonne lecture, donc ! Essaie de m'y comprendre… Si tant est que… J'ai moins écrit dans la dernière partie ; il ne faut pas abuser ! Et j'y reviendrai souvent : quel outil pour mes ateliers d'écriture ! Toujours, cette envie de jouer avec toi, au jeu de l'écriture - et rien là de plus sérieux.
L'amitié comme en plus.
Comment vivre en poète
Eric Poindron1
" On sent bien qu'il existe une obscurité inhérente à la poésie, mais on imagine un peu vite que le poète doit la rechercher alors qu'il doit la dissiper. "
Roger Caillois
Vivre en poète, c'est se sentir comme un électron libre propulsé en dehors des limites de son chant d'attraction. A la fois joyeux et désespéré, à la fois isolé et confondu à l'Univers… (page 13)
Vivre en poète, c'est profiter d'une page blanche - ou presque - dans un livre intitulé "Comment vivre en poète" et avoir envie d'y mettre ses propres mots. A peine, comme cela, au crayon à papier qui glisse aussi simplement qu'on l'efface.
…
Celle que j'aime dort encore
je suis sur la terrasse dans le calme des coqs
je bois du thé noir
… (page 15)
Dire qu'il est cinq heures dans un pays qui fait monter les marches* aux coqs qui se la ramènent un peu trop tôt. Que celle que j'aime dort aussi et que j'ai près de moi mon vieux Baudelaire dans la Pléiade, épais volume volé à un libraire ce qui lui gâcha la journée, mais pas la vie, la mienne.
*Expression populaire d'autrefois pour dire : envoyer quelqu'un au tribunal.
Le poète vit à Paris, qui est une ville de poètes, mais pas seulement. Il peut aussi vivre en province puisqu'il est possible de vivre en poète partout.
…
Le poète peut exercer un métier qui ne compte pas. Ou jouer aux échecs. Ou ramasser des champignons.
… (page 17)
Mon fils enseigne les échecs, fait du vélo, ramasse des champignons. Les fait sécher. Comme nous les mots, tout seuls. Samedi, j'irai avec lui en forêt de Rennes. A Rennes, la Maison de la Poésie est le long du canal. On dit toujours que c'est un coin de campagne dans la ville.
Quelquefois le poète lit les livres qu'il achète mais ce n'est pas une obligation. Quelquefois le poète lit deux pages puis se met à écrire… (page 18)
Ce genre de page où on nous a laissé bien peu de place pour les notes - et à gauche, où c'est pas facile. Mais on se dit qu'on va le racheter ce livre, pour l'offrir. A une amie poète ; parce qu'on a une amie poète, et qu'on lui offre souvent des mots.
…
Je crois aux poètes du Grand Dehors et du Grand Vide. Quand le vent souffle large. Le Souffle et l'écho du souffle…
…
L'assassinat de la poésie est commis sans conscience, mais en toute conscience, par les tristes crapules qui la décortiquent à la vilaine manière d'une autopsie. (Page 20)
Est-ce la page pour dire que je taille la pierre et qu'il en sort souvent un poème ? Même quand je me tape sur les doigts - mais ce n'est pas souvent.
Celui qui vit en poète, c'est celui qui fait, qui dit, qui lit, qui luit. Qui pille, puis éparpille. (page 23)
Et puis, de ci, de là, quelques petites traces dans la marge. Touches à tout.
Vivre en poète, c'est peut-être / être toujours quelque part au milieu de nulle part égaré au cœur des chahuts et des chaos ; être seulement ici ou là, là où je ne m'attends jamais. … (page 25)
Je marque cette page avec un marque-pages de la librairie Le Bleuet à Banon. J'ai croisé cette route, ce village de Provence dont je ne savais rien, surtout pas qu'y vivaient, que s'y débattaient tous ces poètes dans cette "plus grande librairie de France", m'a-t-on dit. Alors moi, comme cela, j'ai déposé deux volumes, d'un de mes deux livres, comme cela…
Comment vivre en poète, c'est peut-être / cette réponse de Jean-Claude Pirotte : "Lorsque les gens me demandent si je suis écrivain, je fais le mort."
…
Quant à l'édition d'un texte, ça vaut à peine un paraphe. Là n'est pas l'enjeu. Une fois la première phrase passée, il n'y a plus de morale. (page 26)
"Ecris, écris" dit Jacques Josse "le reste… !" Et il regarde le ciel, comme il regarde la mer.
(page 27) La page d'avant ou celle d'avant, je lis les mots de Reverdy, sur la neige bleue du toit fendu. De mon camping-car où je vis en poète, il n'y a pas de toit fendu, et c'est heureux. Juste des rideaux-volets qui ferment presque bien par où un matin de grand soleil, dans la boîte presque noire, je voyais les gens du dehors marcher sur la tête.
Alors parfois, je les ouvres en grand, ces volets, sur la Lune.
L'écritoire est un vaste pays en silence.
Qu'ai-je fait de l'hiver ? (page 29)
Tu verrais la taille de ma table d'écriture. Entre le bol, le lait, le miel, le testeur de diabète, la page blanche - ou pas.
Tu chercherais la place de ton livre - ou pas.
On n'écrit pas de la poésie parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais parce qu'on ne sait pas faire autrement.
…
Ecrire sur une pierre trouvée, c'est lui offrir des yeux et le don du regard.
On a vu des poètes écrire sur des galets, et les pierres se mettre à sourire. (page 30)
Si c'est de la poésie, c'est pour tout le monde ; et si ce n'est pas pour tout le monde, alors ce n'est pas de la poésie. (page 31)
Pour la pierre, si tu savais… !
Mais tu sais. Sur le chantier, Thierry Metz. Tu sais !
Tu vois, ami,
Apprendre à lire un paysage ne détruit absolument pas le paysage. Il faut apprendre à regarder pour rien ; et regarder le paysage comme une succession de strates ne tue pas la poésie.
Tu vois, ami,
Si on écrit quelque chose, il faut raconter les à-côtés.
On ne gagne pas ses galons parce qu'on découvre quelque chose de sensationnel. Tout est déjà écrit : il faut seulement trouver une petite place. (page 32)
Ami, cette envie de te répondre. Bon, c'est déjà fait. Et puis, j'aime pas écrire sur la page de gauche. Je sais, tu me feras sur la page de droite, une petite place plus confortable.
Comme la poésie, ce livre convie des poètes à prendre place en ces pages.
Ce livre pose des questions mais n'apporte pas de réponses.
…
Souvenez-vous aussi qu'il n'existe ni bonnes ni mauvaises réponses, et qu'à la question posée "pourquoi écrivez-vous ?", la réponse la plus brève du poète Saint John Perse sera toujours celle de l'essence : " Pour mieux vivre." (page 34)
Je t'envoie, Eric, "Le questionnaire Vagamundo" de mon premier livre - enfin, l'avant-dernier !
Le questionnaire Vagamundo
Depuis quand écrivez-vous ?
Depuis que le vin ne m’écrit plus.
Quand écrivez-vous ?
Le matin quand un grand cœur bat dans l’aube et le silence.
Ecrivez-vous ?
Comme je caresse les pierres,
De ma grosse main de tailleur de pierre.
Vous ?
Même pluriel, n’est pas une fin
Puisqu’il reste ils
Et surtout elles
?
J’ai toujours aimé poser la question : Quoi ?
***************
Ensuite, ici et là dans :
QUESTIONS SANS REPONSES
SENTIER D'ECRITURE
Des pages à noter où rien n'est noté.
Trop de place, peut-être.
En si peu de mots, quel poème
allez-vous écrire dans les rares blancs d'un ticket
de métro, d'un titre de transport - amoureux ? -
et à qui ? (page 51)
J'ai souvent écrit sur les tickets de bar (il n'y a pas de métro à Fougères)
Mon éditeur a tout refusé, ce devait être très mauvais
Il y avait encore trop de place.
Comme ce poète Celan qui cherchait un "Tu à qui parler", j'ai un "je" qui traîne ;
ai-je le droit de dire je
dans une histoire de poèmes ?
(page 53)
Je. Tu. Qu'importe ! Parfois je te dis-tu. A d'autres c'est à moi, ce tu.
pourquoi celui qui n'écrit pas peut-il vivre en poète ?
(page 62)
Je voyage en camping-car ; je dois faire de la poésie avec des chevaux fiscaux.
" Quelle humanité dans l'œuvre qui n'aura pas collaboré avec le hasard. "
(page 62)
Voilà le genre de phrase hasardeuse née des rencontres avec la page de droite.
Alors, quel poisson êtes-vous ?
(page 63)
Un chevesne, qu'en pays Gallo, on appelle un dard, du fait de ses nombreuses arêtes sans doute.
Pour Marie-Claire Bancquart, le poème est "comme une série de "désobéissances" à la langue commune."
Quelles sont vos désobéissances ?
(page 68)
Je m'en fais des obligations mais ne sais pas si j'en ferai fortune.
" Lucarne. Par cette lucarne - la seule dans la ville - on assiste aux travaux secrets de la nuit."
André Hardellet
(page 69)
Comme je n'aime guère le bleu, si fatigué, si usité, j'allume une chandelle jaune pour voir la nuit.
Qui est ce lecteur, cet ami inconnu, à venir ?
(page 69)
Il faudrait trois points d'interrogation à cette phrase.
en typographie étourdie - ou fantôme -,
un "blanc" mal placé, comme un ange qui passerait,
est peut-être une " coquille vide " ?
(page 73)
Ici, pas de note ; juste un trait en marge pour dire aimer (il y en a beaucoup tout au long de ton livre, ami). Mes traits souvent sont circulaires, comme en mathématiques, les vecteurs d'un cercle.
FAUT-IL entretenir des correspondances
avec d'autres poètes,
ET POURQUOI faudrait-il
établir des correspondances entre poètes ?
(page 77)
La page m'a-t-elle laissé la place pour répondre ?
Devait arriver cette question.
Et avec elle, celle que je me pose : dois-je t'écrire ? T'envoyer mes notes ?
Mes questions ? Mes non-réponses ? A quoi bon ?
Et puis, je me dis qu'il faut vivre en poète. Dangereusement !
Quel télégramme écririez-vous à un poète admiré ?
(page 78)
Ça ne doit pas être facile (!) (?) / Stop
Quel télégramme écririez-vous à l'être aimé ?
(page 78)
Ça n'a pas été facile (!) (?)/ Stop
… Et puis le soir descend, il fait rouge et jaune, le jaune de la nuit…
(page 79)
Je souligne ta "nuit jaune"
Enfin jaune !
T'en a pas marre, toi, de tout ce bleu dans les poèmes ? A croire qu'il n'y a qu'une couleur !
La nuit surtout !
On peut être écrivain à temps partiel et poète à plein temps. Même celui qui n'écrit pas. Quant à l'édition d'un texte, ça vaut à peine un paraphe.
(page 81)
Oh, comme c'est mon cas ! A part, peut-être pour la dernière proposition : le plaisir de voir mes textes publiés ! Je ne "cracherai pas dans" le livre/soupe.
J'ai enlevé le masque et me suis vu dans le miroir…
J'étais l'enfant d'il y a tant d'années…
Je n'avais pas du tout changé…
Fernando Pessoa
(page 82)
Récemment, j'ai rêvé que j'étais le fils de Jacques Chirac (il venait de décéder).
Prévenez-moi quand mourra Pessoa.
Je déplace des cailloux, je les glisse dans mes poches puis les abandonne, plus loin,
ailleurs sur le chemin, comme un autre rien. Ce n'est pas un dérangement, mais une
manière délicate de désordonner les géographies.
(page 83)
C'est curieux : je maçonne avec des pierres partout récupérées. Des moellons de granites de couleurs, des marbres ramassés ici ou là, des schistes, des basaltes… Ainsi je voyage en bâtissant et en perdant les géologues.
… Ne pas comprendre c'est aussi la poésie.
(page 83)
Avec force conviction (ce qui m'est inhabituel), j'ai rayé ton mot "aussi", l'ai remplacé par "d'abord" !
Racontez-moi où et quand vous avez planté votre dernier arbre.
(page 83)
J'espère bien qu'il en parlera lui-même !
Que faites-vous pour promouvoir
votre maison d'édition et la poésie ?
(page 84)
J'écris aux poètes pour dire que je les aime.
Il est des combats qu'il ne faudrait jamais
perdre : celui en faveur du point-virgule en
est un. Ambigu pour certains ; archaïque
pour d'autres, le point-virgule est pourtant
un ami précieux
(page 92)
Le point-virgule, indispensable ; même à celui qui écrit sans ponctuation.
La poésie a besoin d'invisibles.
Pourquoi la poésie ne peut-elle être
qu'une aventure collective ?
(page 102)
Parce qu'on nait jamais seul à écrire
(cela a sûrement déjà été dit !)
Quels sont les différents supports sur lequel
il est possible de laisser des traces poétiques ?
(page 102)
Adolescent, j'aimais bien écrire sur les emballages du Tabac Bleu que je fumais. Je me prenais pour François Villon qui ne fumait sans doute pas - faute de tabac ! C'était mes parchemins.
Un été ailleurs / histoire de déserts / blancs ou
brûlant / Le poète se fait voyageur et raconte ses
déserts / Au loin les mots / le poète prend un globe
terrestre et la parole. Loin ou non des tartares…
(page 103)
(et si un jour j'écrivais un livre où je placerai ça en épigraphe !)
Pourquoi la photographie
peut-elle être la complice du poète ?
(page 104)
Les autres poètes (les vrais (!) (?) parfois de travers,
regardent
mon recueil de 32 poèmes et 9 photos.
Ou bien, est-ce 10 photos et 31 poèmes.
ON EST PRIE
De ne pas emmerder le Monde
S.V.P.
Etait le mot imprimé que Guillaume Apollinaire punaisait sur la porte de son bureau comme un mot d'ordre.
(page 105)
Pas de bureau ! J'écris sous l'escalier. Il y avait là, autrefois, un lit.
Ma mère y est née, en novembre 1920.
"Vous voulez dire "il pleut", écrivez : "il pleut" ; vous voulez
dire "j'ai mal", dites : "j'ai mal"."
(page 108)
Vous découvrirez, alors qu'il pleut vraiment, que vraiment vous avez mal.
quelle conversation entretenez-vous
avec un simple caillou ?
(page 109)
Caillou, ça s'écrit presque comme recueil, et je suis justement en train d'écrire un mur.
Quelles sont vos collections ?
(page 109)
De cailloux, justement !
Que vous racontent les oiseaux ?
(page 110)
En faisant des mots croisés, ma femme a appris que la cigale "crie-crie" ;
ça n'a pas arrangé sa confiance dans les gens du midi.
Plus tard en vérifiant, je n'ai pas trouvé ce terme dans la liste des cris d'animaux ;
ça n'a pas arrangé ma confiance dans ceux qui inventent les mots croisés.
Les contes, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît.
(page 111)
Si ton poème ne raconte pas une histoire, ce n'en est pas…
Quelle neige êtes-vous ?
(page 112)
Celle de "Tombe et que n'ai-je"
Paris, Lyon, Barcelone, Cuba, Saint-Pétersbourg,
comme ce chanteur et voyageur espagnol, poète
aussi, qui confie : "Je suis entre les villes et j'ai
organisé ma vie de sorte
à ne pas savoir d'où je suis."
Pont entre deux rives, fesses entre deux bancs,
cœur entre deux aubes, carreaux brisés entre deux
bises ;
D'où êtes-vous ?
(page 113)
"Autour de Negrões
Les villages se nomment
Lamachã
Lavradas
Coimbra da Miõ
Carvalhelhos où coule
Une des plus grandes sources du Portugal
…"
Extrait de Carnets du Barroso
Alors, que cherchons-nous dans le grenier ?
(page 114)
Sûrement la vieille machine à écrire.
*************************************************************************************
Sur quoi allez-vous écrire un livre ?
(page 118)
Le livre se chargera bien d'écrire sur moi.
Voyageur cultivant l'oisiveté avec rigueur et acuité, Hudson
avait pour ambition, entre autres, d'étudier la métaphysique.
Toutefois, la culture du bonheur l'occupant à temps plein,
il n'étudia jamais la métaphysique.
(page 126)
Vivre pour vivre
Le reste est littérature.
Note
- Pour lecture facile :
En police Times New Roman normale : texte original d'Eric Poindron
En police Times New Roman italiques : réponses de Serge Prioul
En police Times New Roman gras : notes d'explications Serge Prioul
En plus gros caractères : texte d'Eric Poindron - 2ème partie du livre