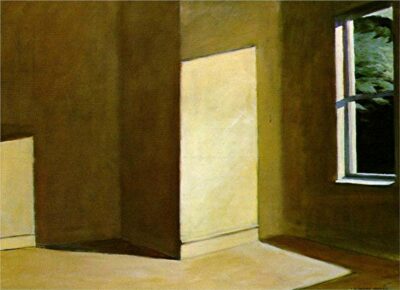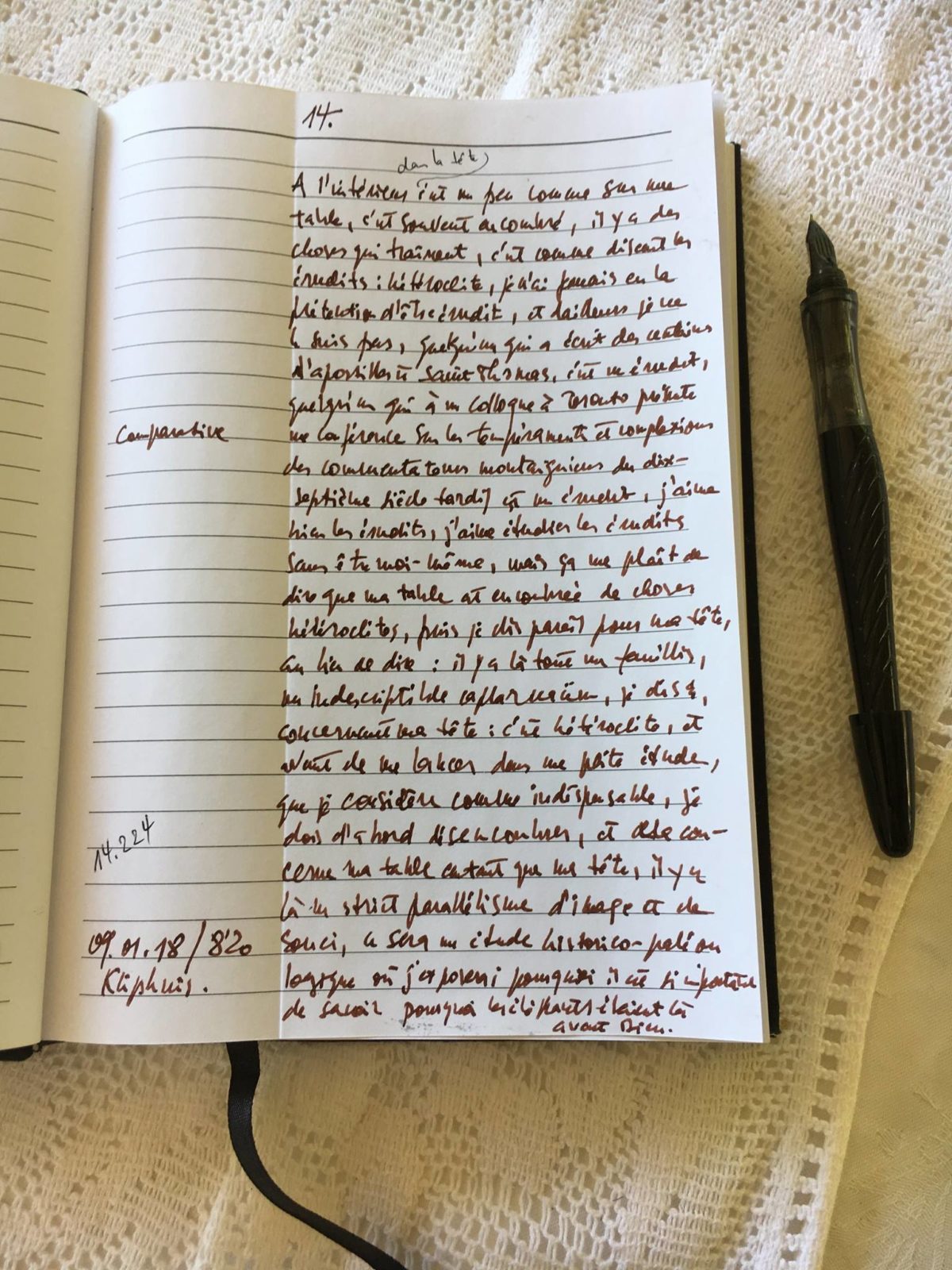Nicolas Jaen, CELUI QUI A VU LA TRÈS-DOUCE
Je ne vois pas mon visage quand je te parle mais
tout ce que tu as fouillé en toi pour en arriver là
à moi qui te parle toi qui m'écoutes et me
regardes écoutes et regardes maintenant avec tes
yeux avec ta peau avec tes habits sur ta peau
avec ta nudité dessous tes habits nudité un peu
honteuse outrée rentrée se cachant de plus en
plus sous plusieurs couches d'étoffes se cachant
le visage sur les photographies ou de temps à
autre le regard nu oui souligné par le trait du col
relevé sur la figure où cacher la bouche cacher
les joues cacher le nez dans le noir dessous nous
nous sommes rencontrés comme ça en ce huis-
clos à ciel ouvert le jardin tu m'as offert sur un
plateau un thé que je n'ai pas bu parce que mes
mains tremblaient je faisais des patiences avec
des cigarettes aux moments où tu t'absentais
pour un appel pour faire bouillir de l'eau pour le
thé il y avait du sucre roux celui que je préfère
le goût me venait dans la bouche comme
lorsqu'on voit un gâteau chez un pâtissier on en
a la saveur au palais son goût oui
tu appelais la maison « le château »
tu m'écrivais « rendez-vous au château, dimanche,
quatorze heure »
c'était le temps des murs le temps des enfermés
malgré eux je vivais à cent mètres de toi volets
fermés avec pour seule lumière l'écriture je
nageais dans une atmosphère de fumées
épaisses entendais chaque soir à vingt heure les
tambourinements des casseroles n'y participant
jamais car je pensais aux plus grandes heures du
totalitarisme des angoisses comme des
décharges électriques me tordant les boyaux et
je songeais déjà en une forme de rêverie à ce
que tu évoquais une après-midi dans le jardin
ton internement tu avais quinze ans peut-être et
tu te plaignais de douleurs au ventre personne
ne te croyait ta mère les médecins te prenaient
pour une folle et plus tard ils t'ont retiré trois
tumeurs « grosses comme des oranges » selon
tes mots à toi trois oranges malignes sorties de
ton ventre les enfants meurent ainsi à leur vie
d'enfant les jeux s'épuisent à force d'être joués à
dix ans j'ai décidé de devenir adulte en fait je
crois bien n'avoir jamais cru à l'enfance pas la
mienne en tout cas j'ai jeté mes jouets j'ai filé
rejoindre un ami en vélo mais que veux-tu
quelque chose s'est cassé avec l'os
et une fois seulement des années plus tard j'ai
osé poser ma main sur ton épaule t'embrassant
sur les joues et tu as fait céder ce que tu
considérais certainement comme une emprise un
geste déplacé d'un mouvement sec un Noli me
tangere et certainement ai-je appuyé trop fort
sur ton épaule moi qui ne maîtrise guère mes
élans émotions comme ils m'arrivent je n'ai pas
vu mon visage quand je t'ai dit « au-revoir »
mais plutôt un rictus sur le tien
ce jour-là ton regard dur m'a crucifié
au « château » je suis entré dans tes yeux ai
frôlé la pointe de ton regard me suis laissé
porter par lui l'instant d'après puis rejeter sur la
grève des bienheureux je t'écris depuis elle la
lumière coulait la lumière soudait il y avait des
murs d'ombres où penser tout bas des murs sur
lesquels crachaient les nues ils me roulaient me
ruinaient et un jour écrasé mal j'appellerai un
ami pour qu'il aille m'acheter des cigarettes
sortir je ne pourrai plus ce sera comme mourir
en tout aussi grand cette angoisse-là ce jour-là
depuis je travaille lentement à ma disparition
dans le corps du texte des amis viennent ils
repartent pour revenir ce n'est jamais la même
couleur non c'est le fond du ciel celui des îles de
l'intérieur d'un long regard embrassant l'horizon
c'est l'ange brun de nuit à cause d'un instant
dans tes yeux c'est l'aile légère éclose égalité de
par le monde ta voix au téléphone le vendredi le
dimanche ta voix me parle de son travail de sa
musique
moi j'entends battre tes paupières
ta voix au téléphone et il me faut recomposer
ton visage quand tu me parles toi là-bas moi ici
pas très loin du château tout compte fait toi
Paris son ciel baudelairien ses ciels lavés d'après
les pluies « la mélancolique lessive d'or du
couchant » sur le pont des Arts et puis un jour je
me suis perdu dans Paris perdu jusqu'à plus de
nom et dans l'oubli de mon propre visage oui
partout où je vais il me faut me dépouiller de
moi car je sais trop moi les nerfs les tendons les
veines la couleur rouge à l'intérieur oui un jour
j'ai vu le dedans de mon bras le gauche celui qui
n'écrit pas je me suis arrêté un temps au bord du
puits celui où l'on jetait les sorcières au Moyen-
Âge et j'ai regardé et je me suis penché pour
voir et j'ai vu le ciel et mon ombre en miroir
je me suis détaché de moi
je suis parti en laissant l'autre de moi au bord du
puits et quelque chose me dit que tu as eu un
puits où te pencher toi aussi que tu as également
vu le ciel et ton ombre posés là en miroir que tu
as commencé à marcher loin de ce que tu fus
dans l'oubli de ton nom dans l'éclipse de ton
visage t'es-tu mise pour autant à aimer tes rides
celles de ton nouveau visage je ne crois pas non
je ne crois pas or ce dont je suis sûr c'est que tu
vieillis avec toi une fois franchie l'épreuve du
puits épreuve commune à tous et sélective s'il en
est où une écrasante majorité de personnes n'y
voient qu'un puits un peu de ciel et un peu
d'ombre repartant tout de go afin de la dormir
cette vie infirme et attardée
et nous sommes de ceux qui marchent en avant
l'air a un fond d'une douceur déchirante j'écris
comme je suis entré dans tes yeux sur la pointe
des pieds je gagne sur le blanc ne dois pas faire
trop de bruits le grattement de la mine sur le
papier la nuit ne pas penser trop fort se
concentrer au maximum les experts en
télékinésie ont ce genre de méthodes les
télépathes aussi je suppose mais je n'entends
rien de ce à quoi tu penses et si je ne dis rien
c'est que je m'écoute rêver tout haut tous les
matins continuant le songe au réveil la
télépathie etc font la même chose j'imagine or
l'important n'est pas de tordre une cuillère par la
seule force de sa pensée ou de se faufiler dans
les pensées des autres mais bien d'établir une
grande paix autour de soi « les amis l'œuvre les
livres » un grand calme dans sa demeure et moi
qui ne suis ni télépathe ni expert en télékinésie
je sais ce que je sais l'amitié est un art une autre
forme d'amour plus serein plus beau en tout
puisqu'il n'y a pas le sexe pour la corrompre
cette amitié capitale (toi et moi) et que le simple
fait d'entendre ta voix au téléphone me comble
je me sens plein jeune et beau et tu dis des
choses qui me font rire ou sourire et tu ne sais
pas au téléphone quand je souris quand je me
tiens le front tu sais au clic du briquet quand
j'allume une cigarette pas si j'avais envie de
pleurer juste avant de t'appeler tu sais seulement
mon grand rire en rebond à certaines intonations
dans ta voix à un certain bagou chez toi alors
oui voici un grand rire un de l'esprit voilà nous
ne sommes en aucun cas aptes à tordre une
cuillère sans même la toucher mais cependant
nous sommes forts de cette Joie comme un
accord majeur
un piano pour enfants
et j'ai dû te le dire un matin au téléphone elle
était d'ombres bleues-blanches et toute lumière
et j'avais dix ans peut-être et elle est venue la
très-douce dans la chambre bleue avec sa robe
bleue et blanche et moi j'ouvrais les yeux
comme une fenêtre pour basculer vers une autre
aventure d'autres gens certains chapeautés
certains têtes nues certaines portant un fichu
d'autres en cheveux certains pour le jeu d'autres
pour le désarroi de plus en plus pour l'amour
tous dotés d'un cœur capable de passion et je
fixais le coin de ses lèvres la force de son regard
à elle j'étais tout à elle me rendant mes regards
avec des yeux douloureux mais me souriant
toujours d'un sourire triste en coin mais sourire
toujours il y eut comme un battement de cils elle
n'était plus là puis courir les élévations dans les
escaliers cette étrange sensation d'être
surnuméraire jusqu'à savoir où cacher ce secret
en ce cœur second qu'elle m'a donné là où
personne n'ira le chercher
écoute les battements de ton cœur dans la nuit
ne dis plus rien ne bouge plus ferme les yeux
ferme la nuit sens-tu battre ton cœur systole et
diastole et systole et diastole cette boucle aura-t-
elle une fin entends-tu ce silence entre systole et
diastole as-tu rencontré au moins un ange sur
ton chemin ou as-tu zigzagué avec et contre les
courants pour éviter les chiens de l'enfer à
l'indienne sans trop de bruit comme on parlerait
d'une nage comme un rayon peut émouvoir
parfois toujours par la diagonale et cette pensée
en mouvement j'en parlais déjà autre part tout ce
que nous n'avons ni marché ni couru durant le
jour nous le faisons la nuit dans nos rêves qui
nous agissent nous tuent nous ressuscitent dans
cette très vieille inconscience des êtres à eux-
mêmes alors oui dans ce sens je peux écrire
« nous sommes à nous-mêmes un puits sans eau
sans soleil pas une once d'ombre rien que cette
inconscience pour le moment reste à savoir
comment et dans quel état nous nous
réveillerons »
mais si tu viens viens avec toi
promis je ne poserai plus la main sur ton épaule
ne tenterai plus l'aubade