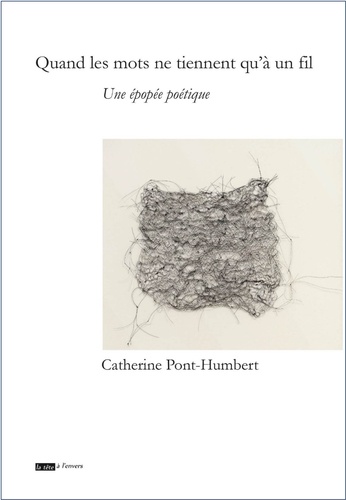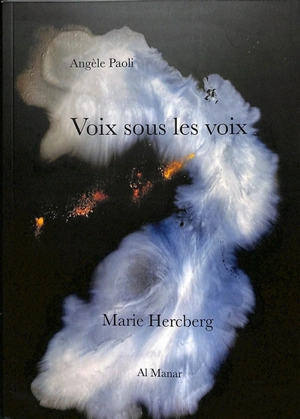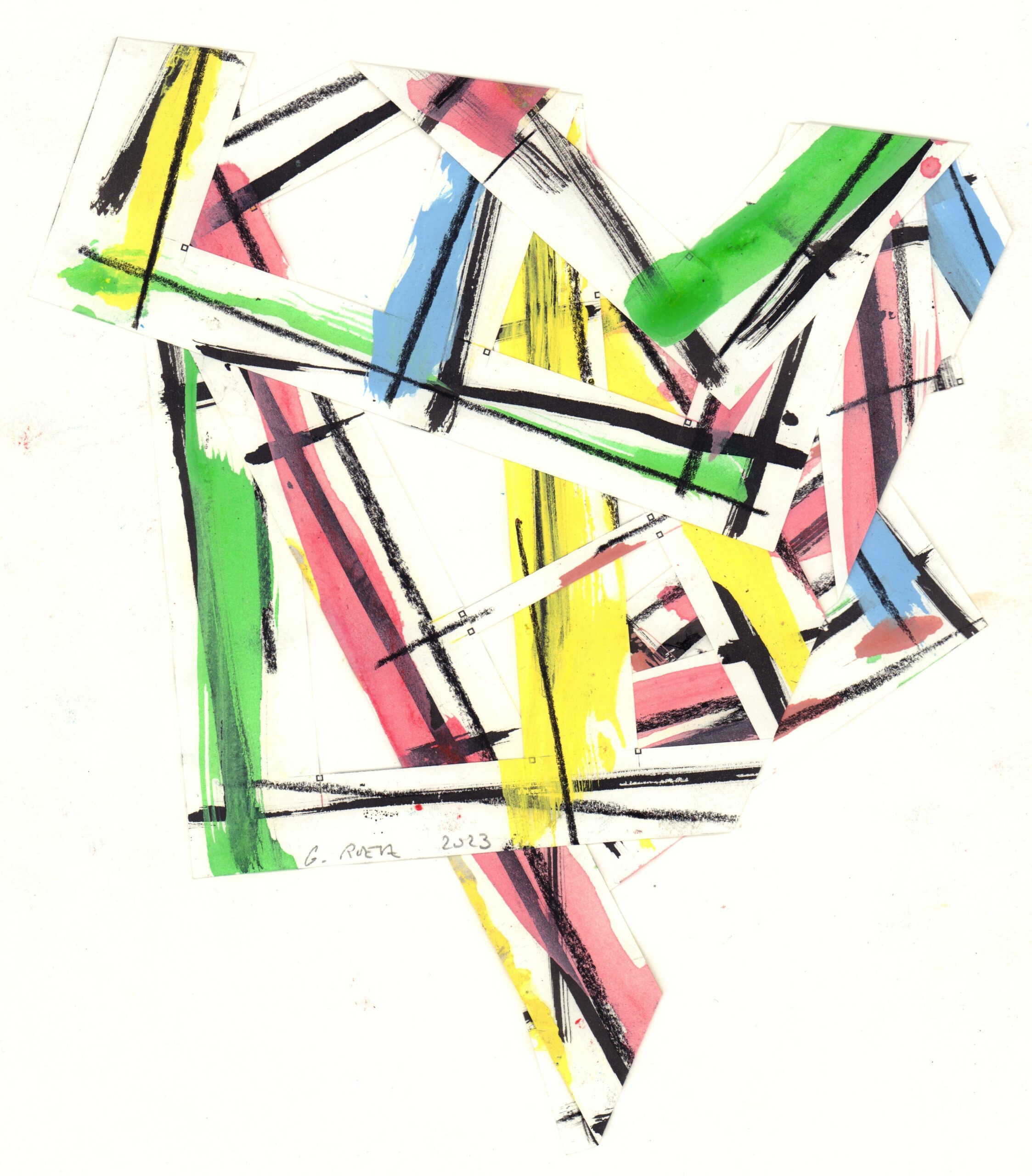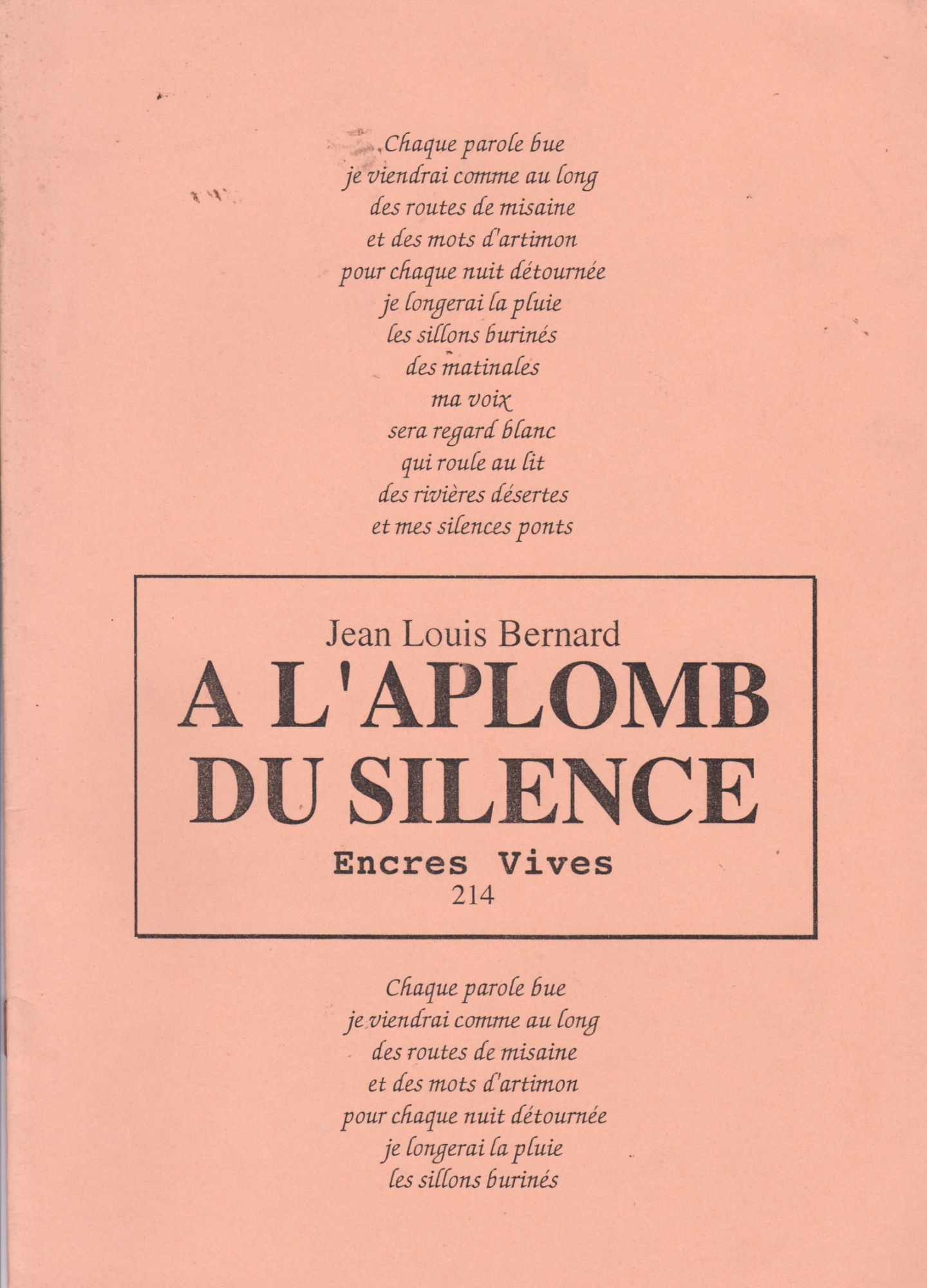La version complète de cet entretien réalisé par Mathieu Hilfiger publié en 2015 sur Recours au poème est paru aux éditions du Bateau Fantôme
Mathieu Hilfiger – Arpentant les multiples chemins de votre œuvre, je me suis dit que pour initier notre entretien, cher Jacques Réda, il serait propice de préciser un peu sa situation, non pas par rapport à je ne sais quelle histoire ou courant littéraire, mais vis-à-vis d’elle-même, précisément dans ce qu’elle peut dire du lieu et du besoin de se situer. En chemin, j’ai eu confirmation, je crois, que cette question était centrale chez vous, que l’exploration, le cheminement, parfois le voyage (je pense que vous le distinguerez quelque peu), bref le mouvement ou sa seule dynamique, constituaient proprement chez vous l’acte poétique, en tout cas le cœur de votre inspiration.
Avant de vous donner la parole, je m’en tiendrai donc à quelques considérations au sujet d’un recueil publié en 1982 chez Gallimard, intitulé Hors les murs. Mais j’aurais aussi bien pu évoquer d’autres œuvres, dont les titres seuls sont déjà révélateurs : Le sens de la marche, Ponts flottants, La course, Un voyage aux sources de la Seine, Recommandations aux promeneurs, Moyens de transport, etc., une large partie des autres évoquant directement des formes de voyage et de mouvement.
« Hors les murs » : de prime abord, le lecteur candide croit recevoir la promesse d’une escapade vivifiante hors de l’enceinte aliénante de la ville, extra muros, de son quotidien bruyant et répétitif. Mais les titres des premiers poèmes déçoivent immédiatement cette inopportune attente, ils désignent en effet des lieux de Paris, et non les plus propices au rêve : Javel, Bercy, Montparnasse, etc., en somme, des quartiers. Au lieu d’une fervente communion avec la nature, vous évoquez très directement les choses les plus indigentes d’une ville – boulevards, immeubles et autobus, stade, etc., et ses habitants le plus indigents. Notre lecteur candide se sent dupé, désorienté – pourtant, il ne sera pas longtemps déçu s’il consent à vous suivre plus avant.
Ce recueil présente le résultat de sortes de relevés topographiques méthodiques de lieux parcourus, essentiellement à Paris intra muros et à proximité (finalement on approche même la campagne). Or, tout relevé de ce genre nécessite une mesure – et celle-ci est ici celle du mètre de la versification – et des jalons – et ceux-ci sont ici les rimes ; mesures et jalons subjectifs qui se substituent aux balises qui emprisonnent l’espace infini que nous partageons tous et qui le marquent avec douceur et respect : « Non, l’espace n’arrive pas à comprendre pourquoi de toutes parts on s’acharne, c’est le mot, à le traquer et parquer en entrepôts […]. »[1] Aidées par une myriade d’images fortes et d’inventions facétieuses à chaque carrefour de vers, ces formes classiques que vous employez, à l’épreuve d’un réel apparemment aussi commun et mobile que celui de la vie et des rudes paysages urbains, produisent un étonnant contraste qui nous bouscule, avant qu’on finisse par ne plus percevoir ces « lieux communs » de la ville comme inutiles et mornes. Oui, ils s’animent, prennent place dans le jeu foisonnant du vivant d’où ils tirent eux aussi leur épingle métallique. La métaphore (ce mouvement, métaphora, que j’évoque) qui les dit, ou qu’ils redeviennent, leur rend une dignité que les poètes leur accordent rarement de bonne grâce. La plupart trouvent plutôt matière et joie dans le chatoiement de la campagne, où le mouvement vital de la nature serait plus aisément perceptible, ou plus authentique.
Faut-il un mouvement pour activer la mécanique poétique ? Ici, un mouvement nous porte de l’intérieur vers l’extérieur, intra puis extra muros, sans d’ailleurs qu’on puisse distinguer une prégnance supérieure. Oui, sans prendre garde à distinguer des hiérarchies, vous continuez à arpenter, n’excluant rien, considérant tout, et chemin faisant vous parlez de ce que peut signifier voyager, laisser son empreinte dans des lieux, inscrire ces rencontres dans son vécu, dans sa mémoire et son corps. Qu’en diriez-vous ?
À votre rythme, vous faites votre bonhomme de chemin, considérant que le chemin fait le bonhomme. Et tout cela en feignant la désinvolture ! Voici l’incipit de notre recueil : « La péniche, tiens, s’appelle Biche, vide elle avance la proue en l’air, doucement. »[2]. Quelques mots sur cette phrase. Celle-ci prend place dans un texte liminaire, « Deux vues de Javel », le seul en prose du recueil avec le texte final. Dès cette première phrase, vous êtes en route, actif, en mouvement ; nous vous accompagnant in medias res. Sommes-nous, comme vous ici, toujours déjà en chemin ? Mais il faut un moyen, mécanique ou non, pour se transporter, et c’est une péniche qui retient votre attention. Cette attention aux moyens de transport (je rappelle qu’un de vos livres porte précisément ce titre-là) qui ouvre le recueil n’est pas anodine, elle me paraît même déterminante pour comprendre votre œuvre. Cette péniche-ci n’est pas à quai, elle aussi a levé l’ancre pour se mouvoir, elle est en mouvement, peut-être sort-elle, comme vous bientôt, « hors des murs », peut-être quitte-t-elle doucement Paris par l’ouest (sûrement : elle part ventre vide de la ville)… Vous semblez vous arrêter à un détail incongru (le baptême un peu dérisoire d’un bateau) en baissant le regard vers le quai – mais là encore il n’en est rien. Le contraste entre le nom de l’animal sauvage traqué et le contexte urbain provoque une puissante évocation poétique. Les homonymes en noms propres ne le démentiraient pas (le thonier-dundee de 1934 et l’affluent de la Loue)… Cette « Biche » filant sur la Seine et sur sa rime avec « péniche », c’est une sorte de « rus in urbe », d’élément ou de vision de la nature dans le milieu urbain. Ce mot de « biche » annonce-t-il le voyage à venir, de la ville vers la campagne, de l’urbain vers le rustique ? Suggère-t-il de manière un peu dérisoire et comique l’absence de supplément ontologique de la « nature » vis-à-vis de la « culture », ou de l’incongruité de leur opposition ? Ou bien est-il simplement l’un de ces jalons parmi d’autres digne d’être retenu et inscrit dans votre carnet de voyage ?
Jacques Réda – La Biche : Je crois simplement avoir été retenu par ce nom de cervidé attribué à un type d’embarcation dont la vitesse et l’agilité ne sont pas les qualités principales. Ou y avoir reconnu un de ces termes affectueux que marins et mariniers emploient souvent pour baptiser leur propre moyen de transport sur les eaux. Tout comme il m’est arrivé de considérer mon deux-roues comme un vrai compagnon de route. Il me semble que dans ce texte, ou ailleurs, j’ai mentionné « un chaland baptisé Paulhan »[3], comme si son patron avait été un fervent lecteur des Fleurs de Tarbes. Ce sont un peu des manifestations du « hasard objectif » des surréalistes, et résultant d’une rencontre de deux cheminements subjectifs particuliers. « Paulhan » n’avait sans doute pas le même sens pour moi que pour le parrain de cette autre péniche.
Pour le reste, votre question porte sur le mouvement, et je la trouve si bien circonstanciée que vous semblez y avoir répondu pour moi.
Qu’il s’agisse de « mécanique poétique » ou de tout autre domaine, je crois que nous n’avons pas besoin de vouloir activer le mouvement : nous y sommes inclus et, resterions-nous parfaitement « en repos dans une chambre », nous continuerions de nous mouvoir dans le temps, pendant que la chambre elle-même, à son niveau, poursuivrait sa course dans l’espace avec la galaxie qui contient le système solaire qui contient notre planète – etc. Prendre conscience du mouvement et vouloir le gouverner d’une certaine manière n’ont à mon avis, et selon mon expérience, que deux motifs : ou tenter d’abolir l’espace, par exemple en allant plus vite que la lumière, et du même coup suspendre le temps (mais c’est une intention de nature prométhéenne tragique) ; ou – autant que faire se peut – accéder en quelque sorte au mouvement pur, au pignon central d’où se démultiplient tous les autres, par l’effet de relativité qui nous fait voir prodigieusement lente le déplacement vertigineusement rapide des étoiles. Disons le « la » fondamental de tout ce qui bouge et ne peut que bouger. Et parfois en effet la musique nous permet d’entrer dans ce chœur qui est en même temps quelque chose comme un progrès en suspens ou, si l’on préfère, le suspens qui avance. J’ai appris cela à l’école élémentaire des « riffs » de l’orchestre de Count Basie. L’univers me paraît à la fois une catastrophe incohérente et une danse jubilatoire réglée au moins provisoirement à la perfection. On peut s’y associer à peu de frais harmoniques et mélodiques, puisque l’élément rythmique y est déterminant. Le surcroît lyrique est notre contribution propre, la réponse de notre émerveillement, de notre désespoir ou de notre révolte. C’est pourquoi nous tentons de lui donner un élan qui réponde à la démesure des faits. Mais celle-ci peut rester perceptible dans la pratique d’une mesure qui figure celle qui les règle aussi, et y adhérer sans abandon ni refus pathétique de nos limites.
Ma prédilection pour l’emploi du vers régulier provient sans doute de cette façon de ressentir plutôt que de concevoir aussi extensivement que possible ce qui est. Et, peut-être, ce qui n’est pas, l’illusion n’étant au réel que ce que l’antimatière est à la matière. Donc le vers est une sorte de « riff » aux nuances rythmiques secondaires infiniment riches, et qui me donne au moins l’illusion de me glisser dans le mouvement d’une mesure souple et rigoureuse de tout. Même quand je ne fais que me rendre à la poste pour y expédier ma réponse à ce premier volet de notre entretien.
M. H. – Certes, nous évoluons toujours déjà in medias res, dans le cours incessant du fleuve (j’allais dire, de la Seine, à moins que ce ne soit le Nil[4]), ou plutôt nous sommes d’emblée partie prenante liquide de ce fleuve universel du mobilisme héraclitéen auquel vous faites parfois allusion, par exemple dans Battement[5] (mais je reviendrai sur cet ouvrage). D’ailleurs, nous le sommes dans les deux aspects de la phénoménalité : l’espace, donc, mais aussi – et vous faites bien de le rappeler – le temps, l’un n’étant que le mode de la présence de l’autre, qui lui a en quelque sorte donné lieu…
Mon intuition initiale, celle de la prégnance dans votre œuvre de la vibration du lieu en tant que mouvement et sonorité, a reçu dans votre première réponse non seulement une confirmation, mais une précision très intéressante, somme toute logique : l’écriture elle aussi ne saurait être générée hors de cette dynamique ; peut-être en est-elle aussi bien, simultanément, un moteur et un épiphénomène, un aspect de son procès autant qu’un résultat, une dunamis et une énérgéia. À ce titre, vous parlez, trop modestement je crois, de la « mécanique poétique ». Car il me semble que c’est tout le mouvement de votre écriture qui, par votre nature et votre écoute, bref votre personne, reçoit les bénéfices de cette mobilité universelle. Qu’en pensez-vous ? D’ailleurs, si cette tentative de « prise du poult » de notre monde, battant de la présence des êtres qui le constituent, se retrouve si farouchement dans votre œuvre, n’est-ce pas aussi celle de toute la littérature ?
Mais certes la poésie, dans son rapport musical à la langue (emploi du vers, de la rime, etc.) permet de mieux donner écho au rythme intime de « ce qui est » ; d’abord ces révolutions astrales que vous évoquez, puis les pas des promeneurs à qui vous avez voulu livrer votre riche expérience personnelle[6] et dévoiler là, et presque sans vers ni rimes, votre passion pour les voyages au sens le plus large. En est-il de même pour la musique ? Selon vous, cherche-t-elle comme la poésie à saisir ou à nous inscrire dans le mouvement perpétuel produit par le grand moteur à explosion de l’univers qui nous transporte, dans tous les sens du terme ? C’est bien : partant du lieu, nous évoquons le mouvement, et nous gagnons l’espace ; poursuivant dans cet espace, nous évoquons le temps et, ce faisant, le rythme.
J. R. – Comme la première, votre deuxième question me paraît si buissonnante que je ne sais trop par quel bout la prendre, et c’est très bien, car elle reflète vos propres interrogations. De sorte que nous nous entretenons de « quelque chose » qui nous est commun mais que nous abordons de deux différents points de vue. Qu’est-ce que c’est ? On en aura peut-être à la fin une idée. Causons toujours.
C’est vous qui avez employé le terme de « mécanique poétique », et je l’ai repris parce qu’il me semble approprié malgré son allure a priori rébarbative. En effet ce mécanisme n’exclut ni la fluidité ni l’aléatoire, à l’image de la mécanique quantique dont il est un aspect particulier.
Puisque nous sommes en tête à tête, et qu’aucun tiers ne risque d’accompagner mes propos d’un gloussement ironique ou d’un hoquet réprobateur, je vous dirai que cette affaire du temps et de l’espace relève pour moi du phénomène que j’appelle « battement ». Leur interdépendance a été rigoureusement démontrée, après un long flottement dans les catégories d’une théologie trinitaire qui prouve bien l’insuffisance d’un dualisme. L’Un ne peut être sans une conscience de soi qui le dédouble, mais ce dédoublement, qui n’est pas division, maintient étroitement le rapport de ce qu’il sépare, et constitue une troisième instance que la théologie nomme Esprit. Je ne le ravale pas en attribuant son rôle à la matière, car le processus qui s’enclenche à partir de l’évolution de la matière paraît la conduire à une sublimation. Autrement dit, la matière est en somme le témoin, le garant, de l’unité préservée de l’espace et du temps. La matière ou bien l’énergie, puisqu’a été établie l’équivalence des deux.
Est-ce que je déraille ? Oui, dans la mesure où ces majestueuses questions posées et, chacune à sa façon, plus ou moins résolues par la théologie et la physique, passent de beaucoup les réponses qu’y apporteraient mes petites excursions dans la banlieue parisienne. Mais je ne pense pas dérailler en estimant qu’il n’est rien de notre activité qui, en quelque mesure, ne reflète ce modèle fondamental du « battement ». Mais il faut dire que j’ai aussi un sens assez prononcé du comique, et que ce n’est pas non plus, au moins sans sourire, que je me vois circuler à bicyclette entre le chaos suburbain et les monuments de Thomas d’Aquin et d’Einstein…
Ah, et puis la musique : eh bien, c’est pareil. J’aime surtout Bach et les autres baroques, et Mozart, Chopin, Ravel. Mais on ne peut pas ignorer, tant je me suis appliqué à le mettre en évidence, le goût tout à fait particulier que j’ai pour le jazz. J’entends le jazz dit « classique » par ceux qui jugent que l’abandon de ce qui foncièrement le caractérise, autorise quand même des emplois abusifs de cette dénomination. Si vous l’estimez nécessaire, je reviendrai sur les motifs de cet intérêt. Il suffit peut-être pour l’instant de préciser que, sans du tout négliger le trait élémentaire de ses origines mélodiques (la pure et simple merveille humaine et pour ainsi dire algébrique du blues), il est pour l’essentiel rythmique. Et je me suis efforcé de montrer comment ce rythme est lui-même un reflet spécialement fidèle du « battement ». Presque une mise en gloire de ce phénomène, dont il capte à sa façon l’énergie afin de nous la communiquer, recharger en somme nos batteries, nous donner à la fois le sentiment de la célébrer et de nous soustraire, en dansant, au caporalisme de la gravitation universelle, voire à ce renversement de la « récession » que Hubble a découvert.
M. H. – Je m’entretenais hier soir[7] avec ma mère au sujet de la forme de dialogue que poursuit Kertész dans ses journaux, et des évolutions entre les différentes époques de ceux-ci[8]. Comme de nombreux écrivains, le romancier accompagne son quotidien de cette écriture diaristique (comme on dit aujourd’hui), il s’y livre, y énonce sa pensée et son opinion, s’y dénonce, etc., sans renoncer à cette forme de parole introspective ; pratique courante, mais où l’introspection – terme ô combien galvaudé – est à entendre à la lettre, comme un regard plongé dans la profondeur impénétrable du soi, toujours en quête de quelque chose, quelque chose de caché, mais dont il reste malgré tout (ou justement) l’intense sentiment de la présence derrière l’ombre des choses, objet a ou autre chose, je l’ignore… Ma mère m’a demandé pourquoi j’avais ce léger sourire aux lèvres après lui avoir répondu à ce sujet : j’aurais pu aussi parler de mon orgueil, mais je lui ai répondu que ma parole n’utilisait que le mode de la « pensée littéraire », question ou « scope » tournant avec souplesse et souci autour de son objet, qu’elle considérera jusqu’au bout ne pouvoir être certaine de connaître. Se rappelle-t-on que le scepticisme constitue une sorte de suspens du jugement permettant à la réflexion de s’épanouir, peut-être le seul rapport valable à la vérité subjective ?
Excusez, cher Jacques, cette digression un peu incongrue, mais là encore, je m’en tiens à cette manière d’avancer (puisqu’il semble que nous parlons du rythme, cette présence du mouvement), quitte à me priver de la garantie de progresser. C’est cette anecdote qui m’est venue là, à la lecture de votre réponse, dans laquelle vous évoquez avec beaucoup de subtilité ce « quelque chose » qui nous soucie positivement, qu’on ignore encore, mais qui semble nous être « commun ». Ti, quelle chose ? « Ti esti », qu’est-ce que c’est ? Ce serait magnifique d’en conclure que les poètes ont mieux compris Platon que les dignes philosophes…
Poursuivons donc avec notre méthode, elle est fragile mais bonne, nous le sentons réciproquement comme il se doit dans tout véritable dialogue.
Vous voyez, je vous prête même maladroitement mes propres mots (ceux de « mécanique poétique », que nous entendons pareillement) ! Ne rejetons ni les poètes, ni les philosophes, ni le jazz, ni le « classique », ni les banlieues, ni les campagnes, ni le métropolitain, ni Saint Thomas d’Aquin… Et puis, avec cet humour délicieux et impossible qui vous est propre, vous vous assurez qu’ « aucun tiers » ne viendra interrompre notre « tête à tête », avant de parler de « théologie trinitaire » ! Je ne sais encore qu’en penser. Recherchez-vous ou rejetez-vous le « tiers », la triade ? À moins que celui-ci doive être là, mais en creux, discret, bienveillante colombe descendant du ciel pour nous bénir de sa médiation, pour mieux dynamiser duel ou dialogue ? Et qu’est-ce que ce tiers ? Pourrait-il être ce « quelque chose » que j’ignore comment nommer, fatalement peut-être, ce ti qui serait l’essence conditionnant le sensible (Platon), ou cet objet a (Lacan), ou cet inframince (Duchamp), ou ce boson de Higgs, ou que sais-je encore ? Pourrait-il correspondre, dans votre pensée, à cette syncope dont la force semble perpétuer la mécanique de ce que vous appelez en effet le « battement » ? Faut-il trois pattes à l’homme pour qu’il y ait un –dia, pour qu’il avance ?
J. R. – Je dois vous avouer que je suis très sensible au vertige. Un jour où je circulais à pied, j’ai dû me résigner à faire de l’auto-stop pour traverser un pont sur la Loire. Même à Paris, quand il s’agit de passer d’une rive à l’autre, il m’arrive de choisir incommodément le Pont-Neuf dont la largeur permet de marcher à distance prudente du parapet. Cela pour dire que la substance de vos questions me donne un peu le vertige. En me penchant dessus, j’y découvre, dans votre réflexion et votre savoir, une ampleur, une profondeur et une allure du courant qui m’obligent, si je ne veux pas reculer trop vite, à me cramponner. À quoi ? Je n’ai aucune vraie culture philosophique, aucune conviction religieuse et ne suis pas même certain de posséder une identité. Donc le réflexe de me cramponner me met sous la main ce qui lui paraît le plus proche, le plus solide ou le plus familier, et c’est encore la question du trinitaire. Bien entendu, elle est un héritage de mon éducation catholique. Je ne sais pas si j’y ai jamais « cru ». Mais le bric et le broc dont ma petite spéculation s’est alimentée, m’a conduit à cet axiome (ou postulat ?) : l’Un me semble inconcevable sans une conscience de soi qui fatalement le dédouble, mais en le maintenant uni à soi par un rapport qui non moins nécessairement le fait trin (j’aime aussi ce mot parce qu’il m’amuse : le trin ou le train des choses – vers quelle destination, sur quels rails…).
Quel rapport avec la syncope ? Le fait qu’elle met en jeu deux éléments d’un rythme – le temps faible et le temps fort – et que simplement elle les inverse. Le faible devient le fort et vice versa, sans autre indication de solfège qu’une sorte de parenthèse horizontale entre deux notes et qui ne se ferme pas. Si bien que l’ordre de la durée s’en trouve lui-même modifié, puisque le temps fort précède normalement le faible, et qu’en tout cas se produit entre les deux un échange d’énergie immédiat et sans déperdition, un pur changement d’état de la « masse sonore » des deux notes, un pur transfert non moins garanti par une autre définition de la syncope en tant que prolongation du temps faible sur le temps fort. Or prolonger est une opération qui exige une certaine durée, ce qui semble contrevenir au principe d’un transfert immédiat. Pour me tirer d’affaire, je ne vois rien moins que la célèbre équation d’Einstein sur l’équivalence de la masse et de l’énergie, où intervient la notion de vitesse – celle de la lumière portée au carré – soit, si je compte bien, environ quatre-vingt-dix milliards de kilomètres à la seconde, et ça ne nous laisse pas le temps de dire ouf.
En somme, la syncope est aussi parfaitement insaisissable dans sa fonction que le lien qui unit les deux autres hypostases de la Trinité.[9] Il serait alors tentant d’élaborer toute une théorie à partir de ce modèle fondamental, et je pense l’avoir amorcée avec le concept du « battement ». Mais, Dieu merci, je ne dispose pas de l’équipement intellectuel qui risquerait de la rendre ridiculement dogmatique.
Ce n’est qu’une hypothèse « de travail », si tant est que le mot convienne à mon activité décousue. Et, de fait, je crois que l’on pourrait, trop facilement sans doute, retrouver le phénomène partout, y compris – vous avez raison – en physique où le fameux boson de Higgs a tenu longtemps ce rôle d’intermédiaire, bien que la découverte de sa « réalité » soulève en fin de compte presque autant de problèmes que lorsqu’il n’était que conjectural.
M. H. – Vous vous baignez très bien, soyez tranquille, dans ce fleuve où j’ai ajouté mon eau, mais dont le flux, sinon le lit, est d’abord vôtre. Et peut-être qu’en reculant sans toutefois être emportés par nos réflexions, nous parviendrons ensemble à une idée plus satisfaisante du mouvement, ce « quelque chose » qui n’est pas simple, mais plutôt multiple : à plusieurs temps, suspens et vitesse, rythmé, énergie produite par un moteur.
Vous posez bien modestement dans votre réponse certains linéaments d’une « théorie sensible » (j’utilise ce quasi oxymore à dessein, en vue de ma question) du mouvement – non, plus généralement encore, de l’être : une manière d’ontologie ou de « métaphysique » ancrée dans l’expérience sensible (une phénoménologie ? Presque une physique). Ontologie d’abord « héraclitéenne », en tout cas très empirique, à la fois proche et lointaine des Anciens (présocratiques et platoniciens). Loin d’être anodine, je crois que votre conception ontologique traverse votre œuvre, elle mériterait une étude à part entière.
Cependant, c’est certainement dans votre curieux (étrange et drôle) ouvrage intitulé Battement qu’on la trouve la mieux dessinée. J’avais promis d’y revenir. « Battement », c’est le terme clé (vous parlez de « concept ») de votre pensée et le nom que pourrait prendre cette doctrine – très personnelle, aussi hétérodoxe qu’elle n’est pas dogmatique, « hypothétique » comme vous dites. (Mais Platon n’a-t-il pas élaboré sa doctrine des formes intelligibles d’abord comme une hypothèse permettant de donner une norme absolue et stable pour fonder la possibilité de savoir – épistémologie –, et par suite de bien agir – éthique ?). Dans la première partie de ce texte surprenant, vous discutez (avec) ces métaphysiques grecques à la lumière d’expériences vécues et les rendez plus proches, du moins de notre représentation, déroulant sous une forme originale une sorte de doxographie : genre typiquement antique, qui chez vous devient divertissant et efficace. En effet, dans la digne assiette théorique moniste de Parménide, vous picorez et déposez votre graine, de même dans l’assiette mobiliste d’Héraclite ou celle, dualiste, d’Empédocle… Ne recherchez-vous pas « l’unité du battement », c’est-à-dire, d’une certaine façon, l’origine du rythme, dans une voie tierce ? Je vous livre également un mot de Quignard auquel vos réflexions m’ont amené à repenser, et qui devrait vous intéresser : « Je pose que le temps n’a pas trois dimensions. Il n’est que ce battement, ce va-et-vient. Il n’est que ce déchirement désorienté. Ce qui reste du fond du temps originaire dans l’homme est un battement à deux temps : perdu et imminent. »[10]
Ces Anciens se prennent eux aussi les pieds dans les filets joviaux de votre « empirisme sceptique ». Il me semble qu’ainsi vous recevez votre part de chacune de ces théories, que vous moulez à la mouture de votre goût, tout prêt à un usage pratique renouvelé… Plus qu’à Platon lui-même[11], c’est à Socrate que vous me faites penser (un Socrate à mobylette) : grand dialecticien l’air de rien, maniant une ironie feignant l’ignorance, poisson-torpille qui dynamise vos sens en vous engourdissant…
J. R. – On peut bien sûr, à tout propos, convoquer les plus vénérables figures de la pensée, et relier le fait le plus futile ou le plus banal aux plus majestueux objets de nos inquiétudes. Je ne m’en prive d’ailleurs pas. Mais j’apprécie que vous ne me compariez à Socrate qu’avec un moteur à deux temps, à la fois pour ménager ma modestie et rester dans le sujet, puisque le Temps lui-même est un phénomène à deux temps, comme la citation que vous empruntez à Quignard le précise. Elle dit aussi que le Temps a trois dimensions, ce qui se discute, parce que le passé n’existe plus, le futur pas encore, tandis que le présent que nous vivons demeure insaisissable. De ce point de vue le Temps n’existe pas. Et le présent ressemble beaucoup à la syncope qui relie les deux temps inversés d’un rythme, si j’appelle « faible » celui du futur (dans la mesure où il reste hypothétique), et « fort » celui du passé où, bien qu’à l’état de souvenir progressivement moins solide, nous trouvons un appui pour rebondir. Ce n’est donc qu’en devenant sans aucun délai du passé que le futur prend une consistance. Le « batteur » a toujours raison, de quelque nom qu’on l’appelle, et j’aime lui donner ceux de Jo Jones, Sam Woodyard ou Zutty Singleton. Platon, Parménide, Héraclite, Empédocle ou bien d’autres, je reconnais que je les cambriole plus que je n’écoute et médite leurs leçons, mais ma précipitation est due à une urgence, je pare au plus pressé. J’ai d’autre part cette conviction intime et que rien sérieusement ne fonde, que nous possédons le savoir absolu : il nous manque seulement une méthode pour y accéder. Le rythme en est une, mais elle nous confond avec lui et ne se prête pas à une objectivation intellectuelle qui jusqu’à présent nous en a plutôt séparés. C’est pourquoi je ne suis intéressé à la physique et à ses développements récents : ils semblent aller parfois dans le sens où je patine sur mon pauvre acquis.
M. H. – On voit bien que chez vous, cet intérêt central pour la mobilité ne doit pas être considéré simplement comme un goût prononcé et une curiosité pour l’évasion ou le voyage. Ce serait, là encore, réduire le vivre poétique à une dimension onirique ou « romantique » trop étroite. L’homme a en commun le transport. Transport comme moyens (ses jambes, ses mécaniques) ; transport comme élan d’enthousiasme le rapprochant d’un objet aimé (ex-altation) ; transport comme capacité imaginative à penser les choses (métaphore). Trois situations fondamentales auxquelles il faudrait sûrement celle du transport comme mesure harmonieuse (la musique) – excusez mon allant, tout ce jazz m’emporte à lancer une définition ; vous n’y êtes pas pour rien, revenant régulièrement à ce sujet de la musique, comme un batteur bat passionnément le rythme. Dans et avec ces situations, l’individu sort de lui-même pour mieux revenir à lui, à la fois plus dense et présent…
La question que vous posez à vos lecteurs, et, préalablement bien sûr, à vous-même, semble être de savoir si l’on va prendre position par rapport à cette mobilité universelle, si l’on va, oui ou non, décider de prendre le « train en marche » et participer au rythme écumant des choses. Oui, parfois il faut se lancer et chevaucher la Biche, se faire biche. Car les choses sont toujours déjà en mouvement, et l’animal immature que nous sommes a à se situer par rapport à cela. L’expression de cet infini mouvement naturel des choses, parce qu’il est distancié par la « raison », peut se nommer « événement ». C’est un terme que l’on retrouve souvent chez vous, par exemple dans votre roman policier L’affaire du Ramsès III. Pour enquêteur, vous mettez en scène un jeune historien, un peu veule, qui considère les événements avec la confortable distance rationnelle propre au scientifique. Par tempérament, il préfère considérer les événements à distance raisonnable, mais à y mieux regarder, sa relation à l’action est assez paradoxale : par exemple, il s’intéresse aux hommes entreprenants et prépare une thèse sur Bonaparte, homme d’action par excellence. Cet anti-héros choisi par le hasard (encore que) est conduit à se positionner vis-à-vis d’événements qu’il considère de prime abord tout à fait extérieurs à sa personne.
Cependant, il va trouver dans sa libido (son attirance pour une jeune femme séduisante et intrigante) le moteur qu’il lui faut pour passer à l’acte, entrer en mouvement, activer son « –dia ». Peut-être retrouve-t-on ici le tiers si nécessaire de tout à l’heure ? Vous écrivez : « […] alors que mon vœu le plus profond était de m’endormir aussi paisiblement qu’à Auxonne en contemplant l’image du navire (mais cette fois j’étais aussi dedans) […]. »[12]. Voici notre homme dans le navire et plus seulement hors de lui, à regarder de la rive la biche rejoindre sans lui sa vie aventureuse… Nous allons suivre avec plaisir ses aventures, car il ne sera pas lâche, alors même qu’au gré des dangers, on aura envie de répéter comme Géronte : « mais que diable allait-il faire dans cette galère ? »
Là encore : il faut un moyen pour se déplacer. Il suffit de peu pour vivre des choses, finalement. Un petit encouragement du désir, une parenthèse autour de ses scrupules objectifs, pourtant solidifiés par le leurre de la mauvaise foi (« Mais je suis homme à préférer, aux démarches laborieuses et aux paperasses que suppose un dédit même avantageux, le saut vers l’inconnu que représente une obstination déraisonnable »[13]). Et de spectateur, on devient acteur ; de la chambre, on entre en scène. La même gravure se retrouve ainsi, simplement retournée, à l’envers, dans la chambre de l’hôtel prête à l’usage et dans la cabine du navire où se joue l’action. Au début du roman, le héros déclare : « J’ai souvent été inventé par les événements. » Il s’est laissé aller au gré des flots ; mais l’histoire raconte précisément cet événement-ci, que cet homme plutôt passif donne un coup de pouce à son destin ; et à la fin, peut-être ne ferait-il plus la même déclaration.
Enfin, vous concluez votre roman avec une allusion au courant héraclitéen des événements, semblant nous dire que l’on peut (plus ou moins) décider d’y tremper le pied : « Mais je m’étais replacé dans le courant du fleuve qui arrose une Égypte intérieure à l’abri des touristes et des pilleurs de sépulture. »[14], posant l’expérience authentique (cette « Égypte intérieure » qu’est la vallée du soi) en opposition avec l’expérience artificielle et brutalement arythmique des profanes et des profanateurs…
J. R. – C’est pourtant vrai que j’ai écrit ce petit roman qui parodie l’un des plus connus d’Agatha Christie. Je me demande encore pourquoi. Peut-être à cause d’un bref séjour à Auxonne, où j’ai tâché d’imaginer ce qu’ont pu y être les rêveries du futur empereur. Et sûrement pour servir de cadre à certaines scènes qui me trottaient dans la tête depuis longtemps, et dont je ne comprends pas mieux maintenant quels peuvent être le sens et la provenance. Cela m’arrive assez souvent et m’incite à supposer que nos « moi » ne sont pas toujours aussi étanches et structurés que nous l’imaginons.
Partout et sans arrêt, des images, qui peuvent s’organiser en scènes de ce genre, s’échappent de tel ou tel cerveau où elles ne se sentent pas à leur aise, et cherchent un refuge dans un autre cerveau où elles comptent la trouver. Comme en rêve, il en va peut-être ainsi de tout ce qui, nous hante et que nous jugeons le plus personnel, mais simplement parce que nous nous sommes accoutumés à elles. Au lieu de les laisser se naturaliser progressivement, je les ai mises à contribution et m’en suis débarrassé dans cette histoire assez loufoque (on ignore en général que Pierre Dac a été mon premier vrai lecteur, voici près de quatre-vingts années). Je n’ai pas relu L’affaire du Ramsès III qui n’en a qu’une douzaine, et j’admire la façon dont vous l’analysez. Elle prouve le contraire de ce que je disais tout à l’heure à propos du caractère évasif de nos « moi ». Et les contradictions prouvent toujours quelque chose ou, au moins, qu’on a presque toujours tort d’affirmer ou de nier – deux faces de la même attitude. Car la réalité se révèle et se dérobe à la fois dans le rapport – d’union ou de séparation – qui existe entre les deux termes contradictoires. Si peu sérieux que soit le Ramsès, il y a du sérieux au fond de cette affaire, la seule question restant de savoir s’il est convenable de traiter avec frivolité le sérieux, comme si au fond il en manquait lui-même. Parce qu’il n’y aurait de fond à rien. Dès lors un événement en vaudrait un autre. Il ne reste plus alors qu’à danser, puisque, faute de fondement, subsiste quand même un rythme dont les différents tempos se superposent d’une façon qu’on a cru longtemps stable et harmonieuse. On ne peut que ressaisir ce qu’ont peut-être en commun les phases diverses d’un détraquement qui, de manière fugitive, a dû connaître celle d’un équilibre parfait. Le ressaisir quelquefois à l’état sauvage pour ainsi dire, par exemple dans un paysage ou un ciel nuageux ; ou – voulu – dans la structure d’œuvres d’art d’ambitions inégales : un silo à grains et une cathédrale, un graffiti et une toile de Poussin, le blues et un choral de Bach, une contre-rime de Toulet et la terza rima de Dante. Electivement enfin pour moi ce battement, propre au jazz, qui – d’une simple glissade syncopée – a transformé le pas de notre marche, si aisément caporalisable, en libre et jubilant accord avec ce point où la nécessité a connu elle-même une résolution du conflit entre le suspens et le mouvement. Ça ne dure en général que deux ou trois minutes, bien sûr, mais on peut toujours (ou en tout cas longtemps) faire repartir le disque…
Je me demande si vous ne vous montrez pas quelquefois trop subtil. Mais je respecte trop Héraclite pour lui refuser de monter à bord du Ramsès III. Et il est probable que tout le fret qu’on a embarqué en cabotant ici et là, occasionnellement en fraude, fermente dans les cales et en laisse des émanations monter jusqu’au pont de la première classe. Je me souviens que l’éditeur de ce petit roman avait choisi de le présenter sous cette bande : « un bateau ivre ». Rimbaud rejoint Héraclite, et le Nil l’indistinction des fleuves impassibles. Qui a raison ? Laissons-les en discuter ensemble.
M. H. – Retrouve-t-on dans ces œuvres si diverses, dans un poème, ou pour vous par préférence dans le jazz, ce « quelque chose » que nous essayons vainement de saisir, et qui, dites-vous, leur est cependant « commun » ? S’agit-il d’autant de tentatives impossibles de capturer (ressentir) dans la coulisse de l’être cet événement sauvage qui met toutes choses en mouvement, ou les fait apparaître présentes dans notre existence ?
J. R. – C’est parce que j’avais l’impression d’avoir déjà, d’une façon ou d’une autre, répondu à cette question, que je suis resté muet. Mais vous êtes un inquisiteur intraitable. Il est vrai qu’il s’agit du Saint-Esprit. Ou de la syncope ou, en effet, du boson de Higgs, particule intermédiaire. C’est le mot. En théologie orthodoxe (pas au sens d’Athènes ou de Moscou), l’Esprit est bien l’hypostase intermédiaire entre le Père et le Fils. Vous retrouverez cette configuration dans quantité d’opérations de physique, de chimie, de logique, de musique et de la vie courante. Même l’athée le plus convaincu agit et pense selon ce mode trinitaire.
Cet entretien a été réalisé entre fin décembre 2014 et mars 2015. Sa version complète est à paraître aux éditions du Bateau Fantôme
[4] Cf. L’affaire du Ramsès III.
[6] Cf. Recommandations aux promeneurs.
[8] Un autre (1999), Journal de galère (2010), Sauvegarde (2012), et récemment L’Ultime Auberge (2015).
[9] À quoi il convient d’ajouter que, dans la rythmique du jazz, chaque temps se décompose lui-même en un triolet symptomatique…
[11] À la lecture de votre réponse, je repense cependant à ce passage cosmologique du Timée (37d), où le temps de l’âme, qui scande le rythme du monde, se retrouve tendu entre le mouvement sensible des astres (multiples) et l’immobilité de l’éternité (une) : le temps sera ainsi « une image mobile de l’éternité ».
[12] L’affaire du Ramsès III, p. 33.
[14] Ibid., p. 86, avant-dernière phrase.