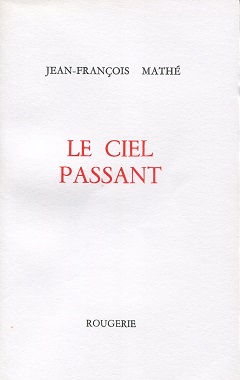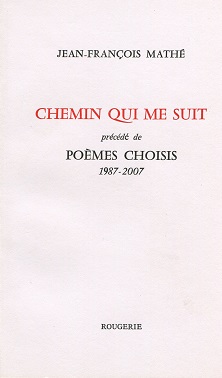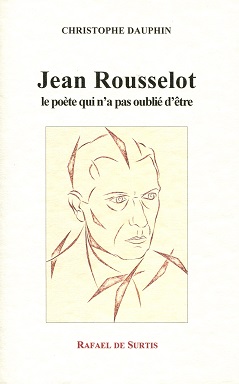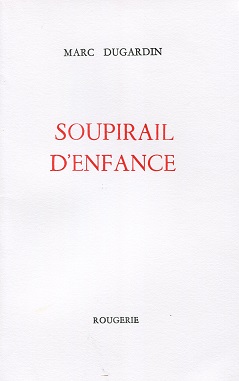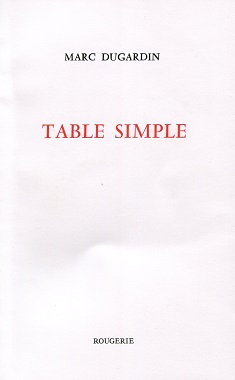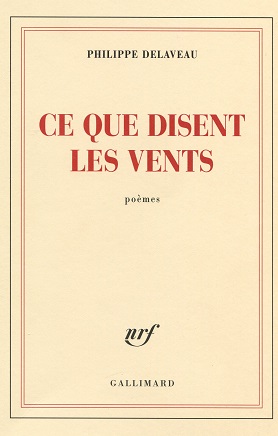Martin Harrison
traduit et présenté par Marilyne Bertoncini
Martin Harrison, brillant poète-philosophe australien et enseignant révéré, était sur le point de publier un nouveau recueil, intitulé Happiness, quand il est mort d'une crise cardiaque, à 65 ans, le 6 septembre 2014 - j'attendais le dernier retour de notre manuscrit, Rainbow Snake - Serpent-Arc-en-ciel , que publie Recours au Poème éditeurs en 2015. Je n'ai rencontré Martin Harrison que trois fois, lors de séjours qu'il fit en Europe ou en Tunisie – la première en 2008, je crois, alors qu'il était en résidence d'écriture à Paris. J'avais commencé à traduire ses poèmes pour la revue franco-anglaise La Traductière, et Il avait alors fait le déplacement sur Nice pour me rencontrer. Il est par la suite revenu, et un projet de publication est né. Quant il est mort, j'ignorais qu'il était désormais, ainsi que le décrit Martin Aitken, sur un fauteuil roulant : son enthousiasme, sa bonne humeur communicative me laissaient espérer de pouvoir lui faire visiter la chapelle Matisse à Vence, que nous n'avions pu voir lors des précédents séjours : grand connaisseur de peinture, il adorait ce peintre et expliquait merveilleusement son rapport à la culture aborigène... Jamais dans ses courriels il ne m'avait laissé deviner son état réel. C'était un homme charmant, chaleureux, attentif, d'une très grande ouverture d'esprit et de grande culture, et d'une extrême simplicité. J'ai le souvenir de promenades le long de la plage en hiver, de visites chez les antiquaires, d'échanges sur ses poèmes ou sur la poésie française, de repas "en famille"... Au cours de ces huit années où nous avons échangé à propos de notre recueil bilingue s'est tissée une correspondance au long cours entrecoupée de vides dont je comprends désormais la cause, de son côté . Chacune de ses lettres était précise, détaillée, pleine d'enseignements et d'encouragements – j'ai appris beaucoup - sur l'Australie, la poésie, et moi-même, à travers ce travail avec Martin, dont l'énergie nous avait fait envisager, dans la foulée, une anthologie de la poésie contemporaine australienne, qu'il me faudrait poursuivre seule...
Quand son assistant, Nick Keys, m'a annoncé sa mort, pour moi complétement bouleversante, il m'a précisé ceci, qui m'a profondément touchée et, étrangement, rassurée : "Je suis très triste de devoir vous écrire pour vous informer que Martin Harrison est décédé ce week-end. Il est mort d'une crise cardiaque dans sa voiture, le long de la rivière Hawkesbury. Quelques jours avant, en revenant de chez Martin pour rentrer en ville, j'ai vu un arc-en-ciel au-dessus de la Hawkesbury (...)" -
Marilyne Bertoncini – février 2015
note – L'interview de Martin Harrison par Adam Aitken[i] présente un regard personnel et intéressant sur la poésie australienne et contemporaine. Elle est précédée d'un bref texte qui la resitue dans son contexte. Les dimensions du "pays" Australie – île et continent à fois - la variété extrême de ses paysages, et de sa faune, des cultures, locales ou immigrées (d'Europe, d'Asie...) en différentes époques, les influences artistiques ou politiques, au cours des siècles, et le souci permanent, dans un pays-continent relativement jeune, de créer une culture nationale commune, intégrant désormais la population autochtone, longtemps méprisée, rendaient nécessaires quelques notes de fin de texte, sur les poètes australiens ou les courants littéraires cités.
***
J'ai rencontré Martin Harrison pour la première fois en 1985, à Newton, New South Wales. J'étais étudiant et apprenti poète à l'université de Sidney, et nous étions voisins. Je traînais avec un groupe de poètes qui se réunissaient à l'hôtel Courthouse, sur Australia Street, à quelques pâtés de maison au nord de chez Martin, un groupe constitué par John Forbes, John Tranter, Pam Brown, Gig Ryan, Laurie Duggan, Dipti Saravanamuttu, Jan Harry, Joanne Burns, Rae Desmond Jones, and Chris Mansell[ii].... parmi d'autres. Martin appartenait à la scène littéraire, mais ça ne me rebutait pas parce que je le trouvais immensément intelligent, chaleureux, spirituel, et il soutenait les jeunes poètes.
Douze ans plus tard, Cordite Review m'a demandé d'interviewer Martin chez lui, dans son appartement de Darlinghurst. A cette époque, j'avais déménagé à Wollombi, à deux heures de route au nord de Sidney. Son second livre, The Kangaroo Farm, venait de sortir chez Robert Adamson et Juno Femes Paper Bark Press et j'avais été frappé par la façon dont ce livre entrait en résonnance avec les discussions que nous avions entre poètes à cette époque. Martin était alors au département d'écriture créative de l'université de technologie de Sidney. Sur la demande de Cordite, j'ai cherché à le rencontrer pour l'interviewer. Il fut enthousiaste. Je ne pouvais pas le savoir alors, mais j'allais étudier à l'UTS de 2000 à 2004, puis y être employé comme lecteur – et même enseigner avec Martin pendant un ou deux semestres. Je l'ai rencontré régulièrement jusqu'à sa mort en septembre 2014.
La dernière fois que j'ai vu Martin, la faculté d'art était en crise, sa santé très mauvaise, il était cloué en fauteuil roulant, mais continuait à s'inquiéter pour ses doctorants. La faculté de l'UTS était en pleine tourmente financière. Il était, malgré tout, incroyablement chaleureux. Ses derniers mots furent des conseils – il m'a dit de rester là, qu'il y aurait toujours du travail pour moi à l'UTS. Ce fut extrêmement important pour moi.
J'ai assisté au service funèbre en mémoire de Martin au NSW Writers Center le 14 septembre ; incapable de dormir cette nuit-là, je me suis rappelé l'interview... Je l'ai cherchée sur internet et l'ai retrouvée, archivée sur Pandora. En la relisant, j'ai été frappé par sa fraîcheur, son enthousiame débordant et les opinions justifiées (avec une touche de polémique) caractéristiques de Martin. Il pouvait parler de poésie à très haut niveau technique, et appliquer sa vaste connaissance des langues, de la peinture, du son, de la science et de la philosophie moderne à une poétique plutôt romantique, d'un mysticisme vitaliste et transcendental. L'oeuvre de Martin penchait vers celles de Les Murray et Robert Gray[iii], poètes qu'il respectait, mais enracinée dans un autre type de vie cosmopolite, dans la sensualité et la matière, dans l'expérience d'émotion et de perception délivrées de la poétique nationaliste australienne... toutes choses qui font sens pour moi. Je dois admettre qu'en 1997, j'ignorais tout de son intérêt pour l'écopoétique, c'est pourquoi il est intéressant aujourd'hui de réfléchir au chemin parcouru par la poésie de Martin et les poétiques australiennes depuis cette interview. Il me semblait à l'époque qu'il critiquait ma position poétique, mais cela ne faisait que rendre nos échanges plus intéressants. Au moins, pour Martin, cela devait être "intéressant".
C'est l'un de deux seules interviews publiées de Martin Harrison, ce qui est contradictoire pour un poète qui aimait parler. Ce qui suit est une version abrégée, publiée, de notre conversation enregistée avec un Walkman Sony.
Adam Aitken, Sydney, 14 September 2014
***
Adam Aïtken - Comment votre travail à la radio a-t-il influencé votre poétique?
Martin Harrison – L'électronique et les médias m'ont toujours passionné, et j'ai aussi su, très tôt, que j'aurais travaillé à la radio – dans ma vie, c'est relié à plein de choses venues de l'enfance : la radio est souvent une expérience enfantine pour les gens. C'est là que commence votre amour des choses. Et puis, je crois que l'écriture n'existe pas seulement pour la page. On écrit aussi pour des films et la télévision ou d'autres sortes de média. C'est une part de l'environnement dans lequel je vis.
AA – Vous semblez utiliser les images de façon linéaire, comme le ferait la télé.
MH – Oui, je m'efforce d'écrire une poésie qui vive dans ce monde où l'on regarde la télé, écoute la radio, va au cinéma. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce que signifie l'image poétique de nos jours : il faut repenser à chaque génération la définition classique d'Horace – pictoria poesis. Je voudrais que mon oeuvre coexiste avec les canaux de perception contemporains. Je m'intéresse au type de détail procuré par un appareil photo avec lequel l'écrivain est familier. Prenez un lieu, une scène ou un personnage : il y a quelque chose dans la façon dont les images rendent compte de cet objet, et dans la façon dont l'attention s'attarde sur ce qui est produit par l'image. Ça définit une sensibilité contemporaine. J'aime ce type d'attention.
AA – On pense en général que l'influence de la radio et de la télévision sur la poésie est un phénomène récent, mais en fait, dans votre oeuvre, vous devez beaucoup à l'esthétique de Roland Robinson[iv]. Il soutient : 'L'important est de continuer à bouger". Je pense à votre poème "La lune contemplée dans le crépuscule sorrentin". Vous écrivez "la lune perceuse", "lune de savoir éternel", et vous écrivez aussi que "tout, là, était à l'opposé de ce que je sentais". De quelle façon ces idées trouvent-elles origine dans la poésie de Roland Robinson?
MH : Je voulais écrire une élégie pour Roland ; Il a publié certains de mes premiers poèmes. J'admirais son travail et je l'aimais beaucoup. C'était essentiellement un humain profondément généreux... un homme avec une mémoire et une énergie exceptionnelles. C'était quelqu'un qui, de façon subtile, vous faisait changer d'avis sur la nature de l'expérience locale. Dans ce poème, je voulais faire ressortir la matière sonore du travail de Roland. Je regrette de n'avoir jamais pu l'enregistrer, comme nous maintenant, et de conserver sa conversation. Il passait de la conversation à la poésie et de la poésie à la conversation. Il a passé beaucoup de temps à voyager à travers toute la Nouvelle Galles du Sud, sur les côtes nord et sud, et dans certaines zones intérienres – pendant et après la guerre, il voyageait et rencontrait surtout les populations locales aborigènes, et il écrivait leurs histoires.
AA – D'une certaine façon, dans votre poésie, le "Je "– le poète – fait un pélerinage dans différents paysages – une apparence de pastorale– mais différente des pastorales de David Campbell[v]. Quel sens donnez-vous au fait d'écrire le paysage australien comme un effilochement des mythes plutôt qu'un renforcement du fossé entre ville et campagne?
MH – Cette dialectique n'a plus de sens. Je ne nie pas l'existence de différences régionales en Australie, les citadins les sous-estiment. Les habitants des villes se représentent très mal l'image qu'on en a dans certaines zones du Bush. C'est vrai. Je n'ai pas l'intention de discuter pour savoir si le pays est une sorte d'espace idyllique. Ce qui m'intéresse, c'est d'en parler comme d'une invention technologique autant que d'une invention de l'espace urbain. Cet aspect est constamment sous-estimé, on n'en comprend pas l'importance. Il me semble que dans ce pays, il faut avoir un sens de l'espace sur plusieurs dimensions. Je sais que ça peut être très dérangeant, parce que l'attachement et la mémoire ont plusieurs niveaux, mais pas comme si plusieurs histoires se déroulaient parallèlement. Je veux dire que votre attachement à une maison, une pièce, un point de vue est vôtre, et il résonne d'une infinité de façons. Mais c'est un peu différent de ce que je veux exprimer, en disant qu'il faut avoir d'une certaine manière cette double vision des espaces et des lieux. Ils appartiennent à des histoires multiples – ils appartiennent à des histoires aborigènes, des histoires de pionniers, des histoires contemporaines etc. Il faut parfois rassembler tous ces aspects, c'est pourquoi j'essaie de conserver ouverte cette possibilité dans les poèmes.
Vous mentionnez l'élégie à Roland Robinson. C'est l'une des raisons pour lesquelles la lune devenait importante dans ce poème. J'essayais de dire une version de la lune. Une version aborigène en quelque sorte. J'essaie de faire tenir deux lunes dans cette histoire – la lune de Diane et la lune des réincarnations qui apparaît dans un grand nombre (mais pas toutes) d'histoires aborigènes de la lune.
Je ne crois pas que je puisse écrire pour tout le monde. Je ne crois pas à la notion de "coeur" de l'écriture, ou de coeur du pays, ou d'un sens de la terre. J'essaie d'écrire une poésie proche de la personne que je suis – je suis essentiellement un européen-australien. Mais, j'essaie d'écrire une poésie que tout le monde, en particulier les indigènes australiens, pourraient lire sans la ressentir comme un travail de colonisation. Et ce pourrait être l'une des différences entre nombre des poésies pastorales que j'ai lues par le passé et que j'admire, et ce que je voudrais faire dans The Kangaroo Farm.
AA : j'aimerais parler de votre version de "Australia" de A.D Hope[vi]. Vous avez réécrit Hope, vous l'avez critiqué, mais on sent aussi de la sympathie pour son poème.
MH – Je suis un grand admirateur de ses poèmes. C'est l'un des poèmes plus les politiques les plus pointus qui ait jamais été écrits. Mais de toute évidence, d'un point de vue contemporain, c'est un poème qui semble écrit par quelqu'un qui se tient toujours dans un espace virtuel, dessinant la carte du pays de l'extérieur. L'ensemble des figures de style tourne autour de l'idée d'aller "là-bas", dans cet espace étranger, et du plaisir de pouvoir en revenir. On peut se demander où exactement Hope doit-il revenir? Il revient à un espace imaginaire et philosophique. L'autre, le troisième pays, ni ici ni là. Mon poème n'est pas seulement une parodie du sien, j'ai essayé de le resituer, littéralement, je suis monté en avion comme une sorte de critique d'art intellectuel, qui réfléchit à l'aspect abstrait du paysage survolé, se demandant si on peu observer la nature en Australie avec un regard réaliste selon la tradition – si ça peut signifier quoi que ce soit.
AA – Le poème "Australia" est tout à fait une vue aérienne. Vous rendez hommage aux peintres des années soixante. Dans le poème 'Rice Fields near Griffith", vous choisissez une vue au ras du sol, mais la vue aérienne du paysage est celle des Aborigènes , et vous jouez avec.
MH – Oui, en fait, mes propres voyages dans les régions visitées par les peintres des antipodes m'ont donné un sentiment tout à fait différent du pays. Et la raison pour laquelle ils avaient décidé de le voir depuis les airs m'a laissé perplexe. Il m'a fallu du temps pour comprendre que leur façon de voir le pays était aussi artificielle que n'importe quelle autre, et qu'elle était aussi influencée par les tendances internationales de la peinture, les aplats, l'abstraction, que par tout ce qu'on peut rencontrer.
AA – Pour revenir au poème "Australia", vous écrivez "un réaliste ne le verrait pas ainsi", ce qui m'étonne, parce que vos poèmes sont pleins de détails précis - mais vous ne vous considéreriez pas comme un réaliste.
MH – En effet. Le poème est écrit pour Robert Gray[vii], qui se considérait lui-même comme une personne intéressée par le monde objectif et une certaine forme de réalisme. Je me disais, voyons, il y a tant de choses qui ne semblent pas pouvoir entrer dans ces catégories. Il faut trouver les façons les plus bizarres et les plus extraordinaires de parler de ce qui se passe littéralement sous nos yeux. J'en parle comme de "la perspective singulière des voyages du Xxème siècle" Je ne dis pas que cette façon de regarder les choses soit meilleures ou pire, mais il faut en tenir compte. J'ai toujours un problème quand on laisse de côté les "évidences", comme la façon dont on voit les choses en bougeant, ou le fait que l'on porte aux choses cette attention qui s'attarde sur les détails, tout en étant extrêment rapide. D'autres formes d'images venant de la télé ou du cinéma influencent aussi notre perception. On ne voit pas le monde comme ceux qui vivent dans une culture de peinture ou d'image imprimée essentiellement statique.
Se pose aussi la question de dire avec exactitude ce qui est devant vous, depuis le mouvement jusqu'aux relations spatiales, aux rapports de taille, ce qui existe dans ce pays n'existe nulle part ailleurs. C'est totalement spécifique. Chaque endroit est fondamentalement différent et il faut apprendre à voir les choses.
AA – Vos poèmes semblent se délecter des faits liés aux lieux – particulièrement de la sécheresse du paysage australien, ce que les poètes australiens trouvent difficile à faire, puisqu'ils ont un certain idéal européen du paysage. Dans la série de poème "Icons", et particulièrement dans le poème "Prodigal Son", un fermier revient pour constater l'état de décadence du pays, et vous concluez le poème par "désaveuglé, il vit l'endroit de nouveau".
MH – Il y a quelques années, j'ai commencé à être très affecté par l'état du pays. Dans ce poème, le fait d'être en mesure de voir de nouveau pour la première fois était donné, non pas comme quelque chose de différent, mais comme une chose nouvelle. C'est un sentiment de renaissance. Et ce n'est pas nécessairement lié à la nature.
AA – Dans le quatrième poème de la série, 'Portrait d'un vrai républicain", vous utilisez "vrai" de façon ironique, et la voix me semble nostalgique ; le poème ne défend rien d'aussi moderne qu'une république australienne.
MH – Le mot "vrai" est à la fois ironique et le contraire. Ce n'est évidemment pas un poème "républicain". Et c'est intéressant de remarquer combien peu de poèmes républicains ont été écrits, en dépit de tout les discours sur la république. Mon poème républicain parle de la nature de la mémoire, de la façon dont les souvenirs viennent de votre parcours passé et à venir. Ainsi, quoi que ce qu'une république puisse être, elle devra être fondée sur une réelle ouverture à nos souvenirs. On ne va pas parler de l'invention d'une république australienne idyllique, mais de ce que nous chérissons personnellement. C'est ce qui parle de mémoire qui est nécessaire à une république.
AA – Le titre au départ était "Le Bestiaire". Je me souviens d'une de vos lectures de l'un de vos "poèmes-animaux" – je me souviens en particulier de 'L'Ornythorinque". En présentant ce poème, vous aviez mentionné "Le Bestiaire" comme un titre possible.
MH – "Le Bestiaire" était le titre prévu pour une séquence de poèmes, pas le livre complet – mais j'ai décidé que je ne voulais pas d'un poème-titre. Je voulais que l'ensemble du livre soit La Ferme du Kangourou.
AA – "L'Ornythorinque "est un poème important de ce livre. C'est la quintessence de l'animal australien adapté à son environnement. Vous dites "l'ornythorinque combine des mondes par la métaphore de pouvoir faire plusieurs choses" , je l'ai vu comme une représentation en abyme de votre poésie – bien adaptée à divers environnements. C'est astucieux, hybride également !
MH – Oui, c'est ce qui m'intéressait en lui – cette faculté de croisement, d'être composite, tout en étant un animal extrêmement souple, extraordinairement acrobatique et élégant. Dans ce poème, je critique de façon brutale le postmodernisme, en disant qu'il n'est pas nécessaire de l'inventer, que ça arrive dans la nature – pas de "stratégie" de "tactique" – tout cet horrible langage dont usent les gens. Des "postures".
AA – Vous écrivez que l'ornythorinque n'est "pas postmoderne, il bénéficie de l'histoire naturelle". Il est intéressant de voir que les naturalistes européens commencent à réaliser que l'Australie n'est pas un pays primitif dont l'évolution se serait arrêtée il y a des millions d'années sur les premiers échelons de l'évolution, mais un endroit où faune et flaure sont très hautement adaptées.
Dans le poème 'Poetry and Paperbarks", vous écrivez que certains australiens continuent de vivre dans un imaginaire importé d'Europe, et que nous autres, les écrivains, préférerions vivre dans un New-York d'hier.
J'utilise moi aussi des images aussi linéaires que celles de la télé, et je n'insiste pas sur la façon dont le pays pénètre les mythes de propriété des éleveurs. Ceci soulève deux questions pour moi - qu'entendez-vous par imaginaire européen importé, et qui sont ces écrivains qui vivent dans un N.Y d'hier? Est-ce qu'ils existent encore?
MH – Bien sûr. Il y en plusieurs. Nous ne pourrions pas imaginer une époque dans laquelle il y ait davantage d'imaginaire européen que la nôtre. Certaines théories européennes se sont extraordinairement bien adaptées à l'environnement intellectuel australien. Il y a aussi les aspirations des gens pour les artifacts et les institutions culturelles qui définissent l'Europe, et qui ne définissent peut-être nul autre endroit, et seraient inappropriées à ce pays. Auparavant, vous avez parlé d'Avant-Garde, est-ce que ce n'est pas seulement une idée étrangère? Il y a eu un immense investissement de toute sorte dans la poésie américaine qui a détourné notre attention du sens de la construction d'une poésie locale, ce qui est une aventure bien plus excitante.
Je suis parfois déconcerté par tout le temps passé à discuter de théories et de méthodologies qui concernent entièrement des idées et concepts européens et qui n'existent que dans les langues européennes. Ceci au détriment de la recherche d'une ontologie pour ici – un état d'esprit lié aux relations entre les héritages culturels, les cultures indigènes, et les cultures contemporaines. En d'autres mots, c'est un asservissement haut de gamme. Un grand nombre de traités théoriques décalquent ce qui s'est développé dans des circonstances particulières en Grande Bretagne ou en Allemagne dans les années soixante, apparemment sans subir de transformation. Les théories marxistes, le rationalisme économique, par exemple... est-ce adapté à ce pays-ci?
Une façon plus claire d'en parler concerne une grande partie de la poésie qui circule actuellement, en particulier les plus jeunes poètes qui écrivent dans une sorte de "langue de traduction", un état d'absence par rapport à l'histoire locale, les origines locales, un peu comme si on se disait qu'on peut simplement lire un poète espagnol, ou allemand, suédois ou de l'Europe de l'Est, sans avoir aucune connaissance de la langue ou de l'histoire, et se lancer à écrire de la même façon dans ce pays. Je ne dis pas d'ignorer tout ce qui vient de l'extérieur, mais seul un internationalisme sans consistance peut imaginer picorer et choisir partout, sans savoir du tout ni comment picorer ni comment choisir.
AA – C'est à dire?
MH – Tout est disponible, mais vous ne savez pas pourquoi vous pourriez préférer ceci à cela. Vous n'avez aucune raison sérieuse de vous engager avec une oeuvre plutôt qu'une autre.
AA – Votre poème "Sangsues" démarre de cette façon naturaliste, mais le dernier vers est puissant : "text-book leeches right now though I see them as false climbing friends." Vous parlez des organismes aux formes changeantes. Est-ce le problème de l'internationalisme, ou des poètes qui s'approprient peut-être des corps étrangers et vivent avec?
MH – Je ne pensais ni à des poètes ni à des écrivains dans ce poème. En fait, je déteste absolument les sangsues. De nombreux lecteurs de ce poème m'ont dit, "Mais vous ne pensez pas que les sangsues sont très bonnes, très belles !" Mais non, pas pour moi. J'ai une aversion pour le parasitisme quel qu'il soit, les parasites tuent un organisme. Les sangsues dans ce poème se collent à vous et vous privent de votre source de vie et d'énergie vitale, et elles sont amorphes; sans forme définie, sans structure, elles sont par définition inintéressantes.
AA - ... mais hautement adaptées à leur fonction !
MH – Oui, dans ce poème, hautement adaptées à leur fonction rationnelle et économique. Elles ne font rien, ne croient en rien, ne disent rien, une fonction à tout-faire.
AA - "Tigre de Tasmanie" est pour moi un poème intéressant.
MH – C'est l'un de ces poèmes du recueil qui réfléchit sur la créativité de différents points de vue. J'ai commencé à l'écrire à Sorrento en hiver. De nouveau, il s'agit d'un poème sur lequel j'ai vraiment essayé de travaillé pendant environ un an. Il y a deux choses dans ce poème. L'une d'elles concerne la nature des sentiments que je tentais d'exprimer et dans lesquels j'éprouvais une immense difficulté à pénétrer avec le langage ; et l'autre chose était de trouver une façon de parler de la chose la plus simple et la plus naturelle qui soit : le fait de regarder par la fenêtre, dans la lumière particulière d'une fin d'hiver, et d'observer les casuarinas contre la vitre, et l'effet particulier de cette lumière. J'ai vraiment passé beaucoup de temps pour essayer de rendre vivant ce détail, ses multiples facettes, et finalement essayer de reconnaître l'intensité de ce qui se passait, le mouvement, quand l'objet entre dans le champs de vision. Il y a une énergie particulière à ce point précis. C'est là, et c'est parti. C'est pourquoi le tigre ne pouvait être un tigre rugissant dans la jungle, il devait d'une certaine façon être une espèce disparue, il est mort, d'une certaine façon. Ça parle de la composition dans des micro-détails. J'essaie de capturer ce micro-détail à chaque moment du jour, de l'avoir présent, de ne pas le négliger.
AA - Le poème du tigre est voisin d'un ensemble de poèmes -"The Closeups". Vous essayez de faire ce que les imaginistes ont voulu faire – pénétrer à l'intérieur de l'objet – mais ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous utilisez une syntaxe tout à fait différente pour y parvenir. Vos vers occupent toute la page. J'ai remarqué, en écoutant certains vers, que le sujet ou l'objet réel de vos phrases disparaissait ou se perdait - mais ça n'avait pas d'importance. Robert Adamson me faisait remarquer qu'en lisant ce poème, il avait essayé de vous pousser à couper ces très longs vers.
MH – J'ai parcouru le livre la première fois que Bob me l'a envoyé et il se présentait assez différemment. Il a subi un tas de changements au cours de ce travail. Je n'essaie pas d'être obscur. J'ai parcouru tout le livre pour être certain que chaque vers était clair, et qu'il n'y avait pas une seule ligne avec laquelle je n'étais pas d'accord.
Mais oui, votre commentaire est intéressant. Difficile d'ignorer la nature de l'image des Imagistes[viii] – cette particularité, cette précision et cette ouverture à la sensation, ce sentiment d'immédiateté, de présence qui se dresse en face de vous, la couleur, les vibrations de tout ceci. C'est nécessaire. Mais je pense que les connexions m'intéressent aussi – la façon dont les choses se connectent, comment l'oeil voyage d'un endroit à l'autre. Comme lorsque vous regardez quelqu'un qui prend un café dans la rue et qu'en même temps vous avez une conversation avec quelqu'un d'autre. Il peut même y avoir une radio en bruit de fond. Ce sont des ambiances aussi précises que l'image des Imagistes. Il faut donc les aborder différemment.
Entre ce livre et le précédent, Distribution of Voices, ce fut une révélation pour moi – qui considère aussi qu'un poème doive être précis, hautement concis, et tout le discours habituel sur la poésie - de réaliser quelle limite c'était de ne pouvoir travailler sur la longueur pour intégrer tous ces détails. Si on en croit la légende, Ezra Pound, après des semaines et des semaines, a soigneusement effacé, dans le making of, le poème en deux vers "Dans une station de métro". Je trouvais que la poésie que je lisais et celle que j'écrivais étaient moins riches que ce qui se passait autour de moi. Je voulais y mettre tout ce que je pouvais, pour qu'elles puissent avoir cette source d'énergie.
Je suis une sorte d'imagiste vivant soixante-dix ou quatre-vingts ans après l'Imagisme, dans un environnement culturel, intellectuel et poétique totalement différent.
AA – On pourrait dire que vous tendez plutôt vers des poètes pré-imagistes, comme Apollinaire – pas dans le sens où vous écririez sur ce que vous voyez en ville – et pas davantage en célébrant l'Australie comme fécondité.
MH – Les poètes que j'admire tout particulièrement appartiennent à cette génération. Apollinaire est pourtant l'un de mes favoris. Je me sens aussi très proche de Blok et Machado. Je trouve intéressant Browning aussi. Des écrivains encore capables de raconter des histoires, qui ne sont pas encore complétement obsédés par la pureté moderniste et la fragmentation, m'intéressent énormément.
AA – Vous voulez tout y mettre, mais vous rejetteriez problablement certaines stratégies poétiques L=A=N=G=U=A=G=E, dans lesquelles tout est jeté dans le poème, dans un geste égalitaire, je suppose. Pourquoi rejetteriez-vous l'esthétique poétique L=A=N=G=U=A=G=E[ix] ?
MH – parce que je pense que ces genres de manifestes confondent politique et esthétique. Ils pensent qu'une théorie du langage pourrait faire ce que les politiques devraient faire. C'est l'idée qu'une utilisation anarchique, ou chaotique, du langage, pourrrait contribuer d'une certaine manière au changement social ou à l'anarchie. C'est une illusion, un erreur catégorielle. Je veux que mes poèmes communiquent avec des gens ordinaires. Je pense que si vous devez disposer d'une théorie avant d'ouvrir un livre, vous excluez immédiatement le lecteur.
AA – Le premier poème du recueil, "Anguilles" contient les vers "les mythes ne nous mènent nulle part" et "le mythos de la péninsule est qu'il dérive riche comme neige". Je ne suis pas certain d'avoir compris où vous voulez en venir.
MH – C'est un vers polémique. Il dit que le mythe s'épuise, pas les réalités.
AA – C'est ironique. Dans "Australia", également, vous écrivez "Appelez-la Australie, appelez-la peut-être riche, l'Argentine supportable avec ses tessons de mythes dressés en mode export."
MH – Oui, et de nouveau, il y a des tessons de mythes construits avec les médias pour le tourisme. Je n'ai rien contre le tourisme, mais je pense qu'une tentative de création d'un art local doit aller au-delà. Je pense aussi que des politiques authentiques iront au-delà. J'ai écrit une grande partie de ce livre au début des années quatre-vingt-dix quand il semblait y avoir trop de convergences entre mouvements politiques et systèmes de croyances mythiques.
Je trouve très intéressante votre question sur l'imagisme parce que la différence entre une personne écrivant maintenant et Ezra Pound ou les autres imagistes est liée aux théories scientifiques : les imagistes vivaient dans une époque où la notion de structure atomique et du raffinement de cette structure qui vous mène au noyau – mais un noyau opèrant dans un système relativiste - est tout à fait évidente à l'époque d'Einstein. Je pense que notre époque, elle, est celle des systèmes vivants.
[i] Adam-Aitken, poète et universitaire, vit et travaille à Sidney. Son plus récent recueil de poèmes, Eight Habitations, a été publié par Giramondo Press. On peut lire son travail en ligne à l'adresse http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/666/15/Adam-Aitken
[ii] John Forbes (1950 – 1998) né à Melbourne, a vécu avec sa famille dans le Nord Queensland, la Malaisie et la Nouvelle Guinée. Sa poésie a été profondément influencée par la poésie américaine de Ted Berrigan ou Frank O'Hara
John Ernest Tranter (né en 1943), poète et éditeur, a longtemps dirigé une émission littéraire à la radio, il est reconnu pour son rôle d'innovateur et d'expérimentateur.
Pam Brown, née à Seymour, Victoria,vit à Sydney. Peintre sur soie, musicienne, cinéaste, elle a aussi enseigné l'écriture, le cinéma et les médias.
Gig Ryan, née en 1956, à Leicester, en Angleterre – éditrice de la revue The Age, auteur de plusieurs recueils de poésie, et d'enregistrements avec le grougpe Disband.
Laurie Duggan, né à Melboune, vit à Sidney. Sa poésie, inspirée par le travail de Kurt Schwitters pour une série de poèmes sur des objets abandonnés et mêle contemplation et textes trouvés (journaux intimes, lettres de pionniers, articles de journal )
Dipti Saravanamuttu, née en 1960, poète sri-lankais et australien, arrivé en 1972 avec sa famille. à Sidney. Les thèmes de sa poésie vont de la conversation quotidienne aux théories littéraires, et porte souvent sur les problèmes de la justice sociale.
J. S. Harry (or Jan Harry; né en 1939) L'un des personnages récurrents de son oeuvre est Peter Henry Lepus, un lapin philosophe capable de citer Bertrand Russel, Ludwig Wittgenstein and A. J. Ayer au cours d'une discussion de politique internationale telle la guerre du Golfe.”
Joanne Burns, née en 1945, à Sidney ou elle vit - son travail oscille entre poésie et prose, et intègre souvent des papiers trouvés, extraits de journal et papiers du quotidien.
Rae Desmond Jones, (né en 1941) – poète, romancier, auteur de nouvelles et politicien. Né dans une ville minière, ses poèmes et récits traitent souvent de l'expérience urbaine, sans nier l'importance du désert pour sa langue et sa perception. Il écrit dans un langue familière, avec une imagerie violente, souvent sexuelle . Sa vision très noire et originale est fréquemment traversée d'éclats d'humour et de sensibilité inattendue.
Chris Mansell (née en 1953), poète, dramaturge et éditrice, née à Sidney, elle a grandi sur la côte duNew South Wales et à Lae, Papua New Guinea,. Lauréate du El Queensland Premier's Literary Award, elle a dirigé à plusieurs reprise le Festival de Poésiede Shoalhaven. Son travail, souvent expérimental dans la forme et le contenu, utilise également les médias digitaux et les collaborations avec des artistes.
[iv] Roland Edward Robinson (1912 – 1992) – écrivain et poète, né en Irlande, et arrivé en Australie à 9 ans, en 1921. Après de très brèves études, il exerça divers métiers dans le bush australien : manoeuvre, constructeur de barrages, jardinier... et danseur de ballets. Soldat dans l'armée australienne, ses premiers poèmes sont publiés en 1944. Il s'inspire des paysages australiens et des scènes de la vie quotidienne. Il fut aussi l'un des plus actifs membres du Jindyworobak Movement - mouvement littéraire nationaliste, actif entre les années 30 et 50, dont les membres tentèrent de promouvoir la culture, et particulièrement la poésie, indigène et de combattre l'influence de la culture étrangère, qui menaçait l'art local.
[v] David Watt Ian Campbell (1915 – 1979) écrivain australien, auteur de plus de 15 volumes de prose et de poésie, il fut aussi un joueur de rugby à quinze ayant représenté l'Angleterre par deux fois. Après 1946, et son installation à Wells Station, sa poésie se centre sur les réalités de la campagne, jointe à sa profonde connaissance de la poésie européenne, ce qui fait l'originalité de son oeuvre.
[vi] Alec Derwent Hope (1907 – 2000) – poète ( influencé par la poésie anglaise de Pope, Auden, Yeats... ) et essayiste australien, célèbre pour son esprit satirique, il fut aussi un critique et un enseignant. Autodidacte, et génie universel, il avait le talent d'offenser ses compatriotes
[vii] Robert William Geoffrey Gray (né en 1945) poète, écrivain et critique, célébré pour ses images et ses descriptions de paysage. Sa vaste érudition et son expérience des cultures de l'Extrême-Orient et des variantes du boudhisme transparaît dans nombre de thèmes et de formes de son oeuvre, comme les haikus. Il est aussi admiré pour avoir saisi l'ambivalence des australiens face à leurs propres paysages.
[viii] Imagisme Le terme fut inventé en 1912 par Ezra Pound, le poète américain, provisoirement transplanté en Angleterre. Mais la prise de conscience de la doctrine imagiste, et même de l'œuvre imagiste, est difficile à fixer dans le temps (Encyclop. univ.,t. 8, 1970, p. 739). Les imagistes (...) ont voulu libérer la poésie de toute vaine littérature pour la ramener à la présentation sobre et directe des moments typiques de l'expérience − les « images », ou synthèses complexes de la sensation et de l'émotion ou de l'idée, telles que nous les vivons (Arts et litt.,1936, p. 42-04)
Leslie Allan Murray, (né le 17 Octobre 1938), connu comme Les Murray : poète, anthologiste et critique et polémiste australien. Sa poésie a été récompensée de nombreux prix et le National Trust of Australia le classe parmi les 100 Australian Living Treasures. Il porte une atttention particulière pour les thèmes de la dépossession, la relégation et l'indépendance dans une oeuvre généralement considérée comme nationaliste, avec un intérêt pour les pionniers, l'importance de la terre sur le façonnage du caractère australien, et la prééminence de la vie rurale par rapport à l'environnement urbain, stérile et corrupteur, d'après le Oxford Companion to Australian Literature -
[ix] L=A=N=G=U=A=G=E était une revue de poésie d'avant-garde éditée par Charles Bernstein et Bruce Andrew entre 1978 et 1981. Les Language poets ou L=A=N=G=U=A=G=E poets est un groupe d'avant-garde qui émergea aux USA de la fin des années 50 au début des années 70. Ils mettaient l'accent sur le rôle du lecteur dans l'achèvement du sens de l'oeuvre et minimisaient l'expression, voyant le poème comme une construction du langage dans le langage même. En développant leur poétique, les membres de l'école Language se fondèrent sur les méthodes de l'école moderniste, représentée par Gertrude Stein, William Carlos Williams, et Louis Zukofsky... Cette poésie postmoderniste a comme immédiats précurseurs les New American poets, terme incluant les poètes Beat, la New York School, les poètes objectivistes..