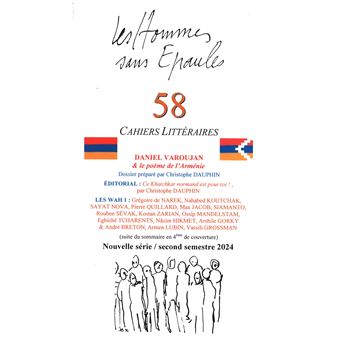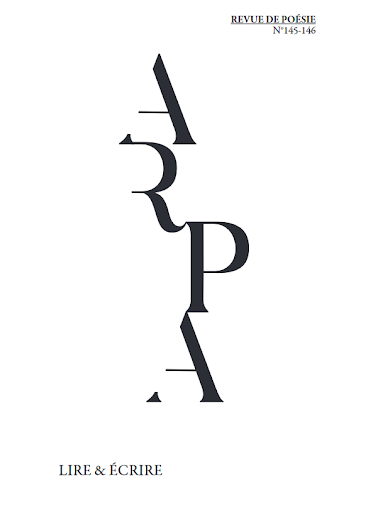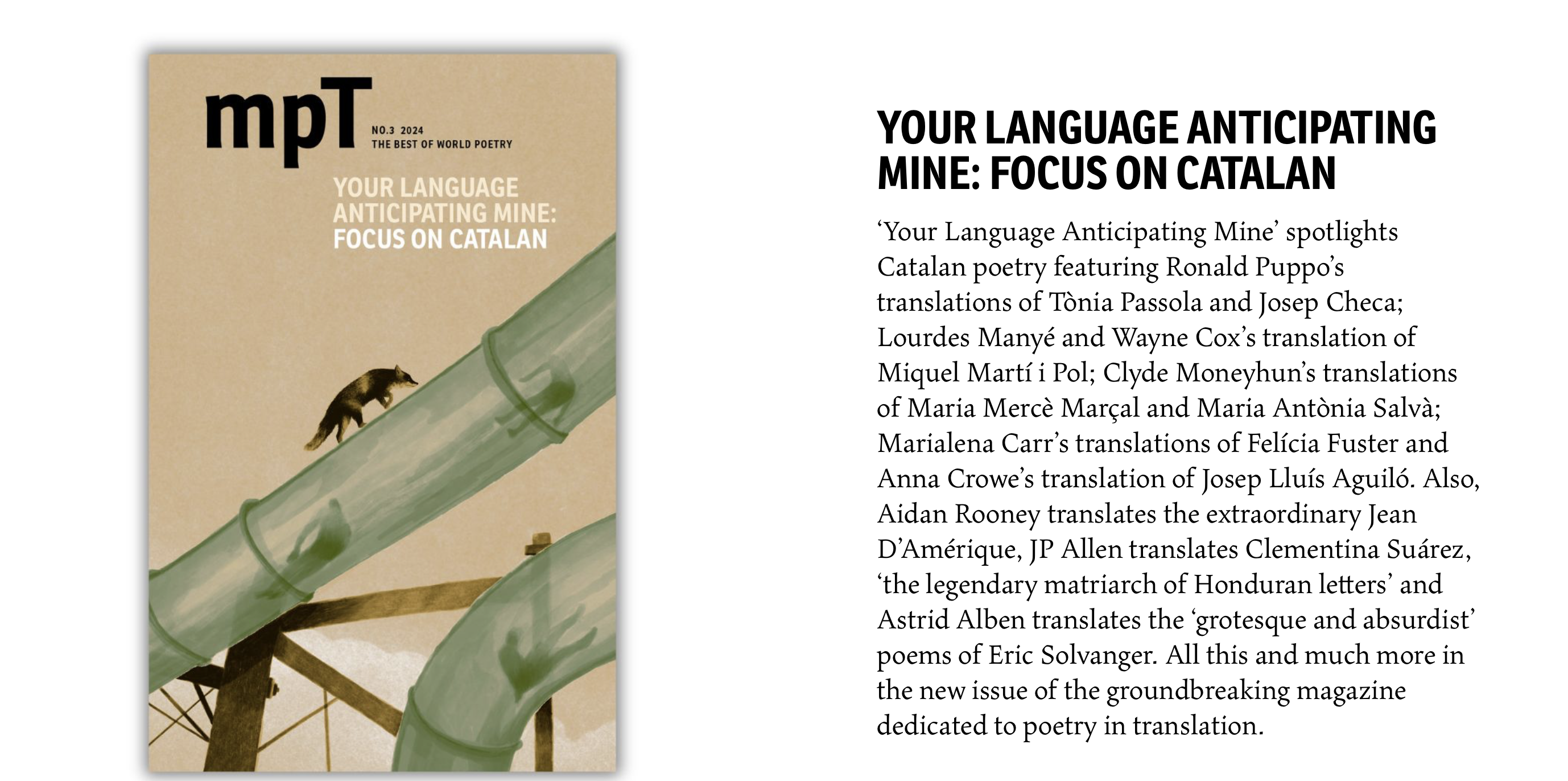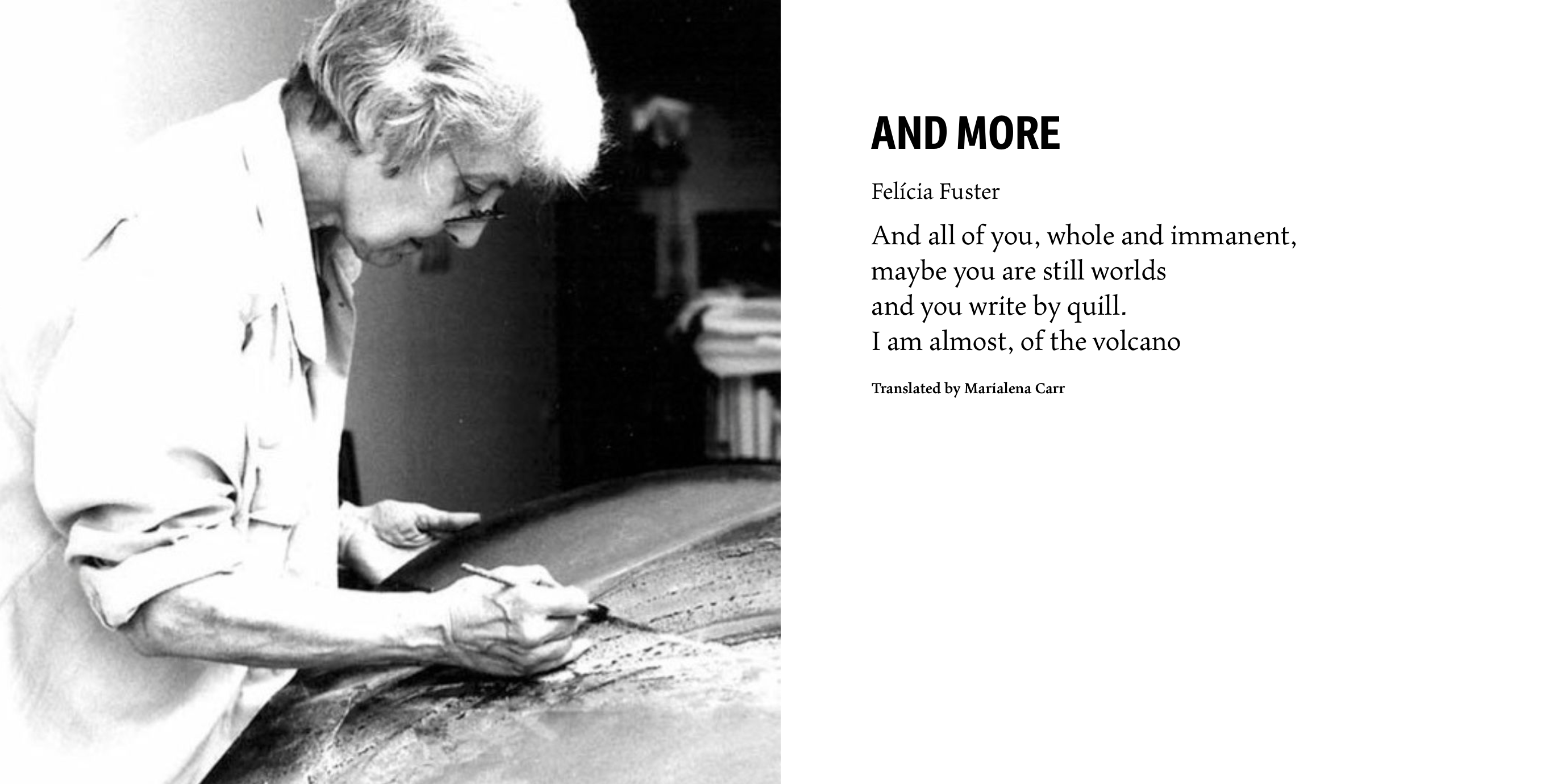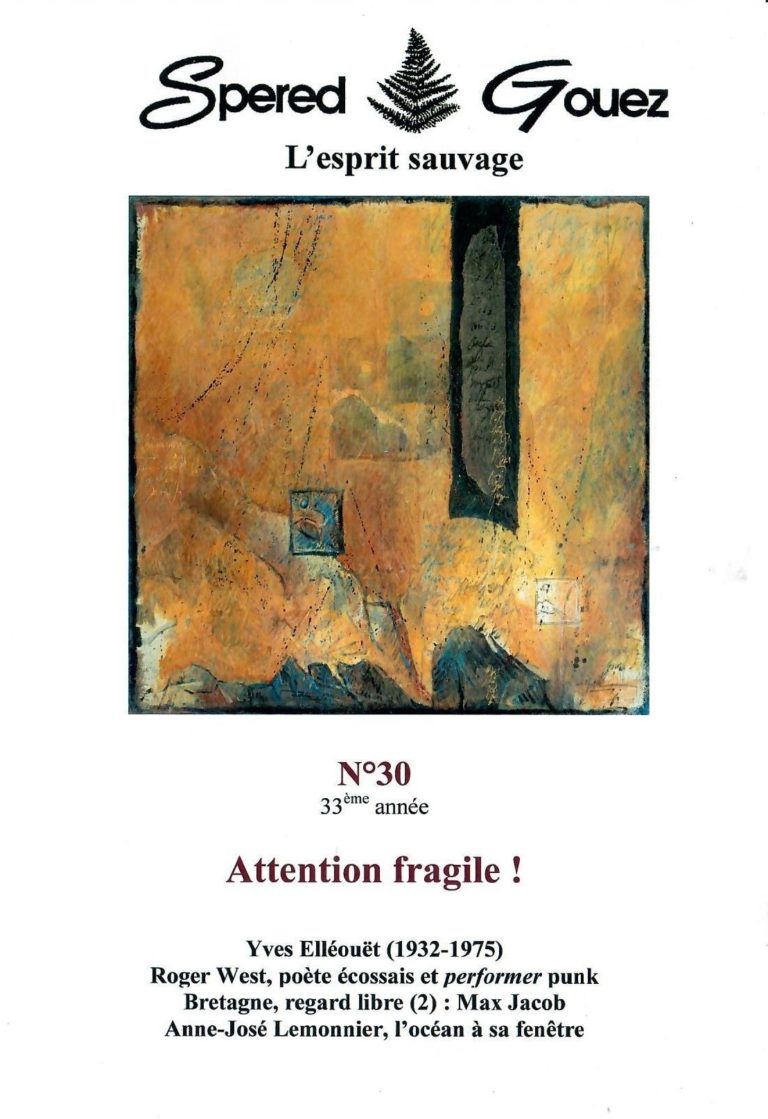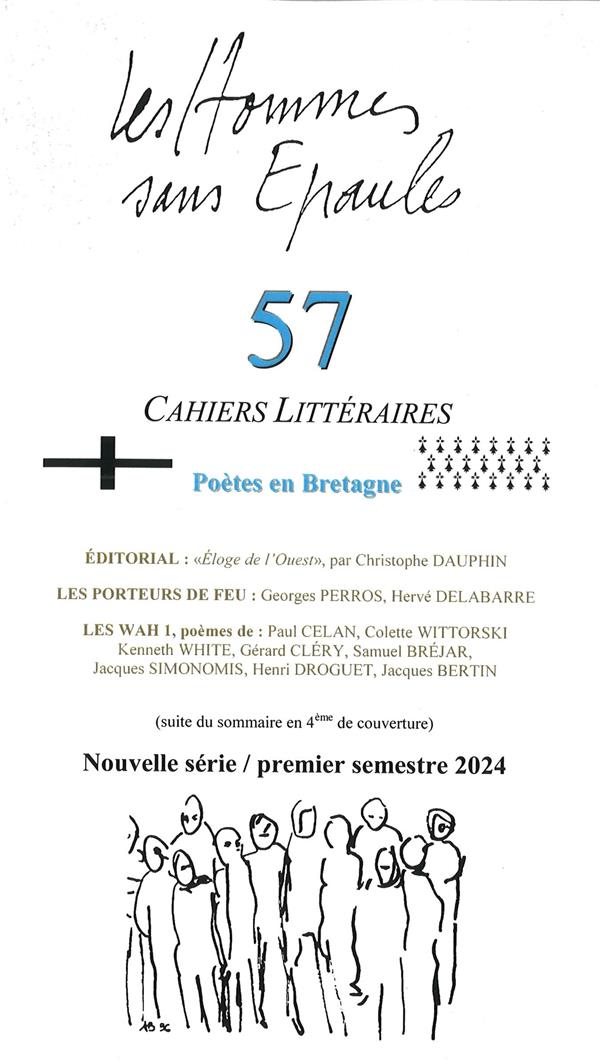Pour toi la littérature peut-elle aider à résister ? À résister à quoi ?
Gilles Deleuze disait que la philosophie devait nuire à la bêtise… eh bien, ma fois, je pense exactement la même chose du rôle de la littérature : une littérature qui ne nuirait pas à la bêtise ne serait pas exactement de la grande littérature. Fi des bons sentiments !
Dernier exemple en date : dans le dernier numéro, ayant constaté que dans l’espace médiatique français l’on disait à peu près n’importe quoi du réseau social X, j’ai décidé de publié le premier chapitre de mon futur livre dit tweet n°1. La tête des gendelettres français quand j’évoque ce sujet (quoi ? tu défends un « fasciste » (sic) ?), et alors qu’ils n’ont pas lu une ligne de mon texte, me montre que je suis vraiment sur le bon chemin… (« Tout est français, c’est-à-dite haïssable au plus haut point », Arthur Rimbaud.) Les écrivains français en sont encore à la diligence et au feuilleton dixneuviémiste, c’est effrayant ! Pire : ils baignent tellement dans une propagande permanente où tout est renversé, façon 1984 d’Orwell (« WAR IS PEACE / IGNORANCE IS STRENGHT », etc.), qu’ils prennent pour argent comptant ce qu’ils ont lu dans un média oligarchique, sans s’être documentés par eux-mêmes.
Donc oui, pour répondre à ta question, particulièrement en temps de déferlement totalitaire (terreur sanitaire, puis terreur climatique, sans parler de la terreur nucléaire qu’on nous ressort régulièrement), la littérature aide à résister. À résister à quoi ? Eh bien à la terreur, justement ! Dans les Cahiers de Tinbad, nous n’avons pas cédé un pouce de terrain à la terreur « sanitaire » (entre guillemets, puisqu’elle s’est avérée n’être que politique — en fait), publiant dès mai 2020 (n°11) un ensemble de textes de Claude Minière, Christophe Esnault, Axel Tufféry, Philippe Blondeau, Michel Weber et moi-même, contre ladite terreur. (Je note que cela a commencé à me valoir une mauvaise réputation dans des milieux bienpensants… c’est très bon signe !… (Rires.))
J’ai toujours su que seules les revues surréalistes s’étaient opposées aux abjects zoos humains à Vincennes, lors de l’Exposition coloniale de 1931. D’où l’urgence de résister à l’abjection politique, lorsqu’on a une revue. Jacques Henric, le directeur des pages littéraires d’artpress, renforce et complète cette idée : « Seules importent les revues qui mènent un combat. » Les autres…
Nous sommes à une époque où avec l’aide de moyens médiatiques inédits les gens ont accès à des narratifs fabriqués par un pouvoir qui dépasse nos frontières. Penses-tu que la littérature d’aujourd’hui prenne ceci en compte ? Est-ce qu’elle relaie ces discours ou bien s’édifie-t-elle en un lieu de résistance active ?
Je pense que la littérature prend trop peu cela en compte. Et qu’elle relaie beaucoup trop ces discours (voir l’indigence des publications dans les lieux « autorisés » (pour ne pas dire, « officiels ») pendant la crise Covid). Sur X, je suis un jeune philosophe qui se nomme Alexis Haupt. Son concept philosophique principal est que nous vivons dans un médiavers, monde entièrement fabriqué par les médias, et dans lesquels les gens vivent enchaînés à leur insu : c’est la caverne de Platon du 20e siècle ! C’est probablement le Étienne de La Boétie de notre époque. (Et d’ailleurs, si La Boétie vivait aujourd’hui, il publierait des travaux sur X, et sans y être censuré, n’en déplaise aux contempteurs aveuglés et automatisés d’Elon Musk.) Puisque Deleuze, encore lui, a dit que la philosophie est invention de concepts ; alors, avec cet Alexis Haupt, nous avons à faire à un véritable philosophe. Je renvoie nos lecteurs à ses travaux, facilement trouvables sur X ou sur les sites de vente en ligne de livres (Médiavers, médiathéisme et complosophisme (2024), Complosophisme — Éloge de la pensée critique (2023), et Discours de la servitude intellectuelle (2023), tous parus aux Éditions L’Alchimiste).
L’autre thèse majeur de ce jeune philosophe est que X, depuis que la plateforme ex-Twitter a été libérée de la censure par, justement, Elon Musk, est le plus vaste lieu de réinformation de l’Histoire humaine. D’où les torrents de haine déversés par les médias oligarchiques contre lui… puisqu’ils sentent bien qu’une grande parie de leur pouvoir (de nuisance) leur échappe. Quoi ? Vous n’avez pas entendu parler des Twitter-Files (censure des discours s’opposant à la doxa covidiste en 2020, 21 et 22, dont j’ai été une victime directe, soit dit en passant, et plusieurs fois) ? Vous vivez sûrement dans le médiavers…
Où en est la poésie, toi qui en publies beaucoup ? Que penses-tu de la désaffection des jeunes publics pour tout un pan de ce paysage poétique ?
Franchement, ce que je vois se publier comme poésie sur Facebook, y compris via le biais de photographies de livres de poésie aimés par untel ou unetelle, m’en dégoûterait plutôt qu’autre chose… Trop de décoration verticale avec retour à la ligne permanent, pour « faire poétique » (en général, sans aucune raison ou contrainte rythmique). Trop de papier-peint (ah ! cette poésie avec des « encres » de X ou Y…). La poésie doit rester rare… pas trop de sucre !… J’ai republié, dans la revue, le fameux pamphlet de Gombrowicz Contre la poésie, dont je partage les idées principales : une revue, comme un repas, doit comporte du salé et du sucré, des entrées, un plat de résistance, et un peu de sucré, en fin de repas.
Je « comprends » donc les jeunes, leur désaffection pour ce genre littéraire… Pourtant, j’en publie pas mal dans ma revue ; par exemple, dans le dernier numéro (17), il y a 4 textes de poésie (si l’on veut bien m’accorder que tweet n°1 en est) : Techniquement je suis vivant de Christophe Esnault, Grotesque muscade de Julien Bielka (op. cit.), La croissance exponentielle du solipsisme de Julien Boutreux, et tweet n°1 de moi-même. Ce qui m’a intéressé dans chacun d’entre eux, c’est qu’à chaque fois l’auteur a trouvé une forme originale pour exprimer sa pensée (et certainement pas de la poésie verticalisée à tout-va pour faire « genre »…). Les Moralistes français, Mallarmé, Lautréamont, « Tel Quel », le répertoire où s’inspirer est vaste ! Que le lecteur y aille voir par lui-même, s’il ne veut pas me croire sur parole !…
La poésie, c’est le rythme ! On ne peut pas échapper à cette exigence… Maintenant que l’alexandrin est mort, ainsi que toute versification, le poète doit inventer des formes autonomes, s’il veut trouver de l’inconnu. À vos plumes (ou claviers) !…