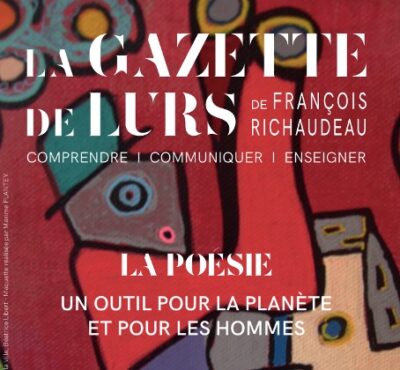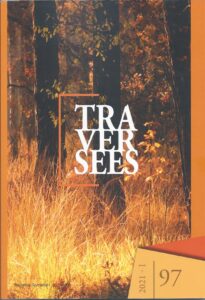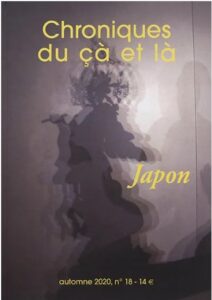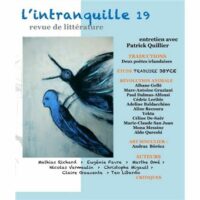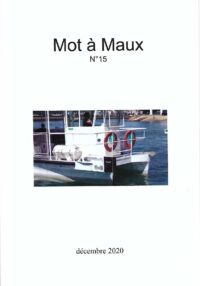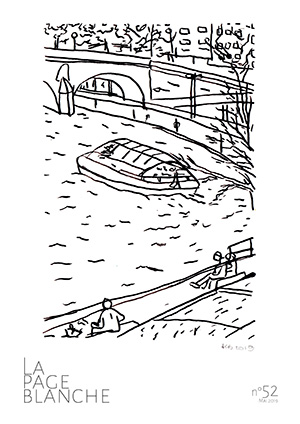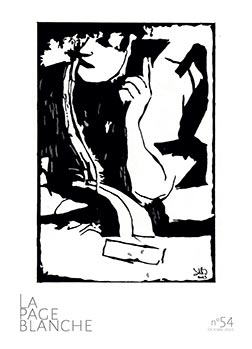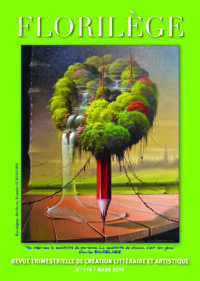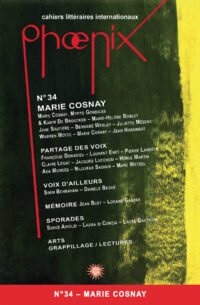On peut lire aussi en version originale et en français des textes de l'auteur nord-américain Peter Gizzi, l'un des principaux représentants de la poésie narrative outre-Atlantique. On découvre une écriture humaine qui se pose des questions sur ce que doit être la tâche du poète :
Les bons poètes défient les choses
avec leur cœur.
On retrouve cet aspect narratif dans le poème Un malheur, de William Cliff, alors que les aspects d'humanité et engagement envers les autres sont présents aussi dans le poème Plans de coupe à l'horizontale, de Nadine Travacca, qui se déroule dans la banlieue de Ramallah en Palestine. De même, Carmen Pennarun nous rappelle que « l'oubli de l'autre au cœur des chaumières brûle assez de feu pour cuire le pain du quotidien ».
Dans ce mélange d'universalisme et de mémoire, il est question de trois artistes disparus : Claude Vancour rend hommage au chanteur berbère Idir dans le poème Transmed alors que Paul Mathieu écrit un très beau texte en mémoire de l'écrivain chilien Luis Sepúlveda, Un bateau s'en va. Paul Mathieu retrace à son tour la vie et l’œuvre de Francis Chenot, pour qui « écrire est d'abord cri ».
La pandémie s'érige bien évidemment en protagoniste de nombreux textes, puisque on vit une Saison close où Orianne Papin nous communique son désarroi. François Teyssandier se demande aussi comment Retenir le temps qui vient, où il est question d'une mémoire qui
n'amasse pas que des souvenirs
Elle retiendra aussi les futurs éclats du temps
Arnoldo Feuer nous dit pour sa part, très clairement, que
Un temps
de bornes
s'est levé .
Cette nouvelle donne dans les rapports au monde débouche dans des regards inquiets et sensibles sur la vie et le temps, comme celui de Laurence Werner David,
Vos grands yeux d'ombres
Sont si redoutables quand, la nuit,
Ils naviguent au bord du bocage des têtes
Pour esquisser une réponse face au mal être, Timoteo Sergoï pense qu'il est nécessaire de repousser les murs : c'est ainsi que « Nous découvrirons la montagne et ses couronnes de brouillard ». Béatrice Pailler ou Marie-Claire Mazeillé cherchent de leur côté à porter un regard qui puisse dépasser l'immédiat et rompre les digues pour atteindre des nouveaux chants (Pailler) sans oublier que « l'horizon est plus vaste que la mer » (Mazeillé). Pour sa part, Aline Recoura tente de réinventer le réel en affirmant
Hier j'ai fait un bouquet
avec les fleurs que je n'ai pas .
Quant à elle, Martine Rouhart semble aussi chercher un refuge, mais cette fois
à l'intérieur de ce jardin
qui s'éveille
dans une inspiration
de poète
aux battements
du jour ,
alors que Frédéric Chef nous transporte sur l’île Callot, près de Carantec, où la nature est le personnage central de sa réflexion, bercée par la lecture de Pierre Loti
Les auteur/es esayent donc de rêver d'un monde nouveau, où le questionnement sur l'existence et sur notre rôle dans la société actuelle semble s'inscrire dans le contexte historique trouble que nous vivons : Adriaste Saurois affirme dans Génération que nous sommes
la génération vaine
désabusée, déjà usée
par l'arc-en-ciel du kérosène .
Dans cette recherche d'un autre monde, Jeanne Champel-Grenier joue avec les mots et tente de créer une nouvelle langue dans le poème À enfant neuf langue neuve, et Patrice Blanc nous explique qu'il faut
creuser l'histoire de notre corps
ce en quoi l'on croit
en nos rêveuses vies .
Cette idée rejoint un poème plein d'espoir d’Yves Patrick Augustin qui insiste sur le fait que le temps n'est jamais stérile.
Une autre réponse face à l'immobilisme auquel nous sommes contraints est la présence de l'autre, comme le suggère depuis les États-Unis Stella Radulescu, qui « détruit les légendes » pour expliquer ensuite que
on est deux dans le miroir des heures
et l'herbe pousse
à côté
printemps
Une présence qui peut s'ériger en rempart contre l'oubli quand il s'agit d'évoquer les êtres chers, comme le fait Denis Emorine, tout en étant conscient que les mots peuvent nous trahir. On peut également créer un monde onirique et personnel, comme Hicham Dahibi, qui évoque aussi ce « printemps dont on ne peut profiter ».
Certains textes en prose, comme les deux nouvelles de Pierre Krieg, ont en toile de fond des lectures de Nietzsche ou de Kerouac pour insister sur « le sentiment cruel de l'insignifiance de mon existence ». Quant à André Doms, ses Topiques apportent une réflexion historique et sociologique sur les valeurs de notre civilisation. Chantal Couliou, elle, propose une nouvelle à partir d'un fait divers qui dévoile le désespoir d'une mère. Pour finir, Philippe Barma écrit cinq courts textes évocateurs intitulés Barzy ou les Évangiles de la Thiérache.
En somme, les presque 150 pages du numéro 97 de Traversées nous proposent des textes globalement inspirés par l'actualité qui atteignent l'objectif proposé par Patrice Breno : ne pas se limiter « à nos frontières artificielles » et bâtir ainsi des moments de partage autour d'une publication qui fait preuve d'une sensibilité accessible et plus pertinente que jamais.