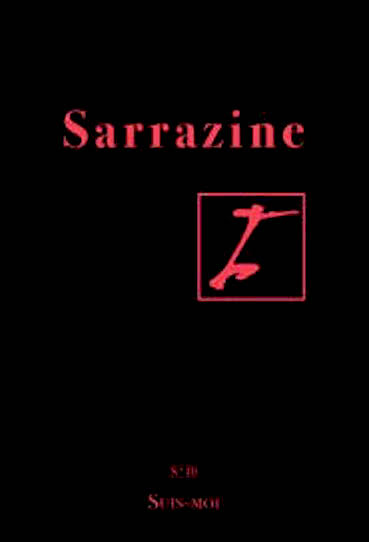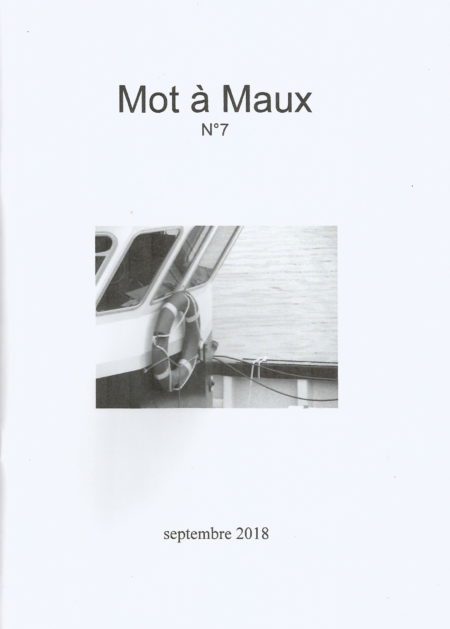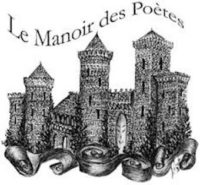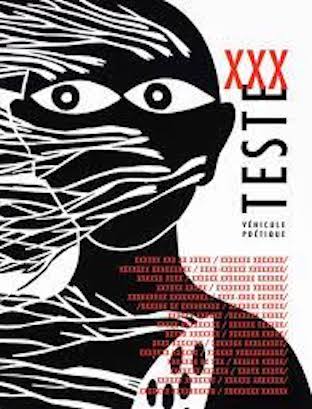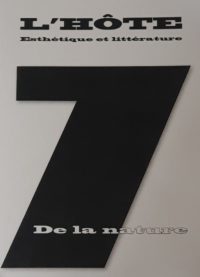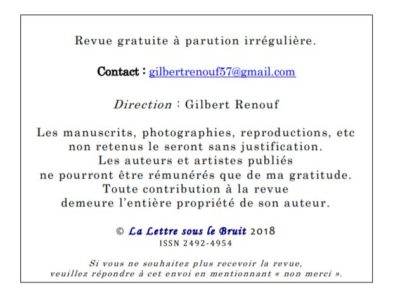Derviche tourneur, revue pauvre et artistique
"Derviche tourneur 1 est une revue protéiforme en devenir qui s’intéresse à la pensée plutôt qu’aux idées, aime les citations plutôt que les répétitions ; si elle tourne, c’est seulement une manière de rétablir le mouvement."
Au titre intriguant, au projet annoncé sur le site associé, répond le format de cette revue de quelques feuillets couleur ivoire pliés comme des origamis, et reçus par la poste - en fait, une production bien singulière. On trouve en ouvrant l’enveloppe :
- Un premier feuillet long, plié en 3 au format A5, contient la carte de visite de la revue « protéiforme » avec l’adresse mail et le site.
- Une page 30x42 cm pliée longitudinalement puis en 3,
- Un deuxième feuillet long plié en 3 également.
Au plaisir enfantin de la découverte de ce que cachent les plis se mêle le plaisir de découvrir les textes, dans un désordre relatif, où participent les noms de Guillaume Bordier, Fanny Garin, Anne Duclos, Jean Gilbert-Capietto, Julien Boutonnier et Clément Birouste.

Au revers de la « une », Une « filmographie » (liste dans laquelle on retrouve bien des titres de notre panthéon personnel) complétée de plusieurs « Rêves cinéma ». Parmi les autres titres des feuillets suivants, « Rêve avéré n°1 », « Défense de pauvreté », « Objets » et « Fragments ».
Le feuillet le plus grand propose une « introduction à l’ostéonirismologie », où je relève cette réflexion qui m'enchante comme le poème d'Henry Michaux , désirant la caravelle qui l'emporte "Dans les corridors des os longs et des articulations".
Il y a des os. Les os rêvent. Les rêves des os produisent le réel.
Tout ce qui existe est créé par cet onirisme des os.
.

Anne Duclos, interrogée, a bien voulu nous donner quelques informations sur cet étrange objet revuistique, à commencer par le choix du titre :
Le nom de la revue vient surtout de raisons purement contingentes et biographiques ; mais la notion de tourner renvoie bien, pour moi, à une fonction essentielle des revues, qui est à la fois de circuler et de mélanger, de donner une forme par le mouvement. C'est en tout cas ainsi qu'on peut l'entendre, et non bien sûr de façon thématique.
En l’absence d’indication sur la revue, pouvez-vous nous indiquer la façon dont vous fonctionnez (rythme de parution, choix des textes, équipe…) ?
Pour répondre à vos questions, le plus simple est de commencer par dire qu'il n'y a pas de fonctionnement ni de régularité. Pas exactement d'improvisation non plus, mais plutôt un suite de projets. Le rythme, si on peut encore le dire ainsi, est très lent : en moyenne un numéro par an. Mais on réussira peut-être à accélérer le processus. La diffusion se fait principalement par abonnement actuellement, mais ça changera peut-être aussi. Il n'y a pas d'appel à texte pour le moment. Nous sollicitons les auteurs avec lesquels on veut travailler.
Jusqu'à présent, il y a eu trois numéros, chacun de format et de nature différentes. J'aimerais beaucoup que ça continue ainsi, c'est en tout cas l'idée de départ. Le numéro deux est constitué de deux affiches par exemple. Mais le numéro trois reprend cette idée : il peut se lire comme un cahier, mais aussi comme trois affichettes indépendantes (d'où le système un peu compliqué des pliages). La dimension matérielle est donc très importante, on essaie à chaque fois de réfléchir à la création d'un objet, mais d'un objet pauvre malgré tout, et en partie artisanal. Je ne sais pas si on peut parler de typographe, bien que le terme soit très flatteur, mais c'est moi qui ai fait la mise en page de ce numéro. Les numéros deux et trois ont été imprimés en risographie. C’ est une technique de reproduction qui utilise des pochoirs, comme la sérigraphie, mais permet plus facilement que cette dernière d'imprimer en plus grande quantité. On peut ensuite jouer sur différentes opacités pour créer un effet de trame, ainsi que superposer les couleurs (l'impression étant monochrome : il faut un passage différent pour chaque couleur). Cela dit je n'y connais pas grand chose, je fais faire les tirages par un imprimeur.
Je crois moi aussi que cette notion d'objet pauvre a un sens !
Nous sommes deux à porter ce projet, Christophe Dauder et moi-même. Christophe travaille principalement dans le domaine du cinéma, surtout documentaire. Quant à moi, on peut m'écouter plus que me lire, mais ça n'a (pour le moment ?) pas de lien avec la revue. J'ai encore du mal à décloisonner et rassembler mes différentes activités, même si je pense que les revues, de manière générales, peuvent justement être un dispositif le permettant. C'est particulièrement visible pour les revues en ligne il me semble. En un sens, on pourrait tout à fait renverser le rapport initial et voir dans les revues papier des "objets pauvres" par rapport aux revues numériques !
_____________
Notes :
1 - (https://revuedervichetourneur.wordpress.com/