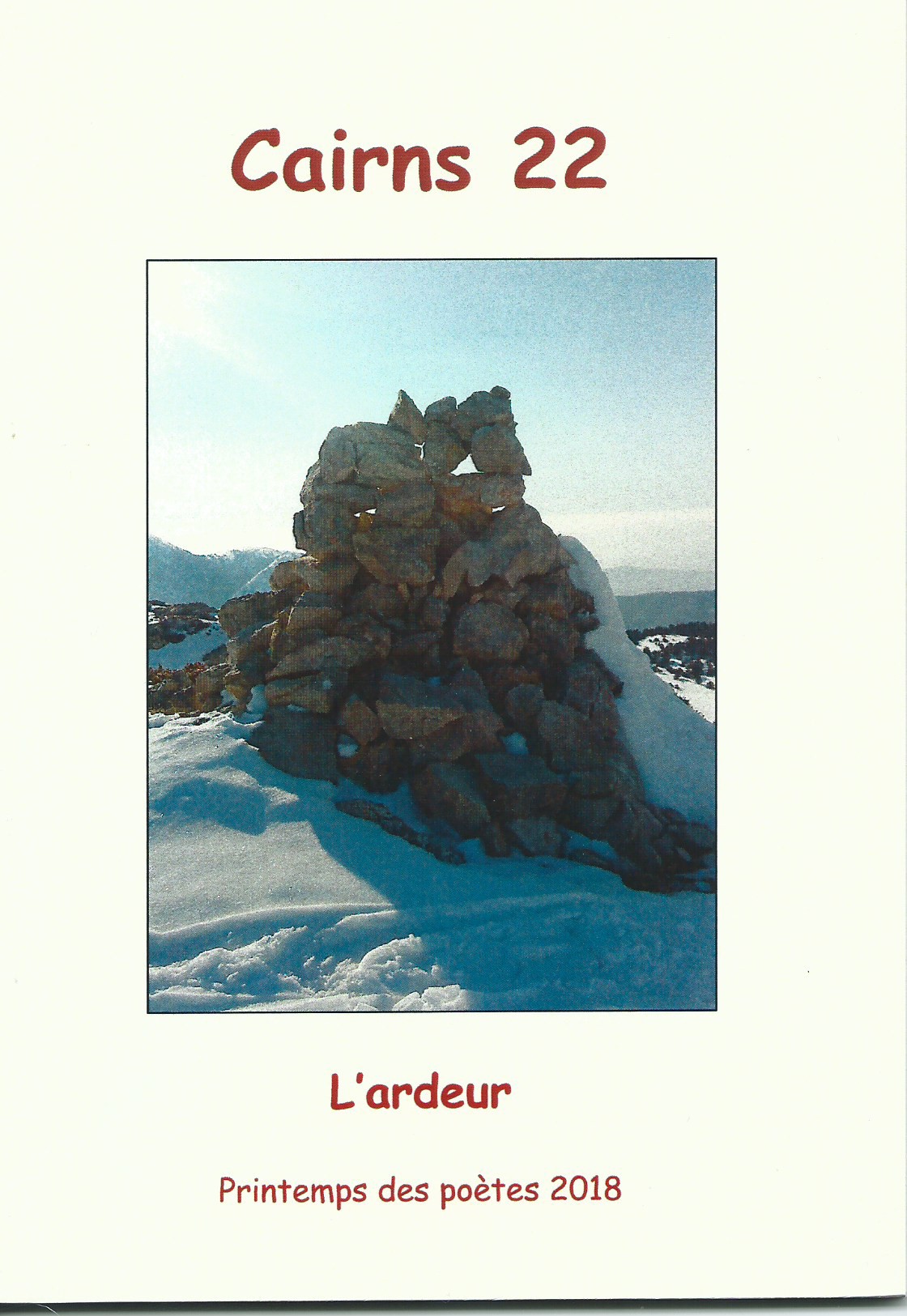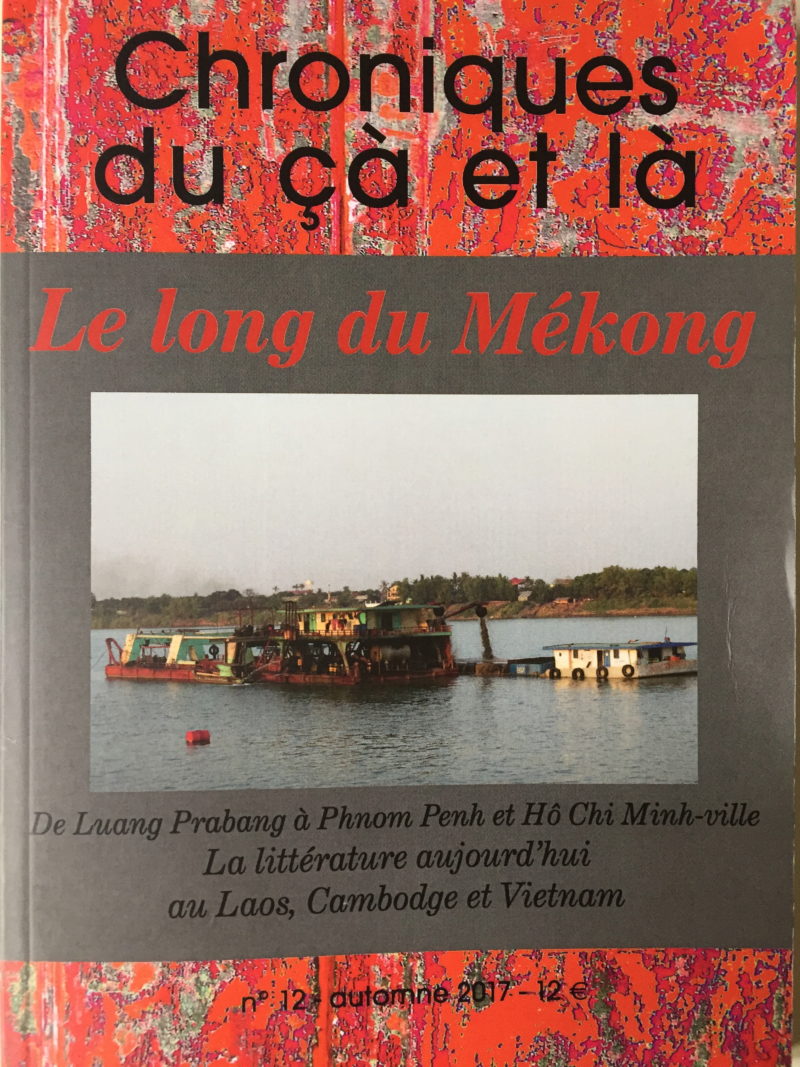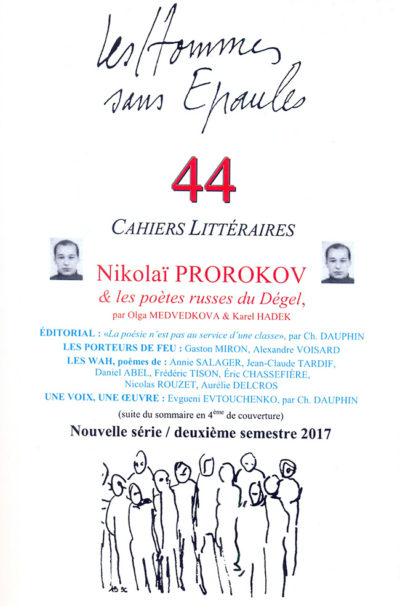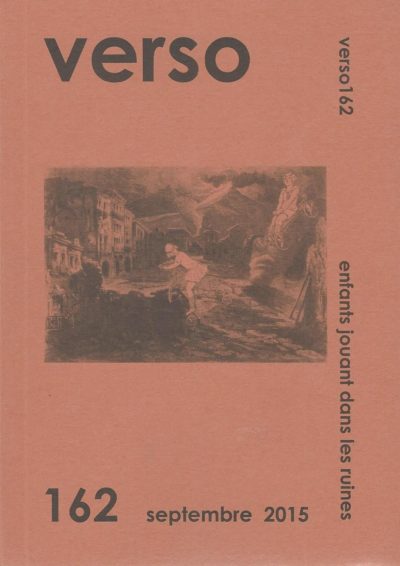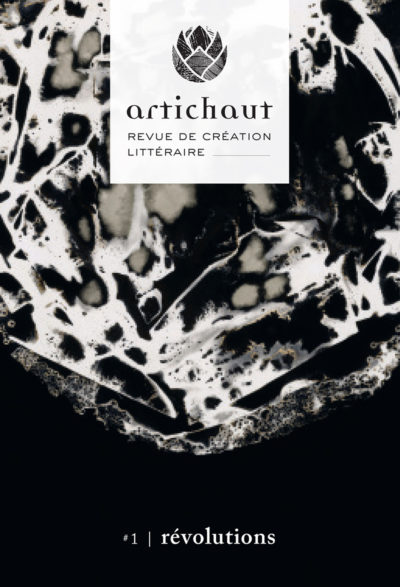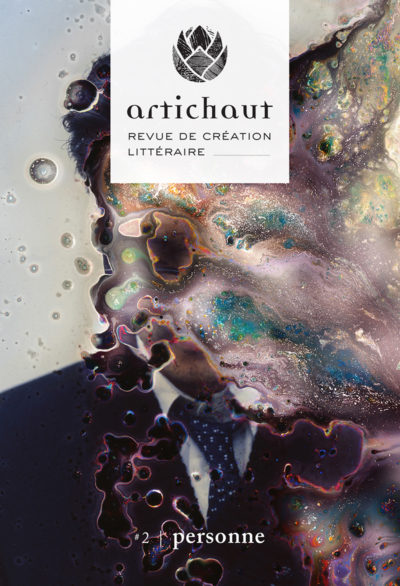Les questions appartiennent à tous et à toutes... Nathalie Riera, qui a dirigé cette traverse-là, premier numéro hors-série de Les carnets d’Eucharis, évoque une "poésie en alerte sur les routes du monde". Son ouverture "défie les frontières" (dixit Laurence Verrey) car les passerelles peuvent être « transfrontalières ». Il y a ainsi du hors-les-murs, hors-les-normes et hors-les-frontières à explorer : sont-ce les vestiges résiduels de l’utopie ? Quoiqu’il en soit, le projet éditorial de ce tigre borgésien se veut "polyphonique" : 19 poètes (dont 12 poétesses) portent leurs "lambeaux du dire » (L. Verrey) « en un champ libre voué à l'élargissement" (P. Chappuis). Déambulons à leur suite en inventant notre parcours personnel, sans oublier que la moindre escale poétique se veut humaine (ou l’inverse).
En baguenaudant dans la langue, arrêtons-nous d’abord – pour y prendre des forces ? - dans la pâtisserie familiale vaudoise du poète Olivier Beetschen, dont la seule description exhale la gourmandise. « L’ambiance, de caramélisée, devenait pétrifiée » lorsqu’un client Yul Bruner/Taras Bulba commandait « un kilo de pralinés » à sa mère. Un « factotum essouflé » du style Quasimodo servait sur une plaque des œufs en chocolat, tandis que « les dames à froufrous péroraient » dans un mini tea-room. La présence attachante des parents imbibe tout le poème, donnant vie à ce commerce gustatif.
Revenons vers la maison, ce lieu fixe à la base de soi pour les sédentaires que nous sommes devenus. Pierrine Pogey retrouve la sienne au terme d’un voyage après diverses « circonstances » : « Voici de l’espace et du pain/Désormais sa joie se tient hors d’elle ». Le temps bouleversé s’inscrit ici en lien énigmatique, entre un coup de téléphone ou des allers et venues : « Demain paraît le passé/Date, noms, souvenirs, rien ne la sauve (…) – Tout est prêt. La montagne se referme ». Dans ce monde, où le poème dont le tissu se défait comme des fils, ressurgissent les souvenirs « de la beauté d’autrefois ».
Quittons ensuite la ville, pour musarder en pleine nature. Le poète Pierre Chappuis rôde sur les chemins anciens de glane. Il y reste des brins de paille, des pavots parmi les blés où le couchant se mue en « brasier de novembre ». Son regard a une sorte d’appétit sensuel lorsqu’il observe une « mer de brouillard éraillée, retenant ses hoquets » ou une ligne de brume qui « lentement (…) s’effiloche ». Fusionnel, il entre dans le paysage avec une jouissance intime : « L’horizon l’englue » en un monde « sombre dans le jour sombre ». Son récit, accompagné de commentaires en italique mis entre parenthèses, semble proposer des strates au vécu.
Cependant un tel voyage à travers un paysage peut se réaliser par la médiation de l’art. Françoise Matthey observe une peinture de Constable, La charrette de foin ((Notons que la charrette paraît plutôt vide !)), avec un moulin « dans le lointain d’une plaine ». Le tableau habité est vivant avec un « homme sur le char » qui « offre sa sueur au pain secret des âges/mène ses chevaux dans la fraîcheur d’un gué ». « Il est assis dans une bienfaisante lassitude », avec une enfant qui « semble appeler tandis qu’au loin/les faucheurs s’offrent au branle-bas des graines » et qu’une lavandière « heureuse/chantonne la rédemption des cendres ». Devant le tableau, la mémoire de l’observatrice « veille », comme si des souvenirs archaïques en renaissaient subrepticement : « Par quelle roue ai-je été égrenée par les chemins du monde ? » L’eau vive, pressent-elle, « ne cesse de me désaltérer ».
Faisons enfin une ultime escale dans cette nature actuelle pour la découvrir en voie de destruction, envahie par le synthétique. Le poète Laurent Cennamo rôde ainsi au milieu des bois. Même là, deux hommes jouent avec des voitures télécommandées près d’une tente en toile plastifiée ! Il déplore ce « monde en plastique » qui lui rappelle l’odeur de ce « monstre/violet (…) muni de ventouses » des jouets Mattel. Autre rappel : son oncle surgit de la fosse graisseuse avec une clé à molette. Comment devenir homme désormais avec cet « (incompréhensible cadeau, vivre, vraiment/ d’un muet le songe dans le noir)».
*
Allons alors flâner plus loin au long de la mer Egée avec Sibylle Monney, « le pied devant le pied ». La poétesse y découvre les îles « lointaines » : Mykonos, Delos et d’« autres terres insulaires par la même mer intérieure logées », dont Tinos que surplombe la montagne d’Exombourgo au « crâne minéral ». Semblable escarpement est actif : « le dôme rocheux observe, (…) guette qui cherche la voie menant à son sommet ». Parmi la sente de randonnées, « la plus empruntée » a « les prises patinées ». Redescendre de ces cimes transforme la vie de la marcheuse : « On se pense une route une autre nous est préparée ».
Au fil de notre lecture, folâtrons encore au bord de ces vagues. Là, deux autres poétesses sont fascinées par une conjonction des sens (ouie/vue) ou des matières et énergies (eau/air/lumière). De loin, la mer se fait connaître par un « vacarme » qui emporte ainsi Francine Clavien. L’auteure unit superbement les perceptions des sens : « Le bruit des vagues/prend le chemin de la lumière ». Façon de découvrir les vagues, ces « bâillons/faits de lambeaux/usés/et pourtant bleus ». Le même jeu de lumière marine transparaît autrement dans la poésie de Julie Delaloye, mais cette fois-ci « à contre-jour ». L’Italie l’inspire avec ses sols du sud si solaires. Là, la terre est « rouge, brasier tourné au souffle du vent ». La nuit, « la plus pure lumière » dépose « dans le miel, la mer,/ce tant d’éternité retrouvée » si rimbaldien.
Une ultime poétesse, José-Flore Tappy, a la même propension à évoquer la mer, mais – hélas - telle qu’elle est devenue aujourd’hui. Elle la voit par la fenêtre – « hublot » de sa chambre, un « un trou dévasté » en une île anonyme, fréquentée par le « tourisme payeur ». Ce lieu « qui prend froid et s’exténue » est la proie de la modernité et… des déchets qui excluent tout charme. Supportant le ballet des « éboueurs, camions-poubelles/ aux manœuvres saccadées » ou du camion de « bebidas », cette «île endosse » son développement ! En marche, l’auteure quête en vain le plaisir d’approcher la les flots : «Allégée/une algue sèche/autour des pieds/je remonte un sentier/sombre et sans étoiles/sable et poussière/soufflés/par les motocyclettes ». Nul doute, la joie a disparu de cet univers de poussières sans étoiles.
*
Cependant il est des promenades d’une autre nature. Elles se font à l’intérieur d’un corps, celui de la mère. L’exploration de soi se fait en revivant la gestation de sa propre naissance. Antonio Rodriguez refait seul ce cheminement intra-utérin en une « nativité lente ». Il s’évoque pas à pas à la deuxième personne : « tu avances vers la lumière qui est de l’air, cherchant la peau (…), tu avances dans la mère, lumière et peau, en amibe aimante (…), tu avances vers la mère (… ), tu avances dans sa matière, mère ouverte de la bouche à l’anus (…) vers la forêt d’une maternité… Sous la dalle du ventre tu nous es livré vivant ». Il naîtra le « bel enfant prêt à percer le silence de son cri ». Le poète en tire un constat plus général : « L’espèce cherche son humanité ». Y parvient-elle ? « Tout ce qui secoue peut se voir en poèmes », estime-t-il dans un éblouissement créateur.
Notre errance se poursuit aussi dans le monde des concepts approchés par ces poètes choisis : ici le mal, là la liberté, ailleurs les proximité des lettres des mots, l’enjeu grammatical. Dans Qui instruira le livre du calme, Jacques Roman s’auto-questionne : « où donc se loge le mal de l’homme ?». Ne pouvant répondre à cette inquiétude métaphysique, il dénonce âprement le mal, la terreur, proclame la haine des guillotines, des exécutions capitales, des fours crématoires : « cris hurlements plaintes râles/horions insultes crachats et rires de hyène/animale terreur agrandit les pupilles/la graine de la haine semée à lever/d’un bras de folie sorti du néant/carnivore exterminatrices fleurit rouge ». Peut-on y échapper ? Il y a encore « tout le mal à venir ». Seule Cassandre a la réponse.
Pierre-Alain Tâche, dans Qui dit vrai ? questionne quant à lui la liberté poétique. Au nom de cette liberté, il écarte (« abolit ») la muse Nusch ( Nusch Eluard ?), se souvient de la disparition d’Hélène et de la mort de Jules Lequier en nageant à travers l’océan. C’est l’occasion de s’interroger sur le poète qui « a repris le don/qui répondait au don d’autrui,/le vouant à d’autres desseins ». Se référant à Guillevic et à Michaux, il continue sa quête intime : « me porter dans la faille muette/où risquer encore ‘la recherche/ passionnelle et comblée/de quelque chose que l’on sait/ne jamais atteindre’ » (dixit Guillevic). Même si la poésie est impossible (ou peut-être pour cette raison ?), il intègre dans ses écrits cette longue citation de poète. Il mue aussi, comme Jacques Roman, le titre de son poème en question.
Sylviane Dupuis constate, elle, la proximité des mots mur et amour : le mur est si proche de l’amour, à deux lettres près. Ce n’est probablement pas un hasard, car le mur est obstacle et l’amour insatisfait vient peut-être de « l’a-mur ». Le « mur est en toi (…) obstruant tout ». Lorsque l’espérance s’écroule, le mot Dieu va remplacer ce rien : un « mot-cri à la racine/invisible du souffle !» qui emmure. Nait enfin la poésie dans « les interstices », « dans le défaut des murs, cette faille, cet entre-deux ».
*
Dans ces péripéties de l’errance, que faire de la détresse humaine de notre société ? Trois poétesses l’explorent et sont soulagées ( ?) par le même refuge poétique. Nous rôdons d’abord dans une société peu démocratique qui exclut jusqu’à ses propres membres. Marie-Laure Zoss, touchée par les marginaux à la Jeanne Benameur (citation d’ouverture), appréhende ce monde bouleversé et chaotique, jonché d’êtres abandonnés au fil des lieux et – sans doute -des écrits : « Des frères, s’ils sont, leur parler où, chacun dans son angle ? ». Ses mots et ses phrases se heurtent, s’emboitent, se brouillent, s’enchevêtrent proposant des indices, suggérant des incertitudes. Ici « se lèvent des hordes hivernales (…), du chantier ferment tantôt les grilles, des ombres les tirent, casquées de jaune à la tombée ». Tandis que s’éteint « l’ampoule intermittente de la pelleteuse ; à quelques mètres, d’autres battent la semelle sur le goudron ; s’envolent des châtaignes, une patate brûlante… ». Que faire ? Y aller ou non ? « On recule vers les containers (…) la trouille au ventre ». Des travailleurs répondent à l’appel selon une « procédure de rigueur » ! L’écrivaine, elle, cherche en esprit « une planque minuscule ». Est-ce le poème dans lequel « on besogne à tailler des phrases dans du préfabriqué ».
La poétesse Sylvia Härri explore aussi étrangement les douleurs humaines, tout en bouleversant fermement les codes grammaticaux du Bescherelle (!): « je me souviens, tu me souviens, il me souvient, nous me souviennent, vous me souvenons, ils me souvenont ». L’île de Lesbos émerge avec ceux qui s’y sont réfugiés : « Visages sans nom/entassés dans l’attente/derrière les barbelés ». Parmi eux, « ce vieil homme/Alep gravé sur le frot/- cicatrice ou racine ». Que faire ? Ne pas oublier pas plus que ne s’oublient en vrac « les portes de placard laissées ouvertes » … d’arroser l’orchidée, faire bouillir l’eau, éteindre la lumière, etc. Que faire ? « Changer les mots contre d’autres, les syllabes contre les silences, les silences contre le silence. »
Pour Laurence Verrey, l’heure « barbare » est « en déshérence mélancolie » dans ce monde dévasté par tant de guerres cruelles et de morts. « Quand l’appel des naufragés déchire la mer/lacère le sommeil que les vagues/avaient d’un coup les cris », alors la poétesse a un recours, un refuge : « recourir au poème/comme un corps émergé un rocher/qui tient bon ». L’instant qu’elle capte en jouant avec les mots et les sons est aux « bords du dire/toujours à franchir – affranchi ». Alors elle dira cette nuit kirghize, sous les étoiles « bien clouées » de la constellation du Chariot, auprès de ce lac d’Issyk Kul ((Issyk Kul, traduction le lac chaud.)) qui pour les habitants est « une femme amoureuse et le jouet des vents ». Elle semble y être un instant apaisé ?
*
Que reste-t-il au terme de cette promenade à travers les mots, où la lectrice – moi - se sent un peu funambule. La disparition de soi, la mort, est-elle l’ultime étape ou un recommencement ? Pierre Voélin, est d’abord un promeneur inspiré qui, entre huppes et biches, pouliches, poursuit le « rêve amoureux » de la reine de Saba. Dans la « bergerie des étoiles », il compte les « soumises – les revêches/ les tendres et les étoiles ». Il saura même voir « les cortèges/d’anges » des ruines de Duino dans ces espaces où tombe la neige et « où brûle la main du Dieu ». Façon de dire la mort, cette face cachée de l’existence, tout comme Rimbaud l’a perçue devant le soldat des Ardennes.
Anne Bregani, elle, dit la mort avec une beauté si mystique qu’elle la rend désirable : « elle viendra/l’inoubliée/prendre toutes mes mémoires/lire/toutes mes rencontres/qu’elle a travaillées/de ses morsures obliques ». Cette poétesse « désorientée » frôle enfin l’indicible, la « Divine Tendresse ». Dans les voilures de son soir, Claire Genoux perçoit la mort autrement. Sur la tombe, elle est « cette enfant blanche/avec rien d’autre qu’un corps/comme un vent qui passe/sous les lunes mouillées » « Je redeviendrai ton enfant/ton enfant mort/ dans les voilures du soir ». L’exaltante tristesse de cette « nuit des adieux », une « nuit sans étoile des fontaines éteintes », étreint le cœur.
*
Ainsi chaque poète.sse poursuit la connaissance de lui-même à travers ces instants humains de vie et de mort. Dans sa promenade, il/elle introduit la mer, la mort, l’amour, le mur. Cette prose souvent libre, au rythme souvent variable, aux parenthèses possibles, aux citations d’auteurs intérieures au texte, à l’emploi de l’italique, aux répétitions. Même si l’âme hantée par le temps « est un ricochet de milliards d’années » (Jacques Roman), elle se laisse volontiers emporter dans l’espace. L’appel du sud – vécu ou évoqué - est souvent méditerranéen : Cortone, Mykonos, Delos, Tinos (Exoumbourgo), Lesbos, Syrie (Alep) et parfois moyen-oriental (Kirghizistan, lac Issyk Kul).
Oui, mais les réponses - aussi - appartiennent à tous et à toutes. Au terme de parcours suisse romand (« postface »), Angèle Paoli récapitule avec ferveur les divers élans poétiques de l’opuscule (tantôt « lyre brûlante », tantôt prose « quasi-baroque »). La poésie s’y penche sur ce qui échappe, la naissance et la mort, l’ombre et la lumière, l’onde multiple, les exils, le paysage insulaire délabré, la rêverie devant une peinture, le désarroi face à la vieillesse, des bribes de dialogue, une expérience de la glane, des voix autres, l’entre-deux, etc. « Recourir au poème » est une nécessité vitale, affirme-t-elle avec Laurence Verrey, pour « tenter de trouver un semblant d’équilibre dans le déclin d’un monde en proie à ses obscurantismes ».