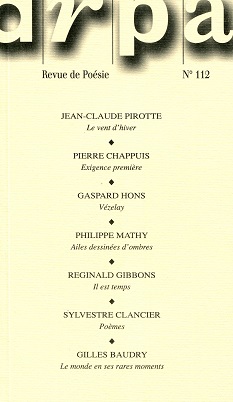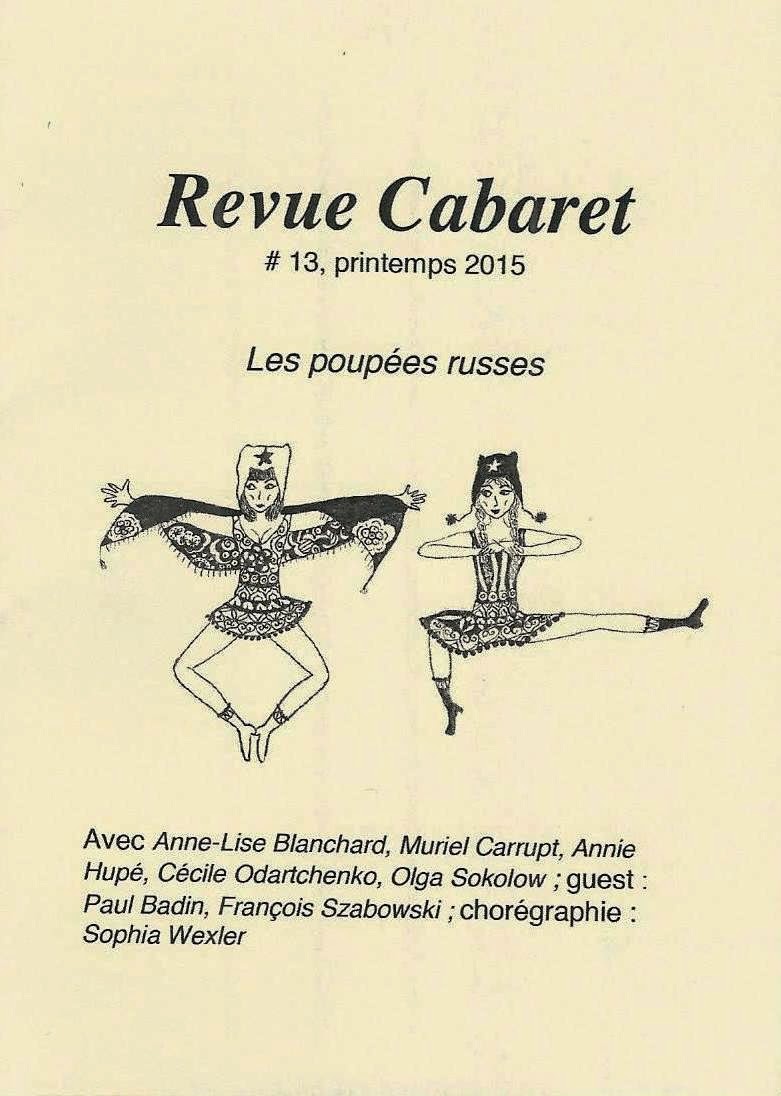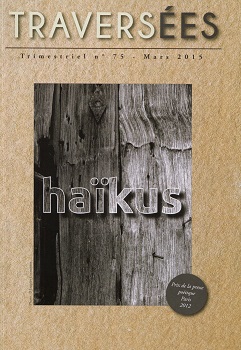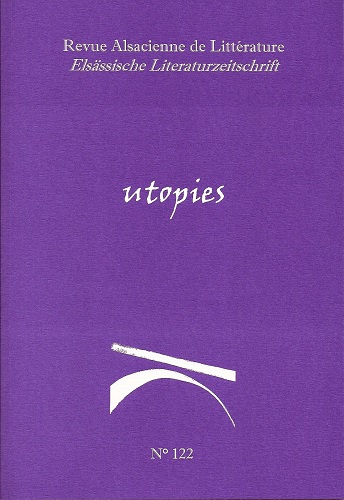The Black Herald : literary magazine / revue de littérature, numéro 5.
Cette revue bilingue en noir et blanc, sans note de lecture, sans photo (sauf celle – superbe – de James Goddard en page de couverture) n’est animée que par deux rédacteurs : Paul Stubbs et Blandine Longre qui font un travail remarquable. Elle met en place un dispositif qui intègre un maximum de formes et de voix littéraires : romanciers, nouvellistes, poètes, dramaturges, penseurs… Tous se font écho, se confrontent, se mêlent, se contredisent et surtout affirment librement, sans thème imposé, leur singularité. Il ne s’agit plus, en effet, de s’enfermer dans des classifications scolaires et arbitraires, dans des mémoires restrictives fonctionnant par opposition, mais de choisir, parmi la diversité des registres et des genres, ce qui fait encore actualité et modernité. Le catalogue des éditions Black Herald Press (huit monographies ont d’ores et déjà paru, notamment celles signées par Anne-Sylvie Salzman, Blandine Longre, Jos Roy… et cinq numéros de The Black Herald sont disponibles) envisage la littérature comme un dispositif capable de tout absorber et intégrer, notamment la diversité des voix qui résonnent dans toutes les langues du monde.
Ce qui s’intègre et se donne à lire, ce sont les clivages, les écarts, l’abondance de la matière, des problématiques et l’éveil alerté dans le refus du monologue intérieur. Il s’agit bien d’approfondir et de recréer tous les enjeux, ceux qui défont le confort des acquis et invitent à une relecture de textes plus ou moins anciens (et oubliés) et à en découvrir de nouveaux, écrits par des écrivains encore peu connus, clandestins. Ces écrivains de générations et d’horizons esthétiques différents ouvrent un espace qui se déplace dans des ruptures et des continuités. Le lecteur est invité à une bibliologie (j’emprunte ce mot à Philippe Beck (1). Autrement dit, le lecteur est invité à une communication et à un partage, à l’amour d’une affinité entre des textes ne parlant pas de la même chose. La mémoire ne cesse de s’étendre dans le présent du passé et le présent du présent.
Ce numéro 5 s’ouvre par un poème aux longues laisses de David Gascoyne : Et le septième rêve est le rêve d’Isis. Il date de 1933 : le premier poème authentiquement automatique que j’ai écrit, suivant la recette orthodoxe du Surréalisme précise Gascoyne et il se conclue par un extrait du Réalisme total du poète tchèque Egon Bondy. Entre ces deux écrivains, influencés par Dada et le surréalisme, une série de contributeurs qui m’étaient pour certains – j’ai un peu honte de l’avouer – totalement inconnus. J’ai ainsi découvert les textes de Pierre Cendors, de Peter Oswald, de Philippe Annocque, de David Spittle et de Paul Stubb. Deux autres textes ont attiré mon attention, l’entretien inédit avec Cioran mené par Bensalem Himmich et un extrait, très contestable : Le Double Rimbaud de Victor Segalen. Mais ce sont, avant tout, les poèmes de Jos Roy : Asphodèles que je voudrais saluer ici. Ils constituent un petit ensemble d’une rigueur prosodique remarquable. Ils agissent, comme les poèmes de son premier recueil : De suc & d’espoir (Black Herald Press) par fulgurance et déflagration. Ils bousculent nos certitudes et nous forcent à lire (et non pas à relire). Ils mêlent, avec élégance, sens et sensation, musique et pensée. Ils captent tout un espace sous tension et jouent sur les paradoxes, comme ici, ce poème, immobile dans le mouvement :
Il y a dans les asphodèles
une histoire de chambre divisée
dans la chambre des lits jumeaux
un corps sur chaque lit errant & immobile
on est là sans savoir si les murs ourdissent
un complot de rencontre ou de séparation
hiverprintempsété
la direction s’essouffle
& les collines dans la chambre se salent d’une odeur
qui tangue entre le fade & le sucré
une ligne de flambeaux éclairerait les pôles ennemis
d’un immense désir farouche
(1) : Philippe Beck : Poésie mondiale, entretien avec Pascal Boulanger et Paul Louis Rossi, La Polygraphe n° 13/14, mai 2000. Cet entretien avec Philippe Beck a été repris dans mon essai : Fusée & paperoles, L’Act Mem, 2008.
Chez Recours au Poème éditeurs, Pascal Boulanger a publié un recueil : Septembre déjà, 2014