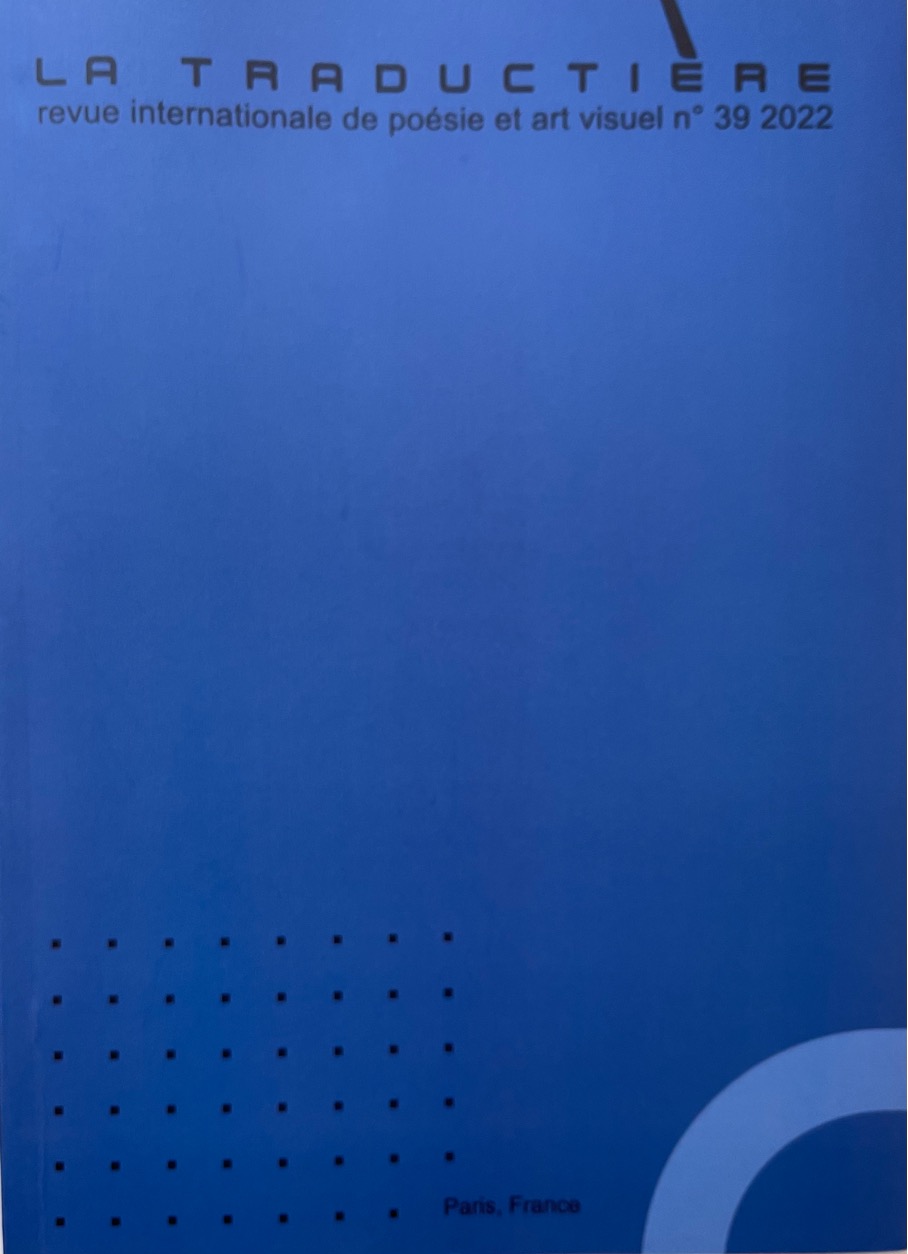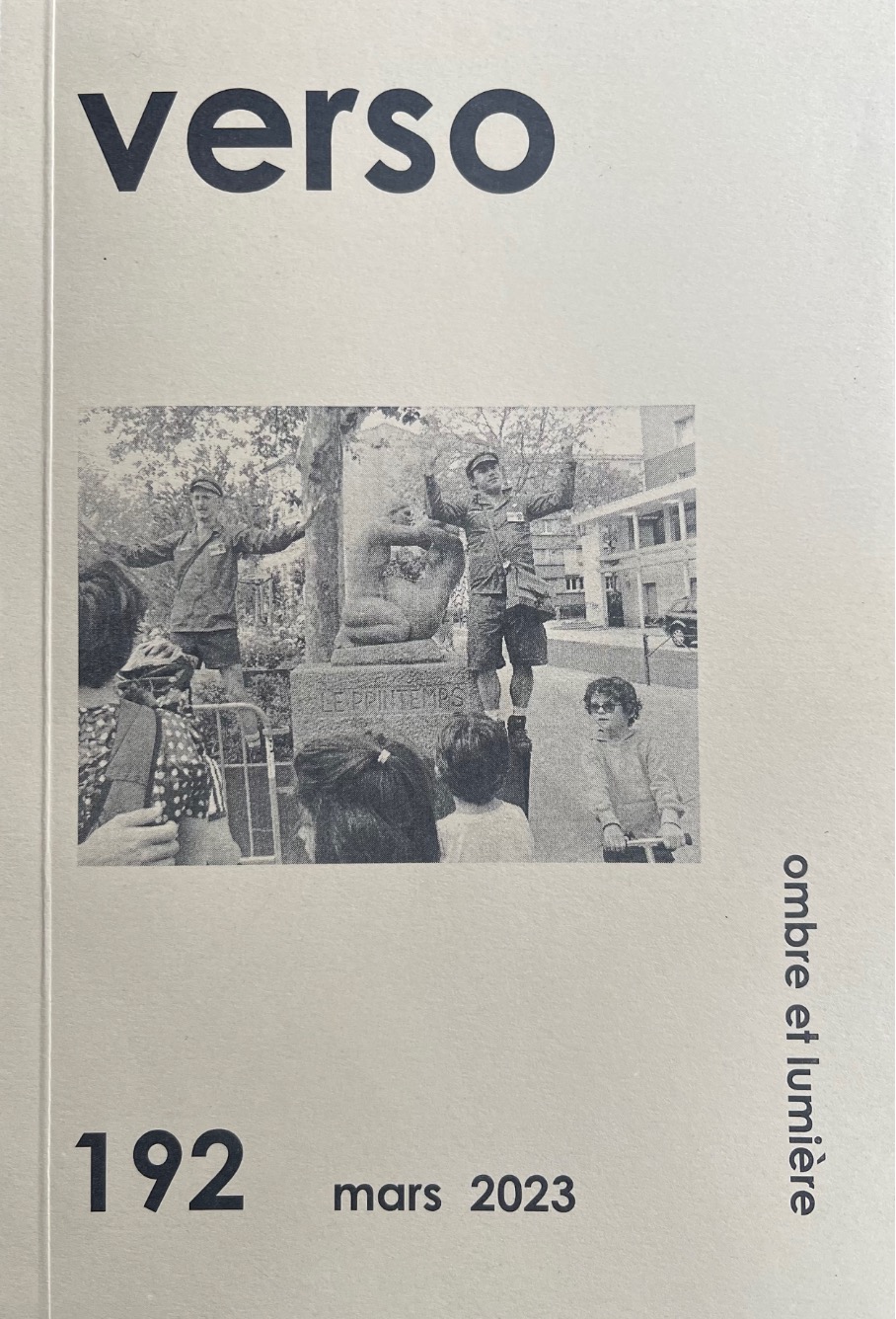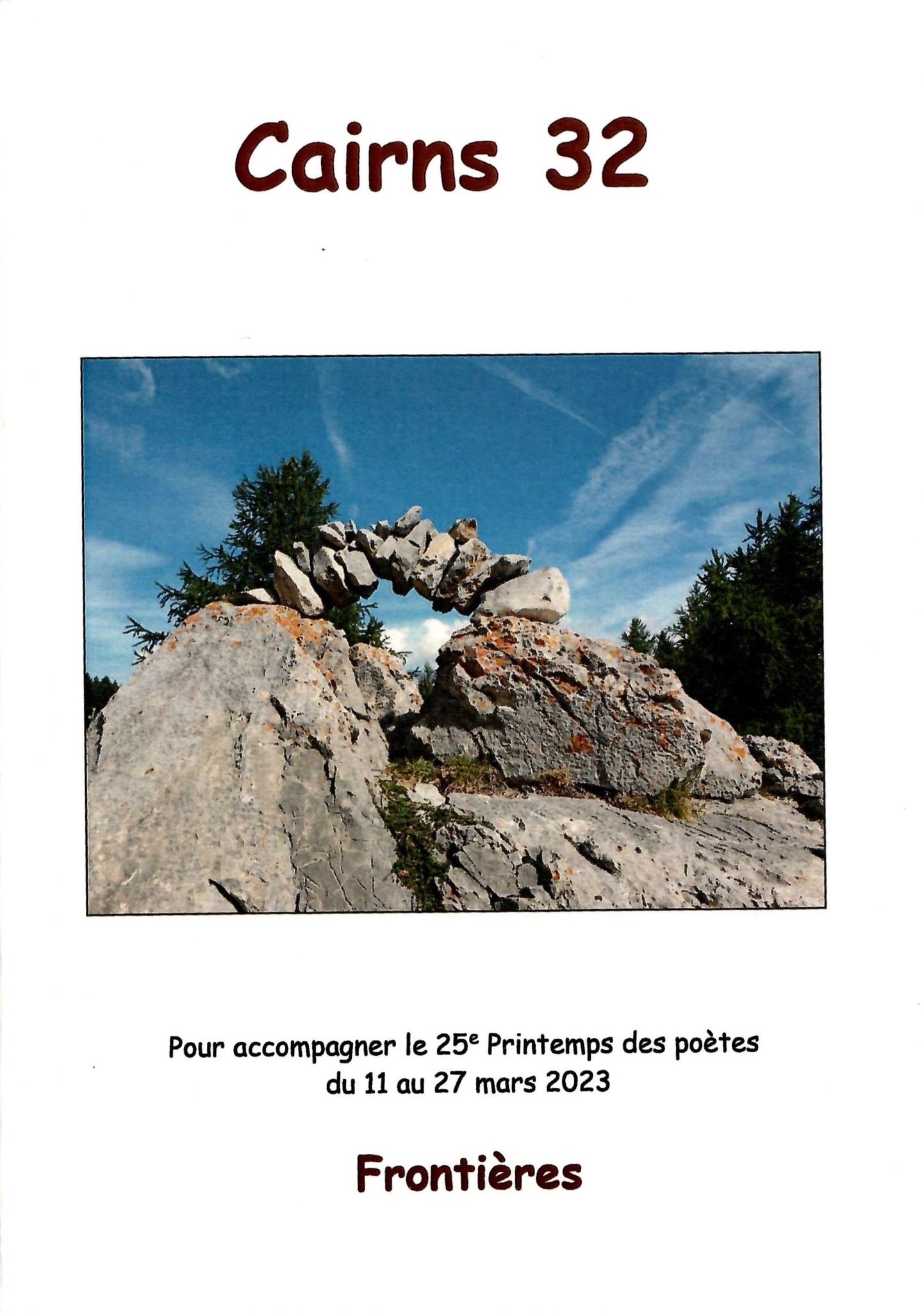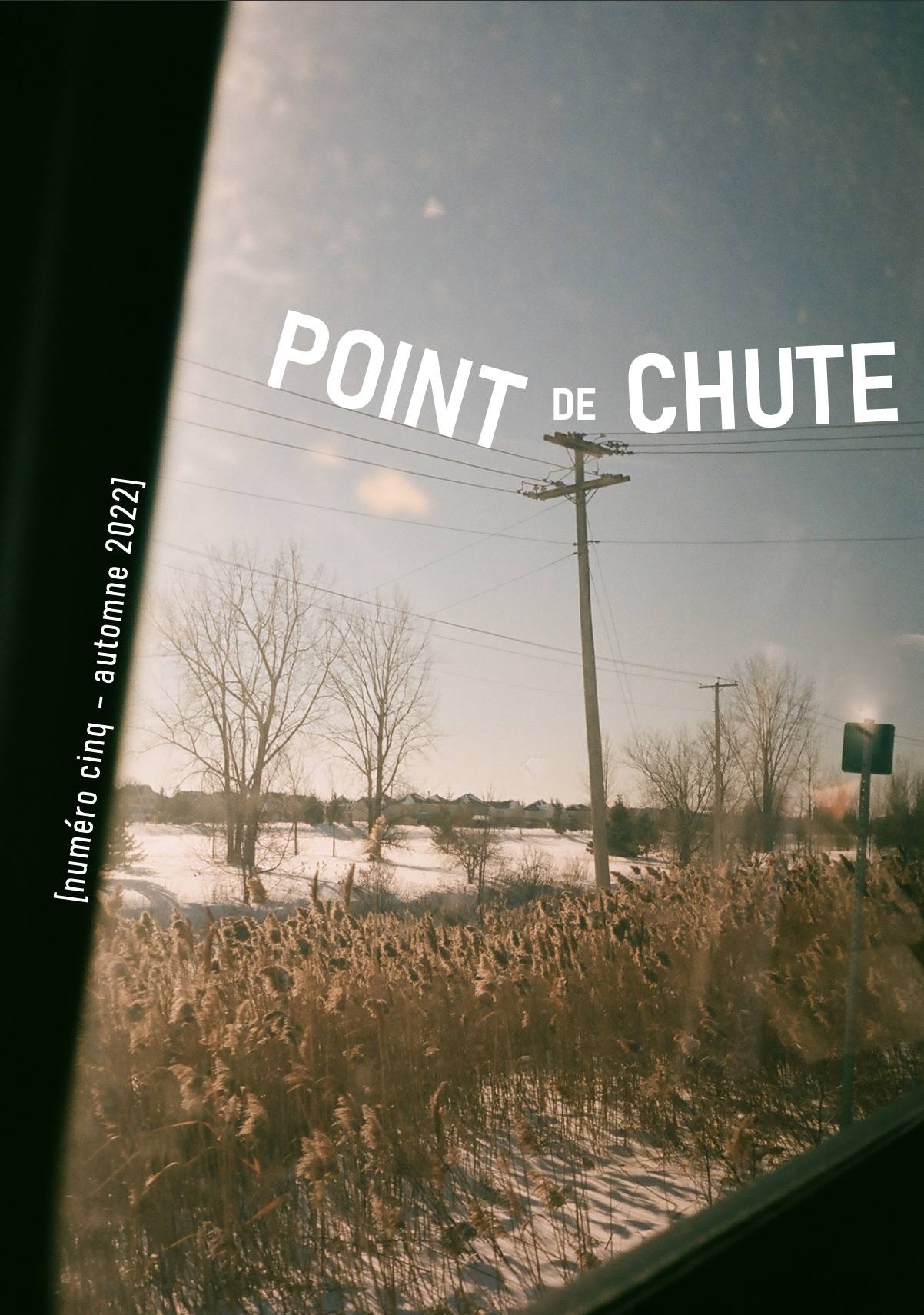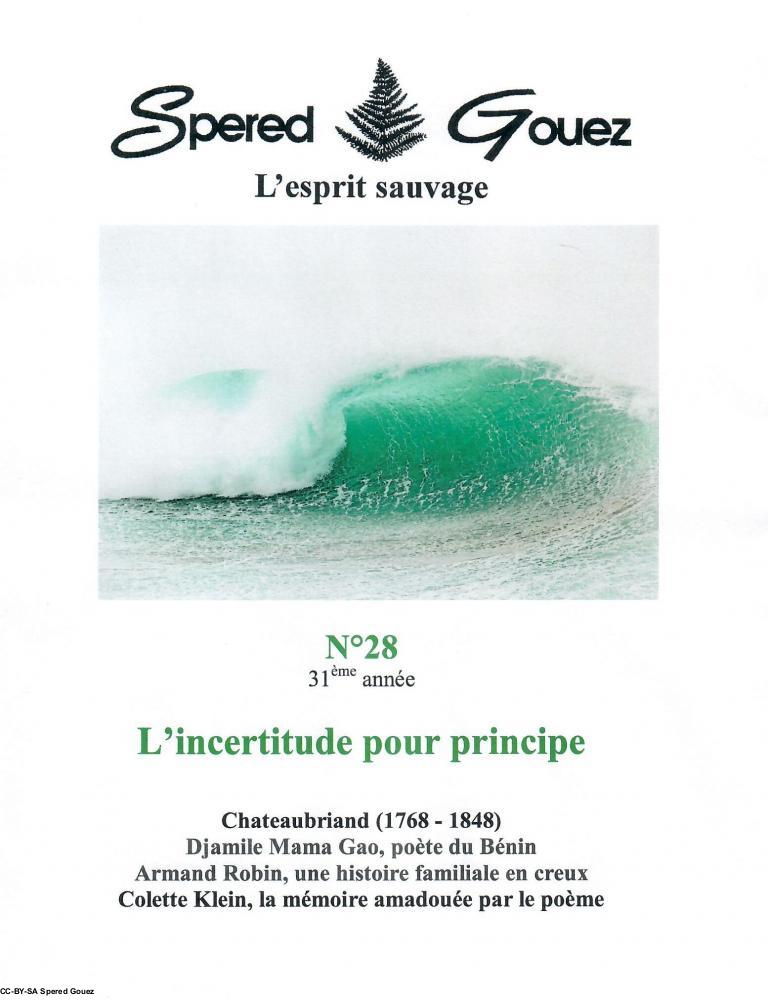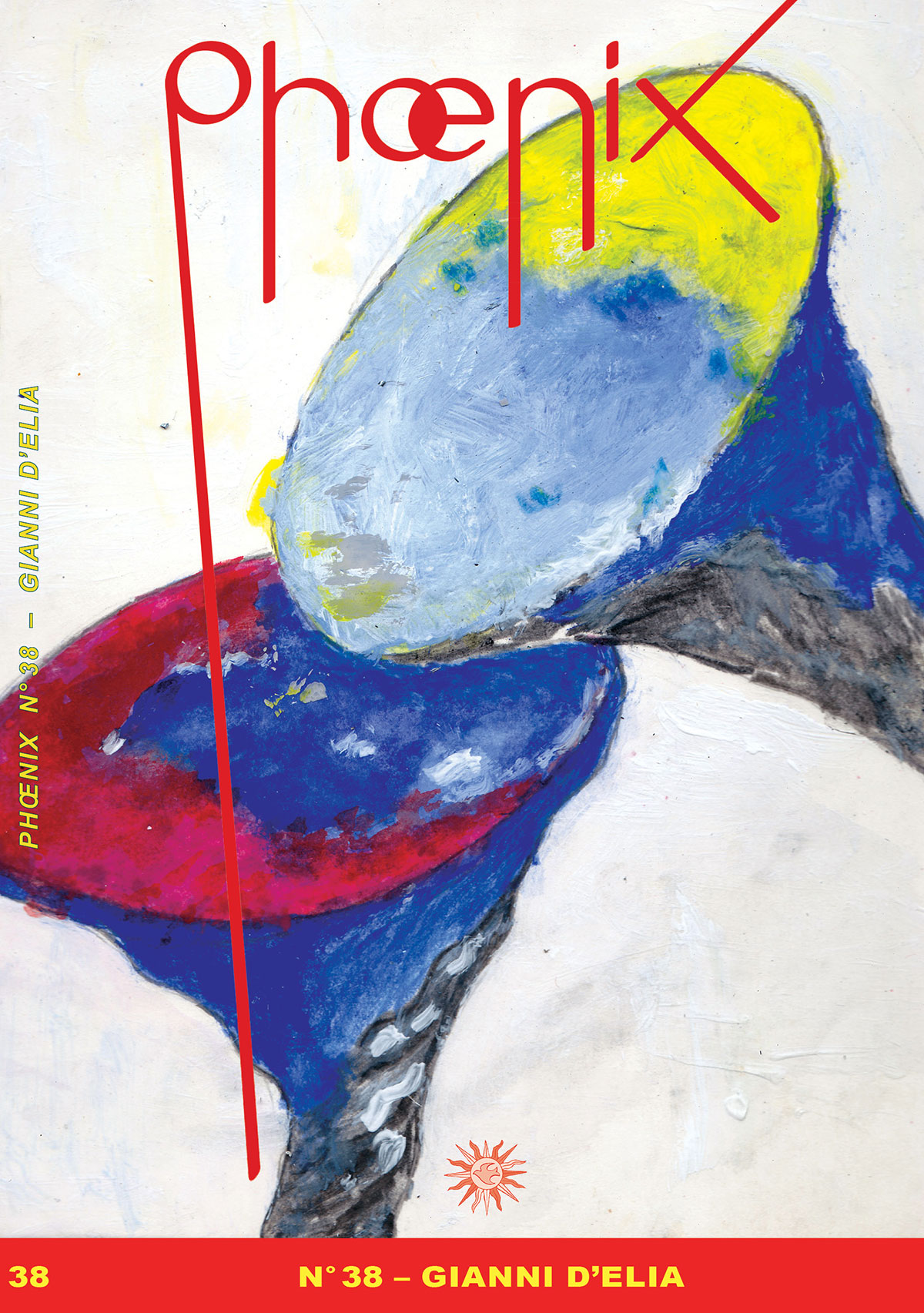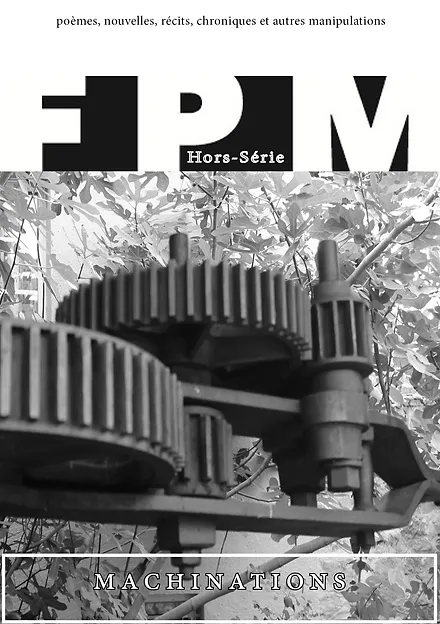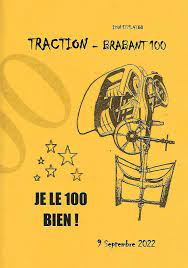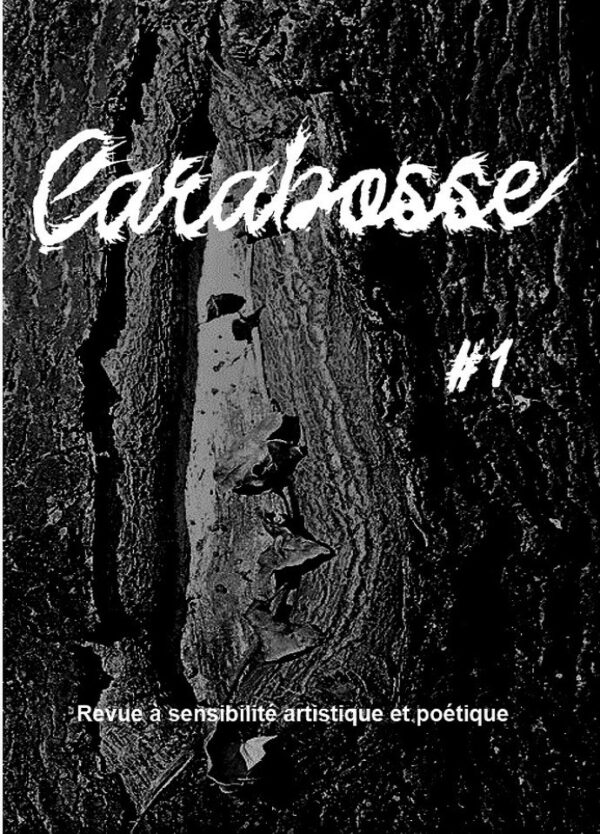S’inscrivant ensuite dans La littérature de ma patrie, la Brève rhapsodie civile de l’Italie Poétique d’après Dante, Campanella, Leopardi, Saba, Pasolini et Roversi démontre comment depuis le mythe du combat entre les frères Romulus et Rémus, l’Italie dès lors « fratricide » a été jusqu’à présent incapable d’une révolution véritable qui supposerait une destruction de l’ancien, autrement dit un « parricide », mais le poète italien ne renonce pas cependant à « L’écrin du rêve » : « Pourtant, nous avions un rêve, / non seulement jouir / du jour présent, mais / la joie aussi de le partager avec les autres, / avec les compagnes et compagnons de lutte, / tu te souviens ? » Signe également d’un compagnonnage artistique, la Lettre à Gianni D’Elia de Mario Richter fait vibrer la formule affectueuse de son adresse en fraternisation véridique : « Très cher Gianni, ». Reprenant par la suite à son compte la question initiale, Filomène Giglio se demande à son tour : « Mais enfin, à quoi ça sert, traduire la Poésie ? ». Elle sous-tend sa volonté de « ressentir, penser, tisser : traduire la poésie de Gianni D’Elia ». Enfin, le dossier s’ouvre sur deux poèmes inédits de Gianni D’Elia, traduits par Filomène Giglio et Franck Merger, faisant de la figure du « Poète » « Le versificateur / Du futur antérieur » et évoquant comment « La musique du temps » « Ramène à l’inachevé… »
Dans le « Partage des voix » entremêlant paragraphes en prose et strophes en vers, Fabrizio Bajec, Marilyne Bertoncini, Alain Brissaud, Aodren Buart, Alain Fabre-Catalan, Christophe Forgeot, Christophe Frionnet, Myrto Gondicas, Bernard Grasset, Pierre Landete, Claude Tuduri tissent les fils de leurs textes respectifs… Ainsi dans deux poèmes, « Poète-cormoran », en hommage à Tristan Cabral, et « Palingénésie », sur les œuvres croisées de la sculptrice Michèle Brondello et du peintre Marcel Alloco, Marilyne Bertoncini interroge la matière des œuvres – mots, plâtre ou toile – et son impact sur la création artistique et sa finalité : « La toile panse-t-elle aussi l’imperfection du monde ? »
Exploration également des arts plastiques, la prose poétique de Bernard Grasset questionne la démarche d’Aurélie Nemours, en empruntant des citations à ses écrits pour nourrir sa propre pensée, sondant l’énigme de la création : « « La vie est dans l’être ». Nuit et lumière. De l’éclat du silence jaillit le sens. Jour de fête, de calme allégresse. L’expérience a le sceau du brasier. Pureté du ton, encre de l’aurore. « Il faut choisir le mystère. » »
Quête d’absolu qui anime également le parcours de Maryse Gandolfo avec Gérard Neveu dont Louis Rama donne « Éclairage » de « La correspondance inédite de deux jeunes poètes – Une découverte », de 1943 à 1944 ! D’abord sa correspondante émerveillée, avant de devenir la compagne et la collaboratrice du peintre Pierre Ambrogiani, pendant 14 ans, puis collectionneuse d’œuvres d’art, elle s’affirme non seulement figure marquante du monde de la peinture à Marseille mais encore et avant tout poète ! En témoignage de cette première rencontre qui restera néanmoins amour idéalisé de Gérald Neveu pour sa jeune égérie, Maryse Gandolfo compose des poèmes ratifiant leur histoire commune et traçant dans ce dernier un chemin nouveau, celui d’un salut possible au-delà de la séparation envisagée : « les désespoirs sont inutiles / une autre Vie / une autre Ville. »
Invité des « Voix d’ailleurs », Umberto Piersanti, présenté par Cristina Bizzarri, et traduit par Monique Baccelli, dont les thèmes de prédilection sont d’une part, le temps différent, et d’autre part, les lieux perdus. Du moment magique de la contemplation d’un paysage après l’ascension d’une montagne à celui d’un retour à un lieu de mémoire, chargé de l’histoire tant familiale que personnelle du poète, son écriture condensée à l’essentiel semble graver, dans certains des poèmes choisis, l’instant crépusculaire, le soir d’une vie, ce retour aux racines : « ce sont les arbres secs, / douloureux, / seul qui a longtemps souffert / dans la vie / revient toujours ici / et tourne autour / avant que le soleil ne descende / et obscurcisse tout »...
En écho dédoublé, en double « génie du lieu », à juste titre, « Génie d’Oc », François Bordes propose dans « NOIR DE NUIT » le portrait en miroir de « JOË BOUSQUET PAR JACQUES HENRIC » : « Le Sud. Aux confins de l’Occitanie, à quelques kilomètres des terres catalanes. Départementale 627. Un homme du Sud conduit, seul dans la splendeur. » : cet homme, c’est Jacques Henric. Il aperçoit « la lointaine masse des Corbières » : « Pays ascétique et pur, mystique et hérétique, dissident en diable qui a porté et vu vivre l’un des plus grands poètes du vingtième siècle » : cet homme, c’est Joë Bousquet, « l’homme foudroyé, frappé par une balle sur le champ de bataille en 1918. », « l’homme fracassé, le poète à la colonne vertébrale brisée, au sexe inerte qui pourtant, envers et contre tout réinventa un art de dire et de vivre l’amour. » Double visage dans la traversée de cette nuit d’errance au cours de laquelle Jacques Henric verra également sa vue se voiler avant la guérison du regard, nuit commune, nuit en partage, nuit complice annonciatrice de la levée du soleil, œil réparateur !
Aube sur les presqu’îles d’une parole en « Archipel », les « Sporades » : Pascal Gibourg, « Besoin d’envol » où remonte sans cesse cette parole naissante : « Les mots viennent d’un lieu incertain, telle une eau souterraine, une source inexpliquée. », Jean-Paul Rogues, « La neige au crépuscule » où l’expérience glissante au soir qui descend rend cette même parole rare : « Il est alors très dur de se mettre à parler, de retrouver les mœurs d’un langage qui semble en état de fabrication à côté de la consistance terrible des choses. », Katia Bouchoueva, « Petites criques de charme » où l’auteur confie : « J’y ai trouvé aussi de courtes et belles / paroles dans les platanes / deux petits oiseaux perdus (à qui ? à vous ?) », Maud Thiara, « Tu écris sur toile à cerf-volant » où s’entend « ta langue de pierre / où muer peut-être », Anne Mulpas, « Ciel-qui-lit (lecture de Juin sur Avril de Elke De Rijcke) » où l’on perçoit : « L’émotion tisse les fils de la pensée. »
Jacques Lucchesi, en critique d’ « Arts », se livre, quant à lui, à un panorama de trois expositions récentes : Hôtel de Caumont : Raoul Dufy et l’ivresse de la couleur, Art-O-rama, 16ème édition, Vues sur la mer au Musée Regards de Provence, où la sagacité du jugement se conjugue à l’élégance du style, tandis qu’André Ughetto s’exerce au « Grappillage N°7 » rendant tout le suc de sa récolte en grappillant des ouvrages récents : Arnaud Villani, Petites vignettes érotiques, chez Unicité, L’Exigence de la chair, poèmes de Nathalie Swan, aux éditions de Corlevour, Dits de la pierre, de Bernard Fournier, chez La Feuille de thé, et enfin, Vers l’apocalypse, de Jean-Luc Steinmetz, au Castor Astral… La revue PHŒNIX N°38 s’ouvre alors aux diverses autres « Lectures » par leurs multiples lecteurs avisés : Etienne Faure, Gérard Blua, Philippe Leuck, Murielle Compère-Demarcy, Michel Ménaché, Franck Merger, Karim De Broucker, Nelly Carnet, Anne-Lise Blanchard, Jean-Pierre Boulic, Nicolas Rouzet, Claude Berniolles, André Ughetto, Nicolas Jaen, Lénaïg Cariou, Anne Gourio, Charles Jacquier, Jean-Paul Rogues… À travers cet amour partagé de la poésie, ouvrons encore le partage par la formule conclusive de l’avant-propos de Karim De Broucker : « Difficile de pratiquer la poésie sans amour, ou d’aimer sans poésie… Paul Éluard lui aussi voyait les deux ne former sur ces cartes que le flux d’un unique océan : « L’amour la poésie ». »