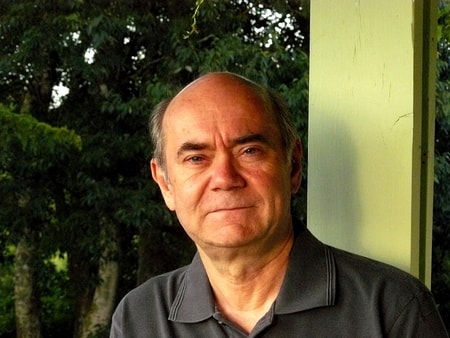Par cette lettre ouverte, je voudrais dire à ceux que l’avenir de la poésie préoccupe qu’aucune raison d’espérer n’est plus forte que celle qui naît de l’expérience même. Ce n’est pas ce qu’une société pense ou ne pense pas de la poésie qui constitue son identité propre, ni ce qu’elle en fait ou n’en fait pas qui détermine sa fonction réelle.
C’est, au contraire, ce que la poésie nous livre d’elle et, à travers elle, de notre société, de notre monde, du réel, de nous-mêmes, qui décide de sa pertinence et de son importance. Tant que la poésie témoignera à travers nous de cette façon-là, rien ne saurait interdire que quelques-uns d’entre nous soient puissamment aimantés, guidés, déroutés par la lecture, l’écriture, l’expérience du poème et s’appliquent à les mener plus loin.
La question des raisons d’être de la poésie et de son avenir est une question récurrente, au moins depuis Platon, mais qui est devenue de plus en plus insistante depuis la seconde moitié du siècle dernier. Cette question prend des visages divers selon ceux qui la posent, si bien que l’on peut se demander s’il s’agit toujours de la même question ou de plusieurs questions confondues dans la généralité de son énoncé. Est-ce bien la même question, en effet, que se sont posée les philosophes et les écrivains, les critiques et les lecteurs, les romanciers et les poètes, les avant-gardes et les éditeurs ? Toujours est-il que la convergence de ces multiples doutes a fini par créer autour de la poésie une atmosphère délétère dans laquelle elle a le plus grand mal à se manifester socialement et à se justifier. Prise entre l’indifférence médiatique et le soupçon philosophique, entre la défiance politique et l’asphyxie économique, la poésie ne peut esquiver les multiples augures de sa fin plus ou moins proche. C’est, je crois, d’une lucidité inédite touchant à sa nature, à ses pouvoirs, à ses limites, que dépendent aujourd’hui la motivation et le courage nécessaires pour en poursuivre l’aventure et faire mentir les Cassandre d’une mort annoncée.
Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de mots aussi employés aujourd’hui que le mot « crise ». L’usage en est si général qu’on ne peut s’empêcher de penser qu’il désigne moins un point critique dans nos affaires humaines que leur état général, voire leur cours naturel. On parlera donc de crise économique, de crise de la famille, de crise du couple, de crise de la fonction paternelle, de crise de l’Église, de crise des banlieues et, bien que moins d’esprits s’en émeuvent, on parlera aussi, entre personnes concernées, d’une crise de la poésie. Mais mon propos n’est pas de détailler les symptômes que l’on associe classiquement à ladite « crise » de la poésie et que chacun connaît, je préfère me concentrer sur le foyer de la question et me demander en quoi une telle « crise » reflète la nature profonde de l’expérience poétique. Au fond, ce qui m’intéresse d’abord ici ce n’est pas le délaissement social de la poésie, mais les raisons internes qui peuvent justifier la poésie à ses propres yeux et soutenir ainsi la perpétuation de son expérience et de sa pratique.
La poésie, à l’instar d’un organisme vivant, a‑t-elle atteint un point critique au-delà duquel son existence n’aurait plus de sens, de raison d’être et serait de ce fait menacée, voire déjà condamnée ? Cela insiste, devient un leitmotiv depuis le bilan paradoxal d’Une saison en enfer et le renoncement qui l’a suivie. On se demande, compte-tenu de la stature de Rimbaud, ce qui a pu s’arrêter là, s’interrompre, s’achever. On se dit que si ce n’est pas l’aventure poétique elle-même, c’est au moins un certain rapport de la poésie à l’innocence. Il semble bien que, depuis la Saison, les Illuminations, le Harrar, non seulement la poésie ait atteint un point critique, mais encore qu’elle se soit reconnue dans la nature même de ce point critique. Cela ne veut pas dire qu’elle soit dès lors entrée dans une crise qui condamnerait son existence, mais qu’elle s’est éveillée tout à coup à sa fonction première qui est d’explorer et d’aménager l’espace ouvert en nous par une crise plus profonde, plus originelle, une crise consubstantielle au langage humain. Cette crise, en quelque sorte organique, du langage humain, qui deviendra un thème récurrent dans tous les domaines des sciences humaines, de la critique littéraire et de la philosophie du siècle écoulé, résulte d’une tension entre les propriétés de ce langage et celles du réel qu’il a vocation de cerner et de communiquer. Appuyé sur des langues construites autour d’un principe d’identité, de fixité, de régularité, de répétition, sa chasse à un réel qui ne cesse d’en déjouer les pièges par sa mobilité constante, son unicité, son opacité, semble vouée à l’échec, non pas à un échec momentané, accidentel, mais à un échec structurel dont la logique serait contenue dans les prémisses mêmes des rapports de toute langue au réel.
Le dévoilement de l’aporie matricielle des relations entre langage humain et réel s’est doublé d’une autre révélation, celle d’une division de l’humain entre « l’homme fictif », qui est l’homme tel qu’il se représente à lui-même, et « l’homme réel », qui est ce qui se produit réellement sous cette fiction.
Les représentations que l’homme se construit de lui-même peuvent osciller entre fantasmagories et élaborations rationnelles, elles se soldent toutes par ce « reste » qu’est « l’homme réel », qui demeure hors d’atteinte de leurs discours. Vers cet « homme réel », il n’y a pas de progression asymptotique du discours, ainsi que pouvait le laisser penser un certain optimisme scientifique, juste un mur auquel on se heurte, celui dont chacun peut faire l’expérience chaque fois qu’il cherche à exprimer ce qui se passe en lui ou à deviner ce qui se passe en l’autre. Cela n’est pas dû à une erreur originelle que l’homme aurait commise en prenant conscience de lui-même et qu’il suffirait de corriger, non, l’homme n’a pas fait cette erreur, c’est cette erreur qui l’a fait, la corriger interromprait purement et simplement la « fabrication » de l’homme.
Il y a donc, au commencement, cet engendrement disjonctif de l’homme en ses deux parts indissociables : l’homme fictif et l’homme réel. Mais les hommes n’aiment pas se vivre ainsi, coupés en deux, et préfèrent en général donner à l’homme fictif la valeur de l’homme entier, escamotant au passage l’homme réel. Le monde issu de ce tour de passe-passe fonctionne sur un mode romanesque, c’est grosso modo le nôtre, celui que nous appelons « réalité » et qui est si lourd de malentendus, de crispations, de violence. D’autant plus lourd que l’homme réel y sera plus complètement exclu de ses calculs. Chaque civilisation a ménagé les trous qu’elle pouvait dans cette « réalité » afin de conserver un contact, fût-il silencieux, avec son homme réel. Longtemps, les religions en furent garantes et donnèrent à ces trous les couleurs du divin. Mais leur bord est friable et leur comblement constitue une menace perpétuelle. Lorsque Nietzsche proclame que « Dieu est mort », il parle de cela, de la faillite d’un certain type de trou et de la nécessité d’en creuser un autre qu’il dira « dionysiaque ».
Dans cette affaire, contrairement aux idéologies, la poésie ne joue pas l’homme fictif contre l’homme réel, mais elle ne joue pas plus l’homme réel contre l’homme fictif. De même, elle ne joue pas plus le langage contre le silence, que le silence contre le langage. C’est, en tout état de cause, une travailleuse des bords, des arêtes, des bonds, des enjambements, des inversions, des passages, des portes dérobées, une orpailleuse d’échos plus que de certitudes. Elle tamise toute réalité pour recueillir les paillettes de sens qui éclairent, précisent, renforcent ces fragiles margelles, qui sont autant de formes d’alliance disjonctive entre l’homme fictif et son homme réel. Est-il bien nécessaire, en ce cas, que la poésie se vende aussi facilement que le dernier logiciel de jeu à la mode pour que nous soyons rassurés sur sa pertinence et la cohérence interne de son expérience ? Pour ma part, je ne le crois pas. Même si nous ne sommes pas tant que ça à entrevoir l’universalité de la fonction poétique chez l’être parlant, celle-ci est chevillée au corps de chacun, et, en ce sens, elle demeure, consciemment ou pas, l’affaire de tous. Et puis, le meilleur, le plus vaste, le plus complexe de son aventure sera toujours devant elle, jamais derrière. Il suffit de recourir et consentir à l’étrange « logique » du poème, ainsi que nous y invite votre revue, pour que celle-ci s’éclaire et devienne presque une évidence. C’est par là que nous pouvons voir qu’il y a toujours, dans ses « poches trouées », de l’inouï, de l’extrême, des trésors qui sentent le soufre, et encore, promis à ses « semelles de vent », d’insolites voyages pour ceux qui sauront apprivoiser le vertige du réel et communiquer à travers leur innocence ou leur stupeur.

Dans cette attente sans objet qui scelle notre passion d’écrire, nous, qui apprenons patiemment à capter et déchiffrer l’écho du choc premier de la parole en chaque chose, n’avons d’autre preuve de la poésie que le poème. Par lui, sans d’abord le savoir, nous témoignons de l’étrange commotion et de l’erreur qu’il faut pour faire un homme, et par lui inventons le retournement sans lequel cet homme falsifié masquera toujours de son roman cette parole des choses flottant entre lui et l’homme réel. Sauf enfermement binaire en quelque avenir automate, comment cela pourrait-il prendre fin sans que s’achève le parlant ? Les logiques inouïes, que le poème met en œuvre presque sans nous et que nous découvrons après l’avoir écrit, sont les échelles de Jacob qui relient, non pas la terre au ciel, mais l’homme falsifié qui nous donne une forme à l’homme réel qui les défait pour tracer en nous, au-delà de leur espace à trois dimensions, le signe en creux du « transdimensionnel » qui est son espace ou non-espace, dans lequel il nous précède et nous attend.