Christine Durif-Bruckert, Les silencieuses
En ouvrant le dernier livre que Jacques André édite dans la belle collection « In Arcadia », nous ne découvrons pas un recueil de poèmes ou un poème en prose, mais un récit minutieux, qui, tout en étant le fruit d’une étude précise, se présente comme une fiction poétique.
Il n’est pas habituel qu’un chercheur donne une place de choix, en explorant un thème, à une création personnelle de cet ordre, même s’il est aussi écrivain. Certes, la littérature et l’art sous leurs diverses formes ont toujours fourni bien des exemples utiles à ceux qui se consacrent aux sciences humaines. Mais il est rare, inversement, que le résultat d’un travail de recherche trouve une sorte de complément sous une forme littéraire. C’est pourtant ici le projet avoué et réussi de Christine Durif-Bruckert, maître de conférence honoraire à l’Université Lyon 2, spécialiste de l’anthropologie et de la psychologie sociale, qui s’intéresse en particulier aux récits des maladies et aux situations d’emprise, sujets qui ont fait l’objet de plusieurs publications. Elle déclare en effet que le recours à l’expression poétique lui permet d’approcher et d’écrire ce qui, dans le réel, reste énigmatique, trouble, sauvage. Une illustration convaincante de la valeur de cette approche originale est donnée dans Les silencieuses, un livre inspiré par les thèmes de l’enfermement et de la maltraitance, qui s’ouvre sur le rappel du récit oral d’une femme, Suzanne R., source du récit écrit et structuré qui suit, rapportant des moments douloureux d’une enfance meurtrie.
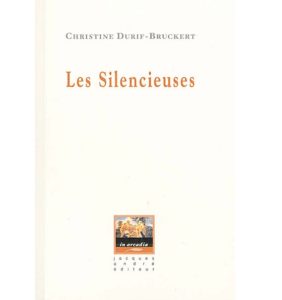
Christine Durif-Bruckert, Les silencieuses, collection In Arcadia, Jacques André Éditeur, 160 p., 2019, 15 €.
Les scènes de l’histoire se découpent en titres, en séquences, en arrêts-images, se frayant des passages dans les endroits les plus étroits, les plus confus, jusqu’à former un tableau reconnaissable de cette période de son enfance.
Dans la petite maison où vit Suzanne, âgée de six ans environ, avec sa famille, personne ne s’écoute ni ne se comprend… Rien ne permet de faire la différence entre le grave et le léger. Elle s’en échappe parfois pour rejoindre une clairière aimée (chapitre 1). Mais la solitude est plus grande encore dans la pension qu’on lui impose brutalement (chapitre 2), et surtout lors de la longue et douloureuse réclusion vécue ensuite dans l’appartement d’une grand-mère austère et distante qui l’enferme dans la maladie et la souffrance. La fillette s’interroge sur le sort qui lui est réservé sans trouver de réponse. Mais, dans un effort constant de résistance, elle sait inventer des lieux lumineux où courent ses petits chevaux de bois, où vivent ses rêves et se réfugient les multiples personnages qu’elle imagine (chapitre 3).
Les petits êtres de bois parlent entre eux tout en parcourant le carton peint de têtes chevalines. Ils tournent inlassablement sous une lumière légèrement jaunie, au fil des tracés que l’enfant a minutieusement anticipés. Elle sait manœuvrer leur stupide inertie.
Quand l’enfant est emmenée un jour dans la maison familiale où elle aimerait rester, personne ne la regarde (chapitre 4).
Suzanne devra attendre bien longtemps avant de décrocher les différents tableaux de son passé, avant d’éprouver le désir de raconter cette période amère de son enfance. Les mots vont alors lui permettre, à la manière de cette clairière attendue illuminant subitement la forêt, de percer l’obscurité du réel, de rendre le monde moins opaque, moins silencieux, comme le font les mots mêmes de Christine Durif-Bruckert dans ce récit poétique poignant.
