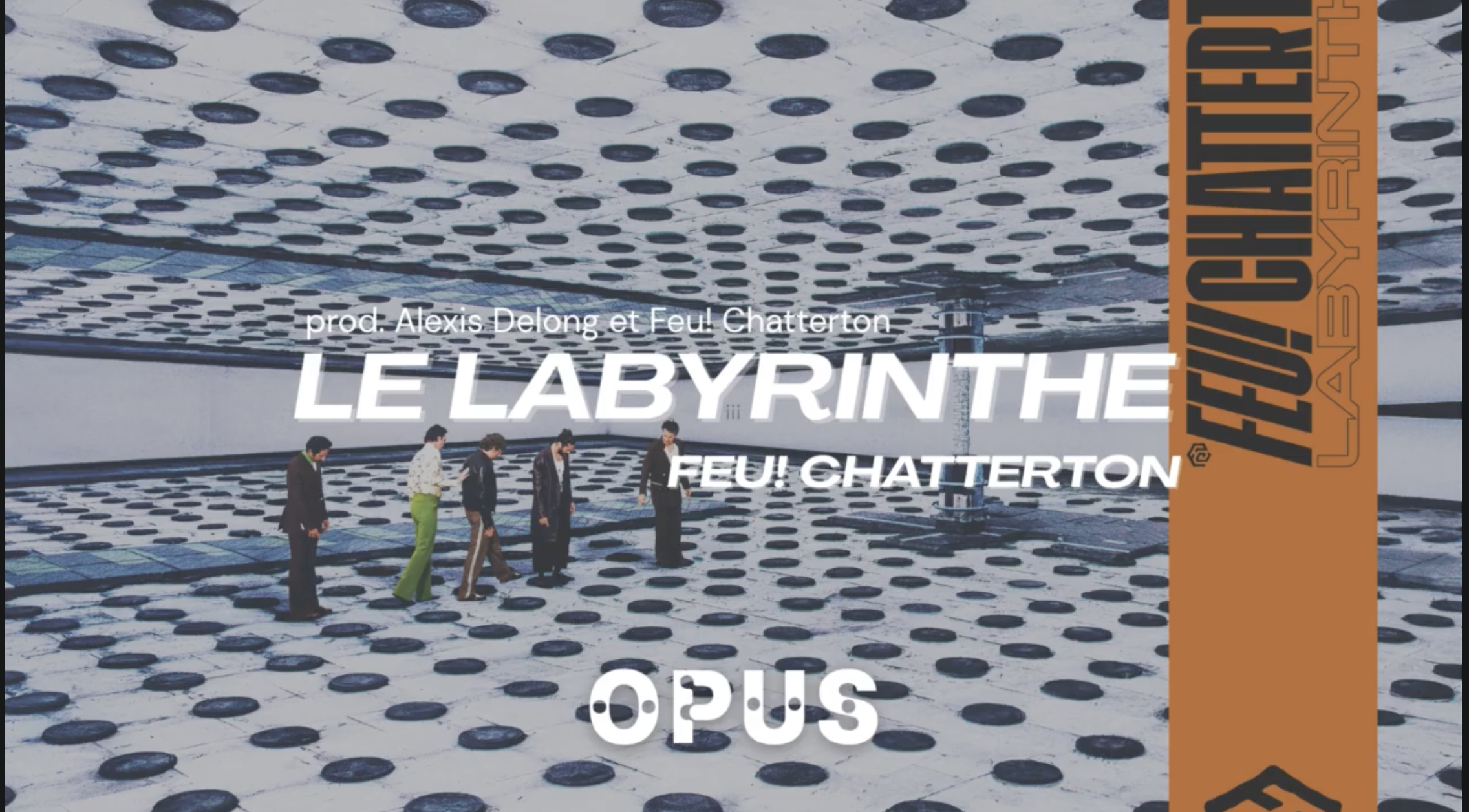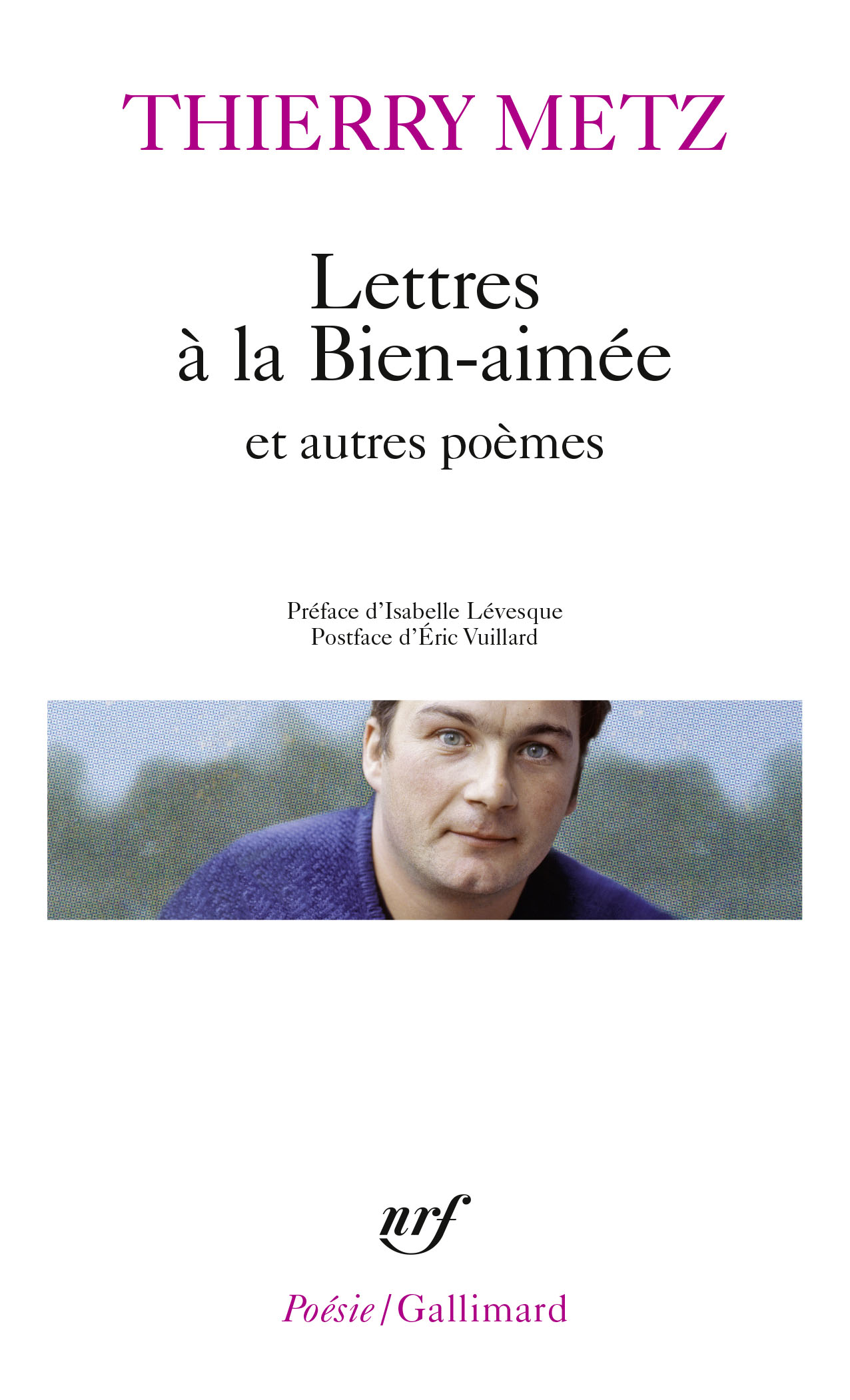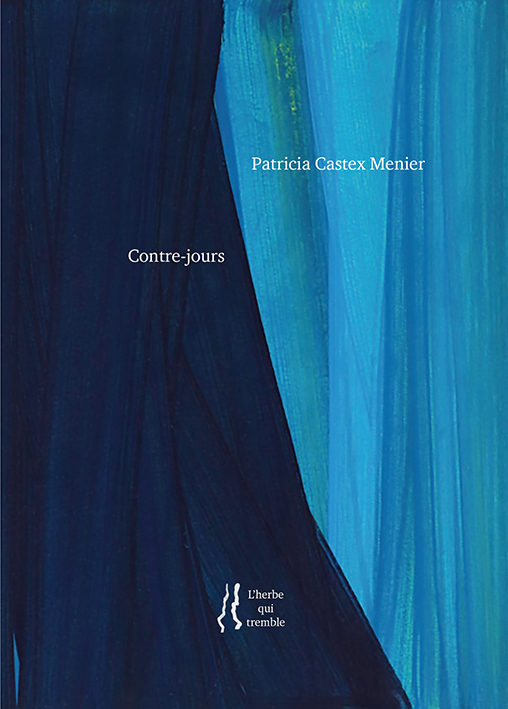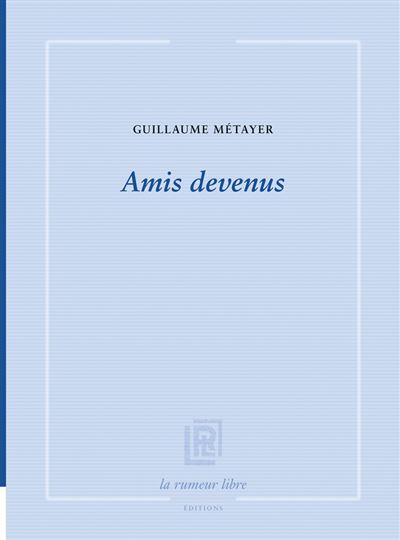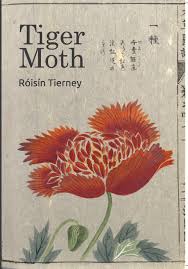32 historiettes (32 Little Stories), ensemble qui compose la première partie de Hard Light (Lumière crue), dont sont tirés les textes présentés ici, s’inspire de récits réels qui ont été contés à l’auteur par des membres de sa famille ainsi que par quelques autres anonymes.
Comme l’explique Michael Crummey : « Ma propre imagination hyperactive est responsable d’un nombre de morceaux complètement fictifs. Plus que toute autre, cependant, c’est la voix de mon père et ces histoires qui m’ont donné l’envie d’écrire tout cela. […] Une grande partie de ce livre est une collaboration entre moi-même et les Terre-Neuviens du passé et du présent. Certaines des personnes qui “parlent” n’étant plus parmi nous pour discuter de la manière dont ils sont représentés, je devrais donc dire dès le départ que certaines libertés ont été prises. »

Le travail de traduction a été multiforme, comme c’est le cas pour tout texte : il a fallu trouver le moyen de rendre la voix et le ton de ces personnes, leurs singularités, leurs individualités. Nous sommes ici dans un monde de pêcheurs, de mineurs et de paysans. La langue Terre-Neuvienne est très marquée d’un point de vue géographique (ce qui m’a amené à utiliser des régionalismes : pouding de pois, sous, piasses, câler les danses carrées) mais aussi technique (langue de la pêche à la morue, métiers de la mine et du bois, par exemple) : le chafaud, les pêcheries, stationnaire, pêcher à la turluttte, épinette. Mon choix traductionnel a été de favoriser une langue nord-américaine pour éviter de gommer cette réalité et ne pas avoir recours à une langue beaucoup trop franco-centrée qui me rebuten d’autant plus que je vis en Amérique du Nord. J’ai été amené à compulser l’incontournable Dictionary of Newfoundland English de G.M Story, W.J Kirwin et J. D. A Widdowson, mais aussi nombre d’ouvrages liés à la pêche à la morue en France et au Canada, sans oublier Saint-Pierre et Miquelon. Michael Crummey a répondu à toutes mes questions, ce qui est un avantage car les auteurs ne sont pas toujours disponibles à ce point.
Il faut enfin préciser que l’auteur éprouve beaucoup d’affection pour ce livre qui parle d’un monde disparu. Michael Crummey évoque cette relation avec beauté : « J’ai perdu ce sentiment enivrant d’être à l’intérieur de la matière, de la porter comme une couche de peau qui bouge et respire avec moi. Et l’éclat s’est terni par endroits, bien sûr. […] Cependant, j’aime toujours ce petit livre. […] Pour le vacillement de sa vie intérieure qui réussit à donner l’impression d’être toujours quelque chose de réel en moi, au bout de vingt ans. » Mon travail de traducteur était justement de retrouver cette immédiateté, de transmettre ces voix émouvantes qui font revivre un univers marin et rustique et qui rendent compte de vie certes laborieuses mais toujours nobles et fières. Le travail initial de traduction de ces textes s’est fait, en quelques mois, dans un envoûtement total tant j’avais été séduit par la beauté, la poésie et le réalisme de ces textes qui parlent d’un monde éloigné mais tellement proche.
Le 19 novembre 2014, Michael Crummey devant une salle comble au Centre de littérature canadienne, où il a lu Sweetland, Galore et Under the Keel.
∗∗∗∗
1
Ainsi allait la vie
Pour la première fois, le garçon voyage jusqu’au Labrador en tant que membre de l’équipage de son père. Ils ont charrié leur équipement jusqu’à Spaniard’s Bay en passant par Harbour Grace pour s’assurer un amarrage ; ils ont chargé filets, malles, gros sel et tonneaux dans la cale du Kyle, installant des habits et des filets sur leur amas d’affaires pour s’aménager un endroit pour dormir. Au moment où le navire quitte Carbonear, plus de deux cents hommes et garçons sont descendus dans la cale pour la traversée, ressac constant de conversations désincarnées dans la faible lumière, fragments de chanson s’élevant d’un coin à l’autre.
Une demi-douzaine d’Américains de Boston et de New York dorment sous des draps de coton dans les couchettes de première classe. Ils boivent du scotch de douze ans d’âge au salon, cuivre poli autour du bar, tache sombre de bois d’acajou sur les murs. Vêtus de manteaux de laine, appuyés sur la rambarde, pour regarder des cathédrales de glace dériver lentement vers le sud, un nuage d’esquimaux venant à la rencontre du navire à Rigolet et à Makkovic. Ils regardent attentivement à l’intérieur de la cale l’enchevêtrement de pêcheurs et de matériel, des mouchoirs pressés contre leurs nez pour se protéger de la puanteur qui monte. Ils peuvent à peine comprendre un mot prononcé par ces hommes. Un homme de la Nouvelle-Angleterre demande au garçon de poser pour une photo, un banc d’îles du Labrador en arrière-plan. Ses mains, tels des oiseaux piégés au bout de ses manches, raides, pas naturelles, il ne s’est jamais fait prendre en photo auparavant. La cravate du photographe est en soie.
Le garçon revient sur le pont autour des heures de repas, se plante près des hublots de la salle à manger pour observer les garçons aux vestes blanches porter des plateaux jusqu’aux tables, mains immaculées et fourchettes en argent fin, bouchées de rosbif et purée de pommes de terre, louches de jus de viande, gâteaux et tartes pour le dessert. En trois jours, il n’a mangé que des biscuits de mer et du thé, son estomac lui fait mal comme une dent qui devrait être arrachée. Ses yeux larmoient tandis qu’il regarde la nourriture disparaître, les assiettes renvoyées à moitié pleines. Les serveurs apportent des cafetières argentées, des digestifs ; les clients repoussent leurs chaises, allument des cigarettes, lèvent un doigt désinvolte pour se faire servir plus de sherry ou de whiskey.
Ainsi va la vie, le garçon n’en sait pas assez pour ressentir de la colère, il aimerait bien que les choses soient différentes, vaguement, sans attentes ; il se tourne vers le mouvement de l’eau, se coupant les paumes à l’aide des ongles de la main pour moins ressentir la faim. Il a trois ans de moins que le scotch sur les tables.
The Way Things Were
The boy is travelling to the Labrador as part of his father’s crew for the first time. They have carted their gear down past Harbour Grace to Spaniard’s Bay to be sure of a berth, loading nets, trunks, curing salt and barrels into the hold of the Kyle, settling clothes and twine over the mound of their belongings to make a place for sleeping. By the time the ship leaves Carbonear, more than two hundred men and boys have descended into the hold for the voyage, a constant undertow of disembodied conversation in the dim light, fragments of a song rising from one corner or another.
Half a dozen Americans from Boston and New York sleep under cotton sheets in the first-class berths. They drink twelve-year-old scotch in the saloon, brass polished around the bar, the dark stain of mahogany wood on the walls. They stand at the ship’s railings in woolen coats to watch cathedrals of ice drift slowly south, a cloud of Eskimos coming down to meet the boat in Rigolet and Makkovic. They peer into the hold at the tangle of fishermen and gear, handkerchiefs pressed over their noses against the rising stench. They can barely understand a single word these people speak. A man from New England asks the boy to pose for a photograph, a school of Labrador islands in the background. His hands like snared birds at the ends of his sleeves, stiff, unnatural, he has never had his picture taken before. The photographer’s tie is made of silk.
The boy comes above deck around mealtimes, stands near the dining room windows to watch white-coated waiters carry trays to the tables, spotless hands and sterling silver forks, mouthfuls of roast beef and mashed potatoes, ladles of gravy, cakes and pies for dessert. In three days he has eaten only hard tack and tea, his stomach aches like a tooth that should be pulled. His eyes water as he watches the food disappear, plates sent back half-full. The waiters carry in silver pots of coffee, after-dinner drinks; the guests push back their chairs, light up cigarettes, lift a casual finger for more sherry or whiskey.
The boy doesn’t know enough to be angry with the way things are, wishes they could be otherwise in a vague unexpectant fashion; turns toward the motion of the water, cutting his palms with his fingernails to feel the hunger less. He is three years younger than the scotch on the tables.
∗∗∗
Années cinquante
Après la mort de père, j’ai monté un équipage et je suis descendu au Labrador moi- même. J’avais tout juste seize ans alors et d’ailleurs les pêcheries battaient de l’aile, il ne m’a fallu que deux saisons pour me retrouver avec un trou de deux cents piasses.
J’ai décroché le boulot à la mine dans l’intention de rembourser ma dette et de me remettre aussi sec à la pêche. Un des autres pêcheurs stationnaires de Breen’s Island m’a écrit cinq ou six ans après mon départ, pour me demander mon bateau et mon chafaud, il a dit qu’ils étaient en train de pourrir. Je lui ai dit d’en faire ce qu’il voulait et je n’en ai plus entendu parler. De toute façon, à ce moment-là, je savais que c’était fini pour moi.
Mon premier Noël, de retour de la mine, je suis allé voir le vieux Sellars. Il m’a offert un whiskey et une tranche de gâteau, et m’a dit d’oublier ce que je lui devais. Mais il n’en était pas question. J’ai sorti une mince liasse de billets de cinquante piasses et j’ai compté deux cents piasses dans sa main. Des billets neufs, le papier aussi craquant que la première couche de glace sur un étang, à l’automne. Puis j’ai repris un verre de whiskey et je suis rentré chez moi, à moitié soûl et avec l’impression que j’avais perdu quelque chose à jamais.
Fifties
After Father died I got a crew together and went down the Labrador myself; I was just sixteen then and the arse gone out of the fishery besides, it only took me two seasons to wind up a couple of hundred dollars in the hole.
I landed the job at the mine intending to work off the debt and go back to the fishing right away. One of the other stationers on Breen’s Island wrote to me once I’d been gone five or six years, asking after the boat and the stage, said they were rotting away as it was. I told him to use what he wanted and never heard any more about it. I knew by then it was all over for me anyway.
My first Christmas home from the mine I’d gone up to see old man Sellars; he had me in for a glass of whiskey and a slice of cake and talked about forgiving some of what I owed him, but I wouldn’t hear of it. Pulled out a slender stack of fifties and counted off two hundred dollars into his hand. New bills, the paper crisp as the first layer of ice over a pond in the fall. Then I had another glass of whiskey and then I went home out of it, half drunk and feeling like I’d lost something for good.
∗∗∗
Michael Crummey évoque la mythologie et les réalités de la vie à Terre-Neuve présentes dans son nouveau roman, Galore. Penguin Random House Canada.
La dernière chanson de Stan
Le premier de l’an, les orangistes se réunissaient à la Loge, leurs écharpes drapant leurs poitrines couvertes de chandails et leurs pardessus, les casquettes de laine poivre et sel ou chapeaux melon laissant leurs oreilles dénudées face au froid. À huit heures du matin, ils étaient prêts à partir, marchant au pas dans Riverhead, puis ils traversaient les South Side Hills, remontant chaque ruelle avant de rejoindre le côté nord de Western Bay. Les catholiques restaient dans leurs cuisines lorsqu’ils passaient, trente-cinq ou quarante hommes chantant, les voix embrumées par leurs haleines dans le froid cinglant, les phylactères contenant les paroles des hymnes protestants. S’il y avait un membre de la Loge qui était trop malade pour se joindre au défilé, ils s’arrêtaient chez lui, pour chanter devant leur clôture I Need Thee Every Hour ou Just A Closer Walk With Thee, le malade reprenant le refrain depuis son lit.
Après le défilé, les orangistes retournaient à la Loge où les femmes avaient préparé un déjeuner. Soupe et sandwich pour 25 sous. Puis dans l’après-midi, récitations, chants et saynètes, et Tante Edna Milley arrivait à la moitié de son poème et oubliait le reste, chaque année c’était la même chose, les mots familiers s’effaçant tout comme les visages des proches morts depuis belle lurette. Le soir, un autre repas, suivi d’un discours, le pasteur ou Kitch Williams de l’école, neuf ou dix heures sonnait avant que ça se finisse ou qu’on débarrasse.
C’est alors que débutait le grand moment dans le hall, dans un grand tintamarre, les gens arrivant de toute la côte pour la danse, catholiques comme protestants. Une centaine de personnes dans la Loge, les tables et les chaises poussées contre le mur dans un bruit de raclement, le plancher en bois tanguant et grondant sous les tapements de pieds. Stan Kennedy joue de son accordéon et câle les danses carrées : Faites tourner votre partenaire, Reculez maintenant. Stan était complètement aveugle, mais pour ça, c’était un sacré accordéoniste, le visage levé vers le plafond comme un suppliant implorant le pardon. Il n’avait jamais pris de leçon de sa vie, son corps possédé par la musique, ses mains tirant des airs de l’air tandis que les gens lui criaient leurs requêtes.
C’est ce que tout le monde attendait avec impatience, cette danse-là. Stan jouait jusqu’à quatre heures du matin, il pouvait à peine prononcer un mot au moment où nous lui permettions de s’arrêter. La buée suintant aux fenêtres à cause de la chaleur des corps des danseurs.
Et la lumière grise de la lune indiquant le chemin du retour tandis que les gens sortaient dans le froid, leurs vestes pliées sur leurs bras, le son de la dernière chanson de Stan dérivant vers les étoiles.
Stan’s Last Song
On New Year’s Day the Orangemen gathered at the Lodge, their sashes draped across sweatered chests and overcoats, salt and pepper hats or bowlers leaving their ears bare to the frost. By eight o’clock in the morning they were ready to set out, marching down through Riverhead across the South Side Hills, up every laneway, then over to the north side of Western Bay. The Catholics kept to their kitchens when they passed, thirty-five or forty men singing, their voices mapped by clouds of breath in the bitter air, cartoon bubbles holding the words of old Protestant hymns. If there was a lodge member who was too ill to join the parade, they stopped at his home to sing outside the fence, I Need Thee Every Hour or A Closer Walk with Thee, the sick man joining in from his bed.
After the parade, the Orangemen went back to the Lodge where the women had prepared a lunch. Soup and sandwich for a quarter. Then afternoon recitations, songs and skits, and Aunt Edna Milley would get halfway through her poem and forget the rest, every year it was the same thing, the familiar words fading like the faces of loved ones long dead. In the evening another meal, and then an after-dinner speaker, the preacher or Kitch Williams from the school, it was nine or ten o’clock before that was finished and cleared away.
That was when the Time really got started, a clap of movement in the hall, tables and chairs scraped back against the walls, people arriving from up and down the shore for the dance, Catholic and Protestant alike. A hundred people in the Lodge, the hardwood floor pitching and rolling under the stamp of feet. Stan Kennedy playing his accordion and calling out the square dances, Swing your Partner, Now Step Back. Stan was as blind as a stone, but he could play that accordion, his face lifted to the ceiling like a supplicant seeking forgiveness. Never had a lesson in his life, his body possessed by music, his hands pulling tunes from the air as people shouted out requests.
It was what everyone looked forward to, the dance. Stan played until four in the morning, he could barely croak out a word by the time we let him stop. The windows dripping steam from the heat of the dancers.
And the grey light of the moon showing the way home as people stepped out into the cold, their jackets folded across their arms, the sound of Stan’s last song drifting to the stars.
∗∗∗
La loi de l’océan
Domino Run, Labrador, 1943
Durant les années de guerre, les Américains avaient des douzaines de bateaux sur la côte, qui effectuaient des relevés des îles et cartographiaient chaque recoin. Ils érigeaient des mâts sur tous les promontoires avec de petits lambeaux de soie au sommet, à quarante, cinquante pieds de hauteur pour certains. Nous n’avions aucune idée de la raison pour laquelle ils étaient là, mais nous volions chaque morceau de soie sur lequel nous tombions, les descendant du mât entre nos dents, ils étaient parfaits pour faire bouillir un peu de pouding de pois, ou à utiliser en guise de mouchoirs.
Un après-midi, nous étions au large en train de pêcher à la turlutte, à la mi-août, le temps suffisamment beau jusqu’à ce que la brise tourne et qu’un vent aussi chaud que des gaz d’échappement de fournaise souffle. Nous avons remonté nos lignes et nous sommes rentrés directement dans la Tickle, sachant à quoi nous attendre derrière. Nous sommes passés devant l’un de ces navires d’exploration sur notre chemin, planqué dans une crique peu profonde et ils n’avaient même pas jeté l’ancre, juste lancé un grappin. Nous nous sommes arrêtés pour les prévenir mais le capitaine nous a plus ou moins ri au nez, et la bourrasque s’en est venue tel que nous l’avions prévu, le vent suffisamment méchant pour décharner une vache.
Le lendemain matin, le petit bateau d’exploration se trouvait sur la terre ferme, emporté à une hauteur de plus de vingt pieds hors de l’eau. Lorsque ça s’est su, chaque bateau dans la Tickle a tout de suite mis le cap vers la crique et ça n’a pas traîné. Nous avons pris tout ce qui n’était pas boulonné, nourriture, argenterie, literie, livres et cartes, boussoles, alcool et vêtements. J’ai mis la main sur l’une de ces horloges mécaniques qu’ils avaient à bord, mais j’étais trop avide de la rapporter au bateau de Papa ; je l’ai cachée derrière un buisson et suis retourné vers le bateau pour prendre quelque chose d’autre. Et pas question que quelqu’un vienne me la voler.
Les Américains étaient plantés sur le côté, mais ils n’ont pas prononcé un mot. La loi de l’océan, vous voyez, objets de récupération. Nous étions comme une meute de sauvages d’ailleurs, soixante-dix ou quatre-vingts hommes et garçons grimpant à l’intérieur par le côté, que pouvaient-ils dire ? On a nettoyé le bateau en quinze minutes, comme si on essayait de sauver des souvenirs de famille dans un bâtiment en feu.
Les Américains ont envoyé un remorqueur plus tard ce jour-là pour le bouger de la terre ferme et nous avons tous aidé là où c’était possible, lançant quelques lignes autour de la tête de mât, le faisant balancer d’un côté et de l’autre jusqu’à ce qu’il se libère en se dandinant et qu’il glisse dans l’eau comme un phoque depuis une plaque de glace.
Nous n’avons pas cessé d’attendre qu’une autre occasion comme celle-là se présente, mais les Américains se sont montrés plus intelligents par la suite ou peut-être ont-ils été plus chanceux. C’est tout un travail de faire la différence entre les deux dans le meilleur des cas.
The Law of the Ocean
Domino Run, Labrador 1943
The Americans had dozens of boats on the coast during the war years, surveying the islands, mapping every nook. They had poles erected on all the headlands with little silk rags at the top, forty, fifty feet high some of them. We had no idea what they were there for, but we stole every piece of silk we came across, carrying them down the pole in our teeth, they were perfect to boil up a bit of peas pudding, or to use as a handkerchief.
We were out jigging one afternoon, mid-August, the weather fine enough until the breeze turned and a wind as warm as furnace exhaust came up. Took in our lines and headed straight back into the Tickle, knowing what to expect behind it. Passed one of those survey ships on our way, holed up in a shallow cove and they hadn’t even dropped anchor, just put out a grapple. We stopped in to warn them but the skipper more or less laughed at us, and the squall came on just like we said it would, the wind wicked enough to strip the flesh off a cow.
Next morning that little survey boat was sitting on dry land, blown twenty feet up off the water. When word got out, every boat in the Tickle headed straight for the cove and we made pretty short work of it. Took anything that wasn’t bolted down, food, silverware, bedding, books and maps, compasses, liquor, clothes. Got my hands on one of those eight-day clocks they had aboard, but I was too greedy to take it all the way to Father’s boat; hid it behind a bush and turned back to the ship for something else. And I’ll be goddamned if someone didn’t go and steal it on me.
The Americans were standing alongside but they didn’t say a word. Law of the ocean, you see, salvage. We were like a pack of savages besides, seventy or eighty men and boys climbing in over the side, what could they say? Cleared the boat in fifteen minutes, as if we were trying to save family heirlooms from a burning building.
The Americans sent up a tug later that day to take the ship off the land and we all helped out where we could, throwing a few lines around the masthead, rocking her back and forth until she shimmied free and slipped into the water like a seal off an ice pan.
We kept waiting for another chance like that to come along, but the Americans got smarter afterwards or maybe they just got luckier. It’s a job to say the difference between those two at the best of times.
∗∗∗
Les Brûlis
Imagine-le, si tu peux, l’oncle Bill Rose, arrière-grand-père, mineur à la retraite, homme à tout faire. Fais apparaître une silhouette à partir du peu que tu sais. Pardessus noir descendant jusqu’aux genoux, une canne, la bosse permanente de son dos causée par un accident à Sydney Mines. La scie de menuisier que ton père garde au sous-sol qui porte ses initiales : W.T.R.
Jeune homme, il a participé à la construction de l’Église Unie de South Side, quinze sous de l’heure pour son labeur. Il a fait voile vers le Cap-Breton. Il s’est ruiné la santé dans les mines à ramasser du charbon. Une demi-douzaine d’hommes de Western Bay morts dans l’accident qui lui a endommagé le dos, leurs corps rapatriés et enterrés aux Brûlis des années auparavant.
Il tient un atelier de menuiserie, à quinze minutes de la maison de sa fille, il s’y rend tous les jours sauf le dimanche, ouvre la porte sur une odeur de gomme d’épinette et de sciure de bois. Une famille étendue de ciseaux à bois en rang ordonné sur le mur du fond. Il fabrique des commodes, des bureaux et des bibelots. Un cadre de pin pour son propre cercueil, suspendu au mur, parfaitement aplani et peint des années avant qu’il n’emménage chez Minnie et son mari.
Sa femme est morte depuis plus longtemps que n’a duré leur mariage. Il sera enterré à ses côtés en 1951, à l’âge de quatre-vingt-treize ans, devenu alors un étranger pour elle, son temps dans les mines complètement oublié. L’église de South Side Hills, rasée, une planche gauchie à la fois, le vieux bois disloqué pour être brûlé comme bois de chauffage. Les outils d’une vie, liquidés, à l’exception d’une scie à main que ton père a prise dans l’atelier pour qu’on se souvienne de lui.
L’initiale du milieu, sur le manche, toujours un mystère pour toi.
The Burnt Woods
Picture him if you can, Uncle Bill Rose, great-grandfather, retired miner, handyman. Conjure a figure from the little you know. Black overcoat to his knees, a walking stick, the permanent hump on his back from an accident in Sydney Mines. The carpenter’s saw your father keeps in the basement engraved with his initials : W.T.R.
Helped put up the United Church on the South Side as a young man, fifteen cents an hour for his labour. Sailed to Cape-Breton, spent his health in the mines picking coal. Half a dozen men from Western Bay killed in the accident that crippled his back, their bodies shipped home to be buried in the Burnt Woods.
Keeps a woodshop fifteen minutes from his daughter’s home, he goes in every day but Sunday, opens the door on the scent of spruce gum, sawdust. An extended family of chisels in an orderly row on the back wall. He builds dressers, bureaus, knick-knacks. A pine border for his own grave hung in the rafters, planed smooth and painted years before he moved in with Minnie and her husband.
His wife has been dead longer than they were married. He will be buried beside her in 1951, aged ninety-three, a stranger to the woman by then, his time in the coal mines all but forgotten. The church on the South Side Hills torn down one warped board at a time, the old lumber broken up for firewood and burnt. His lifetime of tools sold off but for the one handsaw your father took from the workshop wall to remember him by.
The middle initial on the handle still a mystery to you.
Notes
1 Collines sises sur la rive sud de Saint-Jean de Terre-Neuve.
2 L’hymne I Need Thee Every Hour a été composé par l’Américaine Annie Sherwood Hawks (1835-1918) et mis en musique par Robert Lowry, son pasteur. Just a Closer Walk with Thee est un gospel traditionnel qui a été repris par quantité d’artistes.
Présentation de l’auteur
- Lorna Crozier — God of Shadows, une cosmogonie du divin - 6 novembre 2025
- Quatre poèmes de Michael Crummey - 6 janvier 2025
- Michael Crummey : poèmes tirés de Hard Light - 6 janvier 2024
- Lorna Crozier, de Vancouver au monde - 5 septembre 2023
- 9 poèmes de Patrick Lane - 1 septembre 2022
- Cinq poèmes de Thomas Krampf - 6 septembre 2021
- Cinq poèmes de Michael Crummey - 5 mars 2021