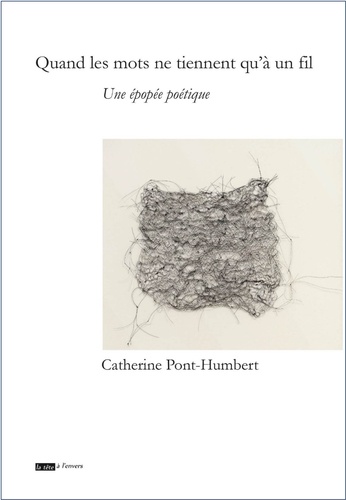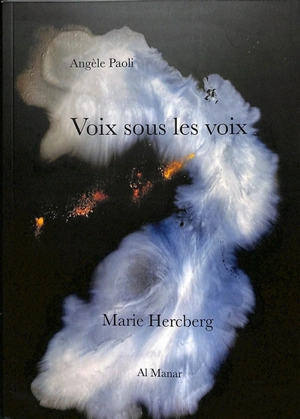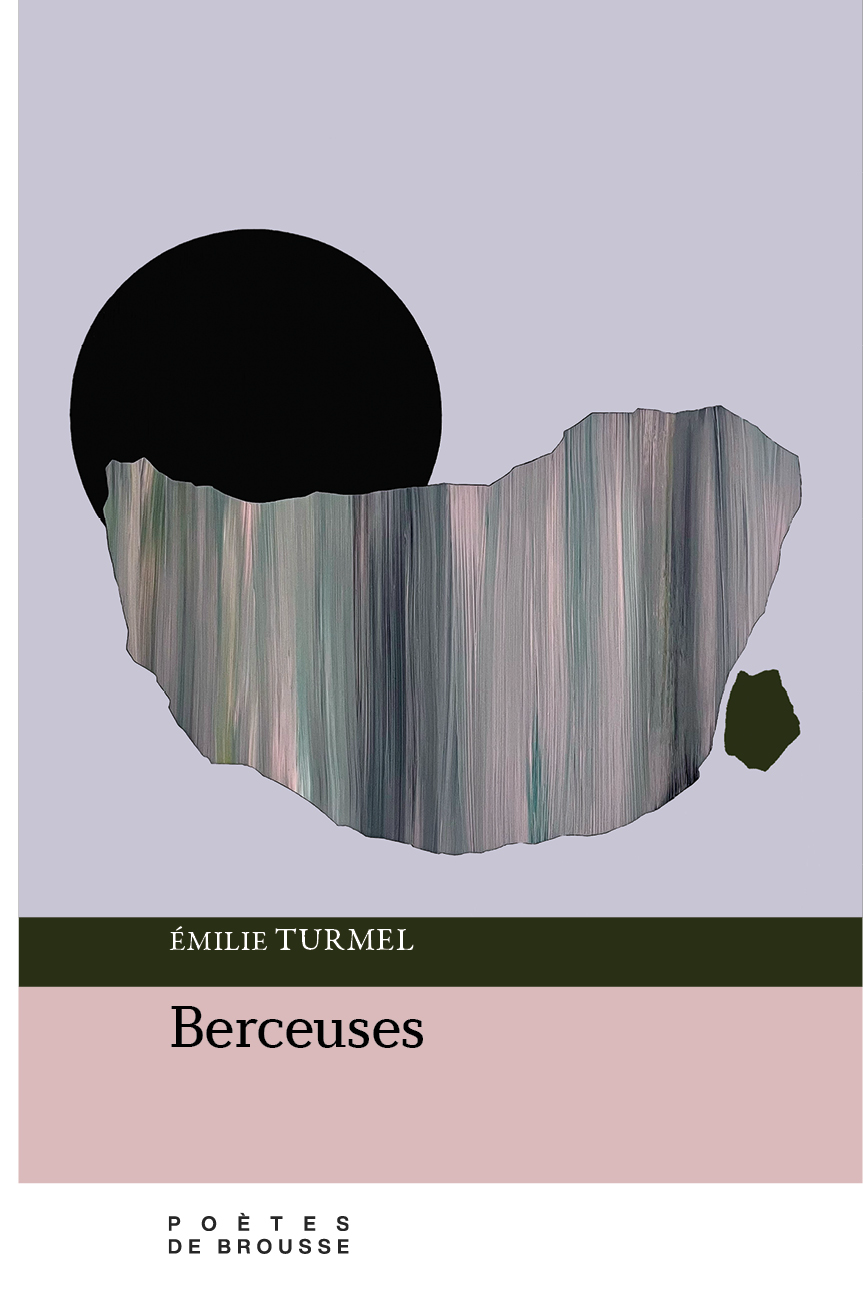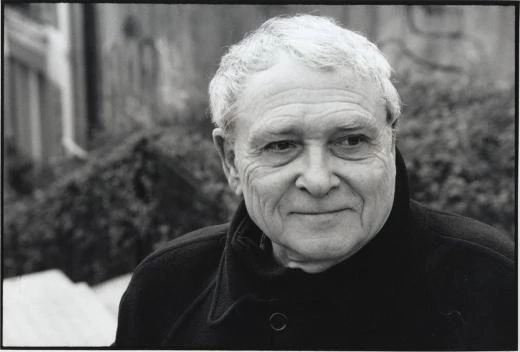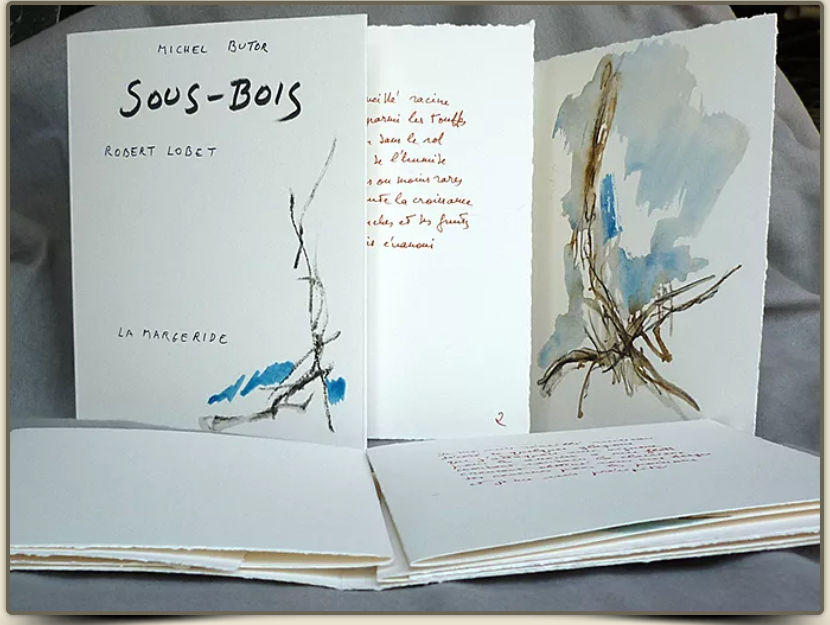Xavier Bordes, nous amorçons par cette question un exercice qui passionnera je l’espère au moins vous et moi. Une plongée dans votre être-poème. J’ai dans les mains votre premier livre publié chez Gallimard, “La pierre amour, poèmes 1972–1985”. Il s’ouvre par une dédicace “à la Femme que l’On dit mienne…”. Puis la voix d’Oscar Venceslas de Lubicz-Milosz nous apporte la provenance du titre choisi :
“Et comme au fond du lac obscur la pauvre pierre
Des mains d’un bel enfant cruel jadis tombée :
Ainsi repose au plus triste du cœur,
Dans le limon dormant du souvenir, le lourd amour.”
Ces vers inaugurent une page nommée “Avant le hasard”, qui elle-même se tourne sur une page nommée “Achillées” qui, comme une divination guérisseuse à laquelle son nom renvoie, s’ouvre par ce vers : “Flûte éparse aux roseaux solitaire”.
Ce mouvement d’amorce, ce maillage sémantique, passant de la Femme à la flûte, c’est à dire de la Poésie au Chant, ou du Mystère au Chant, se dit “avant le hasard”.
Xavier Bordes, au commencement ontologique, il s’agirait donc d’affirmer l’Amour par la divination soignante du poème ?
- Xavier Bordes : Pour un être humain ordinaire, ce que je suis, l’amour est avant le hasard, puisque lorsqu’il n’est pas stérile, nous en sommes « l’effet », l’enfant. Cependant lorsque cet enfant se ressaisit en tant que poète, il entre dans le hasard, il quitte la filiation ; il fait une révolution intérieure. Le voici « sans père », et son instrument symbolique, la flûte, est donc orpheline, solitaire comme Orphée, errant amour fondamental du « monde », éparse dans son chaos à la naissance du chant qui va se traduire par les «roseaux», les calames qui servent à écrire. Le premier poème des Achillées n’est donc pas encore un hexagramme du Yi-King, comme le sont les autres. C’est un « octogramme », chiffrant le 8 de l’infini, le quatre de la vérité de l’aller, additionné du quatre de la vérité du retour. Une figure du encore hors-temporalité. L’entrée dans la vie fusionnant avec l’annonce de la sortie, la mort, « augment métaphysique ».
Vous employez le mot de divination soignante, c’est assez juste. L’amour, l’Eros des grecs, est ce qui aimante entre eux les humains ; les Grecs croyaient même que cela pouvait arriver aux pierres (ce que leur prouvait l’observation des magnétites), sorte de souvenir du temps où l’amour orphique faisait danser l’univers. L’univers, de fait, n’a rien d’uni, ni de désuni, avant que notre conscience ne lui donne l’existence, comme chaque nouveau-né le fait. Il apparaît alors chaos complet, désunion infinie. La seule chose qui permet de s’y retrouver, c’est la mère, « l’aimer la mère ». Fondement guérisseur du monde chaotique, par les liens et attractions qui se créent dans notre cerveau, notre corps qui pense. Cet amour peut être fille-mère/mère-fille (femme-femme) ou fils-mère/mère-fils (homme-femme), le rapport au père étant évidemment second et moins charnel puisque, nourrissons, l’on ne « mange pas » le père. C’est pourquoi la langue du poème doit être la langue « maternelle », celle dont nous avons appris physiquement la concomitance entre les phonèmes et les sentiments dans le temps où nos émotions étaient hormonalement indissociables de celles de notre mère, où nous vivions ses cris de colères, ses ronronnements amoureux, et tous les états enregistrés dès le septième mois par le fœtus en même temps que les articulations du langage correspondantes entendues à travers le corps maternel.
Dès la fécondation, le nouvel humain « entre dans le hasard », mais l’esprit ne commence à le faire, semble-t-il, qu’à partir de ce fameux septième mois. Il demeure que c’est ce qui donne à la « musique » de la langue maternelle, à ses intonations, la force émotive (inconsciente) que les autres langues apprises par la suite ne recèlent pas pour nous spontanément. C’est pourquoi certains poèmes, typiquement ceux de Verlaine tels que « soleils couchants » ou « le ciel est par dessus le toit…», ou « les sanglots longs… », ont, en dépit de la banalité relative de leur contenu de sens, une force émotionnelle pour un français, que n’éprouve pas un locuteur étranger.
En place de divination, à cette étape je dirais que l’amour, épars et sans vrai but défini encore, est le pressentiment que la vie sera un échafaudage (plus ou moins) logifiant du chaos. Le tracé de lignes unifiantes entre des choses qu’aucun rapport jusque là ne réunissait fondamentalement. C’est l’acte-même de « poésie », du « faire son monde ». Cette construction est l’érotisation des choses aperçues, saisies, apparaissantes par amour, au sein du mystère hétéroclite duquel nous naissons, sans boussole autre. Cette érotisation qui donne son relief inoubliable aux temps de l’enfance, prend la plume, le calame, pour livrer un témoignage en langage de cet univers « sui-generis », dépourvu de cause et de justification antérieure à lui-même, excepté l’héritage de la langue maternelle évidemment. Le poète est donc sans père, sans loi, hors de la cité, mais pas sans mère : sa mère, sa Muse, sa femme, c’est la « mer » de la langue maternelle dans laquelle lui et tous ceux qui parlent sa langue, baignent. Mais le poète y nage, y choisit des directions vers des îles mystérieuses ou paradisiaques, ce que Rimbaud représentait par la figure du « Bateau ivre », c’est à dire amoureux du monde, dionysiaquement ivre, et prêt à toutes les explorations à travers « l’inconnu » baudelairien, le monde chaotique.
L’amour, au commencement de toute œuvre, est la pierre sur laquelle se bâtit l’édifice poétique en entrant dans l’exister, c’est-à-dire le hasard, le hasard de la Rencontre au sens le plus général.
J’espère que cette réponse qui ne se veut pas de logique explicative, mais plutôt inspiratrice, vous offrira un commencement…
C’est un commencement infini que vous nous offrez là, et les chemins semblent tous de voies ouvertes. Il nous faut cependant en choisir un. Celui, peut-être, de l’acte de poésie, du “faire son monde”. La Pierre amour est un ensemble rythmé précisément par des éléments qui reviennent de façon presque métronomique : Les Achillées, hexagrammes poétiques sonnant comme les instantanés du mouvement, de la transformation de ce monde en cours de réalisation, les sonnets, les chroniques et, au cœur de cette trame, égrenés, les poèmes, le tout composant monde dans un démêlage d’avec la prose. Les vers du sonnet “Le cabinet noir” le laissent penser :
“Alors voici que, sans hâte, tu règles enfin le libre jeu des choses,
Tu sépares calmement de la prose
Le jeu du vers — t’essayant aux diverses flûtes”
Cette prose, dans le monde actuel, social, est partout, qui semble détramer le vivant. Le “jeu du vers” est-il l’enjeu du poème, c’est à dire l’enjeu de ce que la parole peut réserver à l’homme ?
Il vous faudra me pardonner si je vous dis que la formulation de cette question-ci m’échappe un peu. Alors, je vous réponds dans la mesure de ce que j’ai cru comprendre.…
L’affaire de la prose est un sujet délicat. Certains pensent que désormais le vers n’a plus lieu d’être.
Cela me contrarierait de devoir aller jusque-là. Pour ma part j’appelle prose un langage complètement indifférent à sa beauté propre (virtuelle), à la métrique, à son euphonie, et à leurs contraires utiles : « antimétrique », cacophonie, sur le plan matériel, Le vers peut avoir une apparence de prose, se tenir à équidistance (plus ou moins) entre le classicisme, mettons des alexandrins, décasyllabes, octosyllabes, etc… et la prose informe et journalistique. Il s’en distinguera (outre son contenu signifié) par la conscience de la construction formelle du signifiant dont il est fait : cette conscience fabrique les jeux d’échos sonores, les cacophonies qui se résolvent comme des accords musicaux en euphonies, les aspérités de prononciations, la balance des rythmes qui ne repose pas tant sur les syllabes que sur les accents (car contrairement à ce que l’on dit, en Français il y en a, et à ce propos, un nommé E. Charmeux avait jadis publié aux éditions de l’Ecole un bref mais remarquable travail intitulé « le système poétique français » qui contenait un tas de remarques judicieuses). Je me résumerai en disant qu’il y a vers sitôt que le langage qui se dit, l’énoncé, apparaît comme soucieux de son esthétique et de sa formulation. Après, on choisit de mettre en scène comme on veut : des vers plus ou moins longs ou courts, selon que l’on cherche à ce que le lecteur se ressaisisse plutôt de l’unité sonore mot, ou groupe de mots, ou verset, ou ambiance de page entière, etc… Selon qu’on veut signaler un jeu, présenter une image calligraphique en supplément. Tout dépend de ce qu’on entend, en tant qu’individu à goûts spécifiques, par « langage à son (plus) beau » : quand on est jeune, on varie et on « spectacularise » la mise en scène du langage sur la page. En vieillissant et prenant de la bouteille, on se détache davantage du jeu séduisant des apparences – mais l’inverse existe, tel que le Coup de Dés de Mallarmé.
Je ne sais pas bien si la prose « détrame » le vivant, ou ce qu’elle « trame ». Mais je sais une chose : elle avachit la pensée facilement, si on lui laisse la bride sur le cou. Elle s’étale, se disperse, dilue les idées, mange du temps avec des phrases vides, et façonne une uniformité universelle disposée à finir en baragoin franco-anglo-arabo-hispano-chinois d’ici une centaine d’années ou peut-être avant ! Dans la prose, il me semble qu’à l’opposé de ce que j’entends par « vers », rien ne se cabre, rien ne « tient debout ». On n’est attentif qu’au contenu de sens, sans se soucier de la façon dont celui-ci vous est transmis : ce qui justement, influe sur lui et le rend oubliable. Ecoutons les radios ou les télévisions : indéfiniment le même baratin. On finit par ne plus entendre, l’attention ne s’y tient pas, elle dérive. Et par « baratin » j’entends la même syntaxe et le même vocabulaire, qui font que tous les contenus de sens ont l’air de revenir peu ou prou au même. Or, je dirais avec Joë Bousquet qu’un poète s’efforce à ce que « sa vérité », ou sa réalité si l’on veut, ou encore le monde tel qu’il s’est tramé ou se trame dans son for intérieur, soit « inoubliable », c’est-à-dire mémorable dans son apparition, inattendue peut-être, marquant d’un pas spécialement rythmé les sentiers de la mémoire. « Ma vérité est à rendre inoubliable », devrait être la devise de chaque poète. On pourra revenir sur tout cela…
Maintenant pour répondre à ceci plus précisément : « Le “jeu du vers” est-il l’enjeu du poème, c’est à dire l’enjeu de ce que la parole peut réserver à l’homme ? », je crois qu’en effet l’enjeu du poème est d’être ce que la parole peut réserver à l’homme, encore que j’ai des réserves à propos de ce « réserver » : je dirais plutôt offrir à l’homme, construire pour l’homme à partir de tout ce qui lui échappe et que la parole rêveuse, pensive, peut, comme un filet qu’on jette dans l’eau puis retire sans savoir ce qu’il contiendra, amener un moment au jour, même sous forme de fragments tordus, de bouts d’épaves humaines, de pieuvres ou de thons, de ruines de sentiments inconnus comme des Atlantides, et qu’il s’agit en quelque sorte de photographier par l’écriture avant qu’un coup de queue, une vague, un chavirement du langage dans lequel nous ramons, ne les renvoie dans l’obscurité chaotique des abysses… La racine log (logos, langue, langage, etc…) suggère un « vaisseau », au sens de vase, ou de nef. Il s’agit donc de recueillir. La prose ne recueille que rarement, elle s’épanche et se répand, elle s’ex/plique, déploie les plis, s’aidant pour cela des clichés du déjà-connu, du déjà-formulé, du pré-énoncé. Le vers ne « s’explique pas », comme a dit un poète, il « saute les explications », les laissant à la relecture méditative et future de la philosophie. Ce qu’il a ramené du chaos peut sembler tantôt conventionnel, tantôt surprenant et incompréhensible, méconnaissable en quelque sorte, si c’est poésie tous les degrés sont possibles. Mais ce sera toujours en faveur de l’inoubliable, cohérence ou pas. C’est en cela que le type du poème ne vieillit pas, traditionnel ou neuf, la question est seulement que sa forme corresponde – selon le poète – à ce qu’il pense être le mieux pour ce qu’il dit. Après, ma foi, ce sont les lecteurs qui y trouveront ou non leur miel. S’ils sont nombreux, on parlera d’un poète célèbre. S’ils sont peu, il sera ignoré. Cela du point de vue de la poésie n’a pas tellement d’importance. Cela en a seulement pour les « ambitionnant d’être poète » à l’ego encore dilaté, et qui pensent que la qualité des vers et des poèmes se mesure à la quantité de personnes du beau-sexe qui se pâment en les lisant !
Avec « l’enjeu de ce que la parole peut offrir à l’homme », nous touchons à quelque chose de très difficile à penser : l’essence même du « logos », qui peut en quelque sorte dire et voir plus loin que nous dans l’inconnu, et éventuellement nous « donner à voir » comme disait Eluard à juste titre. Je pense en effet que nous sommes habitués à parler, mais que c’est le langage qui façonne pour ainsi dire nos perceptions. Sans le langage qui dit, l’implicite reste inaperçu. Sans le verbe « être » nous verrions rose la rose et blanc le lis, sans pouvoir dire à quelqu’un « je veux attirer ton attention sur le rose de cette rose, le blanc de ce lys » par la simple formule attributive : « Cette rose est rose, ce lys est blanc. » Bousquet disait à peu près : « C’est l’eau qui est la chose la plus difficile à découvrir pour un poisson des grandes profondeurs ». La poésie, c’est ça : découvrir et faire percevoir pour toujours l’eau (l’air, les pierres, etc. etc.), notre eau, par l’outil de la langue. Ce n’est qu’un exemple, mais c’est ainsi, toutes proportions gardées, que doit agir le langage poétique, c’est-à-dire à « caractère versifié » (qu’il semble prose ou non). L’enjeu de la parole en ce cas (dite « vers » comme je l’ai définie) c’est donc d’offrir à l’homme la conscience de ce qu’il est, ou au moins de l’agrandir. Mais enfin tout ça est bien compliqué…
J’ai quand même oublié de mentionner au passage que cette notion de “beau” appliquée au langage comme sa teneur en “vers” est également sa proportion “d’inoubliable”. C’est la même raison, en l’occurrence, qui pousse à choisir des vedettes de cinéma à la figure exceptionnellement esthétique, à faire des plans filmés les plus “beaux” possibles, et… J’ajouterai que la “teneur en beauté” dont je parlais, équivaut à la “teneur en poésie” des œuvres humaines en général, dans la mesure où ce qu’on pourrait appeler l’essence poématique, celle qui fait que quelque chose recèle de la poésie, devient poétique, n’est pas réservée au seul langage. Elle est constituée par, en, la nature humaine en tant qu’elle a la capacité de créer du sens à partir de ce qu’elle discerne de l’expérience du milieu mystérieux où la naissance projette les humains de générations en générations. Le langage n’est que le miroir du moment où cette expérience entreprend de se penser en symboles qui lui sont parallèles, à elle rattachés par le lien immatériel, spirituel, du “signifié” qui se recueille pour exister dans les “signifiants” d’une langue. Et plus ou moins bien selon les secteurs de l’expérience et des mises au point plus ou moins ingénieuses selon les peuples, de la langue correspondante. Ainsi les Inuits sont plus fort en langue poétique, pour ce qui concerne la neige, la glace, etc… mais sans doute dénués de langage ou presque, en ce qui concerne l’univers tropical ou saharien. Lorsqu’un Inuit veut faire du poème sur le Sahara dans sa langue, il est donc obligé à la comparaison, la métaphore, etc… “Le sable luit comme de la neige…”, “les dunes à dos de morse…”, “le craquement des falaises au petit-matin ainsi que banquise au dégel”, etc… Tout va devoir passer par l’analogie, qui est le seul moyen, sans connaître l’être (des “choses”) de connaître les relations entre ces choses, leur existence, la façon dont on peut concevoir de les articuler entre elles pour réduire le chaos énigmatique qui enveloppe le surgissement au “monde” de notre “être en vie”. En somme, poétiser c’est accompagner l’apparaître avec des mots, contre les mots de l’habitude qui fait disparaître : je cite souvent le jeune marié dont l’épouse est ce qu’il y a de plus beau dans sa vie, et le même, vieux marié, qui lit son journal et répond distraitement “oui” quand elle va lui verser son café, ou ne répond même plus, et ne sait même plus, en partant au boulot, si elle était habillée ou nue comme la main. La poésie “remarque” et fait remarquer, avec évidemment interrogations. C’est là sa “beauté inoubliable” : lorsqu’elle l’est évidemment, sinon, ma foi, c’est du poème “neutre”, du filon de langue maternelle à faible teneur en pépites. Par ailleurs, il y a tous les degrés entre le filon “grand poète”, comme Hugo, le filon “très poète” comme Bousquet, et le filon “quasiment pas poète” comme Émile Hinzelin, qui est à la poésie de son temps ce que Bouguereau était à la peinture de Van Gogh ou de Manet.
A nos yeux, Xavier Bordes, vous êtes un poète inoubliable tant la beauté qui parcourt vos poèmes semble inouïe à nos temps desséchés.
Inoubliable d’abord, en vertu de la puissance d’imprégnation imaginale qui marque de son sceau la personne qui vous lit. Elle reçoit vos vers, essentiellement amples, et leur présence bat tellement fort, comme d’une vie propre recueillie à la source même de la vie, que la mémoire entend la retenir par cœur. Nous invitons par exemple à lire le somptueux poème “Voeu” dans La Pierre amour, ou le sonnet “Sans berger…”
Inouïe ensuite, parce qu’en matière de poésie, il nous semble qu’il en va de même que dans tout autre domaine. Le poème n’est-il pas le lieu d’enregistrement sismographique de ce qui arrive à la langue ? Nous remarquons que les progressismes divers, les décorticages universitaires, les microscopes linguistiques, les théories du langage, le mouvement de la déconstruction accompagnant les idéologies séculières ont eu une incidence visible dans le poème. Il parait entendu aujourd’hui que le lyrisme, pour être acceptable, doit être “aride” ; que le poème doit être court, l’image anorexique. La conséquence en est une poésie au souffle court, plus lapidaire qu’un haïku, désincarnée, abstraite jusqu’à l’inintelligible, coupée du monde.
Votre poésie est tout le contraire de cela et donc inouïe tant dans le bain gris de l’époque que dans ce qu’elle donne à entendre de “ce qui doit être lu” à ce moment précis de l’existence.
Notre modernité poétique peut-elle dépasser ce désaccord entre le mot et le monde, le poème renouer avec le monde et le monde refaire alliance avec le poème ?
Que pensez-vous de tout ceci ?
Bon : pour commencer, je ferai les réserves d’usage que recommande l’humilité… à la modestie, devant l’élan d’enthousiasme étonnant que votre groupe manifeste pour mes poèmes. Mais je ne feindrai pas de penser que cet élan me chagrine : j’ai toujours espéré qu’à travers ma poésie chaque lecteur puisse à lui-même s’offrir, grâce à la langue, la part intérieure la plus profonde, horrible, splendide, merveilleuse, enragée, amoureuse, contemplative, de lui-même. Ce que ma poésie peut avoir de proprement inouï, c’est en ses lecteurs qu’elle va le chercher. C’est en eux qu’elle trouvera toujours sa source. Et votre adhésion, en ce sens, prouve que le temps de la poésie « anémique » ou « anorexique » dont vous parlez, et qui était en réaction il est vrai – de pauvreté réaliste – à la somptuosité verbale de la plupart des grandes voix lyriques du XXème siècle (devenue pour certains une inflation à purger), que ce temps commence à passer, et que de jeunes gens tels que vous en sont les hirondelles, les signes avant-coureurs…
Du moins est-ce ainsi, comme un printemps de notre langue, que je le vois, en ce début de siècle-ci, vers lequel je me suis toujours projeté, comme vers le passé lointain, par une sorte d’alliance entre la science-fiction et l’archéologie, dont certains poèmes tel que « An de grâce 2030 » ou le poème sur le verre à pied brisé sont le témoignage.. ;
Lorsqu’on écrit de la poésie et qu’on a le culot, si j’ose dire, de la publier en se figurant que cela peut avoir quelque importance, c’est forcément un testament à l’usage des générations futures qu’on laisse. On est indifférent à la génération qui nous est contemporaine, et qui est en quelque manière notre « pays » par le langage, le temps et le lieu. On sait bien que l’on n’est pas prophète en son pays, et que même s’il se trouve qu’on le soit, ne serait-ce que par jalousie ou par agacement envers ce qu’on juge être de la forfanterie, injustifiée par définition, on ne sera pas écouté.
En ce qui me concerne, j’ai toujours rêvé que ma poésie soit lisible à toutes les catégories de personnes des générations futures : que l’érudit savant puisse y trouver, disons en abrégé : de quoi en faire son miel, de même que celui qui ne lit pas, en général, de poèmes ou de textes réputés difficiles. C’est vous dire donc quel bonheur j’ai pu ressentir lorsqu’il m’est arrivé de recevoir des témoignages émus de personnes qui m’avaient lu par hasard, et qui, ordinairement occupés à traire leurs brebis ou leurs vaches, ou à visser des pièces mécaniques dans leur usine, m’expliquaient que la poésie jusqu’alors était très loin de leurs préoccupations et ne les avait jamais intéressés.
Quel rapport avec votre question ? Eh bien, je ne pense pas que la poésie façonnée dans un langage aride, prétendant se passer de ce qu’on appelle communément la « beauté », puisse fonctionner, ni longtemps, ni de manière à toucher de larges pans de la société… Une poésie universitaire faite pour être lue par de savants philosophes, doit avoir en même temps une couche de lisibilité qui apporte quelque chose de positif aussi, un agrandissement de la vision, une lecture davantage stéréoscopique du monde chaotique où nous vivons, à tout un chacun, à « l’homme de la rue » comme disent « les gens de la haute ». C’est même dans cette capacité à transmettre à ceux qui sont le moins en situation d’apercevoir l’abîme de mystère où nous vivons, qu’une poésie touche à sa véritable grandeur : Villon, Verlaine, etc…
La poésie sèche, brève, intentionnellement ambiguë, dont seul quelqu’un qui a lu Sartre, Nietszche, Heidegger, Kant, Descartes, Feuerbach, Engels, Locke, Hegel, Fichte, Platon, etc… peut vaguement tirer profit ou se délecter, est une poésie aristocratique, une poésie de seigneurs qui écrivent entre-soi, comme les samouraïs composant des haïkus. Par ailleurs, réduire la part de l’envol de l’imagination dans la langue, brider le récit dès qu’il ne s’agit plus de « roman » sous prétexte que c’est prose et non plus poésie, squizze en quelque sorte toute possibilité du langage d’accéder à son « plus beau », lequel est moins « formule compactée » qu’envol (certaine diraient rhétorique – et alors?) de la Vision, de l’Apparition. Pour imaginer, la pensée a besoin d’une certaine quantité de langage, comme un avion d’une certaine longueur de piste pour décoller. Mais aussi, que cette quantité soit quantité au sens propre, avec mesure, rythmes, systèmes sonores, scansion cachée (puisqu’aujourd’hui, toute scansion trop visible passe pour vieillotte et désuète), bref renouer avec l’utilisation des signes temporels. Par exemple, si les « refrains » existent dans la chanson, c’est qu’ils ont comme le retour de Noël chaque année, une fonction de « sécurisation paradisiaque ». Le couplet se présente en temps linéaire, mais le refrain appartient au temps cyclique, à l’éternité. Il tend donc à détacher la chanson du quotidien tout en en parlant, comme fêter le jour de l’an rassure puisque nous le revivons comme s’il s’agissait du seuil de la même année, excepté qu’elle sera un peu différente. Le jour de l’an atteste que nous avons survécu à toutes les années marquées par des jours de l’an précédents, donc que celle qui vient ne sera pas si dramatique.
Il y a de même en poésie un mariage à faire entre l’incantation qui ressortit au temps cyclique, (et qui cherche à mettre en état d’hypnose, d’acceptation dodelinante, comme une berceuse par exemple,) et le « message » qui ressortit, non à l’éternel, à l’Édénique, mais au temps linéaire contemporain, plus ou moins tragique, inquiétant, abominable, dramatique, à propos duquel le poète veut faire accepter par les esprits sa vérité, ce qu’il considère comme une vérité qu’autrement, sans « l’astuce » de la beauté, de la musique du langage, de l’emploi rêveur des mots, la Cité refuserait par angoisse de voir la réalité : qu’elle s’enfonce dans l’usure et la désadaptation, et se cramponne au passé parce que c’est ce qu’elle connaît et des dangers de quoi elle a triomphé.
Quant à savoir donc si «notre modernité poétique peut dépasser ce désaccord entre le mot et le monde, le poème renouer avec le monde et le monde refaire alliance avec le poème », je ne suis pas certain que ce soit là l’objectif, disons souhaitable… Quand vous dites la poésie moderne « coupée » du monde, même dans les poèmes « anorexiques » dont vous parlez, ce n’est pas sûr qu’il s’agisse vraiment de cela.
Cela me fait aborder un autre aspect, difficile, de la question, et sur lequel nous reviendront souvent je suppose : qu’est-ce qu’un « monde » ? Et lorsqu’on se « couperait du monde », de quoi se couperait on exactement ? De quoi ce « monde » dont le poète moderne se serait « coupé » est-il fait ?
Je ne veux pas entrer maintenant trop longuement ici, mais pour moi, le « monde » en soi n’existe pas. Ce qui existe, c’est « ce que la Cité dit du chaos et comment elle a réussi pour se société consentante à organiser, architecturer ce qu’elle a perçu du chaos pour en faire un « monde » justement, ce que les Grecs appelaient un « kosmos » ». Dans cette idée de cosmos, il y a l’idée de « rangement de l’apparu », exactement comme les « cosmétiques » servent à mettre en ordre l’apparition du visage, de la chevelure, des sourcils…
Or, au cours de la vie, des individus humains comme de leurs sociétés, on expérimente que forcément le chaos évolue, se transforme, connaît des tremblements de terre, des bouleversements, des Fukushimas, des tsunamis violents ou très progressifs. Mais la Cité, pour laquelle toutes ces éventualités sont des menaces de mort, s’efforce de continuer à dire « son monde » dans les termes que le passé – lui qui a triomphé de son ex/futur – avait trouvés et qui jadis avaient permis à la Cité de s’adapter et de survivre. Vous voyez la difficulté : d’une côté poésie, printemps, « glasnost » métamorphose, « nouvellement », langage du monde qui change. (Un poème de la pierre amour y fait allusion, montrant le regard des anges qui voient du haut d’une fictive éternité l’évolution de l’éphémère.), et de l’autre, politique, automne ou hiver, nivellement, glaciation (telle que la société soviétique qui mettait ses vrais poètes au goulag, et ne supportait que les rabâcheurs tradictionnels), crispation du « monde de la Cité » sur sa redite éternelle et conservatrice.
C’est pourquoi le philosophe, chargé du truchement entre le poétique et le politique, entre le Poète et le Cité, du temps de Platon mettait le Poète à l’écart de sa République. Le monde de la République est constitué de signifiés « vissés », « soudés » à leurs signifiants de telle sorte que la République voudrait que ce vissage soit « une bonne fois pour toutes » et ne change plus : « sinon on ne peut pas s’entendre, puisque tout le monde ne mettrait pas la même chose sous les mêmes mots ». Le monde du poète est un chaos en exploration qui cherche à faire dire ce qui n’a pas encore été vu, perçu, connu, compris, (ou a une bonne part de cela) à des mots, des tours de syntaxes, d’un monde qui les a reçus et les avait faits pour dire autre chose. Ce glissement apparaît dans la métaphore (et la plupart des tropes). Il insécurise la langue de la Cité, pour lui faire dire des choses qu’elle n’imaginait pas jusqu’alors être en nécessité de dire.
Le résultat est qu’on en arrive à tous les degrés de variations entre l’extrême radicalité de l’expression du nouveau, quasiment incompréhensible à la Cité, c’est-à-dire à « Monsieur Toulemonde », qui a produit la désaffection envers la poésie contemporaine – à quoi s’ajoute l’effet du surréalisme sur les esprits bavards et pas poètes, qui se sentent en poésie, c’est-à-dire en position de « saisie des apparitions chaotiques» sitôt qu’ils disent n’importe quoi, de préférence avec l’aide d’un hallucinogène — , et d’autre part la langue commune ou quasi-commune, qui n’appréhende qu’un monde du passé avec le langage des poètes du passé, convenu, pétrifié.
Pour tenir les deux extrêmes, ce qui est un peu mon ambition, il n’y a donc qu’une solution : desceller le langage du passé pour le revirginiser, comme disait Élytis (à mon propos d’ailleurs), grâce, par exemple à l’ironie, qui passe pour antipoétique aux yeux des amoureux de la poésie traditionnelle, et pour cause ! Elle casse l’univers passéïste, le monde «ancien» dont Apollinaire était las, mais où ces derniers se sentaient si bien, dans une poésie digérée, accoutumé, consentie. Utiliser le sonnet d’Hérédia en se moquant de soi-même lorsqu’on fait un sonnet sur un sujet moderne, ça ne plaît pas aux lecteurs qui prenaient leur pied dans Hérédia jusqu’alors… quitte, comme ces archéologues, à vivre en imagination dans la Cité des pharaons égyptiens parce qu’ils ne se sentent pas à l’aise dans la Cité d’aujourd’hui. L’expérience des forums de poésie m’a appris, par exemple, quelle passion, que je ne soupçonnais pas, les apprentis poètes nourrissent pour les alexandrins classiques. Et lorsqu’ils ne les pratiquent pas, c’est en général par incapacité, avec l’excuse du «vers libre» et de la liberté moderne, et non pas parce qu’ils ont mis au point une autre forme de scansion ou de versification neuve et personnelle. Les poètes de forums internet sont d’un conformisme poétique ahurissant, et sans relation avec l’efficacité de l’expression qu’ils devraient souhaiter, rechercher. Ils étouffent en eux leur « ingenium », leur génie, celui que n’importe quel d’entre eux avait encore dans son enfance. Je veux dire que tous les enfants sont jetés par la naissance en «situation poétique», jetés dans un chaos avec mise en demeure de s’y retrouver le temps d’une vie, et ils répondent quasiment tous à cette situation avec un génie et une inventivité frappantes, dont témoignent leurs dessins, peintures, «mots d’enfants», expressions que les adultes trouvent frappantes à la fois par leur simplicité et leur évidence. Il me revient toujours à ce propos la solution qu’avait trouvée un bambin au bord d’un lac de ma jeunesse, en apercevant pour la première fois des cygnes, des cygnes superbes qui s’approchaient du bord : « Regarde, maman, des canards majuscules ! » C’était un acte de poésie, comme il s’en fait d’ailleurs souvent, le temps d’un clin d’œil, dans la vie quotidienne, puis les gens n’y pensent plus. Et pourtant, pour moi, cet enfant avait conçu là un petit chef-d’œuvre, quelque chose d’exemplaire.
La poésie est un état d’enfance continué jusqu’à la mort, qui ne s’est pas laissé stériliser par le « monde » articulé au long de la jeunesse, par les « adultes ». Dans cet ordre d’idée, d’ailleurs, je pense que le soi-disant adulte qui a tué en lui cet enfant-là, n’est qu’une moitié d’être humain, et sans doute la moitié la plus vide…
Bref, voilà un peu comment j’aborde la question de « l’alliance » du « monde » avec le « poème ». Une guerre amoureuse au quotidien pour ainsi dire !
Nous aimerions aborder maintenant la dimension compositrice de vos poèmes et de vos recueils. Nous vous avons bien compris quant à la chance que constitue le Chaos dans lequel tout enfant est par nature jeté, le mettant en demeure d’apporter une réponse par une organisation d’essence poétique. Au fondement de la condition humaine, il y a “le génie poétique pour pouvoir”, pour le dire maladroitement. Ce “Kosmos”, monde organisé, composé avec les éléments à la disposition de l’homme, apparait fortement à l’œuvre dans vos recueils. La Pierre amour, pour rester encore dans ce livre, est fortement structuré. En va-t-il de même à l’intérieur de vos poèmes ? Autrement dit, tendez-vous à garder la maîtrise constante d’une organisation dans vos poèmes ou, à partir d’une architecture symbolique, à partir de l’architecture d’une métaphore d’ensemble, laissez-vous l’inspiration jouer son jeu librement ? L’inspiration, comme l’eau, dépend-elle d’éléments chaotiques, ou se révèle-t-elle beauté dans le lit d’une composition voulue par le poète ?
C’est très étrange, pour moi, de « rencontrer » votre questionnement… Je veux dire que je suis confronté ici, sur ce point précis, à une sorte d’indétermination : oui, ce qui se dit/écrit participe, avec extrêmement – comment formuler ça ? — de minutie, à la fois, dans le même moment de l’avancée, d’un jeu libre et insouciant de l’inspiration et d’une maîtrise constante et angoissée du déroulement de cette avancée. C’est une expérience – un des points communs entre Odysseas Elytis et moi — dont les autres ne m’ont que rarement rapporté en vivre une analogue.
Simplement la chose apparaît plus visible dans certains livres de poèmes que d’autres, où j’ai cherché après coup à la dissimuler sous une apparence plus nonchalante, moins crispée sur une géométrie dont Jean Grosjean m’avait fait un jour observer qu’elle pouvait avoir un aspect antinaturel et rebutant…
De fait, structuration et liberté quand on écrit comme moi sous la dictée de, mettons, l’inconscient (encore que ce ne soit peut-être qu’une manière moderne de s’en rapporter à «l’entheos» platonicien) ne font qu’un, jusque dans le chiffrage signifiant du nombre des lettres d’un vers, du nombre de vers d’un poème, du nombre de mots, et autres maniaqueries délirantes de mon langage. Ainsi La Pierre Amour, s’inscrit sous le signe du 2 x 7 apollinien, car il est l’expérience première, solaire, de l’amour, de l’illumination, se passe accessoirement au Maroc. L’expérience du 7 aller, et du 7 retour chiffre donc un tas de choses dans ce livre, jusqu’au nombre de lettres des exergues et citations ! J’en parle ici comme on avoue un vice : pour moi, tout poème qui ne soit pas fondé sur un système arithmétique me paraît instable, peu solide, non-destiné à résister au temps. J’ai besoin qu’un poème allie la géométrie mathématique d’un cristal, et le naturel du langage qui s’épanche. C’est ce besoin qui m’a conduit à considérer l’épeire, cette petite araignée courante des jardins, comme modèle du poète : à la fois elle construit une toile adaptée à chaque espace dont elle prend «possession», avec l’aisance propre à la nature, et en même temps chaque toile est construite, parfois malgré les apparences, selon une loi mathématique qu’une équation peut exprimer. D’ailleurs il existe un site internet sur le sujet depuis 2004, qui montre que la spirale d’Archimède est pratiquement le modèle idéal de la toile de l’épeire soyeuse.
(http://perso.numericable.fr/~araignee/archimede1.htm)
En ce qui concerne mes poèmes les choses fonctionnent un peu de la même façon, avec la même association de rigidité du signifiant et de liberté du sens qu’il porte. C’est ce qui rend pour moi l’exercice poétique incomparable. On occupe un moment la position qu’on rêve être celle d’un dieu. On tient dans ses mains le fil des orbites et des mondes dans une sorte d’hypnose indescriptible où tout s’organise et réorganise en fonction du besoin de ce qui est à dire d’une part, et de l’invisible structure dans laquelle cela doit entrer d’autre part. Il y a pour moi – je précise encore une fois – une satisfaction violente à ce que cette coïncidence se mette en place et fasse pièce au chaos, une satisfaction comparable à celle d’une enfant qui, ayant en tas devant lui les milliers de morceaux incohérents d’un puzzle, par la seule envie de se mettre à les organiser voit une sorte de force magique ou mystique lui venir en aide, lui en dicter la mise en place, et il voit sous ses yeux apparaître une image splendide qu’il aurait été bien incapable d’imaginer.
Telle est ma façon personnelle de ressentir que « je » est un autre ! Et depuis la première fois, il y a longtemps, que cette expérience de «poétisation» a surgi dans ma vie, j’y suis resté «addict» comme à une drogue dont on ne guérit pas. Si cela ne m’a pas attiré les mêmes ennuis que leurs drogues aux drogués, ce phénomène a pris dans ma vie une place impérieuse qui l’a parfois rendue très compliquée, en particulier dans mes relations avec mon entourage. Ainsi, quand au fond de moi enfle la vague d’un poème qui doit s’écrire, si j’en suis empêché, je deviens odieux, intenable, et j’ai beau me réfréner, tant que le texte n’a pas pris corps et encre sur du papier, je n’aurai pas la paix et je resterai haïssable !
Pour recentrer les choses sur votre questionnement, « L’inspiration, comme l’eau, dépend-t-elle d’éléments chaotiques, où se révèle-t-elle beauté dans le lit d’une composition voulue par le poète ? », la réponse est donc «les deux à la fois mon général», car dans le cas du poème, chez moi, ils sont les deux faces du même moment, du même surgissement. La numérologie y est active, se coalise avec tous les autres éléments de correspondances significatives, alchimiques, kabbalistiques, tout ce qui peut contribuer à ce que le poème «cuisiné» soit solide dans le moindre détail. Mais il n’est pas nécessaire que le lecteur en soit conscient. Plus il aura le sentiment que le poème est spontané mieux cela vaudra, car c’est la réalité et que cette réalité soit armée secrètement d’un corset irisé que le poème sécrète comme un noctiluque développant sa coquille, voilà qui importe peu à celui qui a seulement envie de voir la mer s’illuminer dans la nuit. C’est la raison pour laquelle je n’ai guère de brouillons : sitôt que «ça brouillonne», rien ne marche, rien n’est assuré, l’état poétique n’est pas en place. Je peux raturer et recommencer indéfiniment, si je me suis fourvoyé cela ne donnera rien, ce sera du temps perdu. Alors, je jette à la poubelle, directement. J’imagine que Rilke fonctionnait également ainsi, et que c’est la raison de la période de long silence qui a précédé les Sonnets à Orphée et les Élégies de Duino… Il devait être désespéré pendant cette sorte d’absence du poète en lui. C’est ce que j’ai toujours le plus redouté, que soudain mes ténèbres intérieures ou celui qui y règne deviennent muets. Elytis a connu un passage comme ça, et en contribuant à éponger son anxiété, j’ai travaillé à soigner la mienne.… si bien qu’un jour il m’a écrit que «c’était reparti» et j’en ai ressenti une sorte de rassérènement intense.
Ma conviction est que la «posture poétique» est un peu comme celle du navigateur sur son voilier, il doit à la fois être souple et entièrement disponible aux énergies chaotiques des vents, et en même temps les maîtriser en se glissant entre ces forces et les utilisant pour parvenir à l’île paradisiaque ! Il s’ensuit que le poème qui est au nœud de ces forces, un nœud qui se déplace avec le poète lui-même au cours du temps d’écrire – et parfois il y a intérêt à être capable d’écrire suffisamment vite si l’on ne veut rien perdre (alors on s’invente une sorte de sténographie personnelle) ! -, ce poème est chaque fois la découverte d’un nouveau monde né pourtant du recensement et du chiffrage des pouvoirs de notre langue maternelle… Et c’est un poème constitué de la fixation de deux forces antagonistes, architecturées depuis le «degré zéro», la lettre, jusqu’à la page, au groupe de poèmes, au recueil entier, avec des fils conducteurs qui se répondent forcément d’un poème à l’autre et qui construisent ainsi dans l’esprit du lecteur ( moi-même en premier) un système harmonique «supra-significatif», tel que les relations puissantes qui ricochent d’un texte à l’autre, d’un livre à l’autre, etc… façonnent ce que certains appelleraient une vision et que moi j’appelle «cosmos» parce que la simple notion de vision est trop limitative. De la sorte, chaque mot, individuellement pris, d’un poème à la longue va rayonner de relations allusives supplémentaires qui vont peser de toute leur lumière sur les sens nouveaux qu’il prendra pour se référer à un ou des «apparu(s)» chaotique(s) qu’il change ainsi en monde.
Ce système harmonique est aussi complexe qu’une partition. Les sonorités du langage y contribuent, autant que les synonymies, les analogies, les homophonies, les approximations les plus diverses. La pratique du poème chez Max Jacob en ce domaine m’en a beaucoup appris. Lui en particulier, mais il n’est pas le seul. Une vraie poésie plonge chez nous jusque dans Homère, Sappho et Archiloque, Pindare, Perse, Horace, nos aïeux spirituels, en passant par tout ce qui a été écrit de poésie en français, qu’il est bon de savoir refaire, « pasticher » à titre d’exercice. Enfin, entre autres. Car les poètes arabes, chinois, japonais, leurs techniques d’écriture et leurs civilisations sont aujourd’hui intégrés aux allusions de la poésie moderne : les poèmes en forme d’hexagramme du Yi-King, les Achillées de La Pierre Amour, en sont l’aveu. Ils pavent un itinéraire existentiel. Aujourd’hui, je ne les aurais plus laissés visibles avec une forme singulière. Plus le singulier passe inaperçu mieux cela vaut, car les lecteurs d’aujourd’hui sont fragiles, facilement désorientés, ils n’ont pas la force lisante des lecteurs de Mallarmé, alors même que beaucoup de la poésie contemporaine réclamerait autant de pénétration dans la compréhension, dans la saisie, qu’en réclame la lecture d’un sonnet de l’auteur du « Coup de Dés ».
Pour la souplesse et la capacité de mise en écriture, la connaissance familière du grec, du latin, accessoirement d’une langue germanique, me semble également recommandée. Il faut que l’instrument soit sûr et l’épaisseur diachronique des allusions aussi. C’est comme disait Joe Bousquet «l’auréole qui se reforme sur la couronne qui se brise». Mais tout cela est une autre affaire, quoique la même au fond. J’imagine que pour vous ces précisions enlèvent beaucoup au «mythe mystérieux de la création inspirée»… comme on aurait dit du temps des Romantiques. En ce qui me concerne, je ressens la création poétique comme un phénomène suffisamment fascinant et mystérieux pour n’éprouver pas le besoin d’en dissimuler ce que j’en connais. (Je forme seulement le vœu que, contrairement à ce que m’a dit quelqu’un, la « transmission explicative » de mon expérience personnelle ne soit pas, comme elle l’est souvent à ce qu’on dit, ennuyeuse. Cela ne m’enchantera pas si cela me donne l’air d’un ancien combattant qui raconte sa guerre !…)
Nous nous apprêtions à vous demander quelle est votre vision. Nous formulons donc différemment : Xavier Bordes, quel est votre cosmos ? Lisons votre poésie, pourriez-vous nous dire, car alors tout y est. Cependant, pouvez-vous en parler pour nous aider peut-être ? L’ensemble de votre œuvre donnée à lire, quel cosmos, comme on dirait “quelle vision”, l’anime ?
Pas facile à expliquer, puisque ça se dit en poèmes, justement parce que la prose unilinéaire répond mal à ce qu’il faut davantage suggérer que recenser…
C’est pourquoi je reste un peu bloqué, Quel cosmos ? Ce truc complexe que je m’applique à écrire/décrire, c’est ça le “cosmos”. Je vais chercher à en trouver les grandes lignes mais je crains bien que ce soit davantage réducteur qu’éclairant… Être critique et commentateur de sa propre œuvre en poésie est difficile, d’autant que c’est le trajet qu’on fait à travers qui construit ce que le lecteur aura à y découvrir pour lui-même en tant que “cosmos”… et qui peut fort bien différer d’un lecteur à l’autre sans qu’il y ait pour autant “erreur de vision”!
Je demande un délai pour réfléchir encore à ce genre de question… Ce qui l’anime, au-delà de répondre simplement “vivre”, “agir vivant”, faudra que j’y songe plus avant et ce n’est pas simple à déployer. Tout le monde, disais-je, sait ce qu’est l’amour, la vie, la poésie… mais personne n’est capable de les expliquer, tout juste de tenter de les mettre en scène dans le langage aussi justement qu’il les sent… Et justement si on procède comme ça, c’est qu’il s’agit de ressenti humain, du subjectif pas aisément objectivable, au contraire des sciences comme la physique, ou l’astronomie…
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……
Réflexions faites, je peux sans doute proposer quelques orientations autour d’une conception globale…
Philosophiquement, il me semble qu’il y a «de l’être», et (d’autre part) ce que nous appréhendons de cet être en fonction du temps, du moment : tout poème est poème de circonstance, et tout moment peut être circonstance du poème, c’est-à-dire prétexte à émergence de l’être, à «apparition» (phainomenon), c’est-à-dire à existence de ce qui est sous forme «de coordonnées» spatio-temporelles. Or le spatio-temporel, tout ce qui constitue l’existence de la matière, est «fragment» de ce qui est. Tout ce qui existe est en quelque sorte de l’être sous forme de bribes incomplètes, de parcelles d’être tirées momentanément de l’indéfini, c’est à dire appréhendées par l’esprit comme « chaos ». La fonction poétique du langage – le langage n’a pas cette seule fonction mais c’est la plus importante, la plus puissante, la plus noble — consiste à s’emparer de ces lacunes de l’être, de ces bribes chaotiques, indicibles, inconcevables, mais éprouvées par les perceptions, et de tenter de les objectiver en les rendant dicibles, puis en les faisant exister par l’expression orale ou écrite, historiquement orale puis écrite probablement.
À partir de ces bribes plus ou moins génialement rédigées (on pourra y revenir), et pas spécialement, pas uniquement par des poètes « professionnels » (je veux dire s’assumant comme tels), se constitue un matériau, qui fut préhistoriquement constitution d’une langue, puis ensuite constitution d’une langue poétique à l’intérieur de la langue transmise et reçue de générations en générations, laquelle avait par des actes poétiques constants au cours du temps, réussi à organiser les bribes lentement perçues et désignées, jusqu’à ce que raboutées vaille que vaille comme les pièces d’un puzzle pas vraiment concordantes, elle constituent le «réel» d’un peuple, c’est-à-dire la façon dont sa cité s’est fabriqué une «vision du monde», précisément : un monde tendant à se vouloir «uni-vers» dans l’esprit collectif de la cité, pour que l’échange des paroles ou des écrits soit aussi un échange de directions (signifiés) vers des « référents », autrement dit un échange de sens.
Lorsque ces échanges de sens sont bien organisés et établis dans la cité, je les appelle «cosmos». Un cosmos, c’est l’acceptation par tous de l’organisation du sens dans une société. C’est la façon (subjective) d’une société de gérer des échanges de sens (objectifs) grâce à des signes signifiants, des signes encodés, reliés à des objets, des actes, des fictions, etc.
Le grand cosmos planétaire est celui constitué, «in progress», par la science qui se veut occupée à constituer la pensée d’un univers, c’est-à-dire d’un cosmos sans chaos, uni, à un seul versant. Bien entendu l’impulsion de cette démarche est théologique, elle vient de l’idée du monothéïsme, ce que j’appelle «être» correspondant dans le cosmos religieux au «theos», le dieu qui unit tout, à travers le symbole du «thêta» grec en particulier : θ, lequel représente l’œuf cosmique, barré par la surface planétaire avec en-dessus la coupole Ouranos et en dessous la caverne hypogée Hadès. (Toutes les lettres de l’alphabet grec cachent ainsi une symbolique constitutive du cosmos grec dans ses signes graphiques élémentaires).
Ils s’ensuit que toute poésie est forcément multiple, plurielle, diverse, et que ce ne peut être qu’une réflexion philosophique postérieure sur le poème qui va organiser ce qui a surgi, ce qui est apparu, soit pour en faire un grand poème cohérent à l’usage de la rénovation du monde de la cité (en passe de désadaptation par son entropie), soit de d’inventer une logique entre des bribes de poèmes de la dimension «d’une lame de rasoir rouillée» pour tirer parti de façon «cosmificatrice» des bribes qu’un poète a passé toute sa vie à tenter d’arracher à ce qui est pour en faire de l’existant.
Le cosmos que mes écrits donnent à lire se présente donc à toutes les étapes, selon la circonstance, depuis la bribe, disons le haïku, jusqu’à de plus grands ensembles organisés par une feinte cohérence, pour donner le sentiment qu’il «y a» du réel», même s’il semble parfois insaisissable et nouveau. C’est une des raisons pour lesquelles j’utilise les artifices de la poésie de tous les temps et de toutes les cultures. Les formes, les références, les mythologies, etc… Un jour on verra qu’un tenant du « monde arabe », ou du « monde asiatique », ou « africain) seront aussi à l’aise dans mes poèmes que des français, parce qu’ils y reconnaîtront aussi des références à leurs mondes, en vertu du fait que la France – je me targue d’être français – était ouverte sur la planète et avait, à son insu, étendu momentanément son cosmos à une grande partie de celle-ci : ce qu’on appelle «colonisation» avec les intérêts économiques et matériels plus ou moins sordides, a toujours diffusé implicitement une « vision du monde » comme vous dites. Nous sommes le produit du mixage de, respectivement, celles d’européens préhistoriques colonisés par des Ariens, colonisés par des Gaulois, colonisés par des Romains, colonisés par des Francs, etc… Et les « mondes » sont faits de toutes ces couches. Pour ma part donc, le poète dans sa langue étant une civilisation à un seul personnage – à lui tout seul, d’où son immense solitude -, j’imite ce mouvement de dévoilements et de mélanges de « cosmoï » successifs ou superposés, pour témoigner énergétiquement, pour produire la continuation du devenir cosmique de l’être dans les générations qui me liront. Je relie, je marque des étapes pour inciter le lecteur au mouvement poétisant, davantage que je ne fais un «état des lieux». La générosité du poète doit être davantage de susciter que de produire des textes admirables en eux-mêmes. C’est pourquoi j’ai pris la démarche que vous sembliez proposer au sérieux. Ce n’est au fond qu’un pari sur la vie. Enfin, je crois que je me suis très maladroitement expliqué… De toutes façons, on ne fabrique pas le mode d’emploi de la poésie de quelqu’un : on lui dit : « Tiens, voilà un livre ! Fais en ce que tu veux et qu’il engendre ce qu’il pourra, peut-être des merveilles, peut-être rien du tout ! » C’est le risque de tout écrivain et a fortiori de tout poète : de n’être pas lu, même par ceux qui ont parcouru attentivement les lignes d’un de ses livres. Mais c’est aussi la chance qu’à travers nous les livres, comme disait Joe Bouquet, écrivent des livres, c’est-à-dire transmettent à des jeunes gens l’envie, l’énergie de poursuivre l’ingrate tâche qui consiste à donner du sens à ce qui est, ce «dieu Anu» des Sumériens.
Xavier Bordes, vous avez, nous l’avons dit, publié trois livres de poésie aux éditions Gallimard, et plusieurs chez d’autres éditeurs, mais vous publiez également des poèmes directement sur internet, dans divers blogs, tel que
http://xavierbordes.wordpress.com/
Cette attitude est peu commune en France, de la part de poètes d’importance (je rappelle que vous avez obtenu le Prix Max Jacob en 1999). À la poésie demeure attachée cette sorte de sacralité qui semble devoir faire passer le poème, pour faire “autorité” – j’emploie à dessein le terme en vertu de son sens étymologique — par le support “papier” et la “belle édition”. D’autres raisons, moins avouables sans doute, président à cet état de fait. Vous donnez à lire, dans divers blogs, vos poèmes presque quotidiens, tranchant ainsi dans le vif de ce que le microcosme poétique français semble pouvoir admettre. Que voulez-vous bien nous dire de ce choix iconoclaste, et peut-être donc, à ce titre, vital ?
Sans vouloir minimiser la reconnaissance que représente un prix littéraire, il ne me paraît pas que cela suffise à considérer un poète comme « d’importance ». C’est à la collectivité des lecteurs d’en décider, après décantation par le temps, et dans ce domaine, le destin d’une œuvre est quasiment imprévisible. Tels dont les écrits firent fureur en leur temps, comme François Coppée, sont presque oubliés. D’autres, en leurs temps à peu près ignorés, sont devenus centraux comme Arthur Rimbaud. Et encore n’est-il pas tout à fait certain qu’au cours des siècles futurs, s’il en reste à notre pays, les choses ne s’inversent pas, sinon que la question même s’efface avec l’effacement de la littérature et de la poésie comme on l’entendit jusqu’à présent…
Ce qui m’amène directement aux divers aspects de votre question. J’ai bénéficié du « support papier », et de « belles éditions » — au-delà de l’imaginable, si je songe par exemple à « La chambre aux oiseaux » ou au « Grand cirque Argos », aux « Levées d’Ombres et de Lumière », tous livres inédits et tellement « sacrés » qu’ils sont pratiquement inaccessibles -, mais il existe aussi de belles éditions d’un genre plus modeste : le « Sans père à plume », illustré d’un bois du remarquable peintre Jean Trousselle notamment, ou « Je parle d’un pays inconnu » édité par In’Hui. Tous ces livres ont pour moi une qualité essentielle : les éditeurs ont respecté le texte des poèmes à la virgule près. Et si l’on y trouve une ou deux fautes d’orthographe, c’est parce qu’elles sont intentionnelles et signifiantes, ce qui de nos jours d’ailleurs — mais je n’en avais pas conscience — a perdu toute fonction dans la mesure où presque plus personne, même les professeurs de français agrégés, n’est sûr de l’orthographe de sa langue !…
D’autre part, il faut bien noter que les machines à écrire n’ont été remplacées par cette merveille qu’est le traitement de texte par ordinateur, qu’aux alentours des années, disons 1985, et même peut-être plus tard pour le grand public. Jusque alors, les livres étaient le seul moyen — avec les autres supports imprimés bien sûr — de répandre un écrit, en dehors de lectures radiophoniques par exemple, qui sont fugaces à moins d’avoir été enregistrées.
Ce n’est donc pas que le livre ne soit pas à mes yeux, avec ses pages faciles à effeuiller, son odeur d’encre, la matière pour moi prodigieuse qu’est le papier, quelque chose d’infiniment respectable et aimé en tant qu’objet. Cependant, je lui fais quelques reproches, ou disons plutôt, je lui vois aussi quelques inconvénients : quand un auteur publie un livre, tous ses amis s’attendent à le recevoir gratuitement, persuadés qu’ils sont que l’auteur ne paye pas les exemplaires qu’il leur envoie. C’est en partie vrai chez de très grands éditeurs, comme Gallimard, qui ne sont pas chiens pour le service de presse notamment… C’est déjà moins vrai pour les plus petits qui n’ont pas les moyens de lâcher gratis une part importante d’un tirage, surtout le premier dont on ne sait même pas s’il se vendra…
Or pour les livres, malheureusement comme pour beaucoup d’autres choses, à la fois l’argent est le nerf de la guerre et faire un livre — c’était encore davantage le cas avant l’informatisation — revient cher, et d’autre part la majorité des lecteurs ont dans l’idée que le livre devrait être bon marché, que la culture, ça ne devrait pas se payer, et que les livres sont donc hors de prix pour, comme vous le dites « des raisons inavouables ». Cependant, vous, vous faites une revue sur internet et non sur papier… Avouer que cela coûte infiniment moins cher d’éditer de cette façon est donc du simple bon sens, pas honteux du tout, mais prouve que la nécessité pour les éditeurs de livres qui prennent des risques, de gagner de l’argent, n’a rien « d’inavouable », excepté pour les nombreuses gens qui, dans notre pays hypocritement et officiellement brouillé avec l’argent, considèrent qu’il est naturel de tout obtenir sans payer : ils ne se doutent pas que quelqu’un paye toujours quelque part ! Nous sommes quelque peu Grecs sous cet angle !…
Il se trouve cependant qu’éditer sur internet pour un auteur, quoique ne rapportant pas grand’ chose sinon rien du tout, est un investissement léger : un ordinateur et une connexion au réseau suffit. Des tas d’organismes mettent à disposition des gens des moyens d’éditer préformatés (comme on dit), sites, blogs (Overblog, wordpress, etc…), ou de livres virtuels (tel Calameo). Je cite ceux-là parce que ce sont ceux que je connais le mieux et qui m’ont semblé les plus séduisants.
L’apparition de ces moyens, fondamentalement enracinés dans la technique informatique de l’hypertexte, a changé complètement la donne. N’importe qui aujourd’hui peut se publier, au sens de «se donner à lire à un public librement». D’où le foisonnement ahurissant des blogs, de poésie entre autres, qui nous découvre que le goût de s’exprimer et pour la poésie particulièrement, depuis les textes les moins, comment dire, satisfaisants, les plus lacunaires, jusqu’à des textes d’excellente, voire de haute tenue, est bien plus répandu qu’on ne l’imagine ordinairement, même lorsqu’on savait que toutes éditions-papier confondues, le nombre de titres de poèmes en livres-papier est le plus élevé, chaque année, de toutes les catégories qu’on publie : évidemment, sur une cinquantaine de mille, quarante neuf mille et peut-être davantage, sont édités à un nombre d’exemplaires très limités, sans publicité, souvent à compte d’auteur. Il demeure que, sur le fond, l’intérêt pour la poésie n’a pas disparu, et avec l’internet, la chose devient patente.
Ce qui est un peu plus ennuyeux, c’est qu’on ne sait pas bien de quel type est cet intérêt : est-ce de vouloir se « répandre » pour le prestige de se vouloir « poète » ? Souvent cela semble le cas. Les auteurs alors participent à des forums sympathiques où ils s’auto congratulent réciproquement en fonction de leurs affinités. De fait, ils lisent souvent assez peu en dehors de leur «cercle», et sont surtout soucieux de montrer avec fierté ce qu’ils ont écrit, que ce soit indigent ou remarquable. C’est une forme de démocratisation, je suppose, comme dans les autres arts : tout le monde écrit des poèmes, tout le monde peint des tableaux, tout le monde se pense du génie (incompris souvent), fait des chansons, etc… et malheureusement, ceci est une sorte de compost fertile d’où n’émergent que quelques roses, comme d’habitude… Car hélas il y faut le don, le talent, etc… toutes choses qui ne s’achètent pas, ne se transmettent pas, — en la matière pas de miracle. C’est comme dans la musique populaire : il ne suffit pas d’avoir tout ce qu’il faut pour faire un « tube », je le sais mieux que quiconque. Même la chanson la plus impeccablement concoctée, arrangée, enregistrée, n’est jamais sûre de ne pas faire un flop ! C’est dans le moment de la confrontation avec les gens que ça se décide, et parfois des années après d’ailleurs : la même chanson qui a fait flop aujourd’hui peut se changer en un succès demain… Ce sont les mystères du temps, de la mentalité des peuples à un moment donné, des événements contemporains, de la chance en somme.
L’internet est donc une sorte de « tribunal » par la statistique, qui présente de durs avantages : On y est jugé par n’importe qui. On y est méprisé ou apprécié par n’importe qui. Personne de ces lecteurs n’investit directement un centime pour vous lire (et être éventuellement déçu). Quant au public, il n’est évidemment pas spécialisé comme celui des acheteurs de livres de poèmes coûteux, qui préfèrent savoir ce qu’ils veulent.
C’est donc un test formidable pour un écrivain, et surtout pour un poète. Il n’est plus qu’un parmi tous ? Il peut même se déguiser, se présenter sous des pseudonymes divers, un peu comme Pessõa. De sorte que s’il récolte des enthousiasmes, des louanges, des attestations de bonheur de la part d’un public d’internautes, il sait qu’il ne peut s’agir QUE d’appréciations sincères et véritables. Le lecteur internaute ne donne guère dans le snobisme, il réagit immédiatement et spontanément. Il se fiche complètement que vous soyez illustre ou inconnu, savant ou ignorant. C’est seulement l’écrit et la façon dont il reçoit cet écrit qui l’intéresse et apparaît quand il réagit.
Il y a donc là quelque chose d’infiniment précieux. Car évidemment, un véritable auteur n’écrit pas pour telle ou telle personne, il écrit pour lui-même en tant qu’être humain, et s’enfonçant dans ce qu’il a de plus « lui-même » et de plus spécifiquement, individuellement, humain, il rêve de rejoindre par là, par l’origine en quelque sorte, l’universalité pour les textes qu’il publie. Obtenir donc une sorte de sondage permanent en ce qui concerne sa création est un apport formidable d’internet. Mais c’est aussi une dure épreuve de «vérité», car on en entend parfois des vertes et des pas mûres, et les critiqueurs amateurs ont parfois la dent dure, voire l’insulte facile, autant que la louange dithyrambique ! Et cela ne dispense pas du tout d’évaluer soi-même ce qu’on fait, sans se laisser « manger » par des jugements de concitoyens, dans passablement de cas, «à côté de la plaque», comme c’est bien naturel en notre difficile domaine.
Le créateur n’est donc pas davantage dispensé d’évaluer critiquement son propre travail, mais il a une idée plus claire de l’impact de son œuvre sur un large échantillon de ses «frères humains», à travers toute la planète qui plus est. Il reçoit des leçons de bon sens qu’il lui faut savoir accepter. Cela m’a beaucoup fait réfléchir sur les enjeux de limpidité du style dans le poème, par exemple, qui depuis toujours ont été pour moi essentiels : j’ai une admiration immodérée pour La Fontaine en poésie et pour Diderot en prose. De surcroît, on peut entrer en relation avec d’autres créateurs qu’on n’aurait probablement jamais (ou en tout cas bien plus difficilement) pu rencontrer autrement, à cause de la distance par exemple. La poésie n’est pas une activité d’aristocrate, et chez le poète la générosité doit être le revers de l’orgueil ! C’est seulement à la Façon de Rutebeuf et Villon qu’elle peut « faire autorité ».
Ou encore d’une sorte d’ascète dans son ermitage !
Le choix de se donner à lire sur l’internet, pour un poète, est-il «vital» selon votre mot ? Je ne sais. De mon point de vue, sans aucun doute. Cela dit, en ce qui me concerne c’est véritablement un choix. L’édition sur livre-papier, ou en revue-papier, ne m’est pas hors de portée. J’ai seulement pris goût à la publication au « jour le jour », et aux réactions des amateurs qui me suivent. Parfois nous échangeons des avis en courriels privés, et j’apprends énormément de choses d’eux. D’ailleurs, nous pratiquons en ce moment même ce genre d’échanges que seul l’internet permet vraiment, en ce sens qu’à la fois il y a un dialogue, mais que ce dialogue, comme un échange de correspondance, peut apparaître médité, réfléchi, tout en fonctionnant dans l’immédiateté si l’envie nous en prend. Il me semble que c’est dans ce sens qu’il y a quelque chose de vital, de lié à une vitalité, dans cette façon de fonctionner. Cela ne remplace pas le livre, encore moins l’écrit en soi, mais cela y ajoute, apporte un supplément, permet à un public de tâter de vos œuvres et d’investir éventuellement dans un livre en sachant ce qu’il peut en attendre. Une forme de franchise en somme, qui évite d’acheter «chat en poche» comme on dit. Dans une période où personne n’a envie de gaspiller, spécialement les jeunes, l’internet pour la poésie et pour la culture en général me semble un merveilleux auxiliaire. Même si évidemment, cela ne fait pas la fortune des poètes — quoique je n’en connaisse point, de toutes manières, pour qui de leur vivant la poésie ait été facteur de fortune !
Nous aimerions maintenant aborder une présence habitant toute votre poésie — tout au moins celle que nous connaissons — et c’est la figure de Aïlenn, dont Recours au Poème a proposé une rencontre en publiant Litanies pour Aïlenn. Nous la voyons comme la figure idéale de l’aimée, mais aussi nous pressentons dans son nom quelque sens caché, quelque appel même, peut-être. Son nom est mystérieux. Lèveriez-vous un peu le voile à ce sujet ?
Le mystère des noms ! Il fascinait Marcel Proust ! Je ne sais si Aïlenn est la « figure idéale de l’aimée » : dans les poèmes, elle est assez réaliste me semble-t-il. Je m’efforce toujours d’être, comment dire, dans un lyrisme exact et terre-à-terre. Ce n’est contradictoire qu’en apparence : il s’agit, que ce soit dans le rapport avec un être humain, avec les objets, etc… — tout ce dont nous avons constitué notre «cosmologie», — d’appréhender par la formulation ce qui est le plus « spécifique », faute de quoi nous cessons « d’habiter poétiquement cette terre », et nous en venons à mépriser, à laisser sombrer dans l’habitude, qui fait désapparaître les choses et les êtres vivants, ce qui compose notre univers. Le problème avec l’idéalisme, c’est qu’il abstrait et donc nivelle tout. Il habitude donc par standardisation en quelque sort. De mon point de vue, l’humain et la féminité en particulier, sont à rejoindre par extrême particulier et l’on n’y accède pas à travers le général. « Les femmes sont comme-ci, toutes les nanas sont comme ça… » et autres déclarations globalisantes rendent « l’autre » (féminin ou masculin d’ailleurs) irréel et inintéressant. C’est en s’enfonçant, si je peux le dire, dans l’extrêmement particulier d’une personne, qu’elle peut devenir une figure : ici, dans le cas d’Aïlenn, la figure de la femme « interface » entre celui qui poétise, et ce qui est. Ce que la poésie décrit de sa féminité tente d’être tellement proche de l’origine de sa nature qu’elle ne puisse ni être confondue avec aucune autre, ni ne pas être ce qu’on appelle « femme » de la façon la plus évidente qu’un homme puisse percevoir.
Je ne veux pas me perdre dans les détails, mais je veux bien préciser le sens du nom : il s’agit de lettres originellement prises à l’alphabet hébraïque, dont la signification est liée à la Cabbale, et qui me sont venues spontanément la première fois que j’ai rencontré la femme dont il est question dans « La Pierre Amour » livre qui est le récit de cette rencontre qui m’a changé en type qui écrit des choses. Le Aleph représente l’intemporel, le An des Sumériens par exemple. Les autres lettres concernent le mode de relation de ce qui est hors du temps, ce qui est de « l’être » non encore étant, avec le chaos où il vient s’insérer du fait de la naissance, qui est en même temps rencontre. Pour davantage de compréhension, il faudrait nous plonger dans les livres de Carlo Suarès, les « Spectrogrammes de l’alphabet hébraïque », en particulier. Mais n’entrons pas dans ces complications qui nous entraîneraient trop loin. La figure dont il s’agit est donc à concevoir comme celle de l’Apparition. Apparition continue, pour ainsi dire alchimique en ce qui concerne les ambitions du langage, qui conditionne, comment dire, par son existence même, la révision de tous les rapports d’un poète avec son monde, donc sa manière de dire, de ressentir, d’agir.
Je ne sais pas bien comment m’y prendre pour dire ça en logique aristotélicienne ! Aïlenn, c’est une dame précise qui vit avec moi, c’est la poésie elle-même, c’est « l’or » du silence et « l’argent de la parole », c’est l’aube et l’éveil lumineux aux choses que provoque sa rencontre et sa présence, c’est le monde tel qu’il m’apparaît : tout est étroitement interdépendant, tout est « le même », différent et contradictoire dans sa concrétude et diversité, donc déroutant comme l’est la femme que j’aime. Par son truchement, la manière dont je vois a été ressourcée, définitivement débanalisée, concrétisée, donnée comme un acte de tous mes sens par cette apparition et sa présence continue. Elle est la membrane osmotique à travers laquelle je parviens à correspondre avec ce qui est, même si dans un texte elle n’est pas nommément présente, peu importe : ce texte n’aurait pas existé sans elle, tout simplement. Le peu que j’ai écrit dans ma vie (j’étais musicien avant de la rencontrer) s’est révélé nul et non-avenu et tout a changé dans ma vie, comme j’imagine cela arrive à tout garçon qui tombe raide-dingue d’une fille. En somme, il n’y a rien là que de très banal, c’est seulement la conscience aiguë du phénomène qui pousse ensuite à le poétiser, à vouloir en témoigner…
Mais je ne parle pas d’une personne fictive, d’une figure artificielle, au contraire : ce que le poème dit sont ses qualités et ses défauts, sa présence physique, intellectuelle, sa manière de rendre pour moi possible en permanence un monde augmenté d’une lumière constamment neuve, qui n’éclairait pas les choses avant elle : une sorte de phosphorescence supplémentaire que le fait d’aimer, de désirer, de chérir, a ajouté à tout ce qui m’advient, à tout ce qui entre dans le champ de ma conscience… Aïlenn m’a rendu mon monde désirable et éloigné l’ombre de la mort qu’elle a vidée de son sens et de son caractère obsessionnel.
Il suffit qu’elle existe, qu’elle soit là. Evidemment, si elle part trop longtemps et trop loin le monde s’éteint, comme si les batteries qui le rendaient constamment « apparaissant » s’étaient déchargées. C’est comme ça je suppose pour tous les types qui ont trouvé La Femme. Celle dont on sait instantanément en la rencontrant que ce sera « elle », ou personne. Tel est de fait, ce qu’on appelle « sentiment de la beauté » : cette luminescence, ou phosphorescence, posée sur les êtres et les choses comme à Pentecôte la flamme du St Esprit, pour risquer une comparaison hardie que je ne veux pas religieuse, qui illumine et inspire ce qui sans elle souvent n’existerait même pas : ce qui serait peut-être à côté de nous, mais absent de notre conscience et de nos sensations, non-remarqué disons. Ainsi que la « chose la plus difficile à découvrir pour un poisson des grandes profondeurs, l’eau », comme disait Joe Bousquet.
Dès lors, pour parler des choses on essaie de trouver des analogies en supplément au langage ordinaire, on fait foisonner des comparaisons, les oxymores, les synecdoques et métonymies, toutes sortes de figures du langage, de tropes, destinés à faire participer le lecteur, notre légataire « testamentaire » en poésie, à cette réalité augmentée, vivante au sens absolu, en laquelle, dans mon cas, Aïlenn me donne la possibilité de vivre.
Il n’est pas simple d’exposer cela, de dévoiler de l’intime de cette façon. Ce n’est pas vouloir me dérober que de juger qu’à présent, ici, j’en ai assez dit. Le reste apparaîtra de soi-même à ceux qui auront quelque peu fréquenté mes livres. De toute façon, en cherchant à exprimer cela logiquement on est immédiatement confronté à cet indicible que précisément l’expression poétique s’efforce en permanence de contourner et de « prendre à revers » ! Et dans ce domaine, contrairement à ce que pensent tout un tas de tenants d’écoles minimalistes ou prosaïstes contemporaines, il ne suffit plus, du moins est-ce mon point de vue, d’en revenir à quelque fragment de langage plat et journalistique, en pensant que leur affligeante humilité sera opérationnelle et ramènera le regard des humains sur le monde conventionnel de la société en le magnifiant. Quelques bribes pensives ne font pas le poème. Quelques ruines indigentes ne font qu’appauvrir ou rendre inaccessible, indigeste, toute vision du chaos, toute mutation «alchimique» (disais-je) par le moyen de la langue maternelle, de ce chaos en «cosmos». Il ne suffit pas de dire «je quitte les extravagances du lyrisme épique à la St John Perse, du moralisme elliptique à la René Char, le délire surréaliste d’André Breton ou Eluard, etc…» comme on abandonnerait la conception baroque, en architecture, pour entrer dans les lignes dénudées et mondrianesques du Bauhaus, non, il ne suffit pas de cela, du retour à l’indigence qu’on prend pour de la simplicité, pour ressusciter une magie poétique qui semble, au XXI ème siècle, à la fois partout diffuse et en voie de disparition comme une espèce menacée…
En pensant à « Aïlenn », j’ai toujours à l’esprit cette image des torii devant l’entrée des temples japonais : ce sont des portes, quoique des deux côtés ce soit le même monde, qui conduisent depuis le « profane » vers du « sacré », au sens de « réalité augmentée (d’une lumière secrète) » si j’ose emprunter cette métaphore à l’informatique, à la 3D… J’avance ce concept d’un « sacré » sans y voir du religieux à proprement parler, seulement un peu comme la vision objective que présente Elytis au début de l’Arbre Lucide, avec l’apparition de l’ange-femme et la cloche qui sonne le changement du chaos ancien en cosmos neuf, fondé sur le «même monde».
Voilà ce que s’efforce de rendre perceptible aux autres, à travers ma langue maternelle, la poésie que j’écris et dont Aïlenn est le cœur. Je ne suis pas certain que ce soit compréhensible, et il est impossible de parler de cela sans quelques incohérences, puisque le principe logique du « tiers-exclu » en est banni, comme de tout ce qui est poésie et manière d’être fondamentale de l’homme-symbolisant. (Ne pas exister de manière symbolisante, pour les humains est impossible, c’est ce qui les distingue pratiquement de tous les autres êtres vivants.)
Une autre ligne de force de votre poésie est la richesse des cultures auxquelles elle fait appel ou référence, ou qu’elle convoque, ou revisite, nous ne savons quel terme vous paraîtra juste. Il y a le Yi King et la “philosophie” chinoise, nous l’avons évoqué. Il y a l’importance de l’Orient. Et bien d’autres. Pouvez-vous nous en parler précisément ?
Lorsque j’étais à l’école primaire, le rose de « L’empire français » couvrait une bonne partie de la mappemonde qui était dans notre classe. Il m’en est resté l’idée que le mot France portait en lui une sorte de vocation à désigner un monde spécial, rayonnant, universel, capable d’échanger et d’accueillir. La langue, la littérature, françaises, qui de fait sont une même chose, a des qualités spécifiques qui sont d’une nature originale : c’est une langue qui s’est toujours rêvée elle-même, souciée consciemment d’elle-même. À partir de quelques essais arabes effleurant la grammaticalité, ce sont les Français qui ont fabriqué les premières grammaires, assez rudimentaires encore, à l’usage des notables anglo-saxons administrés par les lieutenants de Guillaume le Conquérant, et qui voulaient parler le langage des nouveaux maîtres pour accéder à un statut moins subalterne. La recherche grammaticale est une affaire, aujourd’hui plus ou moins disparue, qui ensuite a passionné pendant des siècles les érudits. On a coupé les cheveux en quatre, fait des académies, etc… pour mettre au point le «bon parler» ou le «beau parler». Cette exigence permanente dont je disais qu’elle est perdue de nos jours, a façonné un outil de pensée dont le souci d’expulser les équivoques dans la transmission de l’information a toujours été primordial, et a servi d’exemple en Europe. Il s’agissait de dire d’une façon précise, économique et élégante. De régler dans le langage les lois d’une certaine façon de voir le monde, encore aujourd’hui sous-tendant l’évidence de la vision du réel des français, et qui leur fait souvent s’impatienter devant la confusion ou l’illogisme dans lequel vivent des peuples parlant d’autres langues aux fonctionnements empiriques, inconscients et flous. Ce n’est pas un hasard s’il est resté dans les grands organismes internationaux le codicille après rédaction des grandes décisions : « Le texte français en cas de litige faisant foi. » C’est aussi ce qui rend difficile la traduction en français de certains textes, notamment poétiques mais pas seulement, lorsque leur langue originelle est capable d’un « flou artistique » que le français supporte mal. L’apothéose de cette langue à mon sens a été atteinte avec Diderot en prose et La Fontaine pour la poésie.
C’est la période où l’essentiel des trouvailles, en particulier scientifiques, se font en français. Sans qu’elle perde ces qualités, uniques parmi les langues répandues, de précision, d’organisation intellectuelle, de douceur dans les sonorités, (le ‑e muet n’existe qu’en français à ma connaissance), de structuration logique (et non psychologique comme d’autres langues, il faudrait à ce sujet aborder la question d’ordre d’apparition des thèmes dans la phrase, etc…), structuration qui construit des relations entre les phénomènes mouvants (verbaux) et les phénomènes stables (nominaux), sans donc perdre ces qualités, les Français ont fini par en avoir un peu assez de la fameuse « clarté ». Comme en musique Debussy, on s’est mis à redévelopper l’équivoque, le délice de l’hésitation plurivoque, de la polysémie, l’hermétisme, de l’approximation, de tout ce qui pouvait en somme rendre du fautif et du charnel, du désordre, de l’embrouillé explorable, du malentendu délicieux, à une langue trop limpide en ce qui concerne sa mise au point d’une réalité française. Dans les idées, cela a commencé avec le Romantisme. Il s’agissait de nuancer subtilement la palette sentimentale et introspective. Mais le phénomène ne touchait pas encore à la langue française elle-même. Ensuite, il y eut le Symbolisme, qui lui, s’est mis à chercher des formulation-limites aux marges de la langue. Verlaine, Mallarmé, Corbière, Laforgue beaucoup, Charles Cros, ont démontré qu’on pouvait trouver des formulations neuves qui, sans renoncer à l’essentiel de la langue, pouvaient l’amener à un équilibre différent capable d’exprimer des faces du chaos encore non désignées, « inconnues » selon le mot de Baudelaire, exemple de ces maîtres de la langue lassés de trop bien la connaître et l’utiliser. Nous arrivons alors au seuil du XX ème siècle : en même temps que Dada et le Surréalisme désarticulent, jusqu’à l’absurde à l’occasion, la langue et les représentations pour ouvrir des perspectives qui parurent d’abord insensées, puis seulement inouïes au sens rimbaldien - un salon au fond d’un lac, par la magie du haschich -, et le souci du «bon français» encore scrupuleux jusque chez les artisans du 19ème siècle n’ayant que leur certificat d’études, s’évanouit des consciences. On n’y a plus vu un point d’honneur au contraire, mal parler, faire «peuple», est devenu chic et snob jusque chez les aristocrates ! Un côté bobo « antibourge » avant l’heure. L’Éducation Nationale elle-même a très vite renoncé, de reculade en reculade, de prétextes de linguistes sur «la naturelle évolution de la langue», en rages d’instituteurs qui ne savent plus la grammaire ni l’orthographe : ces mêmes Instituteurs qui, du temps de Jules Ferry avaient été les farouches gardiens de la langue, les fanatiques de la grammaire et de la dictée, les fameux «hussards de la République», se sont souvent métamorphosés en l’inverse, et sont devenus des tenants tout aussi fanatiques du laxisme linguistique, de l’indifférence « égalisatrice » à la qualité du parler et les admirateurs éperdus de Prévert, pour eux le plus grand des poètes.
Le mouvement d’expansion territoriale s’est retourné en même temps en un mouvement de contraction, avec les «décolonisations», et du coup, au lieu d’avoir un monde français qui s’intéressait vaguement aux «sauvages exotiques» qu’il fallait «éclairer» et instruire, on est passé à une mentalité où ce qui arrive de l’étranger, USA en premier lieu mais pas seulement, devient une coqueluche. Pour tous ceux qui ne quittent pas encore la France en touristes, l’exotique, n’importe lequel, est plus excitant que le pays calme et confortable qui se développe après-guerre. Les «autres mondes» sont devenus ce qui fait rêver. Les modes de vie des «peuples premiers» sont devenus un exemple, dont on rêve d’acclimater la prétendue « liberté », « l’instinctivisme », la façon de se soigner par les plantes, etc… depuis les forêts du Cameroun ou de l’Amazonie vers les forêts de pierre des cités européennes. Cela donne l’intérêt de Lévi-Strauss pour la « Pensée Sauvage » et la déception de « TRistes Tropiques ». « Ecuador » ou « Voyage au pays des Tarahumaras » de Henri Michaux. « Les conquérants » de Malraux. Et ainsi de suite. Mais cela produit aussi le tourisme français qui préfère, quand il en a les moyens, à des régions variées et magnifiques de son pays, des régions variées et magnifiques du Cambodge, ou Angkor ou le Grand Canyon du Colorado, ou les Pyramides d’Égypte, pays qui fait rêver les Français à juste titre depuis Champollion.
En ce qui me concerne, je veux montrer par là, de façon un peu sommaire, combien le français, citoyen et langue, a un rapport avec le reste du globe. Le Japon des estampes d’Hiroshigué avec Van Gogh et les Impressionnistes. Baudelaire qui séduit les poètes japonais. Passons. Une poésie française se doit donc pour être française de garder des relations au niveau de ses mythes personnels, de ses symboles, avec le reste des grandes cultures du monde connu, tel que la France le voit. Il me semble que cela doit être l’un de ses traits constitutifs. Comment penser un monde aujourd’hui en tant que poète français, sans rien savoir (ou mentionner) des autres mondes de la Terre ? Ignorer la Chine ? Les civilisations amérindiennes ? Les sociétés arabo-musulmanes ? Les mille univers africains ? «Rien de ce qui est humain ne nous est étranger» doit rester notre devise contemporaine. Celle qui nous fait français. Avec naturellement le droit d’aimer et de choisir ou de repousser et de détester les mondes qu’on a été amené à connaître, ce qui pose évidemment des problèmes : aimer les lions libres dans leur savane peut amener à vouloir les aimer libres dans les rues de Paris, mais évidemment, là, ça ne fonctionne plus et on se met à leur tirer dessus très vite. Toutes proportions gardées, le problème des immigrations est celui-là. Cependant, je reste convaincu que la langue française et la structuration de pensée qu’elle implique, même altérée comme aujourd’hui, a une vocation d’assimilation et de redéploiement de tout ce qui lui était étranger… C’est en quelque sorte sa puissance performative à long terme. Et l’une des raisons pour lesquelles je crois profondément qu’il est impossible d’être un poète français sans être aussi un traducteur et s’être passionné pour plusieurs langues étrangères. A ce sujet, on ne mesure d’ailleurs pas ce que l’éducation française a perdu en abandonnant le latin, et aussi le grec. C’étaient des langues suffisamment différentes et suffisamment proches de nous pour nous introduire à l’idée que l’on peut penser « autrement » que « françaisement », tout en n’étant pas dérouté au départ par un écart aussi important qu’avec le tchouvache, l’assyrien, le bantou, l’hébreu ou le chinois mandarin. Cela permettait aux Français d’avoir un esprit entraîné à saisir la pensée de l’autre, à avoir l’intuition de ce qu’elle veut exprimer, même quand ladite pensée est distante de la leur. Donc d’entrevoir que des pays très différents de langues peuvent construire des mondes très différents, mais pas obligatoirement insensés et méprisables pour autant.
Les Français actuels sont infirmes en ce qui concerne cette capacité. Ils sont aussi infirmes que lorsqu’ils lisent le monde d’une langue poétique dans la langue de leur monde-France, c’est-à-dire lorsqu’ils lisent un poète qui au sein de la langue française s’est forgé son français à lui, pour, au sein de la réalité « française », exprimer sa réalité à lui. Le français littéraire pour la majorité des gens est une langue étrangère, et parfois plus étrangère que celles qu’ils ont été contraints d’apprendre par nécessité commerciale et économique. J’espère cependant que la grammaire implicite (mais aussi explicite et construite avec exigence pendant des siècles) du français ne disparaîtra pas totalement. Si la perte d’un dialecte Papou de certaines régions de Nouvelle-Guinée, même si parlé par seulement trois cents personnes, est désolante — je pense à Ivolo Kéléto, le Homère papou — et comparable à une région anéantie par un incendie, la disparition du français serait un désastre pour le globe, du genre engloutissement de l’Atlantide sous les eaux ! Le monde de la langue française n’est pas un hexagone clos, mais un centre mouvant et rayonnant de la pensée, qui se trouve aussi bien au Viet-Nam qu’au Sénégal, en Egypte ou ailleurs, non pas parce que le français est seulement une des langues du bizeness et de l’argent, mais surtout parce qu’il est la langue exemplaire et le ferment d’une des plus riches et plus universelles histoires de la pensée, et le continuateur de sa fécondité en droite ligne depuis les Grecs (et la Bible). Toute la civilisation de l’Occident est «fille d’Aristote» et du Christianisme, mais la France l’aura été davantage que toute l’Europe réunie, du moins jusqu’à la Seconde Guerre mondiale…
D’autre part, est-ce dans une volonté de faire totalité, correspondant à une époque cosmopolite ? Dans une nécessité de récapituler l’ensemble des richesses culturelles de l’humanité, dans une époque où le poète appartient lui aussi à une sorte de “mondialisation” ? Ou est-ce tout autre chose qui vous requiert dans cette voie ?
Tous les poètes qui ont vécu une fin de siècle ont été un moment des récapitulateurs un peu ironiques et sans illusions. La poésie ayant une composante testamentaire, en même temps qu’elle anticipe et devine, fait le bilan plus ou moins complet du présent, et dit quel est son héritage de la poésie qui l’a précédée. Le mien remonte évidemment à Homère, Sappho, Archiloque, Pindare,Virgile, Horace et Perse, Li t’aï Po et ses émules, mais aussi les Upanishad, Tagore, Hafîz, Isaïe, Rutebeuf, en passant par les Romantiques Allemands, John Donne, Byron, Dante, Pétrarque, bref, la liste n’en finirait pas. J’avoue que je n’ai guère hérité des poètes russes ou de Mongolie, j’ignore le Russe et ce que j’en ai lu de poésie traduite me reste souvent hermétique. « Récapituler l’ensemble des richesses culturelles de l’humanité » est bien sûr impossible, mais par « synecdoque » désigner dans mes poèmes cet ensemble par allusion plus ou moins discrète à certaines de ses « parties indispensables » évidemment oui. Ce n’est pas tant une volonté de faire «totalité», que de faire sentir qu’il y a « beaucoup et divers ». De convoquer pour ici les trouvailles de l’ailleurs, leur donner droit de cité en français discrètement. C’est-à-dire de façon aussi peu voyante que possible. Comme on assimile des éléments du chaos avec la cohérence-incohérente de l’évidence poétique, supra-cohérence qui peut à la fois être irrationnelle, et passer pour naturelle, pourvu que l’inspiration y pourvoie. Évidemment, dès que cela sent l’artifice, c’est raté. Les belles habiletés manquent souvent de naturel et l’inconscient ne s’y trompe pas. La question de cette chose magique qu’est le «ton juste» qui naturalise le plus exotique, souvent en passant par la beauté, reste une des irréductibles vertus de la poésie, qui manque à ses contrefaçons.
Le poète est donc celui qui, serrant au plus près le souffle de sa langue, s’en sert pour voyager à travers le plus de mondes possibles, que ce soit dans l’espace ou dans le temps. L’imaginaire s’y allie au fait, l’immatériel au matériel. Et plus tu t’avances vers les profondeurs du pays de ta langue maternelle, plus tu deviens quelqu’un qui est de toutes les langues, si je puis dire. C’est parce que les Français ne sont plus assez français, qu’ils doutent et qu’ils ont mystérieusement honte de l’être consciemment en profondeur, qu’ils n’arrivent plus à assimiler l’irruption de l’ailleurs. Lorsque l’on tremblote sur ses cannes, si j’ose dire, lorsqu’on se sent faible et d’équilibre peu assuré, l’idée de prendre en charge quelqu’un dont, de surcroît, on ignore ce qu’il pèsera, devient repoussante et parfois insurmontable. Regardez ces types qui forment l’équipe de France de foot et qui n’osent même plus chanter la Marseillaise, simplement parce que le « sang impur » y est dit devoir « abreuver nos sillons ». Et qu’ils croient qu’on parle du sang des immigrés. Ils ne savent même plus que ce sang dit «impur» est celui du peuple révolutionnaire qui meurt pour la liberté — par opposition au sang pur, au sang bleu de l’aristocratie en exil qui attaquait la France républicaine ! Enfin bref !
Les Français aujourd’hui sont davantage ignorants d’eux-mêmes que les étrangers qui s’intéressent à leur pays. Je ne parle pas bien sûr de ces pauvres footballeurs milliardaires qui ont pour tout vocabulaire une centaine de mots et pour syntaxe quelques bafouillages.
Au temps d’Internet, la « mondialisation » se répercute sur le poème. Mais il faut éviter qu’elle se répercute par la massification culturelle, et la mise de la langue aux standards anglo-américains, par exemple. C’est en étant soi-même qu’il peut y avoir échange avec ce qui n’est pas soi. Si l’on est déguisé et méconnaissable, qu’on fait semblant de, comment ne pas passer inaperçu et ne pas être esquivé par le dialogue ? Ce qui doit passer inaperçu, ce n’est pas la différence, mais la façon de l’exprimer. Tel était notamment le talent des parleurs de salons du temps de la Monarchie. Sinon, l’on exacerbe les inquiétudes et les incompréhensions. Plus on parle de refréner le «racisme», plus on emploie le mot pour «lutter contre», et plus le racisme s’accroît. C’est le mot publicitaire de Salvador Dàli : « Qu’on parle de moi, même en mal ! » Il s’agit donc de ne pas s’obséder de ce qui n’est pas français, ni dans le sens positif, ni dans le sens négatif. Je n’espère hélas pas que ce soit absolument aisé à comprendre…
Pouvez-vous maintenant nous parler de vos influences poétiques ?
…Celle que j’aurais accueillies, je suppose ? La plus lointaine dont je puisse me souvenir remonte évidemment au collège. Il existait à l’époque des dépliants cartonnés à l’usage des élèves. C’étaient des aides-mémoire très bien faits qui résumaient en quatre à huit pages l’essentiel de ce qu’il fallait savoir, par exemple en grammaire latine, ou grecque, ou française, ou en histoire selon le programme de telle ou telle classe. Mon père m’en avait offert un dès la cinquième, un « Memento Usel » concernant la marche à suivre pour l’exercice du commentaire de texte, composé en deux parties : la prose et la poésie. Deux pages de conseils théoriques fort judicieux pour l’une comme pour l’autre, et dans les deux cas, deux pages concernant un exemple type.
De la page de prose, aucun souvenir. En revanche, la page de poésie avait, pour exemple commenté, «Clair de lune» de Verlaine, imprimé en vert. Lorsque j’ai lu ce texte pour la première fois, comment décrire l’événement ? C’était comme si une nouvelle porte, aussi importante que la musique, s’était ouverte quelque part dans mon cerveau. J’ai vécu des jours, interne que j’étais, cette année-là en particulier, avec ce poème pour tout univers. Il était une clé, une formule magique, qui remettait chaque fois à ma portée un monde d’imagination et de sensations que je croyais fugaces.
Au bout d’un certain temps, bien entendu je me suis mis à rechercher d’autres textes, de Verlaine d’abord, qui puissent me faire cet effet. J’ai trouvé par hasard sur les quais, pour deux sous, un livre étrange, gris, imprimé sur du pauvre papier, édité chez Seghers, et intitulé « Misery farm » de Louis Parrot. (Depuis, ce livre ne m’a plus quitté, même si évidemment, j’en ai accumulé une quantité d’autres au cours des années.)
La force des images et de l’ambiance qui irradiait de « Misery Farm » m’avait empoigné dès les premières lignes, et même si les poèmes, nullement mis en forme à la façon verlainienne, me semblaient plutôt négligés et déchiquetés dans leur apparence, ce que leur contenu me donnait à entrevoir me fascinait.
Alors Lagarde et Michard vint : que m’avait prêté un «grand» de classe de Seconde. Je n’ai guère été sensible aux poèmes d’avant Lamartine et Musset, excepté en ce qui concerne Ronsard et Du Bellay, un peu Malherbe, et Maynard qui me faisait déjà penser à Nerval :
L’âme pleine d’amour et de mélancolie
Et couché sur des fleurs et sous des orangers
J’ai montré ma blessure aux deux mers d’Italie
Et fait dire ton nom aux échos étrangers…
Evidemment, il se peut que ma citation ait été déformée par le temps, et pour tout dire, ni je ne sais plus de quel poème elle vient, ni pourquoi ma mémoire a retenu cela et pas autre chose !
Ce n’est que des années plus tard, après Hérédia, puis Leconte de Lisle, puis Baudelaire, puis Nerval, puis Rimbaud, puis Apollinaire et Aragon, et une kyrielle d’autres que j’ai commencé a avoir envie d’écrire moi aussi de la poésie. Evidemment, j’ai acheté un « dico de rimes », en l’occurrence son auteur avait un nom prédestiné, il s’appelait « Desfeuilles ». Le dictionnaire en question était précédé d’un petit traité concernant la poétique en français, les formes fixes et les autres. Bref, tout ce qu’il me fallait pour m’amuser à jouer les acrobates du vers façon Théophile Gautier. Je ne m’en suis pas privé, et je me suis exercé à pasticher tout ce qui était pastichable, juste pour rivaliser techniquement. Bref. En première, j’étais capable de fabriquer de «faux poèmes» plus vrais que vrais, y compris dans le style de Max Jacob, le premier dont les conseils à un jeune poète me servaient de modèle (avec ceux de Rilke), ou d’Apollinaire, ou encore de St John Perse, encore récent. À l’époque, Char n’était pas très répandu mais Eluard, si.
Toujours est-il que j’écrivais de plus en plus de poèmes quand à l’Université après avoir commencé en licence d’histoire, j’ai continué en littérature, à Nanterre puis à Vincennes, où est survenu un autre choc : Jean-Pierre Richard y traitait de la poésie, en particulier de Mallarmé. Et notre ultime exercice avec lui était, ad libitum, de faire un poème ou plusieurs sur ce poète, sa vie, ou ses thèmes. Pour ma part, j’avais fait trois sonnets où je concentrais tous les thèmes et les tours de Mallarmé. Je me souviens parfaitement qu’en me les rendant, Jean-Pierre Richard, spécialiste s’il en est, m’avait dit : «Si le corpus mallarméen n’était pas connu et clos avec certitude vos poèmes auraient pu me faire croire qu’on avait retrouvé des sonnets inédits de Mallarmé… À ceci près,» avait-il ajouté «que j’aurais peut-être eu un soupçon à cause de la concentration de tous les thèmes mallarméens dans ces trois fois quatorze vers, qui rend ces poèmes «presque trop» mallarméens !» C’est J.P. Richard qui m’a fait découvrir Joe Bousquet, après un mémoire de maîtrise que j’avais fait sur « Quel royaume oublié » de son quasi homonyme Alain Bosquet…
C’est dans cet athanor de Vincennes des premières années que j’ai rencontré également Yves Bonnefoy, puis Michel Deguy, puis Michel Butor, puis Meschonnic qui, tard, peu avant sa mort, et sans que rien ne me le laisse présager (nous avions fait des colloques ensemble encore peu auparavant) à contre moi déclenché une ire critique, bizarre, qui m’a valu quelques défenseurs amicaux et quelque peu indignés, parmi lesquels Jacques Roubaud…
A Vincennes, j’avais également travaillé avec Serge Leclaire, un lacanien, sur la psychanalyse du récit, notamment chez Robbe-Grillet ; avec Dubois à Nanterre auparavant, et du coup en linguistique à Vincennes avec Ruwet, sur la grammaire générative, avec Todorov sur Chomsky, avec Germain, avec Henry Mitterand sur Zola, également sur le conte analysé par Vladimir Propp avec un excellent spécialiste dont le nom ne me revient pas. Dès la première année, c’était si passionnant que j’ai « passé » 14 «unités de valeur», dont on n’avait le droit de faire homologuer administrativement que six par an, me semble-t-il.
Tous les personnages rencontrés alors, pour moi fameux, sont demeurés des amis (Je ne les cite pas tous !), que je ne les ai pas toujours revus aussi souvent que je l’aurais voulu… D’autres poètes sont nés à Vincennes ces années-là. Je n’ai pas été le seul, à travers l’incroyable richesse intellectuelle de ces quelques années, à me mettre à écrire des poèmes, en quittant de plus en plus évidemment mes influences de jeunesse, dont je ne gardais souvent que le ton, ici ou là, pour jouer ou par ironie.
Ainsi, je peux bien dire que dans ma première dissertation du CAPES, j’ai forgé les citations de tous les auteurs selon les besoins de la thèse que j’avais à défendre, et si les correcteurs s’en sont aperçus, il n’en ont rien dit.
Pour les influences qui demeurent, ou celle qui sont intervenues plus tard, il y a eu évidemment Deguy, Bonnefoy, Bousquet, et plus tard Elytis, qui m’avait donné un tel inhumain travail pour l’acclimater en français, mais aussi qui m’a obligé à des « tours de force invisibles » si je puis dire. Car il m’en est resté qu’à la fois, il faut ne jamais renoncer à ce qu’on voulait dire, fût-ce par des tours de langue inusités ou incorrects, mais il faut également que cela «passe» quasiment sans que le lecteur s’en rende compte, que l’extrême artifice ait toutes les apparences du naturel jailli de la bouche proférante du poète. Comme ces statues de métal encore chaudes, brillantes au démoulage, qui n’ont pas reçu les coups de lime des polisseurs et paraissent sortir de la terre tout armées comme Athéna de la cuisse de Zeus.
En ce domaine, l’exercice de la traduction est puissamment formateur pour un passionné de poésie. De plus, je me sentais très parent d’Elytis dans la démarche qui consistait à ramasser secrètement toute la tradition littéraire de mon pays, jusqu’à Homère, puisque la Muse française, pour imiter un vers fameux, nous a faits fils de la Grèce, de Rome, des Chansons de geste, du Trobar Clus et de la poésie courtoise sarrazine, etc…
Vient un moment, lorsqu’on en a eu la patience, où tout ce foisonnement finit par se fondre en le métal particulier qui nous exprime exactement comme nous le voulons, et qui nielle de paroles d’argent le silence d’or de la page, damasquinant d’une sorte d’arabesque de vers l’épée aiguë de nos douleurs intimes.
Quant aux autres influences, il y eut Diderot, modèle pour moi inégalé de la prose française, dont les leçons ne sont pas à négliger en poésie. Et il y eut la vie, les années passées dans des sociétés étrangères, les amours, les deuils. Ce qui pèse, en somme, sur tout un chacun.
Nous terminons par une question qui aurait dû être la première. Pouvez-vous nous raconter qui vous êtes ? Votre parcours ? Les liens entre votre parole poétique et les événements de votre vie ?
…Qui je suis ? Voilà une question qui couperait les jambes à Diogène, celui qui « cherchait un homme » avec une bougie allumée en plein jour ! Je suis quelqu’un qui se tutoie, se regarde de l’extérieur, avec une enfance dont les dix premières années furent heureuses, et les dix suivantes une maladie intermittente, mais toujours présente, avec la mort qui rôdait jusqu’à mes vingt ans où un oncle médecin m’a annoncé que j’étais tiré d’affaire contre toutes probabilités. C’est ce qui m’a poussé à me passionner pour Joe Bousquet, dont je m’imaginais et reconnaissais fort bien l’état.
Coincé durant de longues périodes dans ma chambre, je lisais absolument tout ce qui pouvait me tomber sous la main, et quand je n’avais pas trop mal au crâne, je passais mon temps à écrire des musiques, que je composais pour moi, et que les gens trouveraient probablement inaudibles aujourd’hui. J’ai brûlé à peu près tout à la mort de mes parents. J’ai peint pas mal de tableaux aussi. D’ailleurs, quand la période de maladie a eu pris fin, je me suis jeté dans l’existence de toutes les manières.
Après ce n’importe quoi, j’ai rencontré Aïlenn — celle de La Pierre Amour — grâce à une conférence de mon cher Carlo Suarès, et ce fut comme d’arriver dans un port du bout du monde. Nous avons quitté Paris pour le Maroc où j’ai enseigné et fait du journalisme automobile de 1973 à 1984. Là, j’ai commencé à écrire, et en dehors des articles divers, ce que j’écrivais a « viré » rapidement d’une écriture, disons de prose « romanesque », vers la poésie.
Dans cette même période, j’ai préparé ma thèse de littérature sur Joe Bousquet, sous l’égide de Jean-Pierre Richard que j’avais connu, ainsi que d’autres professeurs devenus amis, tels que Michel Butor, Henri Meschonnic, Yves Bonnefoy, Nicolas Ruwet, Michel Deguy surtout, grâce auxquels la poésie a fini par acquérir pour moi une place centrale et vitale.
C’est durant ce séjour marocain que j’ai connu l’œuvre d’Elytis qui venait d’avoir le prix Nobel, et fait connaissance de Robert Longueville, mon co-traducteur. Alors qu’Elytis avait refusé quantité de traductions, dont quelques unes en collaboration avec René Char, il a aussitôt accepté les nôtres. J’ai publié dans Loess, dirigé alors par Jean-Pierre Roque, un numéro spécial illustré sur Odysseas Elytis. Quelques poèmes de moi titrés «La Nébuleuse du scrabble» en allusion à un tableau que m’avait offert le peintre Jean Trousselle — un peintre prodigieux et insuffisamment connu -, ont paru dans un livre collectif publié avec Michel Poissenot. Puis JP Roque a édité mon premier recueil personnel, dans un petit livre préfacé par Michel Deguy et avec un bois gravé de Jean Trousselle, qui s’intitulait « Le Sans-Père à plume ». Livre auquel P. Kéchichian a fait l’honneur d’un article dans Le Monde.
Ensuite a paru Marie des Brumes, d’abord en partie dans le revue PO&SIE, et plus tard chez l’ami Maspéro, qui n’était pas encore devenu « La découverte ». Quelques années plus tard, rentré en France, j’ai publié la traduction d’Axion esti, et mon premier recueil un peu massif, chez Gallimard.
Un jour, je reviendrai peut-être sur tout cela. Mais à vrai dire, voyant le tu que je suis à peu près aussi gros qu’un moucheron sur la vitre de l’horizon, je parle de ça pour vous faire plaisir. Il s ‘est passé tant de choses qui m’ont toutes apporté des signes et des impressions, qu’il faudrait des centaines de pages pour en parler, à supposer que cela ait la moindre importance !
De tout cela je déduis que, sous l’influence d’extrême importance accordée aux questions sonores, aux questions visuelles et plastiques, aux questions de civilisations, de philosophies diverses et de religions (que j’ai pratiquement toutes étudiées de près), ce que j’écris est un essai de connaître qui est, ce qu’est, l’homme, l’être humain, à travers l’ego que j’habite, la seule chose que je puis explorer de l’intérieur et de l’extérieur en même temps, comme quelqu’un qui est en colère peut, en même temps, observer dans un miroir son visage en train de dessiner les traits de la colère, et s’objectiver ainsi. Le langage pour moi joue ce rôle. Il fait correspondre le dedans et le dehors, la sensation et l’interprétation, et permet par analogie de tenter de comprendre les autres, et les choses du monde chaotique et mystérieux en lequel la naissance nous a précipités…
Je me vois comme un banal «homme des lumières», dont le modèle premier de prosateur est Diderot et le modèle premier de poète est La Fontaine, accompagnés évidemment de quelques autres : le Claudel prosateur de Connaissance de l’Est. Le Max Jacob du Laboratoire Central. Henri Michaux, et une foule d’autres, dont Louis Parrot, quasiment ignoré aujourd’hui… Bref, la liste de ceux qui ont jalonné mon parcours est infinie. Disons que, dans l’ensemble, ce ne sont pas des poètes laconiques. Ni minimalistes, si cela a un sens. De toutes façons, la magie poétique est si difficile d’accès qu’un siècle comme le XX ème, qui a connu une abondance de poètes de qualité ¨C il suffit de se plonger dans les anthologies pour s’en rendre compte -, ne verra tout de même se dégager qu’une poignée de noms incontestables. Et les autres, si méritants et explorateurs qu’ils aient été, retomberont dans le minuscule espace confidentiel de quelques cercles d’initiés.
Ce que j’appelle « magie poétique », c’est le fait que — un peu comme à lire « Les enfants de Septembre » de Patrice de la Tour du Pin — tel poème vous empoigne à la première lecture, vous jette dans une façon nouvelle de voir le monde, et qu’elle ne vous quitte plus : on en demeure agrandi à jamais. Les poètes capables de cela, ceux que j’appelle pour moi « intensément poètes » sont rares. Pour les autres, les bons poètes, il en existe des tas, qui ne laissent dans nos mémoires rien de décisif hélas, car la manipulation habile du langage n’est que l’une des serrures qui ouvre la porte de l’inconnu… Mais ce n’est pas la principale, et ceux qui veulent croire qu’elle l’est se plongent dans une illusion à laquelle ils croient, mais qui n’est qu’une imposture : leur langage et ce qu’ils sont ne coïncident pas.
Enfin, pour en arriver aux liens entre mon «parcours poétique» et ma vie, cela supposerait une vraie biographie, chose impossible ici. Mais je puis répondre sur le principe : un poète cherche à tout propos ce qui est à tel point infiniment lui-même que cela devient un trait général de toute l’humanité. C’est à force d’être particulier en poésie, avec ses qualités, ses réussites, ses défauts et ses erreurs, que le poète a une chance de devenir universel. Bien entendu, cela ne suffit pas non plus : il faut qu’il sente constamment sur ses épaules le poids de l’Inexplicable, du jusqu’alors indicible, et qu’il parvienne à en formuler quelques bribes en les rendant inoubliables. Il s’ensuit que tout poème est évidemment « de circonstance », et en même temps, que s’il est poème il transcende radicalement la circonstance qui l’a fait naître.
J’ajouterai qu’il faut, pour parvenir à cela, une rigueur envers l’écriture et envers soi-même qu’on peut qualifier d’impitoyable, et qui rend souvent la vie insupportable à l’entourage. En tout cas, je vous livre ici les conclusions de mon expérience, qui vaut ce qu’elle vaut : rien pour certains, beaucoup pour d’autres… Et sans préjuger du devenir d’une somme d’écrits, les miens, qui ont davantage de chances de tomber dans l’oubli que de susciter l’engouement des lecteurs à venir. En existera-t-il d’ailleurs, lorsqu’on s’attarde un peu à anticiper la façon dont tourne la situation des êtres humains sur cette planète ? Je comprends, même si quelqu’un en moi m’empêche de la partager, la position des écrivains qui considèrent qu’écrire ne vaut que si ça sert à faire de l’argent et de la célébrité tout de suite ; et que la poésie est un type d’exercice si complètement périmé que nulle œuvre désormais ne survivra vingt-six siècles comme a survécu celle d’Homère ou les Upanishads.
Je dirais volontiers, à la suite de Nietzsche dans les Sept Sceaux, faisant dire à Zarathoustra : « Parce que je t’aime, ô éternité ». Cependant, une sorte de démon ironique toujours présent dans un coin de ma conscience se moque, me raille ainsi que l’esclave dans le char du triomphateur, en susurrant « N’oublie pas que tu es mortel ! » Dans mon cas, c’est pratiquement dès mon entrée dans la vie qu’il a commencé à chuchoter à propos de l’insignifiance de l’art, de la physique, des mathématiques, de la musique, de l’écriture, de la poésie en général, sans cesser une seconde depuis… J’y vois pour seul avantage que cela aura entraîné mon esprit à une forme de pénétration intellectuelle, d’exigence et d’intuition suraiguisée, qui me fait en permanence sonder les gens et les choses pour soulever le masque d’or derrière lequel se cachent les génies grimaçants de la réalité, celle que construit évidemment la pensée des hommes !
J’ajouterai que la plupart des artistes ou des écrivains remarquables que j’ai eu la chance de rencontrer, sur ce point sont rarement d’une opinion différente de celle que je viens d’énoncer. Odysseas Elytis ne disait il pas « La vérité s’échafaude exactement comme le mensonge » ! Ce genre de vérité est précisément ce que j’appelle réalité. Une réalité jamais achevée, que l’esprit poétique ressent avoir pour mission de continuer, de développer, d’enrichir de toutes les façons accessibles au cerveau humain, tout en sachant… que ce n’est rien, et que tout créateur mourra avant d’avoir obtenu le commencement d’une bribe du « fin mot de l’histoire ». Sous cet angle, les religions sont pour moi des tentatives et des réussites (ou des ratages) poétiques comme les autres, quand même certaines eurent si peur de la rivalité naturelle des poètes en leur temps que leurs prophètes ont mis la poésie à l’index ! Au fond, je crois que la position du poète est pour ainsi dire « christique », même s’il ne s’agit pas de christianisme. En travaillant à assurer le salut d’un langage, le poète cherche à sauver quelque chose de ce qui constitue l’essence de l’être humain, et probablement son « meilleur », une « vision », une « perception », une « apparition », je ne sais comment dire : mais là, nous entrons dans une forme de jugement qui supposerait que nous ayons des raisons de nous estimer ici dans une position surplombante, qui autoriserait à juger. Ce n’est plus du ressort du poète, mais sans doute du philosophe et des institutions, autrement dit de ce qui est à la poésie ce que l’intendance est à l’avant-garde, en quelque sorte. Bon, je stoppe ici…
Je souhaite que ces réponses, forcément parcellaires, vous donnent, à vous et à vos lecteurs, un peu de satisfaction.
Propos recueillis par Gwen Garnier-Duguy
- ZÉNO BIANU : Rencontre avec Gwen Garnier Duguy - 7 juillet 2024
- L’honneur des poètes - 5 juillet 2021
- Revue des revues - 4 juillet 2021
- Marc ALYN, Le temps est un faucon qui plonge - 5 mai 2018
- Xavier Bordes : la conjuration du mensonge - 1 mars 2018
- Entretien avec Nohad Salameh - 1 mars 2018
- Rencontre avec Richard Millet - 8 novembre 2017
- RENCONTRE AVEC BERTRAND LACARELLE - 2 septembre 2017
- Jean-Louis VALLAS - 31 mars 2017
- Elie-Charles Flamand, La vigilance domine les hauteurs - 28 juillet 2016
- Elie-Charles Flamand - 21 juillet 2016
- Munesu Mabika De Cugnac : Un monde plus fort que le reste - 31 mai 2016
- ZÉNO BIANU - 29 mars 2016
- JAMES SACRÉ - 27 février 2016
- Avec Claire BARRÉ pour son roman ” Phrères” - 8 février 2016
- La collection poésie/Gallimard fête ses 50 ans : rencontre avec André VELTER - 3 janvier 2016
- André Velter/Ernest Pignon-Ernest, Pour l’amour de l’amour - 21 novembre 2015
- Conversation avec Xavier BORDES - 8 septembre 2015
- THAUMA, n°12, La Terre - 14 juillet 2015
- Jean Maison, Presque l’oubli - 5 juillet 2015
- Paul Pugnaud, Sur les routes du vent - 10 mai 2015
- JEAN-FRANÇOIS MATHÉ - 28 février 2015
- Juan Gelman, Vers le sud - 20 février 2015
- CHRISTOPHE DAUPHIN - 1 février 2015
- Claude Michel Cluny - 11 janvier 2015
- MARC DUGARDIN - 13 décembre 2014
- A‑M Lemnaru, Arcanes - 6 décembre 2014
- Maram al-Masri, L’amour au temps de l’insurrection et de la guerre - 30 novembre 2014
- Revue Les Hommes sans Epaules, n°38 - 1 novembre 2014
- Onzième n° de la revue THAUMA - 19 octobre 2014
- François Angot, A l’étale - 13 octobre 2014
- Si loin le rivage,d’Eva-Maria Berg - 14 septembre 2014
- Sur deux livres récents de Jigmé Thrinlé Gyatso - 7 septembre 2014
- Saraswati, revue de poésie, d’art et de réflexion, n°13 - 7 septembre 2014
- JEAN MAISON 2ème partie - 28 août 2014
- Nunc n° 33 : sur Joë Bousquet - 25 août 2014
- PHILIPPE DELAVEAU - 13 juillet 2014
- Le prix Charles Vildrac 2014 remis à notre ami et collaborateur le poète Jean Maison pour son recueil Le boulier cosmique (éditions Ad Solem) Extraits - 16 juin 2014
- Rencontre avec Nohad Salameh - 13 juin 2014
- Jean-François Mathé, La vie atteinte - 8 juin 2014
- PASCAL BOULANGER - 18 mai 2014
- Charles Bukowski, Les jours s’en vont comme des chevaux sauvages dans les collines - 21 avril 2014
- Paul Verlaine, Cellulairement - 7 avril 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (10) Arnaud Bourven - 6 avril 2014
- La vie lointaine de Jean Maison - 30 mars 2014
- L’Heure présente, Yves Bonnefoy - 23 mars 2014
- MARC ALYN - 22 février 2014
- BERNARD MAZO — AOÛT 2010 - 12 février 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (6) Pascal Boulanger - 8 février 2014
- Pierre Garnier - 1 février 2014
- Une nouvelle maison d’édition : Le Bateau Fantôme - 30 janvier 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (5) Gérard Bocholier - 26 janvier 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (4) : Alain Santacreu - 12 janvier 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (3) : Jean-François Mathé - 30 décembre 2013
- JEAN-LUC MAXENCE - 29 décembre 2013
- Rencontre avec Gilles Baudry - 30 novembre 2013
- A L’Index, n°24 - 25 novembre 2013
- Jean-Pierre Lemaire - 1 novembre 2013
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (1) - 23 octobre 2013
- Le dernier mot cependant de Jean-Pierre Védrines - 16 octobre 2013
- Mille grues de papier, de Chantal Dupuy-Dunier - 9 octobre 2013
- Rencontre avec Balthus de Matthieu Gosztola - 29 septembre 2013
- Demeure le veilleur de Gilles Baudry - 25 septembre 2013
- EUGENIO DE SIGNORIBUS - 25 août 2013
- Dans la poigne du vent, de F.X Maigre - 16 juillet 2013
- L’extrême-occidentale de Ghérasim Luca - 8 juillet 2013
- Au commencement des douleurs, de Pascal Boulanger - 22 juin 2013
- Le 23e numéro de A l’Index - 20 mai 2013
- James Longenbach, Résistance à la poésie - 10 mai 2013
- Jean Grosjean, Une voix, un regard - 19 avril 2013
- Etienne Orsini, “Gravure sur braise” - 5 avril 2013
- Paroles à tous les vents, Boulic - 22 mars 2013
- Gérard Bocholier, ses deux derniers recueils - 15 mars 2013
- Jean-Pierre Lemaire, Faire place - 8 mars 2013
- Ariane Dreyfus, par Matthieu Gosztola - 2 mars 2013
- Marc Delouze, “14975 jours entre” - 24 février 2013
- Mangú : Le sens de l’épopée - 23 février 2013
- Les poèmes choisis de Paul Pugnaud - 9 février 2013
- Faites entrer l’Infini, n°54 - 2 février 2013
- Au coeur de la Roya - 19 janvier 2013
- Entretien avec Jean-Charles Vegliante - 24 novembre 2012
- Un regard sur Recours au Poème - 3 novembre 2012
- Pierrick de Chermont, “Portes de l’anonymat” - 7 octobre 2012
- Denis Emorine, “De toute éternité” - 6 octobre 2012
- Hommage à Sarane Alexandrian, Supérieur Inconnu n°30 - 6 août 2012
- POESIEDirecte n°19, le désir - 2 août 2012
- Marc Baron, Ma page blanche mon amour - 1 août 2012
- Bernard Grasset, Au temps du mystère… - 1 août 2012
- Totems aux yeux de rasoir - 19 juillet 2012
- Vers l’Autre - 5 juillet 2012
- Jean-Pierre Boulic - 2 juillet 2012
- Jean-Luc Wauthier - 2 juillet 2012
- Le bleu de Max Alhau - 30 juin 2012
- Jean Maison, Araire - 21 juin 2012
- Rencontre Jean MAISON [1ère partie] - 13 juin 2012
- Patrice de La Tour du Pin, le poète de la Joie - 18 mai 2012
- Rencontre avec Iris Cushing - 5 avril 2012