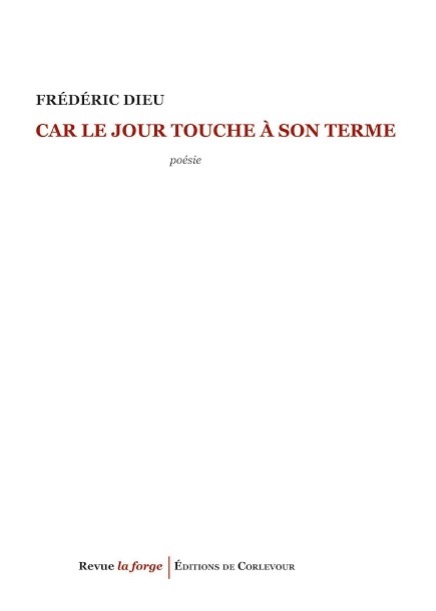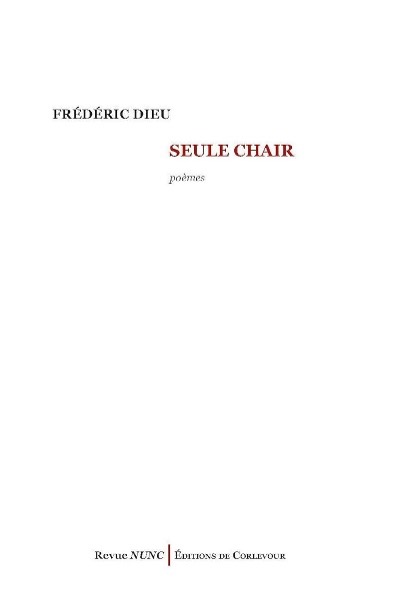I.L. : « Proch dolor » dans Car le jour touche à son terme, « Dominus flevit » dans Seule chair : ces quelques mots latins participent-ils de l’inscription de ces livres dans une tradition ?
F.D. : Il est certain que j’aime la langue latine, que j’ai longtemps étudiée avec bonheur durant ma scolarité et qui est aussi la langue dans laquelle sont parfois chantés, dans certains monastères, les Psaumes qui sont parmi les textes les plus poétiques de la Bible. Mais les titres que vous mentionnez ont une origine plus précise. « Proch dolor » est le titre d’un motet de Josquin des Prés (1450/1455 – 1521) que j’aime beaucoup, c’est une chanson de deuil composée en hommage à l’Empereur Maximilien, dont la trame et le déploiement polyphoniques accompagnent l’âme du défunt dans sa montée vers Dieu.
« Dominus flevit », qui signifie « Le Seigneur a pleuré », est le nom d’une église de Jérusalem située sur le Mont des Oliviers, édifiée là où, selon les Evangiles, le Christ a pleuré sur Jérusalem (Lc 19, 41-44), une église à laquelle son architecte italien, Antonio Barluzzi, a donné la forme d’une larme : une larme posée donc sur le Mont des Oliviers, qui ne coule pas, qui ne peut ainsi disparaître, parce qu’elle ne cesse jamais d’être versée, parce qu’elle est le fruit d’une lamentation qui ne passe pas.
I.L. : Deux œuvres musicales apparaissent dans Car le jour touche à son terme, un motet de Josquin des Prés (« Proch dolor ») et le Quatuor pour la fin du Temps de Messiaen. Est-ce en raison du texte pour l’un, des circonstances de composition pour l’autre ? Ou la musique elle-même entre-t-elle en compte ? Quel rapport votre écriture entretient-elle avec la musique ?
F.D. : J’aime, dans certains poèmes, entretenir une forme de dialogue et de résonance avec d’autres arts. Ou plutôt, parce que le terme d’entretenir relève d’un volontarisme et d’une théorisation/systématisation qui ne sont pas les miens, il arrive que des œuvres relevant d’autres arts me touchent et m’émeuvent tellement, s’insinuent si profondément dans le secret de mon cœur, s’y déposant comme une question personnelle essentielle, que se manifeste en moi, impérieux, vital, le désir d’y répondre par le poème.
Je viens de parler de « Proch dolor » qui relève de la forme du tombeau et qui a révélé et suscité chez moi cette réponse sous forme de déploration et de plainte sans recherche et désir de consolation. Le poème qui fait écho au Quatuor pour la fin du Temps créé par Olivier Messiaen pendant son temps de captivité au stalag de Görlitz en Silésie (Pologne actuelle) a quant à lui été suscité par les conditions de création de ce quatuor autant que par sa substance musicale même : une création dans l’hiver et la nuit de la guerre, dans la souffrance du froid et de la faim, dans le plus grand dénuement, à un moment où l’Allemagne nazie paraissait avoir définitivement asservi l’Europe entière, à un moment où tout semblait perdu. Et pourtant, prenant fond sur tout cela, en faisant sinon le motif du moins la motivation de la création, se déploie un long poème musical et se dessine une délivrance dont les oiseaux sont les annonciateurs et les éclaireurs.
Mais il m’arrive aussi de recevoir d’un peintre l’émotion et la « convocation » sous forme de question que j’évoquais à l’instant. Mon deuxième livre intitulé Matière à joie (Ad Solem) se clôt ainsi sur un poème inspiré par l’œuvre picturale de Giorgio Morandi (1890-1964) dont les natures mortes ne cessent de me bouleverser, notamment par leur disposition « épaule contre épaule » en quasi-portrait de famille, par leurs contours tremblés, précaires, par leurs couleurs passées, par leur fond laiteux, indécis, profond. M’émeut également la façon dont Morandi a travaillé toute sa vie : dans le même atelier familial de Bologne, à partir de pots, bouteilles, carafes, boîtes de conserve ramassés ou collectés au hasard, à partir de toute une « population » d’objets modestes, d’humbles matériaux auxquels il a conféré une incomparable stature et dignité, une beauté discrète et pourtant puissante.
Je peux aussi citer le poème de Seule chair intitulé « La dérobée » : il m’est arrivé tout entier et presque d’un seul coup de l’un des tableaux profondément mélancoliques du peintre danois Hammershoi (1864-1916) qui avait pris l’habitude de peindre son épouse de dos, présence/absence de celle qui est à la fois proche mais comme aspirée par les couleurs là aussi profondes et passées de l’appartement, de son intérieur, ainsi presque en voie de disparition, son visage étant parti le premier. Ce tableau était au fond la projection très exacte du poème qui, en moi, était appelé par la situation que je rencontrais et attendait d’être écrit : ce poème m’attendait et m’appelait mais je ne percevais que des bribes de voix, des morceaux de phrase, qui revenaient, lancinants mais isolés, membres épars détachés de leur corps. La vision du tableau de Hammershoi a totalement ouvert en moi le passage de ce poème en attente et elle me l’a livré et montré tout entier, je n’avais plus qu’à écouter et retranscrire ce qu’il disait !
I.L. :
« Erre le regard sur les bâtisses calcinées, erre et se blesse à l’angle des rues mortes,
où l’on cherche sa vie cherche son bien quelque part où croit que visage et vérité se cachent.
Dès le matin sur les ruines éclairant devant soi la
ville détruite à l’intérieur de soi. La ville où seul appelle et blesse l’angle des rues sans visage.
Appelle et blesse mais l’inverse des caresses est plus supportable que leur absence.
Dès le matin un soleil sans pardon se propose ta perte. »
(« La femme de Loth », in Car le jour touche à son terme, p. 13)
Les versets de vos deux derniers livres contiennent souvent des cellules lexicales qui glissent de l’un à l’autre comme, dans cet extrait : « erre », « blesse », « dès le matin »… tissant un réseau serré de reprises, mots répétés, allitérations et assonances. Comment envisagez-vous l’écriture en versets, leurs rythmes, leur musicalité ?
F.D. : Cela relève en effet de la musique interne au poème et à son déploiement, son mouvement. Mais il est difficile pour moi d’expliquer comment j’aboutis à ce réseau de reprises et de mots tissés (terme tout à fait approprié à ma pratique d’une écriture comme/en tissage d’un vêtement) car au fond, dès lors que le poème a lancé et fait entendre son premier coup d’archet, je suis ensuite, dans le cheminement de mon écriture, dans le sol de la page que je foule, à son écoute et c’est lui qui me parle de cette façon tissée, par reprises, résonances, échos et (sans connotation péjorative pour moi) ressassements. Cette écriture de la lancinance et de la répétition m’est devenue si intérieure qu’elle avance « toute seule » : elle est au fond ma façon de marcher (chaque personne marche d’une façon différente !), ma façon d’avancer. Et quand on marche, on ne pense pas qu’on est en train de marcher, sinon on risque de tomber ! Non, on marche, c’est tout, et on marche à sa façon. C’est ce que je fais dans mes poèmes : je marche à ma façon.
Mais vous avez tout de même raison de pointer cette pratique des reprises lexicales et vocales/phoniques car elle vient bien de quelque part ! Je crois qu’elle est largement inspirée par la lecture de la Bible et en particulier par la rhétorique sémitique qui irrigue les grands livres prophétiques et sapientiaux, tels que celui d’Isaïe, des Psaumes ou de Job. Ces livres, leurs versets, sont construits sur la base d’une structure concentrique dans laquelle la parole se déploie tout en revenant sur elle-même de manière symétrique, en mettant en parallèle des phrases et des termes qui sont différents mais qui se répondent et expriment la même réalité (on parle alors de parallélisme synonymique, par opposition au parallélisme antithétique) tout en l’amplifiant par cette répétition et ce prolongement. Ainsi, dans le livre d’Isaïe (41, 24), il est dit des idoles : vous êtes moins que rien, et votre œuvre, c’est moins que néant. Et dans le livre de Job (3, 3-7), qui a tant marqué Samuel Beckett : Périsse le jour qui me vit naître / et la nuit qui a dit : « Un garçon a été conçu. » / Ce jour-là, qu’il soit ténèbres…/ Cette nuit-là, qu’elle soit stérile.
Enfin, je dois dire aussi que, depuis très longtemps, je suis un amateur de Blues, particulièrement des anciens, d’abord, bien sûr, Robert Johnson, mais aussi Son House, Lightnin’ Hopkins, Smokey Hogg, John Lee Hooker… Or, tout morceau de Blues est répétition et ressassement avec quelques variations des mêmes « idées noires »…
I.L. :
« Un trait qui tremble sur l’eau, une ligne brisée, reste ou début d’écriture. Si
sujet à l’effacement. Menacé de disparaître dans le silence blanc de l’océan. »
(« Sein », in Car le jour touche à son terme, p. 50)
« Ainsi s’achève chaque jour d’été, le regard posé sur la table grise de la mer,
debout sur la terrasse à contempler la grande toile du repos
et goûter, ardente et fragile, la paix des volcans qui passe l’entendement
brûlant à l’intérieur mais présentant figure douce et tiède, renonçant à son
incendie pour se porter jusqu’à nous en brise délicate. Que l’on ne craigne pas sa
caresse. »
(« Salina », in Car le jour touche à son terme, p. 60)
Souvent vos phrases sont segmentées par des points. Parfois, au contraire, elles s’allongent sur deux ou trois versets, le point se fait attendre. Par rapport à l’usage, quelques virgules manquent. Comment envisagez-vous la présence de la ponctuation ?
F.D. : Là encore, la ponctuation doit être pour moi la plus fidèle possible à la « retranscription » du rythme et de la musique que le poème fait entendre en moi, à la façon dont il se fait entendre et veut se déployer. Il a son autonomie, qu’il faut respecter, son mouvement propre : parfois il veut accélérer, dans un seul souffle, et demande alors qu’on ne le ralentisse pas par des virgules ; parfois il ne peut se faire entendre que dans un long déploiement de plusieurs versets, en reprenant sa respiration entre deux versets (c’est le cas dans l’extrait du poème « Salina » que vous citez) ; parfois enfin il fait entendre sa foulée, sa scansion, ses saccades, car il progresse à marche « normale », quitte à allonger le dernier pas (c’est le cas dans l’extrait du poème « Sein » que vous citez).
La ponctuation est donc pour moi, mais c’est assez banal, au service du rythme propre du poème, de sa musique intérieure, à la façon dont il imprime sa marche en moi. Et je reconnais que, ce point de vue, je m’accorde parfois quelques licences, comme vous l’indiquez, en omettant en particulier des virgules, délibérément, pour accélérer le rythme et manifester d’un seul souffle le drame, comme par exemple dans le poème « Terres brûlées » qui ouvre le recueil où je parle de « même les enfants pris arrêtés dans leurs jeux ».
I.L. : Votre poésie est-elle de préférence à lire ou à écouter ?
F.D. : Je répondrai par un terme et un verbe tiers : elle est à dire. J’entends par là qu’elle n’est pas à proprement parler orale, elle ne nécessite pas de performance orale et peut tout à fait s’accommoder d’une simple lecture solitaire, dans le secret d’une chambre ou d’un paysage, d’un environnement que ne mutile pas l’horrible grésillement métallique des prothèses auditives et des écrans atroces qui déversent sans trêve leur bruit et leur bêtise. Mais elle doit être dite, donc proférée à l’intérieur de soi, et pas seulement lue car c’est seulement en étant dite qu’elle peut faire entendre son rythme et sa musique qui participent tout autant que ses mots au déploiement de son mouvement et de son histoire.
I.L. : Vous évoquez au début de Car le jour touche à son terme (p. 9), votre « poétique de la peau livrée ». Seule chair commençait en automne, dans une ville dont le nom (Saint-Maur-des-Fossés) évoque les défunts, puis venaient mariage, naissance, séparation, lutte… Car le jour touche à son termecontinue dans un paysage dévasté, où l’on tente de se relever par des voyages, une quête de sens… Les poèmes peuvent-ils se lire comme les fragments d’un journal intime ou du récit d’une vie ?
F.D. : Oui, mes poèmes sont inspirés et même imposés par ma vie et par ses épreuves. Mais s’ils plongent effectivement dans l’intimité et descendent ainsi très bas dans le secret et l’obscurité de l’homme intérieur, c’est pour le faire sortir de ce tombeau et le hisser jusqu’à la lumière du jour, celle-ci se rencontrât-elle, se donnât-elle à connaître dans l’épaisseur de la nuit.
Je pars de très bas et de très sombre pour aller vers la lumière, pour tenter d’aller vers la lumière, pour voir s’il y a, plus haut, plus loin, s’il y a quelque part de la lumière. Dans ces souterrains et ces boyaux obscurs, le poème est ma lampe.
I.L. :
« Claire tunique ajourée. Avant que s’abatte un coup comme
tombé du soir – en plis qui ondoient puis avalent les membres du cortège.
Tombé du soir – en crêpe flottant indécis autour des manteaux. Couvre-feu. Couvre-
face.
L’heure endrapée se pose sur les paupières et contre la bouche. »
(« Un vêtement que l’on passe », in Seule chair, p. 17)
« Le vent de la colère ne m’a pas emporté. Et, ce matin, visitées par la prime
lumière, terre et chair se surprennent à fleurir. »
(« Terres brûlées », in Car le jour touche à son terme, p. 12)
Comment la nuit remue-t-elle pour vous dans, ou par, l’écriture ? Le « terme » du jour est-il une promesse d’apaisement, ou le début de l’attente de l’aube ?
F.D. : Par contraste avec un jour qui peut être dur, cru, implacable et accusateur, un jour qui est impudique et sans pardon, la nuit (dont le « substrat phonique » est d’ailleurs lumineux alors que celui du jour est plutôt sombre) est douce, consolante et apaisante, miséricordieuse et respectueuse du secret. La nuit est en quelque sorte le baume passé sur les souffrances et les douleurs du jour, elle est réconciliatrice. Et elle réconcilie ainsi le jour avec lui-même, de sorte qu’elle est doublement le terme du jour : elle en est la fin et l’autre nom, le vrai nom. Par sa lumière (Eloi Leclerc a écrit un très beau livre consacré au retable d’Issenheim qu’il a intitulé La nuit est ma lumière), la nuit fait le jour sur le jour, fait le jour sur mon jour.
Le terme du jour, c’est donc sa fin dans le double sens de ce qui clôt et de ce qui accomplit l’être. Et cet accomplissement advient dans la nuit, celle-ci étant plutôt l’issue du jour que l’attente de l’aube.
I.L. : La première partie de Car le jour touche à son terme, a pour titre « Arrière-pays », ce qui fait aussitôt penser à un livre majeur d’Yves Bonnefoy. Votre « arrière-pays » est-il d’abord un temps, celui de l’enfance ?
F.D. : Cette expression aussi a dans mon livre un double sens : l’arrière-pays, c’est bien sûr, dans sa part fondatrice et fertile, cette terre, ce paysage intérieur, cette histoire, ce temps auxquels on peut toujours s’adosser et revenir s’abreuver comme à un puits jamais asséché ; mais c’est aussi, dans sa part sombre, la somme des épreuves et des souffrances endurées, les stigmates ineffaçables et irrémédiables qu’elles ont laissés sur la peau, sur les terres qu’elles ont ainsi abîmées, et c’est surtout la tentation d’en rester toujours à la déploration et à la contemplation de ces malheurs, comme le fait la femme de Job. Le risque au fond de s’y complaire et d’élire domicile dans des « terres brûlées ».
I.L. :
« Allongé sur l’eau ton corps souple et fin, frêlement sinueux. Et moi, à peine
Îlien de France, réfugié contre toi. Mon histoire de corps en dérive dans le monde
flottant – dans ton histoire de sauvetages et de naufrages, de terre impossible dans
l’océan. »
(« Sein », in Car le jour touche à son terme, p. 49)
Les îles sont très présentes. Dans Car le jour touche à son terme, apparaissent Sein et Ouessant, îles extrêmes. Vous adressant à Sein, vous écrivez : « Peut-être reposes-tu sur les plus humbles. Comme le monde sur les trente-six justes cachés » (p. 53). Vous évoquez aussi Salina, île aux deux volcans. Sont-elles source d’une habitation poétique du monde ? Peuvent-elles sauver des naufrages personnels, de la tentation du désespoir quand on ressent « [l]a fatigue et le refus de compter jusqu’à soixante-dix fois sept fois » (p. 39) ?
F.D. : Je suis depuis longtemps, depuis ma jeunesse, fasciné par les îles, par leur forme de retraite et de radicalité dans l’affrontement de l’adversité, par le fait d’être une terre détachée des continents. Vous parlez justement d’habitation poétique du monde : pour moi en effet, vivre sur une île, dans un certain isolement et une certaine précarité et fragilité, dans le détachement de ce qui est continental, massif et plein de soi, vivre sur une île donc est la façon la plus évidemment « extérieure » d’habiter poétiquement le monde. Il n’y a pas d’écriture, pas d’art, pas de création sans retraite, sans contemplation initiale, sans décision de s’écarter du monde et de son bruit, non pour le dénigrer, le mépriser ou le fuir mais pour découvrir ses ressorts cachés, ce qui le fait tenir, pour l’aimer mieux et s’y trouver mieux.