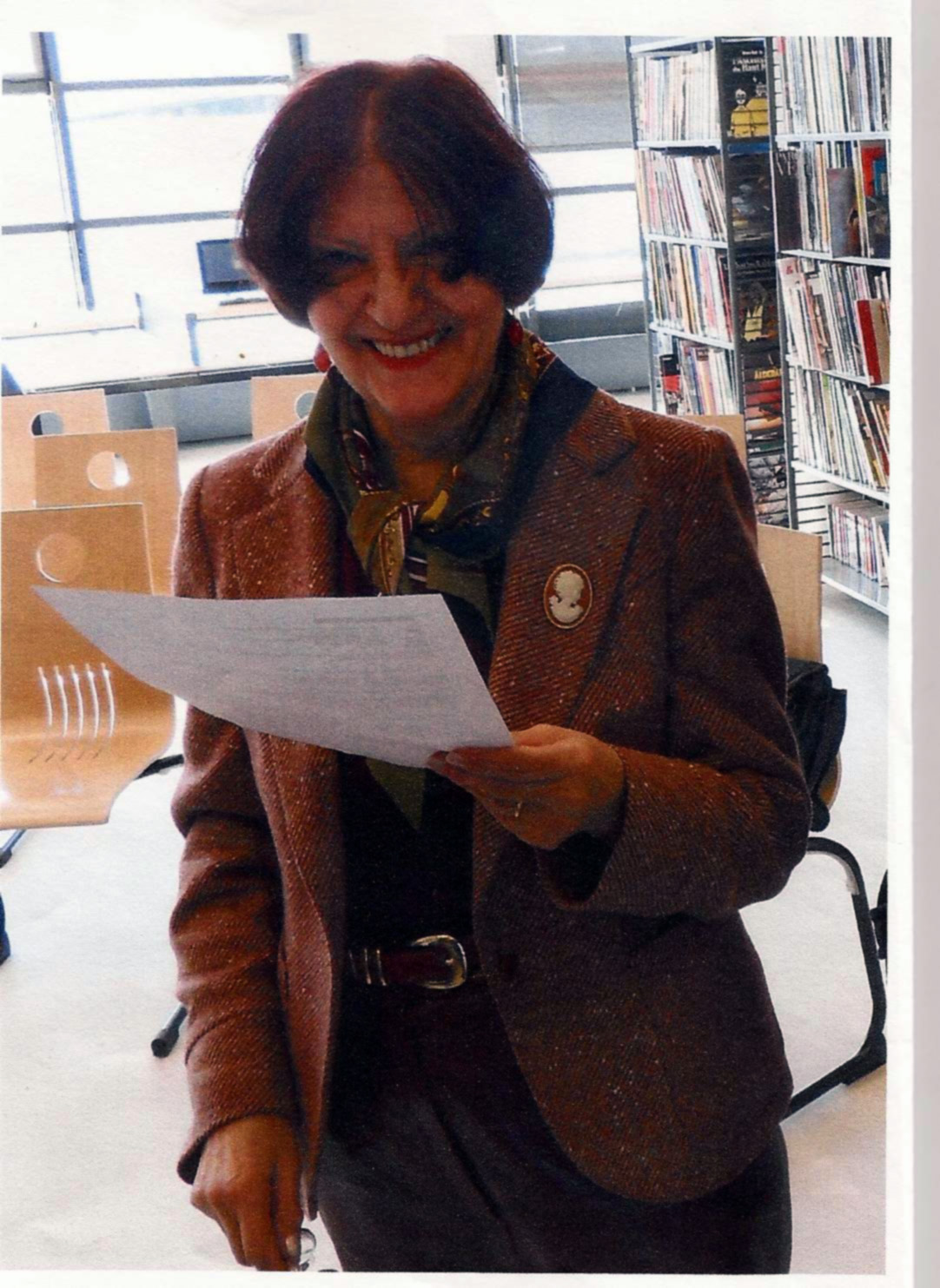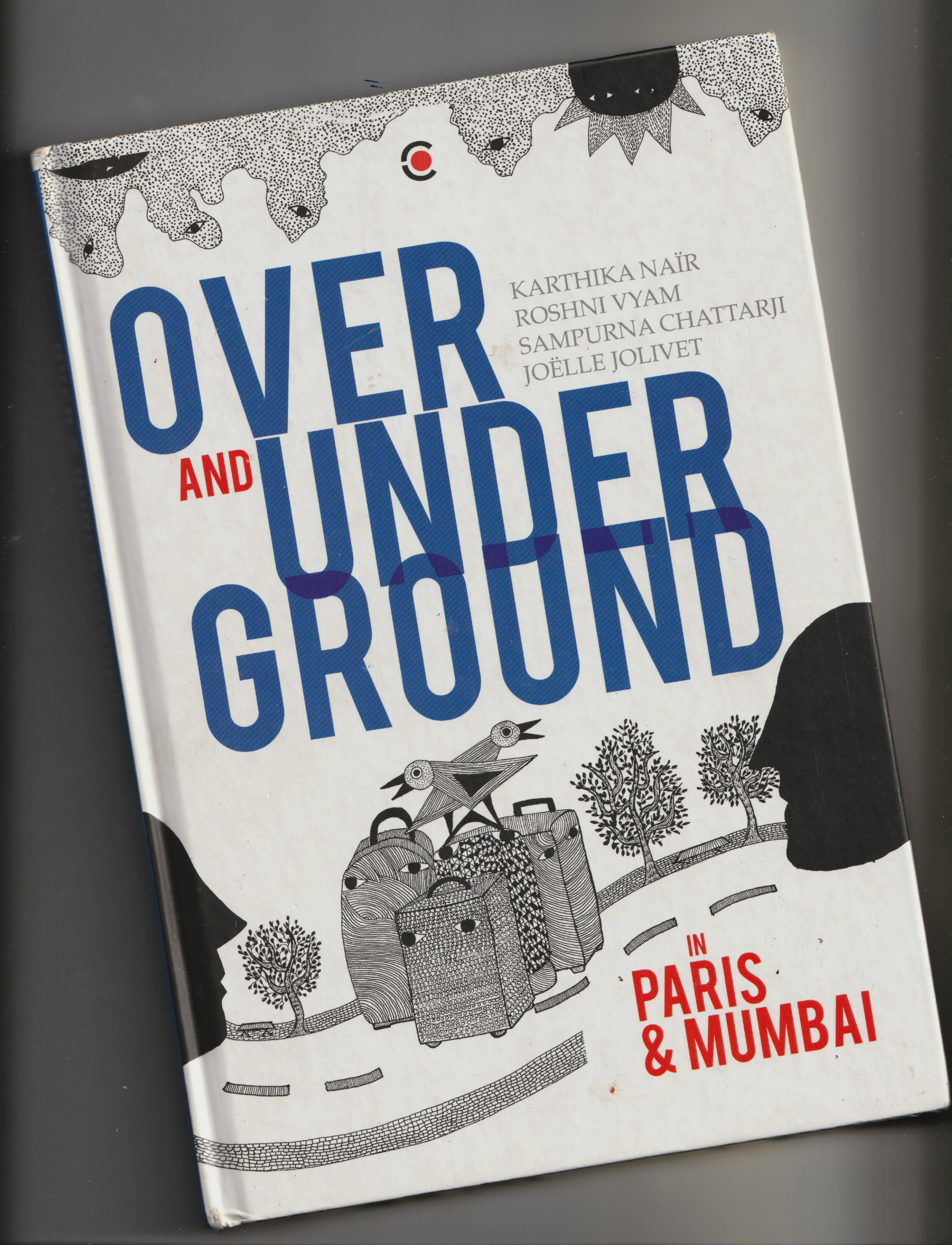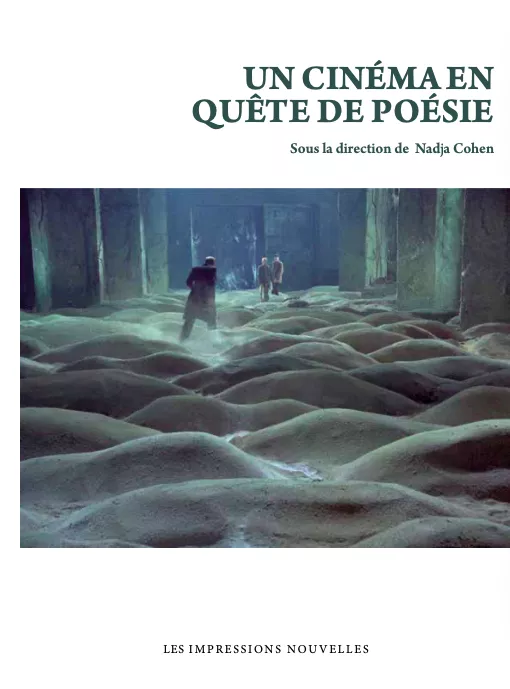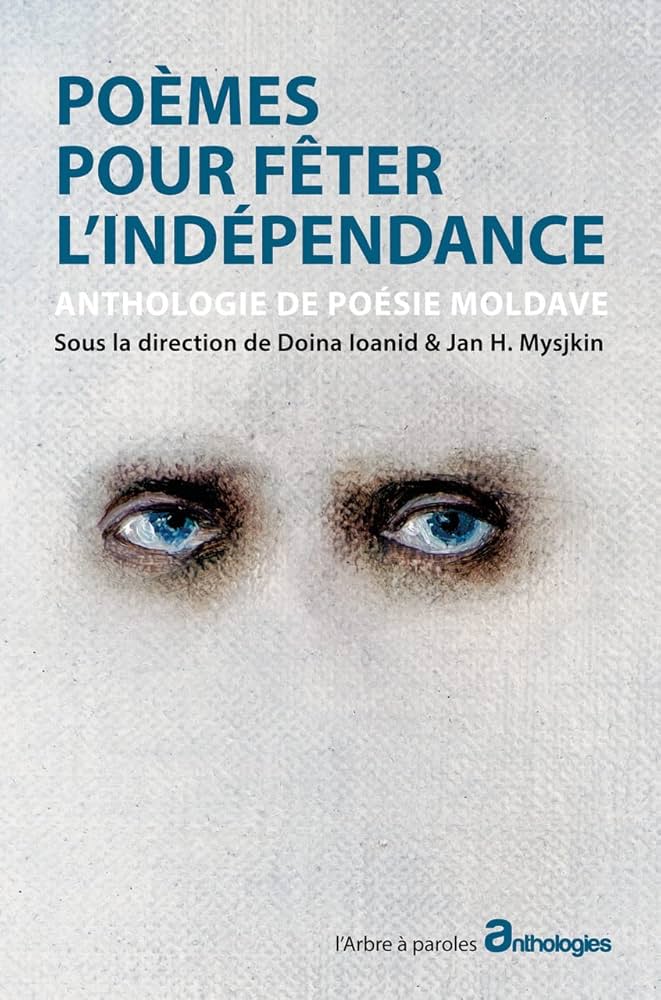Le recueil Jardin sans terre de Nohad Salameh – grande poète libanaise, de culture chrétienne et d’expression française, –, paru en mars 2024, avec des dessins de Jean-Marc Brunet aux éditions Al Manar, reste marqué par l’exil et la déchirure, malgré sa beauté architecturale et s’ouvre par une épigraphe de Nietzsche : « Le Désert grandit : malheur à celui qui recèle un désert ». La première partie « Sandales de sable » (p. 9) évoque ainsi un désert oraculaire, augural et mythique :
Doublés d’oracles
Nous pressentons le désert (p. 25)
Désert peuplé de « fables et royaumes », paysage né du chant (p. 25), désert comme une stance, un cantique. Ainsi ce désert qui gagne en nous est habité par l’imaginaire et le rêve.
Désert se dit en grec Eremia. Le terme désigne, au sens premier, un endroit non habité, par exemple ces rochers abrupts, ce lieu sans humains où Zeus et Héphaïstos vont enchaîner Prométhée. Il est cette immense étendue où l’on se perd et qui connote une absence d’hospitalité, un terrible sentiment d’abandon, un lieu sans vie et sans hommes, au bout du monde, affecté d’un climat extrême, trop chaud ou trop froid. Il désigne un désert de sable, une terre aride ou une région glacée. Il est tel ce vide qui se creuse, désert cosmique au cœur de toute chose, désert de pierre et de terre pétrifiées par le sel, espace de sécheresse entre terre et ciel. C’est pourquoi Eremia signifie aussi solitude, isolement puis désolation, dévastation et enfin vide, absence ou privation :
Rien que ce non-ciel
sur toutes les pistes de l’âme
dans la stupeur des nuits
en marche vers l’égarement
l’excès ou l’exiguïté d’espace
au point de ne plus savoir où poser le pied (p. 11)

Nohad Salameh, Jardin sans terre, dessins de Jean-Marc Brunet, Al Manar, 108 pages, mars 2024, 20 euros.
Le mot « désert » suggère donc des correspondances à l’infini, non seulement déserts physiques, du sable, de la mer, des montagnes et de la neige, non seulement ces aspects dépouillés de la nature, qui évoquent la stérilité, l’éloignement, l’existence hors du temps mais aussi ce lointain espace intérieur et paradoxalement fertile qu’aucun télescope ne peut atteindre où l’homme est seul dans un monde de mystère, de solitude essentielle et de création. Le désert des désolations terrestres est ainsi le maître qui conduit à soi, désert qui rend à l’intimité, à l’origine, désert d’action de grâce dont l’ermite connaît le secret :
Désert dans une mémoire poreuse et frêle !
lorsque s’ouvrent tes volets de sable
et devient lisible ta soif de clarté
nous allumerons nos yeux
chandelles sauvages
horizons fous de couleursIl se peut que ton silence
nous renvoie aux origines
de toute douleur
ou de princières résurrections. (p. 12)
Physique et métaphysique apparaissent, en effet, ici de même source, inséparables :
désert : espace d’un sanglot endeuillé,
d’une transe
d’un bonheur éloquent.
Comment nommer tes jardins de feu
sujets à tant de dévotions ? (p.13)
Le désert est cette présence infiniment nue dans un visible que presque rien ne sépare de l’invisible. La tentation du désert devient l’infini lui-même et dans cet espace infini ou indéfini s’entrevoit une quête de dimension mystique, le désert se révélant comme, un lieu imaginaire.
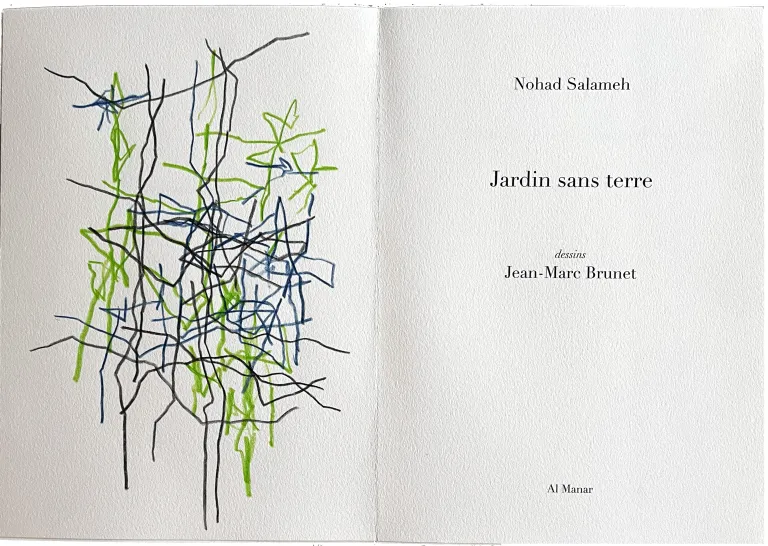
La poète chemine sur les pistes du désert intérieur, désert de l’être, et porte l’intuition d’une même vérité, vécue dans l’apprentissage que propose le désert, apprentissage qui peut revêtir la forme du vertige mais aussi parfois se muer en extase :
avec cette lenteur extatique de voyant (p. 11)
Dimitri T. Analis déclare ainsi :
Les seuls lieux qui m’exaltent sont les déserts […]. Grands silences et profonds bruits les habitent. Monotones et sans limites, leur apparence, parfois sublime, est transcendée par leur simplicité. 1
Mais cette extase n’est atteignable que par l’épreuve. Promesse d’une ouverture à jamais incontrôlable, le désert, correspondant au désert recherché, amène d’abord la désolation, la dénudation, l’absence d’abri, la corrosion, puis à une autre quête spirituelle :
Désert, seraient-ce l’érosion en l’humain,
la matière corrodant le sacré ? (p. 14)
« Desertum », lieu de l’abandon, de ce qui ne fait plus ni chaîne, ni tresse, car le latin « sero » veut dire « je tresse, j’enchaîne, j’enlace », « desero », je sépare, j’abandonne. Le supin « desertum » signifie : « abandonné, deserté, sans plus aucun lien », désert du « déchaînement »2. Le verbe « délier », « desero » signifie d’abord dégager de ce qui lie, dans une sorte de liberté qui dénoue, absout d’une dépendance mais cette liberté est aussi une épreuve. Le verbe délier étant très proche sur le plan homophonique du verbe « déliter », se désagréger, se décomposer, disparaître. Quelque chose comme l’apparence est brûlé, consumé ici de manière implacable et renvoie à la nudité absolue d’être, à la déchirure constitutive. Le désert se fait volonté de perte, départ, séparation, ruine, règne de l’aboli. Faisant de la ruine, retour sur soi, la poète ne peut que constater qu’elle est elle-même creusée d’absence, qu’à la recherche de soi, elle ne trouve ainsi que traces effacées, dépossession, nudité de désastre. Elle se révèle divisée. En elle est une faille, un effacement universel, un glissement dans le vide de l’être.
Désert est bien ce lieu de l’origine et de l’abandon, de la désolation, ce lieu de la perte. Cette perte de soi-même constitue pourtant l’épreuve fondamentale pour mieux se retrouver ensuite dans l’étape ultérieure car le désert s’avère finalement le lieu de la vraie vision, il rend « voyant » :
L’émerveillement –neige de printemps
durait le temps d’une lune dans la main du voyant.
Il permet de voir ce qui n’apparaît aux yeux de personne. La présence visuelle est liée à la problématique du désert comme le note Marie-José Mondzain : « dans les cris au désert se fait entendre une crise du regard, regard sur les dieux sans doute, mais finalement regard sur soi. »3

En effet « la tentation du désert est celle de l’œil passionnément captif de son propre regard »4, amenant avec lui la problématique du « miroir » comme le montre la quatrième séquence du livre : « Ce pays-miroir où tremble mon image » (p. 67).
Dans le monde ordinaire, on ne sait plus bien contempler tandis que le désert est l’espace le plus suggestif et le plus accessible au regard, paradoxalement même au regard de l’aveugle car ce qui importe ici c’est le regard intérieur, « regard incantatoire » :
le jardinier de ses rêves
qui conservera les feuilles vertes
de son désert intérieur. (p. 55)
Ainsi à mesure que l’on s’enfonce dans le désert, l’on est détourné du monde visible, du monde des apparences : « Tout ce qui est proche s’éloigne. […] le désert n’est-il pas le révélateur d’un espace intérieur, son immensité, l’image de la profondeur intérieure et de l’immensité intime ? Dans l’espace désertique, pareil à l’espace de la cécité ou à celui de nos rêves, le poète est à même de réaliser le passage du monde extérieur au monde intérieur, du visible à l’invisible »5, vers « la cité neuve de l’Enfance » (p. 24)
Ta présence en bordure de nos Orients
s’emploie à repousser le mal-être
et à lisser l’abrupt
afin que circule la sève du possible
lorsque la nuit s’engouffre dans la Nuit (p. 15)
Car le désert, lieu du silence, est aussi le lieu de la confrontation à l’absence. L’absence n’est pourtant pas une inexistence, l’invisible n’est présent à l’homme que dans son cachement. Ce mode de rapport à la présence découle de la grâce car il impose le face à face avec un être qui se dérobe. Il repose sur l’hypothèse d’un commencement qui ne serait pas manifesté, c’est-à-dire de quelque chose qui serait donnée et qu’on ne verrait pas. On ne trouve personne au lieu même où l’on attend quelqu’un. Endurer l’expérience du désert et de la solitude est une façon de renouer l’alliance mais aussi de rappeler la nature de l’alliance. Forger une alliance se dit en hébreu couper/casser une alliance. L’alliance est elle-même cassure et séparation. L’anneau de l’alliance est aussi l’anneau du symbole comme sumbolon, relation entre deux éléments dans lesquels nous avons une double relation, inverse : l’unité et la faille6. Le paradoxe mystique rejoint alors l’oxymore comme l’idéal du poétique. Ce qui vaut dans l’oxymore, c’est Sophocle qui nous l’a, l’un des premiers, appris, c’est cet angle absolu, impossible qui ouvre sur l’abîme. L’oxymore, au grand écart, déchire la poésie, et dans cette déchirure se donne l’éclat de la chose. L’oxymore est rencontre de deux lignes de virtualités, événement qui consiste à se séparer, à vivre l’exil, tout en étant lié en un point, dans une quête de l’Unité. La poésie échange perpétuellement la vie et la mort, elle est l’ambiguïté mère de toutes nos autres ambiguïtés. Elle tend un arc qui est ciel et souffrance entre ces deux pôles insaisissables. Le poème dit, par l’oxymore, le moment de la fracture et la recherche frénétique de l’union :
Car à même le Désert originel
[…] Il reste à travers nous ce peu de ciel
qui s’emplume de colombes
et se déploie :
présence et point de départ
plénitude et dépouillement. (p. 20–21)
La poète hôte de l’impouvoir, de la détresse et de l’errance ne perçoit du monde que des paquets d’intensité. Elle est la chercheuse d’or de ces brisures, elle est cette intonation. Réel à bout touchant, ce qui apparaît dans la pauvreté, le désert, la nudité. Et pour prendre, la poète se déprend, elle ne saisit au vif que dans le dessaisissement. Le poème est bifurcation tourbillonnante, sur fond de désert et de retrait.
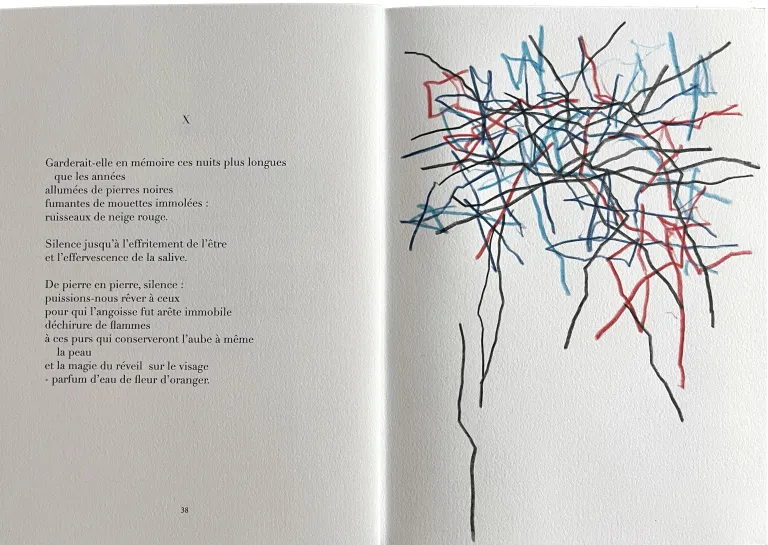
Reste une poésie de ce qui se montre et se cache en même temps. Le poème manifeste une présence-là énigmatique, écliptique comme un battement, présence qui déroute toujours de nouveau le sens, la situation, la substance. C’est être littéralement dans le retrait de l’être qui est la condition de son apparition. C’est ainsi que l’amour traverse l’expérience du désert, de la séparation, de la cassure, de la rupture. Aimer un être suppose l’expérience d’un abîme infranchissable, l’expérience du désert :
Désert, ô poussière d’or !
Soleil en fusion avant de rejoindre
l’envers du temps » (p. 22)
Ainsi le questionnement grave, métaphysique, ontologique sur le rien habite-t-il l’expérience du désert. Marquant ce passage extrême et vital, tout et rien, chez Nohad Salameh, sont mis sur le même plan, comme s’ils s’équivalaient ou pouvaient basculer de l’un à l’autre à tout moment, du Nada au Todo. Le Rien et le Tout semblent constituer les deux pôles du neutre, de ce qui est annulé, les allées ensablées, désertifiées du nul, du nu. Ces allées ensablées sont marquées d’empreintes et de vestiges archéologiques, lettres qui résistent au désert de l’histoire. Le désert se révèle comme métaphore de l’écriture dans les marges et sous les plis du texte, à travers le paradigme de la trace par quoi la poète cherche à construire un sens. Le désert est comme une feuille d’un livre entamée par le processus de l’effacement, document écrit en cours d’oblitération et le poème tente d’exploiter les possibilités qu’offre le désert pour dire les destinées de l’écriture entre inscription et effacement. Comme l’explique José Angel Valente le désert est un état d’écriture, un état d’attente, un état d’écoute et Jabès va encore plus loin qui écrit : « Le désert est bien plus qu’une pratique du silence et de l’écoute. Il est ouverture éternelle. L’ouverture de toute écriture. »7
L’effacement est ici consubstantiel à l’écriture. Le sable, en effet, n’est pas seulement le sédiment infini du désert : il est la matière du livre, de la mémoire du livre et touche à la dimension du temps et à ces « jeux avec le temps et l’infini » qu’évoque Borges8. Mettre en rapport le désert et la parole constitue une relation qui d’après Meschonnic a sa raison d’être : « Selon une certaine lecture de l’Hébreu, mettre en rapport le désert et la parole, ce qu’on a tant de raisons de faire, trouve sa preuve dans les mots qui les désignent »9. Comme le déclare Jabès : « Parler du livre du désert est aussi ridicule que de parler du livre du rien. Et pourtant, c’est sur ce rien que j’ai édifié mes livres. Du sable, du sable, du sable à l’infini »10. On entre dans le désert comme dans un livre.11 Il n’est pas de mot qui ne soit désert, pas de désert qui ne soit mot :
Et elle, la Dormeuse en position d’arc-en-ciel
rédige d’une main spacieuse
le livre de la durée circulaire.
Mais le désert reste aussi impénétrable, aussi indéchiffrable qu’un livre. Et tous les livres sont, comme le dit Borges, une bibliothèque du désert. Dans ce désert, aussi concret qu’imaginaire, Nohad Salameh a recours à la mémoire, de cette mémoire qui est celle des lichens et de la terre, qui est celle de la pierre solaire, mémoire rêveuse des huit dormants d’Éphèse comme cette « Dormeuse de plein jour » dans « Mémoires du demi-sommeil » qui constitue la deuxième séquence du livre :
Elle parlait seule sur les marches du sommeil
lorsque les réminiscences
tel un vertige foudroyant
la saisissait par la nuque (p. 35)
Multiplication du temps donnant de vivre une éternité, une extension de l’espace permettant d’habiter au large :
Garderait-elle en mémoire ces nuits plus longues
que les années
allumées de pierres noires
fumantes de mouettes immolées
ruisseaux de neige rouge. (p. 38)
Car le présent, le maintenant, l’ici, sont aussi mémoire. La mémoire est une naissance perpétuelle qui traverse les strates du temps dans une transmutation. La mémoire est au présent, la mort et la vie coïncident, celle d’une présence à un maintenant, car la mémoire est l’instant. Il faut imaginer, pour tenter de comprendre cette poésie, un éternel devenir de l’instant, l’instant d’infini ne durant pas, mais portant à durer :
Combien de chemins n’a‑t-elle parcourus
en ce désert de nulle part et de partout
à l’affût de l’imprenable (p. 53)
Et de l’instant d’infini, résulte le poids sans mesure de ce qui s’appelle vivre. Miroir du temps, la pierre est un être de mémoire, mais elle est aussi un être-là de l’écriture, faite de surgissement, de vigilance, de cette émergence d’une présence irréfutable dans le maintenant :
L’élue des terres lointaines
qui fait escale dans une forêt de vitraux (p. 68)
Ecrire chez Nohad Salameh, poursuit une solidité et en même temps semble voué au délitement de toute solidité : « Dans la robe de pierre qui confère vie à Isis » (p. 77). On ressent alors la fidélité à l’élan de vie. « Derrière un rideau de sommeil », une cinquième séquence, nous dévoile le monde des songes :
Songe plus loin que terre désertique
en marche dans les nervures nocturnes
ton rayonnement appartient à tout commencement. (p.90)
Ici finit un temps, ici commence une nouvelle ère. Cette cité où se redécouvre l’enfance. La poète est attachée au grand jeu des choses, dans la disponibilité, dans l’accueil au monde, un monde qui s’inverse et qui a réussi à retourner à l’envers, dans un mouvement d’involution comme les dunes d’un désert de sable, pour nous transporter vers une seconde enfance, une nouvelle naissance.
Pour reconnaître cette aspiration à la vie, il faut au poète se dilater dans le sens même de la vie, s’ouvrir indéfiniment, correspondre à ce constitutif élan, dans une coïncidence avec l’effort créateur que manifeste la vie. Nohad Salameh ressent ce lien du tout ensemble :
De transe en transe
sa chair soustraite à la matière
à toute pesanteur
confère vie et agilité à la nuit immobile
au cœur d’une île en partance (p. 98)
C’est pourquoi le désert, monde du songe, constitue, selon José Angel Valente12 un espace paradoxalement fertile, lieu originel de la parole, du rêve et d’un voyage en poésie.
Car c’est à un voyage initiatique vers l’enfance, l’adolescence et la création originelle de l’œuvre, que nous convie également Nohad Salameh dans Une adolescence levantine, texte autobiographique, nourri aux rives des deux cités millénaires de son enfance et de son adolescence : « Saïda/ Sidon et Baalbek/ Héliopolis » (Éditions du Cygne, coll. Mémoires du sud, Paris, 2024). De la première, sa mémoire d’adulte ne retient qu’un flash à la fois visuel et auditif : « la maison de Saïda/ Sidon qui jouxtait la mer et le port », d’où la famille déménage lorsque le père doit abandonner sa ville natale de Baalbek, cité où la jeune Myriam retourne régulièrement pour ses vacances chez sa grand-mère paternelle. L’influence de ces deux villes sur l’imaginaire et la naissance de l’écriture sera déterminante. Le passé immémorial des deux cités abritant, dans l’enfance de la jeune fille, les diverses cultures et religions du Moyen-Orient se côtoyant et s’interpénétrant sans aucun heurt ni confrontation, ouvre à Myriam les portes du rêve en la plongeant dans une réalité où le passé toujours puissant la ramène aux sources de toute civilisation. Sidon, la ville-royaume de l’antique Phénicie, la replonge dans la tradition homérique et biblique. Baalbek, cité aux monuments démesurés, abritant les sanctuaires les plus majestueux du monde antique, lui fait prendre conscience de la durée intemporelle des merveilles architecturales des mondes gréco-romains et stimule son imaginaire, l’aidant à pénétrer dans un espace mythique : « L’esprit de Myriam enclin à brouiller la distinction entre histoire et mythe » (p. 107). Parallèlement, les rêveries poétiques de la jeune adolescente, déambulant dans les labyrinthes des souks de Saïda/ Sidon, nourrissent les dédales de son inconscient en quête d’onirisme. Ces deux lieux identitaires, Saïda et Baalbek, symboliseront, dans toute sa création future, le cœur spatial de sa réflexion, le noyau tendre de ses errances nostalgiques, le point focal de deux cités historiques condensant les sortilèges du rêve et du demi-sommeil : « Baalbek, la ville du rêve infini » (p. 134). La découverte de la sexualité joue également un rôle important dans le développement personnel de l’adolescente. Sexualité liée, dans ses premières manifestations, à un sentiment de faute et de perversité, associée à l’idée de péché : « Sous le signe d’une telle insistante perversité s’inscrivit l’étape majeure de son adolescence ». Cette étape se révèle essentielle pour l’écriture qui prend alors son envol en tant que substitut de l’élan érotique. Peu à peu, l’adolescente saisit la dimension de la création littéraire. A ses yeux, celle qui joue avec les mots s’identifie à une sorte d’alchimiste, transformant le silence en langage. La maladie grave d’une mère chérie, le deuil d’un oncle aimé l’amène ensuite à réfléchir sur son statut précaire de mortelle et sur l’immortalité potentielle de l’écriture. Les rapports privilégiés de son pays, le Liban, avec la France et ses études dans des établissements français orientent enfin son choix vers la langue française, langue qui restera langue de prédilection pour son écriture. Nohad Salameh, prématurément, du fait de son éducation religieuse chrétienne, consciente de la faute, s’inscrit ainsi dans la lignée des grands poètes jouviens : « Soutenue par ses hautes lectures, elle avait prématurément la conscience de la chute ». A la débauche palpable, elle privilégie les orgies de l’imaginaire, autrement extatiques que la drogue et la fleur de pavot. L’adolescente, sans porter de jugement, cherche ainsi à se réaliser grâce à des moyens plus sublimes que les paradis érotiques ou artificiels et cela par la spiritualité et l’écriture. La rêverie sur le passé devient pour l’autrice moyen d’accéder à l’extase par une forme de voyage mentaux et de migrations. Semblable par bien des points au personnage de Paulina 1880, Myriam assiste aux offices religieux du dimanche « ces dimanches extatiques où elle se hâtait d’aller croquer l’hostie d’un Christ vêtu de sa somptueuse douleur : que d’un trait de regard, il donne l’absolution à ses péchés ! » De toute évidence, le sacré se vit comme une forme d’extase, se révélant par une aspiration sublime et une volonté d’accomplissement allant jusqu’au sacrifice (p. 114). Se rejoignent, en effet, rites païens et rites chrétiens, communions, sacrifices ou hiérarchies sacerdotales (p. 121).
L’écriture par sa force de transmutation alchimique, devient, alors, ce vrai et seul moyen d’atteindre l’extase : « Sa prise de contact avec les mots s’opérait avec la totalité de ses sens, interpelant un univers extatique » (p. 70) et l’extase de l’écriture nous ramène à l’enfance et à l’adolescence levantine où les rêves et la création prennent racine et naissance.
Notes
1. Dimitri T. Analis, « L’empire du vide », Dédale n° 7 et 8, printemps1998, éd. Maisonneuve et la rose, p.158.
2. Marie-José Mondzain, « Les voix qui crient dans le désert », Dédale, p. 357.
[3] Ibid, p. 357.
[4]Ibid, p. 362.
[5]Oumama Aouad Labrech, “Le vertige horizontal/ Borges”, Dédale, p. 439.
[6] Shmuel Trigano, « Le désert de l’amour » Dédale, p.331.
[7]Jabès cité par José Angel Valente, « Trois fragments », Dédale, p. 169.
[8]J‑L Borges, Obras Completas, T2, Barcelone, Emécé, 1989, p. 186.
[9]Henri Meschonnic, « Génie du lieu et génie de la langue », « midbar : désert et davar : parole en hébreu », Dédale, p. 313.
[10] Edmond Jabès, Le livre des ressemblances, L’imaginaire, Gallimard, 1976, p. 148.
[11]Anne Wade Minkowski, « Désert dans les langues », Dédale, p 443.
[12]Cité par Olivier Houbert, op cit.
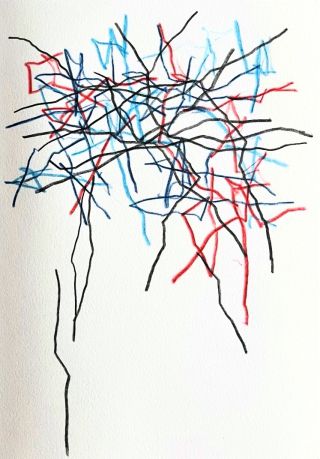
Présentation de l’auteur
- L’œuvre poétique de Marc Alyn : un itinéraire alchimique - 6 janvier 2026
- Éric Brogniet, Le nuage et la rivière - 21 octobre 2025
- Élégies en noir et blanc, l’œuvre de Philippe Lekeuche - 6 septembre 2025
- Catherine Pont-Humbert, Quand les mots ne tiennent qu’à un fil, Une épopée poétique - 29 juin 2025
- L’œuvre poétique de Marc Alyn : un itinéraire alchimique - 6 mars 2025
- Déserts et jardins originels dans l’œuvre de Nohad Salameh, un voyage vers l’enfance d’une création - 6 septembre 2024