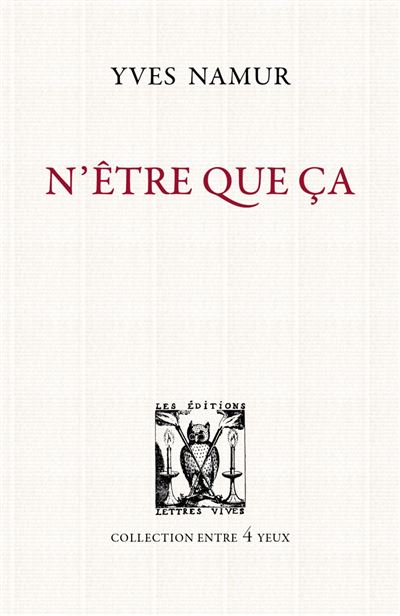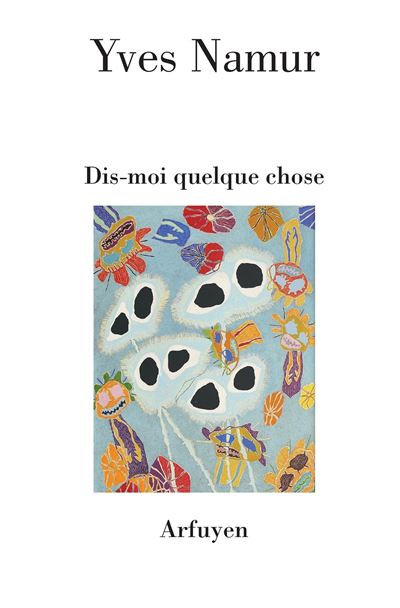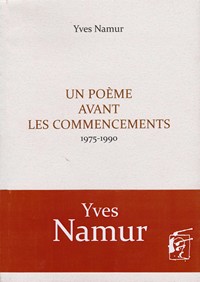Les recueils, tous deux édités en 2013, permettent de parcourir plusieurs décennies d’écriture poétique. Un poème avant les commencements regroupe des textes écrits de 1975 à 1990 ; Ce que j’ai peut-être fait est un choix de poèmes publiés entre 1992 et 2012.
En 1975, Yves Namur avait vingt-trois ans ; il écrivait des textes brefs centrés sur la nature : les feuillages, les grains de blé, un insecte… Ici et là un être humain faisait une rapide apparition. Mais était-ce vraiment un être humain ? Les femmes s’égrenaient et les bras nus étaient recouverts d’écorce. Les intérieurs étaient ceux de la campagne : un buffet, une cruche à eau, une pendule, un grenier. À l’extérieur, les odeurs de la terre et du sel dominaient. Le poète s’éloignait parfois du monde sensible : il scrutait l’ombre, trouvait des brèches, s’intéressait à l’invisible, à la mort et aux songes.
Dix ans plus tard, la poésie d’Yves Namur connaît une première métamorphose. Le poète interroge les mots et le poème, qui ont tout l’air d’être vivants : le mot creuse, le poème le regarde.
En 1990, c’est la forme des textes qui change. Dès le titre de l’ensemble Le voyage en amont de ( ) vide, il y a cet espace, ce silence, cette absence que l’on retrouve ensuite à chaque vers ou presque, et qui donne le sentiment d’un monde devenu en partie indéchiffrable. Puis un autre ensemble, la même année, Fragments traversés en quelques nuits d’arbres et confuses, semble réconcilier le tout. Il y est question d’arbres, de mots et de poèmes.
ces traces qu’on laisse venir,
poèmes peut-être
dans les arbres
[…]
à peine ai-je dit l’arbre
qu’il marche dans la chambre
Un dernier tournant est pris – plus radical, selon l’auteur – en 1992. Yves Namur explique, dans une note placée à la fin du premier ouvrage : « Si effectivement je crois – bien modestement il faut le dire – avoir bâti aujourd’hui un quelque chose qui s’apparente probablement à une « poésie pensante » pour laquelle je suis redevable depuis une vingtaine d’années aux fréquentations des Jabès, Juarroz, Rilke ou Celan, force m’est de constater que jusqu’approximativement 1990, mes intentions étaient toutes autres. »
En ouvrant Ce que j’ai peut-être fait, nous entrons dans l’univers qui est toujours celui du poète aujourd’hui. Un univers où penser, c’est avant tout poser des questions. Il y a quelque chose de l’étonnement de l’enfant, bien sûr, du philosophe grec également. Le poète, comme le philosophe, cherche. Que cherche-t-il ? Serait-ce ce qui est caché derrière les apparences ? On penserait alors à Platon. Serait-ce au contraire l’absence d’être ? On penserait plutôt à Pyrrhon. Souvent, le doute et le sentiment d’être condamné à l’ignorance dominent. Ce qui console le poète, lorsqu’il revient bredouille de sa quête de sens, c’est la beauté.
Ce n’est pas ce qu’il trouve ou ne trouve pas qui importe, c’est la recherche elle-même, le chemin emprunté. Il n’atteint pas son but et continue ; il entrevoit un abîme, une absence, sa propre solitude et continue. Au passage, il s’émerveille devant de petites choses inattendues : la clarté d’une feuille d’or, un brin d’herbe sur le rebord d’une fenêtre… Yves Namur est peu à peu devenu le poète du peu et des riens dont il parle dans Ce que j’ai peut-être fait.