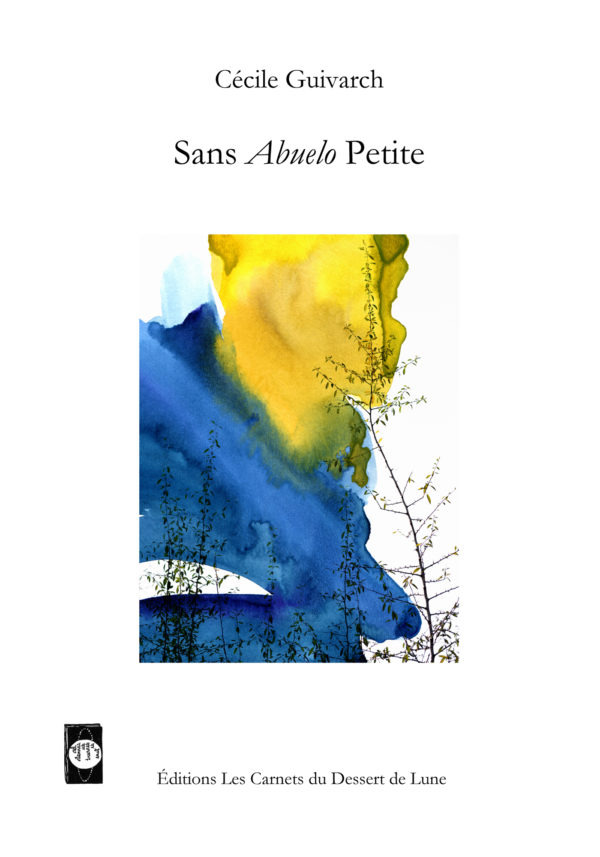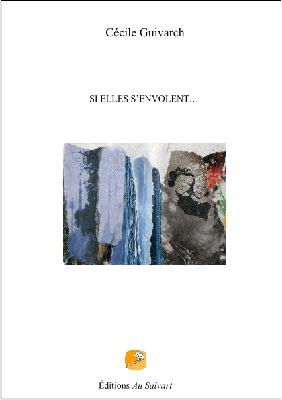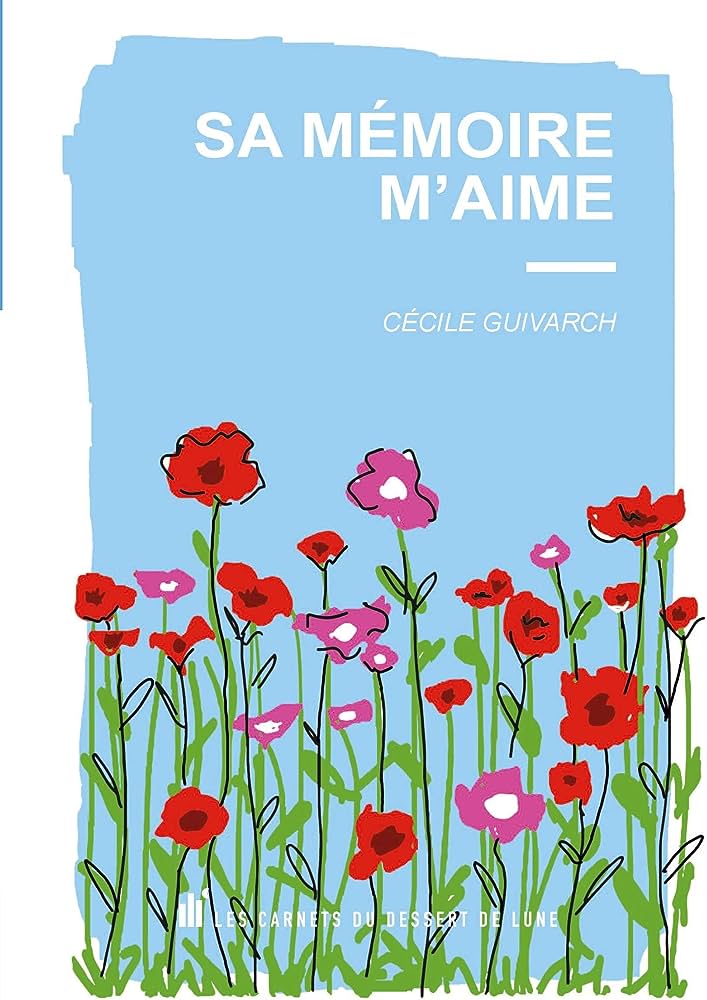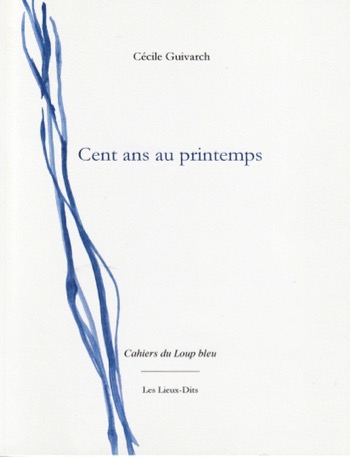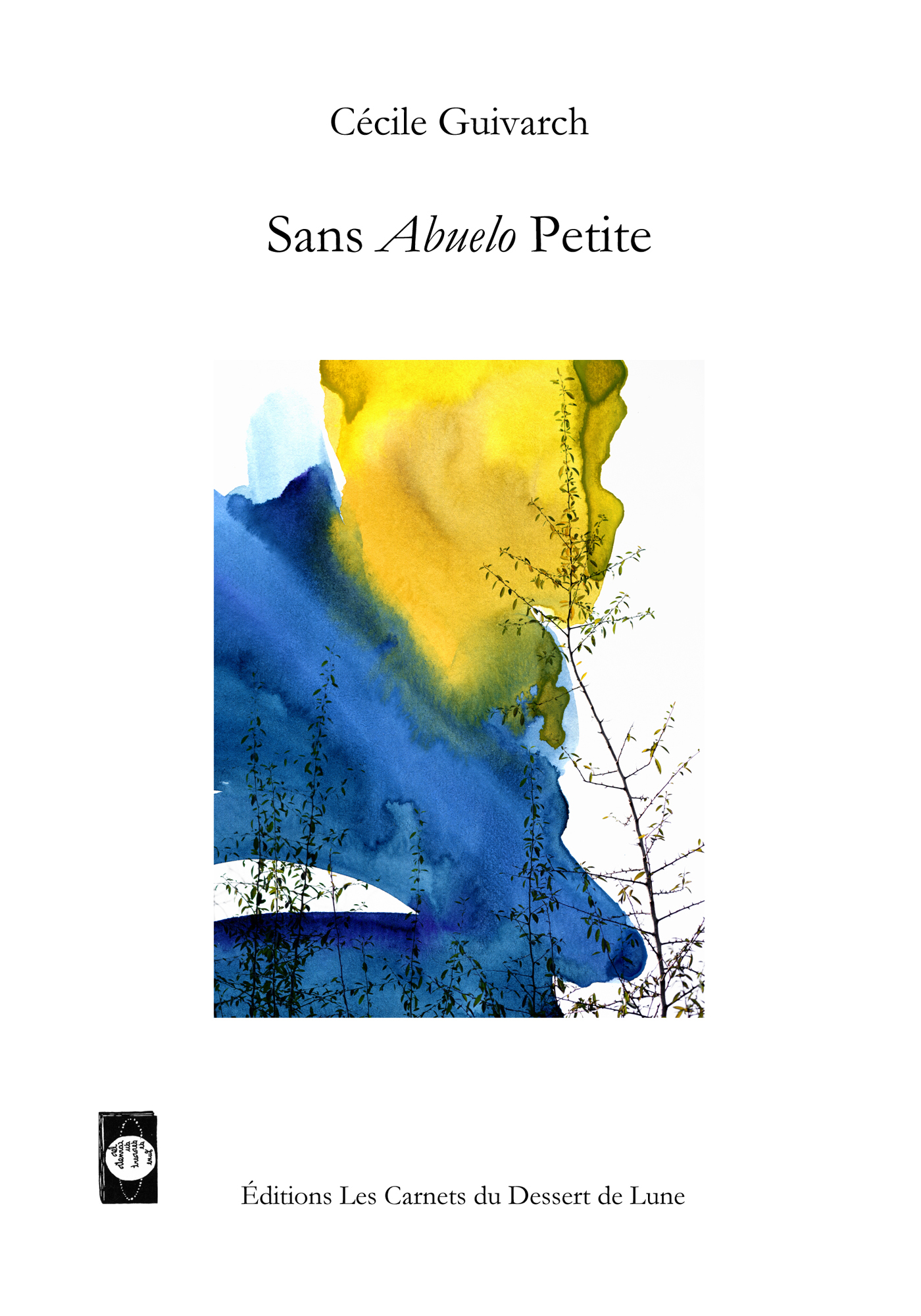Olivia Elias et Simone Molina ont lu Sans Abuelo Petite, le dernier recueil de Cécile Guivarch paru aux Editions du Carnets du dessert de la Lune. Lectures croisées…
Par Olivia Elias
ABSENCE, DOULEUR, POESIE
Quatre personnages. Lui, naufragé sur l’île loin des siens, sa femme aux yeux verts, sa fille et sa petite-fille. En arrière-plan, décor mouvant mais dont la nature demeure la même : guerres, révolutions, terreur, bouleversement qui mettent en mouvement hommes et femmes en quête d’un avenir meilleur.
Lui, elle ne l’a pas connu. L’homme qu’elle appelle abuelo n’est pas son grand-père. Le vrai, L’étranger, l’X dans l’arbre a fui la misère, peut-être la prison. Il s’est retrouvé piégé dans une autre prison, Cuba. L’océan, porte blindée, s’est refermé sur lui. A sa place, les missives ont voyagé.
Il pleuvait des lettres et l’océan les amenait. Il dit à la mère qu’il l’aime, demande des nouvelles de la nina, La nina qui ne parle pas de (lui).
Sa petite-fille l’apprend le matin de ses 9 ans au petit-déjeuner, dans ce pays devenu sien où l’on parle français. L’espagnol et le galicien sont réservés aux vacances au village.
La petite-fille se met à rêver. Je vois une île depuis la plage. Elle n’est pas si loin je peux l’atteindre à la nage…/ Comment fait-on quand on part si ce n’est pour jamais se retourner.
De ce jour, elle lui parle
Tu es un oiseau sur une île
Les vagues s’écrasent sur les rochers
Au loin tout s’est éloigné
Ton île est-elle un ciel bleu
ou juste un peu de pierre
un peu plus de murs ?Sans nulle part d’où venir
Elle parle pour lui
La musique vient des profondeurs.
Roulement de mer, bruit des chevaux, envol des oiseaux.
… Ne sais plus le temps, s’il s’écoule ou s’il s’est arrêté.
Les rêves reviennent en boucle.Son visage, ses yeux verts.
Sa voix en écho, vos amours dans un tas de paille.
Tarrêtes de respirer pendant très long moment
sans mesurer si tu es mort ou si tu respires encore…Lentement tu reviens.
Les ailes coupées, tu les laisses repousser.
Elle, qui n’a pas vécu l’exil, grandit plante déracinée.
Elle, qui n’a connu aucune guerre, pleure à la place du grand-père, des mères et des femmes laissées sans personne, en Galicie et ailleurs…
Mêlant souvenirs d’enfance et rêveries, en textes courts, denses, Cécile Guivarch raconte ce qui est advenu depuis qu’il est parti. Le village, longtemps resté immuable — Hommes et femmes au rythme de la salsa/Mains et ventre vides — aujourd’hui méconnaissable. Le passage du temps sur le visage de la grand-mère. Les errances de la mère à la recherche d’un ici qui serait aussi là-bas, les siens d’une langue à l’autre.
Sans Abuelo Petite où comment le matin de ses neuf ans à la table du petit déjeuner, une petite-fille est devenue poète. Comment, des années plus tard, elle tient la promesse qu’elle lui a faite, qu’elle s’est faite. Recoller la branche manquante à l’arbre… Réparer.
Par Simone Molina
L’écriture de Cécile Guivarch provoque des émotions rares. Non pas de celles qui vous submergent, mais de celles qui entrouvrent délicatement le voile posé sur le mystère et vous permettent d’accéder aux lisières de l’énigme cherchant à se faire entendre depuis la nuit du monde.
Avec son dernier ouvrage « Sans Abuelo Petite » on entre dans cette écriture simple, actuelle, directe, qui nous touchait déjà à la lecture de ses précédents recueils. Et comme l’écrit Luce Guilbaud dans sa préface, Cécile Guivarch « fait revivre les absents » avec « cette tendresse » qu’on lui connait lorsqu’on l’a déjà lue.
Pourtant ce livre-ci possède une qualité qui lui est singulière et qui contribue à inviter le lecteur à lire, et encore relire, cette poésie déployée sur le miroir des pages.
Cette qualité est la conjonction si réussie du fond et de la forme. Comment faire toucher du doigt au lecteur le secret éparpillé dans diverses mémoires mutiques, sinon en appelant ces voix à prendre parole ? Et comment leur donner la parole dans l’éparpillement de l’Histoire ?
C’est par une construction tout à fait précise, une spatialisation de l’écriture dès que s’ouvre le livre, que le lecteur est convoqué à des niveaux différents, et à différents âges.
D’abord à l’orée du recueil, deux exergues. « C’est pas ma terre », écrit Perrine Le Querrec dans Patagonie, et Cocteau annonce clairement que « le poète ne chante juste que dans son arbre généalogique ». Ainsi nous est annoncé le caractère incontournable de l’écriture du poème, l’exigence qui tient le poète au coeur.
Puis nous entrons dans le recueil par quelques pages qu’on pourrait dire polyglottes.
En haut, les poèmes en italique, intemporels. Ils sont la figure de celui qui vient hanter ceux qui sont demeurés là, au pays.
En bas, l’adresse à l’homme qui est parti est directe, actuelle, franche, inquiète.
Dans le début du recueil, tout se passe comme si, sur la page même, se font entendre les voix multiples que chacun porte en soi, avec leurs ambivalences, les doutes, les rêves aussi, dont on sait combien ils tiennent plus du rébus que du récit linéaire.
En haut de la page, la voix est tout autant celle du poète que celle de la femme abandonnée, ou celle de la mère qui craint pour le fils qui s’en va. C’est une voix aux multiples langues. En bas de la page, les contours d’un homme qui souffre dans sa nudité d’homme, apparaissent.
Puis la construction bascule, avec l’apparition de la troisième voix : celle de l’enfant, et d’un regard de et sur l’enfance. Alors, disparaissent les poèmes intemporels des pages de droite et apparait l’âge de l’enfance, avec cette ritournelle « Tartines-pain-beurre-confiture. Fraise et moi petite » qui vient scander une enfance curieuse de ce qui se transmet, de ce qui chante dans la langue, dans les langues, des liens familiaux, des connivences, mais aussi des déplacements. C’est l’histoire racontée par la mère et la grand-mère aussi, et qui nourrit l’enfant, c’est le récit de l’enfance et son souvenir charmant.
Pourtant sur les pages de gauches se poursuit le dialogue déjà entrepris. Du bas, à la lisière et dans l’humus de la page, monte du profond de la mémoire un appel au grand-père disparu, une adresse à celui qui s’est effacé et dont ne demeurent que des lambeaux d’une vie supposée, d’une vie insulaire et sans retour. C’est le poème de l’ailleurs, de l’inconnu, du franchissement de frontières, des paysages exotiques, des hypothèses et des incertitudes.
Et puis, lovés à la pliure interne du livre, sur ces mêmes pages de gauche, mais dans la partie aérienne de la page, se poursuit la fluidité des poèmes bilingues, courts, elliptiques, épurés. Ils creusent en nous, lecteurs, la puissance du secret.
La spacialisation des poèmes, les voix multiples qui se chevauchent, nous emmènent vers une expérience partagée par ceux qui savent écouter les enfants : face à ce qui ne se dit pas, tout enfant sait sans savoir qu’il sait, et cherche à comprendre en interrogeant à sa manière les adultes, mais tout autant les objets du quotidien, et également les arbres, les oiseaux, les fleurs….
Lorsqu’est révélé le secret, « le cœur me monte dans la gorge », écrit Cécile Guivarch. C’est qu’en découvrant l’existence de celui qui est parti, l’enfant perd celui dont elle croyait être de la lignée. « J’ai essayé de comprendre. J’ai lu » écrit-elle.
Alors les souvenirs d’enfance s’interrompent et laissent place à nouveau aux poèmes en italiques qui sortent de l’ombre, de la pliure du livre ; ils vont se poursuivre en lieu et place du récit de l’enfant. Ils viennent à cette place précise, celle de l’innocence.
Pourtant, derrière chaque secret, même dévoilé, subsiste une question. « L’enfant, tu as pensé qu’il n’était pas de toi ». Une question qui dit la blessure au-delà du départ. Cette blessure ensevelit sous le poids du silence. Alors, plus loin, l’exigence d’enterrer les morts afin de « taire le silence ».
« Comment se fait-il qu’on s’habitue à tant de séparations ? » nous dit Yanis Ritsos dans le magnifique poème qu’a choisi Cécile Guivarch pour clore le recueil, comme si se séparer du poème consistait aussi à le confier à ceux dont on sait, ou dont on espère, qu’ils sauront l’entendre.
Ainsi le lecteur a cheminé dans cette partition qui dit les séparations, et qui, au fil de la lecture, inscrit une trame au cœur : la lecture devient navette qui imprime en nous une image des temps de la vie : le passé, le présent, le futur et la poésie qui leur est consubstantielle.
Mais pourquoi ressent-on cela ?
Il ne s’agit pas d’une pensée, ni d’une réflexion, ni même d’une déduction. Il s’agit d’une sensation, d’une évidence dont la vigueur tient à la construction du livre qui n’impose rien, et entraîne à un après-coup de la lecture.
Que nous dit cette construction ? Que le poème, et la poésie, sont là avant le récit et qu’ils lui survivront.
Le poème dans sa forme épurée précède la survenue d’une vérité inouïe, révèle les indices d’une présence sous l’absence. Puis il permet de passer d’une extériorité rendue aride par le silence à une intériorité partageable, universelle.
C’est dire que la poésie ne situe pas sa puissance uniquement dans les mots mais qu’elle réclame une attention portée à l’espace et au temps, à l’espace-temps du multiple de nos vies.
Dans « Sans Abuelo Petite », l’espace de la page renvoie le lecteur aux exils, intérieurs et géographiques, au temps et au hors-temps tricotés par une transmission qui s’ignore et qui se révèle au fur et à mesure qu’il échappe au poète.
Un livre réussi est un au-delà d’une parole singulière car il prend le lecteur par le cœur et par le geste vivant de la main qui court sur les pages. Le poème s’écrit ensuite avec le lecteur, touché en ce lieu qui inscrit le poème en chacun de nous, à sa source même.