Elles sont quinze femmes, nées dans cette petite Géorgie si mal connue, pourtant terre de très ancienne civilisation. Elles sont journalistes, écrivains, enseignantes, traductrices, peintres, dramaturges, et représentent plusieurs générations (la doyenne est née en 1939, la plus jeune en 1986). Certaines sont également connues pour leurs textes en prose, leurs articles, leurs essais.
Leurs poèmes célèbrent leur vie, leur pays, sa mer et ses montagnes, les mythes universels qui lui sont parfois indissociablement liés : n’est-ce pas en Géorgie que l’on situe la Toison d’or ? Ils évoquent la guerre, les blessures, les larmes, la mort, mais aussi la consolation, les « fous » et les « normaux », la voix et le silence, l’amour ou son absence. Elles chantent aussi Cézanne, « diplômé de l’Académie des arts raffinés », dit l’une d’elles.
Et si la Géorgie semble bien loin de tout, elle n’est en rien coupée – au contraire – de la culture européenne et antique, ce qui transparaît constamment dans les poèmes du recueil.
Il va de soi que nos poètes parlent des mots, surtout des mots, de l’écho des mots, de tous les mots « trouvés et perdus ».
Les auteures composant Je suis nombreuses : Diana Anphimiadi, Ela Gochiashvili, Nato Ingorokva, Kato Javakhishvili, Rusudan Kaishauri, Eka Kevanishvili, Lia Liqokeli, Nino Sadghobelashvili, Lela Samniashvili, Maya Sarishvili, Irma Shiolashvili, Lia Sturua, Tea Topuria, Mariam Tsiklauri, Lela Tsutskiridzé.1
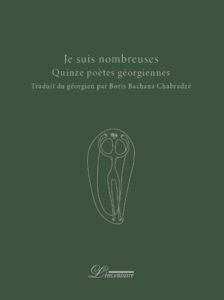
Je suis nombreuses, Quinze poètes géorgiennes, traduit du géorgien par Boris Bachana Chabradzé, Les Editions l’Inventaire, 2021, 120 pages, 18 €.
∗∗∗
Extraits de Je suis nombreuses
Textes réunis et traduits du géorgien par Boris Bachana Chabradzé
Rusudan Kaishauri
La femme-table
Jadis, la table à écrire
Était une femme,
Elle s’affairait aux fourneaux, couteaux a la main.
Quand elle accrochait les vents
Sur les cordes à linge,
Elle essorait les rêves familiaux.
Elle avait ses enfants dans chaque tiroir,
Elle remontait son cœur à l’aide d’une clé.
Elle passait des nuits blanches à écrire des poèmes,
Car elle devait fatiguer ses sens.
Un jour, cette femme s’est courbée
Et est restée ainsi, elle n’a pas pris son envol.
Une chaise effrontée s’est glissée devant elle,
Sans même s’enquérir
S’il s’agissait d’une femme ou d’une table.
∗∗∗
Lia Liqokeli
Je veux que ma mère se marie
Je veux que ma mère se marie,
Qu’elle prenne ses chaussons, sa robe à pois et qu’elle parte.
En son absence, le silence du lever du jour nous tirera vite de nos lits.
Nous nous alignerons, mon père, mon frère et moi,
Tels les rêves déterrés de l’oreiller de ma mère,
Et compterons les objets un à un.
Le miroir racontera comment elle a mis du rouge à ses lèvres amincies, pincées,
A chassé, d’un revers de main, les rides agrippées à ses yeux comme des guêpiers,
A ri, puis est partie.
Nous irons d’une chambre à l’autre et nous nous heurterons à chaque seuil.
Nous ouvrirons tous les placards, fouillerons toutes les étagères.
Et dirons : elle s’est mariée.
Dans la cour sans ombre, trois amas d’écales de tournesol pousseront avant le soir.
Une armée de tasses à café sales nous encerclera.
Mon père perdra ses cheveux et sa barbe blanchira.
Mon frère et moi aurons les cheveux et les ongles
Qui pousseront à une vitesse étonnante.
Grandiront les cactus de silence,
Aux épines de reniflements et de déglutitions.
La maison fera froufrouter les arbustes de toiles d’araignée,
Poussés comme les cheveux de ma mère, bons à être teints,
Les branches de viorne restées aux coins des fenêtres
Tels les anneaux en or vieillis, aux oreilles de ma mère,
Et nous creusera des trous, par paires, dans les murs
Pour y reposer nos yeux humides.
Je me lèverai, traînant avec moi la douleur des plantes des pieds de ma mère,
Ses articulations brisées, son visage flétri.
J’effacerai du miroir son dos marié,
Je casserai son peigne en trois.
Puis nous nous attablerons dans la cuisine.
Mon père se lavera les mains pleines de ma mère,
Au tamis de ses yeux passeront les trente années avec elle et il essaiera
De nous distribuer, telle une salade de chou sans sel oubliée au frigo,
L’histoire inventée de leur amour.
Nous nous mettrons d’accord pour aérer, chacun à notre tour,
Son odeur accrochée dans l’armoire entre paletots et vestes,
Ses pleurs, rabougris comme des kakis séchés,
Restés entre les tchourtchkhelas roulés dans une toile.
Nous nous mettrons d’accord pour ne pas décrocher de la corde à linge,
Avant l’automne,
Les draps étendus par elle,
Tant que le soleil n’y aura pas définitivement brûlé les traces de ses mains.
Nous nous mettrons d’accord pour dire
Qu’il aurait été bien qu’elle nous laisse la moitié d’elle-même,
Que nous aurions attachée à une de ces poignées de porte rouillées
Pour la taillader avec les couteaux de cuisine mal aiguisés
Et tout lui faire dire de nous,
Ce que nous cachent les miroirs, en complot avec elle,
Et les mots enterrés sous sa langue.
Enfin, nous nous distribuerons des marteaux,
Nous nous tournerons le dos
Et nous enfoncerons des clous
Entre les yeux
Pour y accrocher le mariage de ma mère.
Puis, nous composerons une carte de vœux :
Mon père taillera un crayon,
Mon frère dessinera des fleurs sur la feuille,
Moi, j’écrirai :
Toutes nos félicitations.
Nous sommes ravis que tu te sois mariée.
Tous nos vœux de bonheur, maman.
∗∗∗
Rien à voir, Lia Liqokeli, sur la chaîne “Appelle-Moi Poésie” qui propose un rendez-vous
lecture chaque dimanche.
∗∗∗
Nino Sadghobelashvili
* * *
Maman a vieilli,
Elle commence à aimer les sucreries
Et ne nous laisse rien.
Elle se faufile dans la cuisine,
Pique des friandises
Cachées pour nous il y a longtemps,
S’isole près de la fenêtre ou derrière les rideaux
(Pour rendre encore plus intense
L’excitation d’être cachée),
Enfonce ses doigts blancs, faibles et maigres
Dans le sachet de papillotes multicolores,
Picore jusqu’au bout…
Parfois j’ouvre la porte au moment
Où elle essuie prudemment
Son sourire mêlé de plaisir et de souffrance
Sur les traces de chocolat.
En me voyant, elle cache,
Tel un enfant, le sourire de sa main
Et laisse couler deux larmes
De la taille de mon enfance telle que je l’ai toujours imaginée.
Les larmes roulent vers moi,
Traversent toute la pièce,
Et se collent enfin l’une à l’autre.
J’ouvre la porte de la larme couleur sucre,
J’entre et me tiens a l’écart
Pour ne pas déranger maman
Qui se cache avec la vie
Concoctée pour nous,
Et lèche discrètement
Le miel resté sur les bords.
∗∗∗
Irma Shiolashvili
Octobre
Voici mon octobre,
Mon octobre qui s’imprègne de vert,
Mon octobre qui n’arrive pas à jaunir,
Mon octobre d’enfance éternelle,
Mon octobre plein de printemps,
Mon octobre plein d’émotions,
Octobre aux feuilles vertes amassées dans un panier,
Octobre du début de la vie,
Octobre pareil au cœur d’une fille de seize ans,
Octobre non-apparié à la réalité,
Octobre plein de gazouillements d’oiseaux
En place de fruits murs,
Octobre plein du parfum des fleurs,
En place de fruits murs,
Octobre renversé,
Octobre plein de rêves de poète,
Octobre plein d’avrils de poète,
Octobre désaxé –
Je te l’ai mis sur un grand plateau pour ton dîner.
Maintenant c’est a toi
De décorer aux feuilles vertes de mon âme
Cette soirée légèrement ensoleillée, légèrement triste,
De faire se croiser nos réalités,
D’apparier ton octobre au mien,
D’embellir tes idées pratiques, ta récolte automnale
Par mon univers renversé,
De mettre sur la table face à toi
Mon corps tapissé de fleurs
Et de m’aimer
Quand les hirondelles d’avril s’envoleront de mes yeux.
Dispose les fruits d’automne sur la table et invite-moi.
Je viendrai m’asseoir et te dire ce que je ressens
Quand la récolte de feuilles vertes m’appelle à haute voix.
Octobre, d’Irma Shiolashvili
∗∗∗
Ela Gochiashvili
À l’arrêt
Elle a dit qu’elle regrettait,
Qu’elle regrettait d’avoir beaucoup réfléchi,
D’avoir compris trop tard :
La seule chose dont la vie n’a pas besoin,
C’est d’être analysée.
C’est tout ce qu’elle a dit.
Elle n’a pas dit le reste,
Mais je l’ai entendu.
A l’arrêt,
Pour les passagers qui attendaient à proximité,
Rien ne se passait.
J’étais la seule à entendre,
À voir
La femme qui se tenait là, tranquille,
Tonner et faire rage,
Piétiner
Et becqueter
Et maudire
Son propre sort en lui crachant dessus.
J’entendais crie
La femme qui se tenait là, silencieuse,
Je l’entendais crier qu’il était trop tard maintenant…
Que la vie avait déjà été débarrassée,
Telle une table,
Pendant qu’elle réfléchissait,
Et que son assiette intacte
Avait été emportée…
Je l’entendais crier
Qu’elle n’était plus une femme,
Car le soleil, son bijou d’autrefois,
S’était transformé en four,
Qu’elle n’était plus une femme,
Mais une fleur d’ipomée,
Car elle orientait toujours ses os vers le soleil,
Telle une fleur d’ipomée…
Je l’entendais crier
Que dans sa maison,
Malgré son âge avancé,
Il n’avait jamais fait nuit,
Car il ne fait jamais nuit
Dans la chambre à coucher d’une femme seule,
Il ne fait jamais nuit – il fait seulement obscur…
Je l’entendais crier
Que sur la neige bouillante
De ses draps,
Aucune cerise n’avait jamais été écrasée…
Que le lit n’avait pas rétréci non plus…
Qu’elle n’avait jamais pu être faible…
Qu’a cote du miroir, dans l’entrée,
En bas de la penderie,
Avec les chaussons brodes,
N’avaient jamais vécu
Des pantoufles volumineuses et lourdes…
Que dans les recoins de son sommeil
La souris de la peur
Se faufilait constamment
Et rongeait son repos…
Je l’entendais crier
Son dégoût d’avoir trop réfléchi !
D’avoir compte ses pas !
D’avoir tourné sept fois sa langue
Et de n’avoir jamais parlé !
Je l’entendais crier et je l’écoutais.
Que pouvais-je dire ? – Elle se tenait la, silencieuse.
La seule chose dont la vie n’a pas besoin,
C’est d’être analysée –
C’est tout ce qu’elle a dit.
∗∗∗
Lia Sturua
Cézanne
Qui peindra le frémissement des pêches ?
Monsieur Cézanne,
Diplômé de l’académie des arts raffines,
Dormant dans la rue
Ses souliers sous la tête,
Qui a faim, alors qu’aux enchères Sotheby’s
On déguste ses pêches.
Il n a pas l’amour des peintres de rondeurs opulentes
Ni des maîtres du raffinement,
Il est un rectangle et il a mal à un de ses côtés,
Il peint des pêches
Et non la peur errant sur leur rugosité.
Comment aurait-il du temps pour cette mystique,
Alors qu’il a compris la vérité de la forme ?
Mais lorsque Dieu le verra,
La première chose qu’il fera
Sera de lui peindre le frisson d’une pêche,
Le détournant ainsi de la peinture plantureuse
Vers son camp…
∗∗∗
À l’arrêt, Ela Gochiashvili
Cézanne, Lia Sturua.
Diana Anphimiadi
La méduse Gorgone
Quand je t’ai dit que rien ne s’était passé,
Je t’ai menti.
Ça se passe, ça se passe tous les jours
Passerelles, paysages…
Puisque l’amour a fait de moi une poupée,
Je marche, pour les uns – tête coupée,
Pour les autres – un miroir.
Qui me regarde est
Pétrifié,
Figé.
Quand je t’ai dit que rien ne s’était passé,
J’ai juste oublié.
Depuis ce jour,
Toute la cavalerie et tous les fantassins
Portent mon nom
(Mon nom de tête coupée)
Comme bouclier…
S’ils me jettent une pierre,
Ils en reçoivent en retour…
Quand je t’ai dit que rien ne s’était passé,
Je t’ai menti.
Ce n’est même plus un rien. Je respire, j’existe,
Mon cœur étant une tumeur étouffante dans ma poitrine, près du sein,
J’y ai fait l’ablation des mélodies, de la musique maline, des métastases
Qui apportent les voix des jours perdus.
Le cœur est une touffe de chélidoines,
Il se fane.
Hélas, si au moins cela valait la peine –
La nuit , ma tête est accrochée à mon cou avec un poil,
Le matin, ma cicatrice brûle, telle une étoile,
Et puis cela recommence…
∗∗∗
Tea Topuria
La correspondante part en mission
Quand on m’envoie en reportage
La où personne ne m’attend,
Quelque part à la campagne ou chez les gens ordinaires,
Pas auprès de ces membres du gouvernement qui connaissent déjà mon visage,
Quelque part où les gens, certes, savent que j’existe
Et que j’irai peut-être les voir un jour,
Mais pas aujourd’hui, pas maintenant…
Quand on m’envoie chez ces gens-là,
Je crois parfois être la mort.
J’y vais sans prévenir, par surprise,
Brandissant, telle une arme, un micro noir et exigeant une réponse.
Et lorsque, eux, me regardent,
Je crois vraiment être la mort.
Cet homme, par exemple, qui était, tranquille,
Bafouille maintenant, confus :
« Vous savez, je ne suis pas prêt. Vous pourriez voir avec ma femme ! »
Il dirait certainement la même chose à la vraie mort.
Dans une autre maison, une femme, occupée, n’as pas de temps pour moi,
Mais, son tour étant venu, elle ne peut pas refuser.
Elle se plaint seulement :
« Chez moi, c’est un peu le désordre.
Je range ces choses-là. Désolée ! Je ne vous attendais pas.
Je suis mal habillée. Je ne ressemble à rien.
Et que pourrais-je vous dire ?!
Pourriez-vous me laisser un peu de temps ? Je vais mettre mes idées en ordre. »
Elle arrange se robe, arrange ses cheveux, arrange ses rideaux,
Essaie de ne pas montrer sa peur, commence à parler,
Souriant (comme sur une photo de passeport),
Et raconte comment les criquets bouffent la campagne
Ou comment le gouverneur a fait disparaître des milliers de laris
« Si j’avais su que vous veniez aujourd’hui, je me serais préparée,
J’aurais fait le ménage, je vous aurais accueillie
Mieux habillée, avec bien plus d’arguments… »
Je souris seulement, sans rien dire,
Car je n’ai jamais réussi à les convaincre
Que leur vrai visage était, qu’ils le veuillent ou non, justement celui-ci.
Quand on vient prendre l’âme, on ne prévient pas !
Ainsi la mort, telle une correspondante, vient
Quand on n’est pas « prêt »,
Quand on est chez soi, en chaussons ou en vieille robe de chambre,
Ou encore en guerre, en train de cracher son sang et celui d’autrui.
En revanche, la façon dont on t’arrangera ensuite
Fait une belle jambe à la mort.
Ainsi je quitte les lieux.
∗∗∗
Kato Javakhishvili
La voisine
Ma voisine avait les seins affaissés.
Elle avait quatre enfants et avait les seins affaissés.
Elle se mettait du rouge à lèvres et avait les seins affaissés.
Assise, ses pauvres seins lui tombaient presque à la taille.
Ma voisine ramassait ses seins, tels des ballons crevés,
Les fourrait dans un soi-disant soutien-gorge,
Poussait un soupir et s’allumait une cigarette dans la cour.
Elle fumait des cigarettes sans filtre et avait les doigts jaunis.
Elle avait les doigts jaunis et fumait des cigarettes sans filtre, ma voisine.
Tout le voisinage parlait d’elle,
De cette femme sans vergogne sortant chaque nuit,
Laissant quatre enfants pleurer à la maison et traînant le diable sait où,
De cette mère indigne,
De cette femme, malhonnête, puisque son mari l’avait abandonnée.
J’avais huit ans et mes yeux devenaient ronds comme des boutons quand je la voyais.
J’avais huit ans et j’avais peur de ses enfants.
Les voisins disaient qu’elle était incapable d’élever des enfants
Et qu’elle ne savait probablement pas de quel homme elle les avait eus,
Et que ses enfants aussi allaient finir comme elle.
Une fois, je me suis retrouvée chez ma voisine aux seins affaissés.
Mon ballon avait rebondi sur le balcon de la femme aux quatre enfants
Et je m’y suis retrouvée.
Ma voisine était assise et pleurait.
Elle était assise et pleurait, ma voisine.
Le ballon crevé gisait dans la pièce et elle pleurait.
Ma voisine pleurait avec ses seins dégonflés.
Elle passait ses doigts jaunes sur ses yeux et pleurait.
J’avais huit ans et j’ai été embarrassée.
J’ai cru que ma voisine pleurait à cause du ballon crevé.
Puis ils ont déménagé.
Ils ont déménagé et j’ai compris :
Ma voisine était un ballon de baudruche
Lâché pour les fêtes,
Un ballon de baudruche crevé.
∗∗∗
Lela Tsutskiridzé
L’histoire des arbres jaunis prématurément
Cette histoire ne parle pas de cet arbre
Qui nous dit au revoir
Quand nous quittons, fin août, par les routes sinueuses,
Les forêts de la Tusheti pour la plaine,
Qui a jauni subitement,
Parmi un millier d’arbres verts,
Pour qu’au retour à la maison,
Nous ne puissions pas l’oublier.
Cette histoire ne parle pas non plus de cet arbre
Qui est là, à l’arrêt de bus devant mon immeuble
Et que personne ne remarque,
Tout le monde trouvant banal
Un arbre ordinaire à un arrêt,
Alors qu’il semble vivre toute l’année
Juste pour prendre son courage à deux mains
Et s’enflammer, une nuit de la fin août, de la flamme jaune automnale
A l’aide des allumettes du soleil,
Juste pour que nous le remarquions
Et que nous nous exclamions avec admiration :
Mais qu’il est beau, en fait ! Incroyable !
Cette histoire ne parle pas plus de cet arbre
Qui a poussé tout seul sur la colline, à la campagne,
Et qui, à la fin de chaque été,
Lorsque les gens vident leur maison de leurs pas et se précipitent vers la ville,
Refuse la verdure et la fraîcheur
Et laisse jaunir ses feuilles pr
ématurément,
Dépêchant ainsi sa tristesse au secours de la campagne triste.
Cette histoire parle des filles,
Celles qui étaient petites et ont décidé, un jour, de devenir grandes,
Celles qui étaient grandes et ont eu l’idée, un jour, de redevenir enfants
Pour sur vivre,
Celles qui se sont révoltées contre la monotonie
Et qui, un jour, se sont tatoué le corps de mille soleils
À la surprise de tous,
Celles qui, un jour, n’ont plus eu peur de la peur
Et ont extrait de leur corps tous les cris qu’elles n’ont pas pu contenir,
Des filles, des femmes
Qui, un jour, se sont relevées dans ce monde incolore
Et se sont mises à briller,
Tels les arbres jaunis prématurément de la fin août.
Cette histoire parle de nous qui, un jour, devrons penser :
Quitte à affronter l’hiver et la mort,
Autant le faire aussi courageusement et en beauté,
Seulement ainsi,
Ainsi.
∗∗∗
Eka Kevanishvili
La chanson de la femme du mineur
Ce soir, mon homme, mon mari, rentrera tard, enfumé,
Et ses dents blanches scintilleront.
Grace à ses dents, je pourrais le reconnaître entre tous.
Quand je l’ai connu, c’était un homme blanc.
Maintenant, il est couleur de poussière.
On dirait aussi que sa voix est mêlée de poudre de fer
Et que de l’huile bouillante brille dans ses yeux.
Mon mari change quand il émerge du long tunnel, quand il revient sur la terre.
Voila, il ne va plus tarder. Il va ouvrir la porte, souillé,
Rapportant, du cœur de la terre, l’odeur de ses semblables exténués.
Il aura des boites vides dans une main, du pain couvert de suie dans l’autre.
En plus de moi, il aura contaminé le pain, il l’aura noirci.
Il manquera un bout du pain – il aura eu faim en rentrant.
Il s’assiéra à la table et y restera.
Il attendra son potage qui sera suivi de mes inéluctables remarques
Au sujet de nos dettes à la banque
Et de nos ardoises dans les magasins
Et des nouvelles chaussures de l’enfant des voisins
Et des cartables usés de nos enfants,
De la désespérance.
Il s’assiéra et regardera par la fenêtre, vers le ciel.
Le ciel me manque, me dira-t-il, et il se taira.
Ce soir, mon mari rentrera tard et jettera par terre ses vêtements sales,
Il ouvrira la fenêtre dans le froid hivernal.
L’air me manque, dira-t-il, et il se taira.
Et je ne pourrai pas lui parler des cahiers de dessin,
Et des chocolats,
Et des livres,
Et des nouvelles robes,
Et du collier dans la vitrine,
De la vie d’un homme digne, en général.
Je penserai juste : pour vu qu’il ait toujours bras et jambes,
Qu’il puisse descendre à la mine.
La chanson de la femme du mineur, Eka Kevanishvili.
∗∗∗
Lela Samniashvili
Femme poète
Ça sonne comme femme-grenouille –
Si elle coasse, elle doit émettre un son doux,
Elle ne doit pas importuner,
Elle ne doit pas casser les oreilles,
Elle doit porter une minuscule couronne dorée invisible,
Peut-être que quelqu’un la remarquera,
Peut-être qu’on l’embrassera,
Peut-être qu’on lui passera la main sur la tête,
Qu’on l’assiéra à son chevet.
Bref, c’est un conte de fées, une fiction.
Une grenouille, peu importe qu’elle soit femelle ou mâle,
À besoin d’une voix forte
Pour couvrir les coassements des autres,
Pour faire l’éloge encore plus fort du tendre marécage,
Pour conter le temps béni ou elle était têtard,
Ou coasser encore plus fort
Qu’elle n’aime pas sa peau gluante
Ni nager la brasse
Dans les palais d’algues nauséabondes,
Qu’elle trouve barbant de se remplir le ventre d’insectes
Chaque matin, après-midi et soir,
Qu’elle s’inquiète
De ne pouvoir sauter au-dessus de sa propre langue.
Elle attire tout ce qui vole.
Dans cet ennui,
Sa voix est son seul divertissement,
Signe de vie,
Qui lui donne l’impression que son sang n’a pas complètement gelé.
La douceur est impossible dans cette histoire,
C’est une stratégie perdante, elle ne sert à rien.
Ne vous fiez donc pas aux belles couvertures des anthologies
Sur lesquelles vous sourient, seules, des femmes.
Il n’existe pas de femme poète.
∗∗∗
Mariam Tsiklauri, Que dirons-nous à nos enfants.
Mariam Tsiklauri
Que dirons-nous à nos enfants
Que dirons-nous à nos enfants
Quand nous reviendrons de la guerre ?
Quand nous reviendrons de la paix aussi,
Quand nous reviendrons de la mort elle-même,
Que leur dirons-nous ? –
Que nous avons cherché l’amour partout
Et ne l’avons trouvé nulle part ?
Que nous avons cherché la liberté
Et l’avons trouvée dans l’esclavage ?
Que nous avons aspiré au bonheur
Et avons épousé le malheur ?
Que leur dirons-nous ? –
Que nous n’avons trouvé ni Dieu dans les cieux,
Ni maison sur la Terre ?
Que nous avons vu nos horizons se découdre
Et n’avons pas pu protéger la sérénité
De nos temples ?
Que leur dirons-nous ? –
Que nous les avons mis au monde
Pour nous tenir debout sur leurs âmes infantiles,
Comme sur des marches d’escalier,
Afin de ramper vers le haut, vers les cieux,
Tout en restant couverts de terre,
Tels des misérables ?
Voici la souffrance – votre Bethléem :
Donnez naissance, par vous-mêmes, à un Dieu
Qui sera votre égal
Et vous soutiendra davantage
Lorsque vous serez à bout de forces.
∗∗∗
Nato Ingorokva
La ration des poissons
Ma grand-mère
Ne mangeait pas de poisson,
Car elle croyait
Que grand-père, qui s’est rendu à la mort
Et aux flots du fleuve Oder,
Était devenu le dîner des poissons.
Elle
Ne s’habillait plus de soie,
Car elle avait échangé contre du pain
Ses étoffes à robes offertes en dot,
Pour nourrir ses petits enfants orphelins.
Je
N’entends le bruissement des robes précieuses que dans mes rêves,
En raison des peurs héréditaires.
Et dans la réalité,
Sur la table
Dont les pieds se sont amincis à force d’être debout,
Je déguste prudemment le poisson
Pour qu’une arrête ne me griffe pas la gorge accidentellement.
∗∗∗
Maya Sarishvili
* * *
Il serait préférable qu’après la mort
Tu puisses marcher
Ne serait-ce qu’une demi-journée.
Tu irais chez ceux que tu choisirais
Parmi les adresses gravées dans la plante de tes pieds.
Tu irais chez ceux qui ont, autrefois,
Arraché les poignées de leurs portes
Pour te faire comprendre
L’incongruité de tes visites.
On ne demande pas de raisons à une morte,
Tu irais voir tout le monde, les yeux fermés,
Grisâtre, encore un peu chaude.
Ils n’auraient plus à venir
Se recueillir devant toi.
C’est toi qui ferais le tour
Des corps vivants de tes amis
Qui n’auraient plus à se justifier.
Une morte n’a besoin
De rien,
Juste de la capacité de se déplacer
Pour qu’on voie
Comment elle est hors de la vie,
Et qu’on admette
La défaite face aux ordinaires, aux modestes
Choses de l’amour,
Puisqu’on n’aura pas pu
Fermer la porte à la morte.
Maya Sarishvili.
Note
- Le texte de présentation correspond à celui de la quatrième de couverture de l’anthologie Je suis nombreuses, Quinze poètes géorgiennes, traduit du géorgien par Boris Bachana Chabradzé, paru aux Editions l’Inventaire, dirigées par Anne Coldefy-Faucard, éditrice et auteure de cette introduction.
vidéo de la présentation en ligne (en français et en géorgien) de l’anthologie organisée le 30 mars 2021 via Zoom par La Renaissance Française et avec la participation de l’éditrice, traducteur, auteures, Maison des écrivains et Ministère de la culture de Géorgie, Ambassade de Géorgie à Paris, Ambassade de France à Tbilissi et Institut français de Géorgie.
















