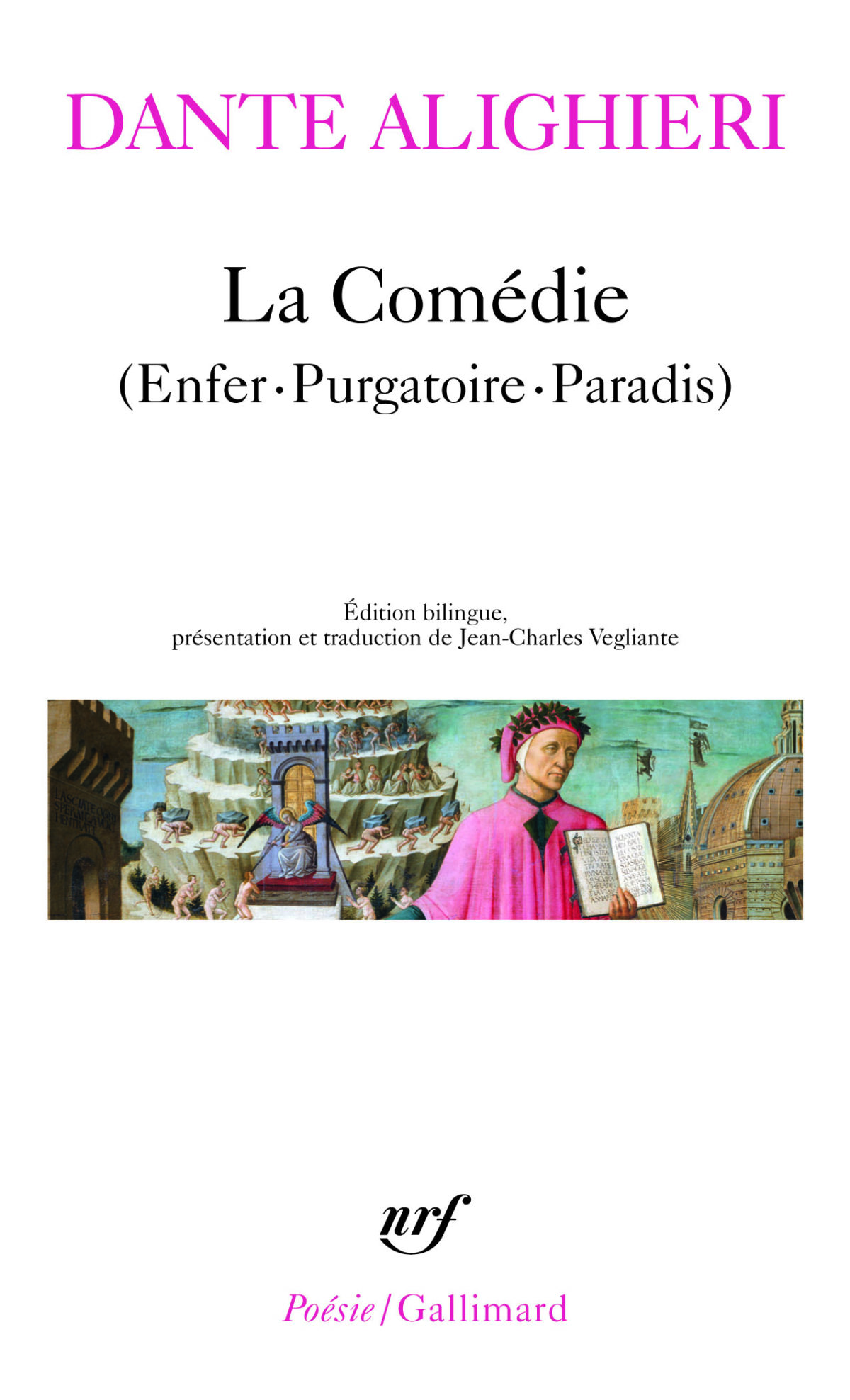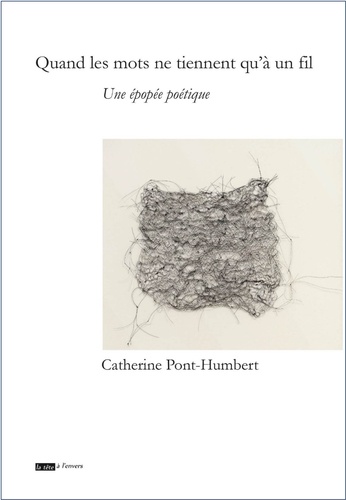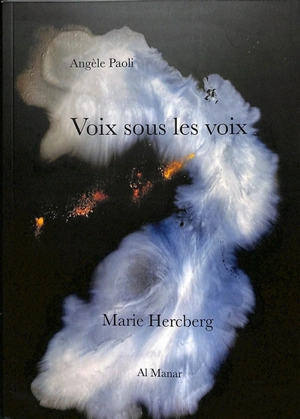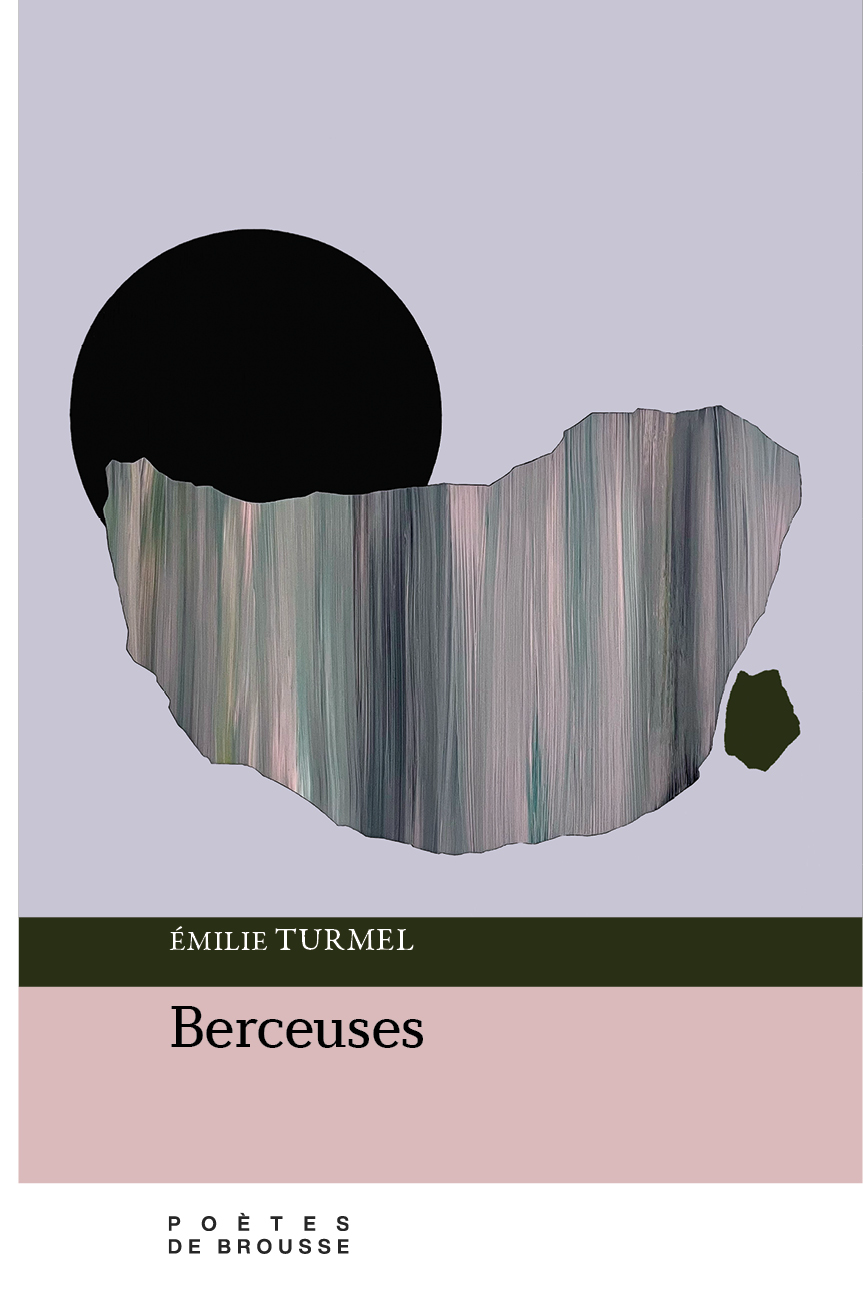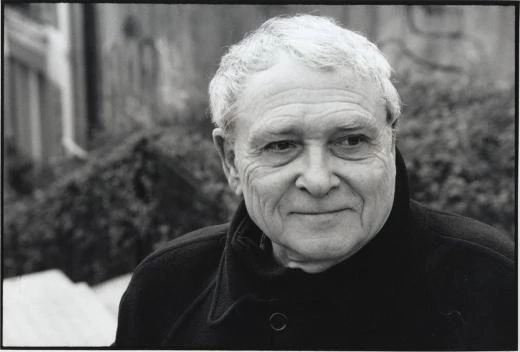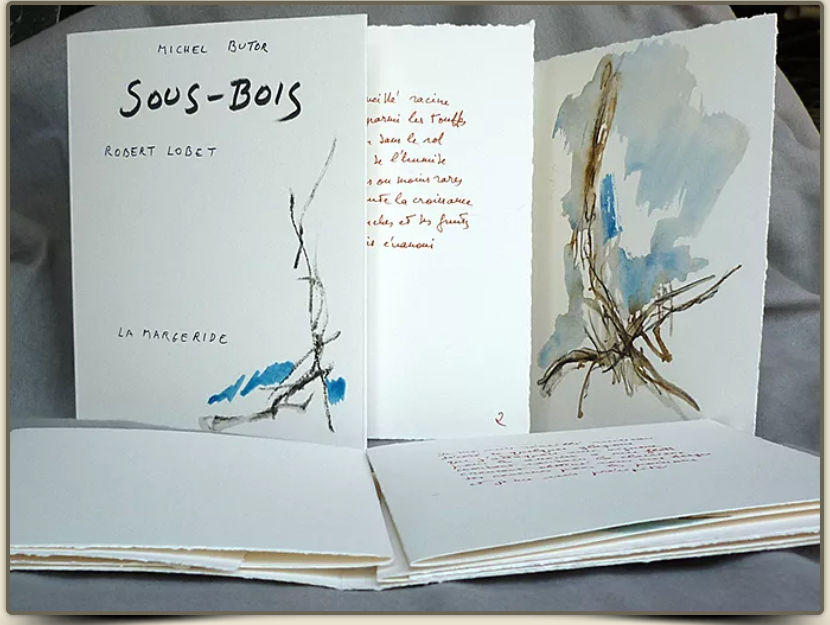Gwen Garnier-Duguy s’entretient avec Jean-Charles Vegliante à propos de la récente parution de La comédie de Dante Alighieri…
Jean-Charles Vegliante, la collection poésie, chez Gallimard, vient de faire paraître votre nouvelle traduction de La [Divine] Comédie, de Dante. Projet exceptionnel pour une œuvre monumentale. Pouvez-vous nous raconter l’histoire de ce projet ?
Votre question concerne moins la chronologie – hélas plutôt longue – que les motivations de cette entreprise, je suppose. Celle-ci a commencé bien avant l’accueil amical d’un responsable d’édition auprès de l’Imprimerie Nationale, d’où vint la parution du premier volume, Enfer, en mars 1996 : très beau livre, composé aux plombs, illustré d’une miniature française (œuvre du maître de Coëtivy), laquelle correspondait curieusement au choix que j’avais fini par privilégier en français pour le terme « dificio » appliqué par Dante à l’effrayante apparition du mal absolu au centre de notre monde (à savoir : construction de type moulin, rouages et murs mêlés, massive et mouvante à la fois, d’où le mot ‘machine’ : « il me sembla voir alors une machine », p. 421 de cette première édition).
Une absolue inhumanité, tellement inconcevable que le voyageur ne parvient pas à interpréter ce qu’il voit devant lui : et splendide métaphore secrète du défi à la raison raisonnante que constitue cette poésie – cette pensée en poésie –, donc a fortiori la traduction d’une telle poésie, toujours au bord de l’impossibilité « radicale » (comme disent les logiciens), ou du paradoxe d’un véritable act of trust sémantique (et donc traductif) préliminaire, comme je préfère dire en forçant un peu l’optimisme herméneutique de George Steiner par exemple (mais, plus généralement, Greimas nous avait appris qu’un monde ne peut qu’être, pour nous, signifiant). Par ailleurs, je le dis en passant, la grande maison que fut l’Imprimerie Nationale accepta de prendre le risque, à l’époque, d’indiquer Dante ALIGHIERI comme auteur, et La Comédie comme titre de l’ouvrage (sur la couverture ainsi illustrée), ce dont apparemment certains distributeurs et certains critiques journalistiques ne se sont pas remis.
Pour répondre plus précisément à votre curiosité concernant l’histoire du projet, il me faut remonter encore en deçà, jusqu’aux premiers essais d’appropriation d’une langue non maternelle mais élue – le français – à travers une remontée aux sources karstiques de mon besoin d’écrire (j’ai essayé de l’exprimer bien plus tard par le poème géographique Source de la Loue, dans Rien commun, Belin 2000), tâtonnante expérimentation de rythmes impairs et de récritures d’une sorte de malgré tout ‘origine’, le grand Livre de l’Alighieri justement, laquelle devait aboutir finalement à une plaquette au titre transparent Vers l’amont Dante (L’Alphée 1986, Avant-propos de J. Risset). Dans l’alternance, à cette hauteur, de vers de 9 et de 11 syllabes, je cherchais le mètre dont une nouvelle traduction (après la voie ouverte par celle de Risset), un texte poétique capable de ‘tenir’ et se transmettre en français du XX-XXIe siècle, une traduction-texte à la hauteur d’intentions – sinon de résultat – de son texte originaire, avait d’abord besoin. Tout recommence toujours par la respiration. Par exemple, très clairement :
Alors la peur s’apaise un peu dans le lac
nocturne, le cœur que fait bruire la mé
moire écrite infinie. Il entend…
Et comme celui, à bout de souffle,
qui presse le sol au sortir de la mer,
tourné en s’apaisant vers l’eau périlleuse,
ainsi mon âme […] etc.
(Pour recommencer, 1984–86)
Cette forme d’enchaînement par alternance, appelée à s’infléchir au cours des essais de traduction précis du texte, allait me fournir enfin la clef dont j’avais besoin : un mètre, je l’ai dit, qui ne devait plus varier (sinon bien sûr par son rythme interne et environnant) au long des 14 233 vers que compte l’œuvre. Le reste fut affaire d’amour et de longue patience.
Vous évoquez la dénomination de l’œuvre : non plus La Divine Comédie, acception jusqu’ici commune en France mais La Comédie. En quoi ce choix est-il pertinent ?
Tout d’abord, il faut rappeler que les ouvrages anciens ne portaient pas à proprement parler de titre. On les désignait généralement par leur matière (mot à mot : ‘Traitant De…’), et plus souvent par leur début ou incipit, du reste souvent latin même quand l’ouvrage était rédigé en langue vulgaire. Dans le cas présent, Incipit Comedia Dantis Alagherii (‘La Comédie’, donc, avec parfois simplement : Capitolo primo del libro di Dante etc.). Même après que Boccace eut inventé le syntagme à succès « Divina Commedia » pour ses propres copies, la première édition imprimée (Foligno, 1472) portait encore un sobre fronton Comincia la Comedia di dante alleghieri di Fiorenze. Ensuite, chaque fois que notre auteur nomme son œuvre, à l’intérieur de son propre texte, il emploie le terme de Comédie, ou de Poème Sacré – ainsi que je l’ai indiqué non pas sur la couverture (déjà chargée) de la présente édition, mais au moins sur la page de titre : La Comédie, Poème sacré. Je pense que c’est le titre qui convient le mieux à ce pur diamant de la Littérature universelle, que l’Alighieri compare aussi au chant religieux biblique ou Théodie (un sous-titre possible aussi, mais moins compréhensible de nos jours), sur le modèle de « l’humble psalmiste » David.
Reste la question de la ‘comédie’ comme genre, sur quoi des livres entiers ont été écrits. En bref, la comédie n’est pas une tragédie (à fin âpre, négative) et n’exige pas un ton – voire un style – uniformément haut ; dans la célèbre lettre, en partie apocryphe, à son protecteur Cangrande della Scala, seigneur de Vérone, vicaire impérial, chef reconnu des Gibelins partisans du pouvoir temporel de l’Empereur, auquel il dédie le Paradis, Dante ajoutera qu’un langage simple et varié est aussi le moyen d’être entendu du plus grand nombre. En fait, proche au début d’un chant villageois, son parler vulgaire est idéalement celui dont usent entre elles les femmes du peuple, pour s’élever peu à peu vers le passage du Purgatoire et puis vers sa partie la plus parfaite, en Paradis justement (et donc en une fin heureuse). Au passage, je souligne qu’une certaine forme de sourire médiéval, sinon de véritable comique au sens où nous l’entendons, n’est jamais absent de cette œuvre. On le voit, ces options rendent d’emblée cette œuvre ‘inqualifiable’ (la dimension romanesque, pas plus que le dialogisme n’en sont absents, par le biais de la ‘comédie’). Pour nous, dans la langue autre de traduction, l’essentiel était donc de préserver l’extraordinaire diversité, parfois l’hybridation linguistique – sur un socle, certes, de florentin illustre, sensible en particulier par la syntaxe et dans certains discours directs particulièrement soignés – jusqu’aux dialectalismes, aux inventions, aux néologies : création libre et souveraine, par laquelle s’est construit d’un même jet le Livre et constituée la langue italienne naissante, en l’absence (faut-il le rappeler) de toute forme d’État central.
Vous parlez de “pur diamant de la Littérature universelle”. Posons la question simplement : en quoi cette œuvre est-elle un chef d’œuvre inépuisable et quels enjeux se sont-ils joués depuis qu’elle existe et à partir d’elle sur le plan universel ?
Je sais que je me suis un peu trop avancé sur un terrain mouvant, contesté, à l’évidence relatif, tant au plan historique qu’à celui de la culture (y compris en ses manifestations religieuses) ou du gender comme on aime à dire maintenant. Si Béatrice Portinari avait écrit sa version de la Vie nouvelle – rencontre avec un petit garçon à peine plus âgé qu’elle, prénommé Dante etc. etc. – il en serait allé tout autrement j’en suis bien persuadé. Et nous aurions sans doute un tout autre texte (même chose, a fortiori, si tout cela s’était passé en Amérique pré-colombienne ou dans l’Asie du sud-est). Cependant… peut-on prétendre que cette rencontre amoureuse, l’exaltation, les souffrances, l’espoir, la sublimation et la promesse de ne jamais se résigner à la disparition de l’être unique-pour-soi et au néant d’un peu de terre gâtée eussent été radicalement différents du point de vue féminin, ou caribéen ? Il faudrait pour m’en convaincre de longues et sérieuses études d’anthropologie comparée, démontrant qu’un tel cas de figure – et le récit qui pourrait en être fait – serait absurde voire inconcevable sous d’autres latitudes et dans des cultures radicalement différentes. Que donc le texte qui en est issu, puis s’est transformé et amplifié jusqu’à dire de cet être unique-pour-soi « ce qui jamais ne fut dit d’aucun(e) » (telle sera La Comédie), à travers un individu pensant nommé Alighieri, serait radicalement intraduisible (il s’agit là, comme l’on sait, d’une aporie logique aussi incontestable qu’indémontrable). Or la traduction n’est pas, ne doit pas être « radicale », mais au contraire relative, transformative, vivante c’est-à-dire bien sûr inventive et tournée vers la transmission ; elle est, je veux croire, et parfois avec des difficultés incroyables, toujours possible. D’autant plus possible que l’œuvre originaire est plus haute, exigeante, appelant ses toujours nouvelles « traductions », comme œuvres destinataires de cet appel à être traduite. C’est à travers le voile déformant, heureusement déformant de la version étrangère, écrivait à peu près W. Benjamin il y a près d’un siècle, que s’entrevoit le fantasme de la langue parfaite. Je l’ai entrevu derrière La Comédie de Dante Alighieri, tout en sachant la contingence de maint détail, de telle croyance, évidemment de toutes les illusions politiques du citoyen poète, parfois si envahissants il est vrai que Saint-John Perse a préféré parler de chef‑d’œuvre occidental – ce que j’ose contester. Mais bien sûr, le “pur diamant” n’était là qu’une métaphore (j’ai insisté autant, à l’inverse, sur le caractère hybride et pluristylistique de l’expression dantesque), nous pouvons mettre “fruit merveilleux” à la place, si vous préférez… Pourvu que l’on accepte de donner, en particulier pour ce qui est de la sacralité déclarée de ce Livre, la primauté absolue à sa poésie.
Vous dites avoir entrevu la langue parfaite derrière La Comédie. Pouvez-vous nous dire plus précisément ce que vous avez concrètement entrevu ? Et préciser pourquoi vous contestez la parole de Saint-John Perse sur la dimension uniquement occidentale de l’œuvre de Dante ?
Je crois avoir entrevu le “fantasme” de la reine Sprache benjaminienne, car il s’agit d’une forme rêvée de langue unique (alors que – Mallarmé – les langues imparfaites en cela que plusieurs exigent justement d’être infiniment traduites), au fond la langue de la poésie même, non pas derrière La Comédie mais derrière le travail de traduction d’un texte qui échappe à sa propre intention, à son temps, aux genres (cette fois au sens rhétorique traditionnel), à la langue « municipale » de son auteur au profit d’une création linguistique dont les différentes régions de la péninsule italique – je dis, dans ma version, les Ytailles – seront pour des siècles tributaires et subjuguées (les italophones peuvent encore, à peu de chose près, lire ce texte aujourd’hui, sept siècles après sa rédaction). À sa tension théologale enfin, puisque je crois qu’un athée peut le lire aussi profondément et légitimement qu’un croyant chrétien – ou d’autre foi. En un mot, il s’agit d’un texte à ce point ouvert dans une infinité de directions, horizontales et biaises et abruptement dressées, que le simple jeu des déplacements / compensations / récritures en traduction donne au moins une image de ce paradis de vérité que serait la langue parfaite.
En introduction au troisième livre, du Paradis, je cite Saint-John Perse quand il reconnaissait à Dante le génie colombien, pourrait-on dire, d’explorateur d’espaces inouïs, absolument vierges (en même temps qu’infiniment savants), tel un ouvreur « occidental » de nouveaux mondes. C’est sur cette détermination particulière, songeant aux avancées maritimes impressionnantes de voyageurs chinois (Tchang Heu) ou arabes (Ibn Battuta), ou encore aux voyages orientaux de Marco Polo ou d’Ibn Khaldûn que j’ai voulu nuancer tout à l’heure la formule suggestive de Saint-John Perse. Il m’a semblé, si nous revenons un instant sur votre question précédente, que le pôle « occidental », quelle que soit objectivement sa puissance d’attraction progressive – et ce, au moins de 1492 aux dernières années du siècle à peine écoulé (disons par exemple 1991 ? un demi millénaire serait un chiffre bien intéressant) –, cette aimantation dominante, donc, reste encore un axe réducteur eu égard aux potentialités concentrées dans l’œuvre qui nous occupe. Autrement dit l’ampleur universelle visait davantage dans mon esprit cette capacité à se renouveler et à s’éployer, par d’infinies nouvelles lectures, que dans un vague universalisme dont nous savons à présent, un peu tard, toutes les limites culturelles, cette fois, oui, occidentales.
Depuis votre première lecture de La Comédie jusqu’à votre traduction de celle-ci, qu’avez-vous découvert dans cette œuvre ? Qu’avez-vous découvert pour vous-même, c’est à dire en quoi son approfondissement vous a‑t-il été bénéfique, mais aussi qu’avez-vous découvert des secrets de cette œuvre, car La Comédie, si elle est une œuvre populaire, contient une dimension profondément ésotérique ?
Pardon, mais je n’ai jamais cru à la dimension ésotérique de La Comédie ; c’est curieux, d’ailleurs, que vous me demandiez cela, car ma première approche non scolaire de Dante fut pour répondre à une très généreuse offre de collaboration faite par René Nelli, sur la poésie du Dolce stil nuovo (Cavalcanti, Lapo Gianni, Davanzati, Cino, Dante…), et justement orientée vers l’idée d’une sorte d’école de “Fidèles d’Amour” plus ou moins sectaire. J’obtins du grand occitaniste que le titre fût infléchi finalement en “Poètes de l’amour et de l’obscur”, que la revue Sud publia en effet (nous sommes là en 1974 et Saint-John Perse était également au sommaire) ; pour mon adolescente incroyable fierté, inutile de le dire – à l’époque, la parution sur papier était sentie comme un vrai privilège. Encore s’agissait-il du jeune Alighieri, entouré de ses amis, et plus largement de ceux qu’il appelait lui-même « tous les fidèles d’Amour » (où l’adjectif “tous” semblerait surprenant s’il s’était agi d’une secte, comme dans le cas peut-être d’une branche du soufisme), dans le plein bouleversement de la découverte amoureuse existentielle et intellectuelle : la lecture des troubadours occitans en l’occurrence, et indirectement de la poésie amoureuse des Arabo-Andalous (le rapprochement entre la Vie nouvelle et L’interprète des désirs d’Ibn ‘Arabî a été bien sûr souvent fait – voir du reste http://autresvoix.blogspot.fr/2009/11/desir-et-elevation-de-ibn-arabi-la-vita.html ). La Comédie, œuvre de pleine maturité, si elle échappe – encore une fois – à toute contrainte autre que celles de la poésie, est bien trop contrôlée, en tout cas au niveau conscient, construite et structurée jusque dans le moindre détail, soucieuse de son “utilité” pour le lecteur immédiatement impliqué (incipit célèbre « À la moitié du chemin de NOTRE vie »…), qu’elle doit aider concrètement sur la voie du salut, et attentive à la vérité dénotative des faits rapportés (c’est son niveau littéral, à prendre toujours au sérieux) pour se permettre si j’ose dire un quelconque ésotérisme. Pour Dante, au contraire, tout homme est « citoyen » du monde (Paradis, VIII) et doit pouvoir – savant ou ignorant, à la limite même païen – être sauvé. S’il/elle le veut.
Vous évoquez la lecture des troubadours occitans. Pouvez-vous nous parler de l’influence d’Arnaut Daniel, que Dante reconnaissait comme le “meilleur”, et quelles influences dans La Comédie l’inspiration d’Arnaut Daniel et la sextine eurent-elles ?
Vaste problème ! Toute la poésie européenne d’une certaine façon a été précédée – sans oublier pour autant la tradition arabo-andalouse, les premiers Minnesänger et les plus anciens trouvères – par celle des troubadours, en particulier occitans, et influencée par elle en ses différentes expressions (lyrique amoureuse, mais aussi guerrière, élégiaque, etc.) : ainsi, pour ce qui concerne l’aire italique, des troubadours tels Lanfranchi da Pistoia, Sordello da Goito (que l’on trouvera en Purgatoire VI-VIII), Lanfranco Cicala ou ses compatriotes Doria, mais aussi des isolés comme l’auteur anonyme de la canzone Quando eu stava in le tu’ cathene… (fin du XIIe s. – voir par exemple http://nositaliesparis3.wordpress.com/2012/06/27/frontiere-marches‑8/) ou encore les poètes de l’école sicilienne autour de l’empereur Frédéric II, parmi lesquels fut inventé le sonnet (sans doute à partir de Io m’aggio posto in core… de Giacomo da Lentini) ; dans l’Enfer, nous faisons mieux connaissance avec l’un des plus importants d’entre eux, Pier della Vigna, notaire impérial. La langue poétique italienne, issue d’une koinè elle-même mixte à partir des formes les plus nobles du sicilien, naît en cohabitant parfois chez le même auteur avec le latin, les langues d’oil et d’oc, et des variantes archaïques de l’italien. C’est dire à quel point, bien avant l’effort d’unification toscan – dont les textes les plus aboutis sauront s’affranchir à nouveau, par l’ouverture à d’autres régions de la Péninsule et aux registres les plus variés, comme dans La Comédie qui nous occupe –, et bien loin de la relative normalisation future du Pétrarque vulgaire, le paysage littéraire était accueillant, divers et contrasté en Italie. Dans ce cadre, Arnaut Daniel est admiré et pris pour maître, désigné à l’attention de Dante (le voyageur de l’au-delà, et l’écrivain Alighieri aussi bien) par celui justement qui venait d’être reconnu comme exemplaire modèle, Guido Guinizelli – l’autre Guido, par opposition à l’ami de jeunesse Cavalcanti. Le poète Guinizelli, vrai précurseur donc du Doux style nouveau (et une autre grande figure d’amoureux, un troubadour encore, sera Folquet de Marseille rencontré au Paradis), confie à celui qui se déclare son disciple :
Ô frère, dit-il, celui que je t’indique
du doigt – et il montra un esprit devant –
du parler maternel fut meilleur maître.
Soit vers d’amour, soit prose de romans,
tous il surpassa ; et laisse dire aux sots
s’ils croient que le Limousin vaut davantage.
Ils prêtent l’oreille au renom plus qu’au vrai
et forment ainsi leur opinion avant
que l’art ou la raison soient écoutés.(Purgatoire XXVI, vers 115–23)
Au passage, sont égratignés les critiques un peu trop sensibles à l’opinion – nous dirions médiatique – de l’époque (le Limousin nommé était Giraut de Bornheil, Maître des Troubadours) ; la raison est une fois de plus mentionnée aux côtés de l’art (surtout d’harmonie), et l’excellence du « parler maternel », sans particularisme ni exclusion, à nouveau exaltée. Arnaut Daniel, considéré auteur difficile par ses contemporains, artisan de rimes rares et de romans raffinés (tous perdus), domine nombre d’imitateurs par la richesse de son inspiration : il perfectionne la forme noble de la canzo, souvent enrichie de rimes intérieures, et en développe une configuration singulière, où les mots-rimes de chaque strophe se retrouvent dans un ordre fixe (de rétrogradation circulaire) au long des six retours – plus un envoi final où ils se concentrent en trois vers seulement – de la sextine ainsi constituée. La permutation vertigineuse des 6 ´ 6 (+ 3) a été qualifiée de métaphysique et suscité des essais d’émulation jusqu’aujourd’hui (Ungaretti, Fortini, le catalan Brossa) ; Dante n’en a usé qu’une fois (Al poco giorno…), sur le modèle de Lo ferm voler d’Arnaut, mais la considère, avec ses « stances sans rythme » (à savoir sans rimes) comme la plus haute des canzoni concevables. Il semble toutefois s’en être un peu éloigné, après la fin extrême du XIIIe siècle ou le tout début du XIVe auquel appartient cette sextine ; en faisant parler le personnage d’Arnaut Daniel en provençal, il lui rend un dernier hommage dans le chant du Purgatoire cité, en mêlant d’ailleurs des stylèmes d’Arnaut et d’autres de Folquet.
Chez Pétrarque, huit sextines plus une double (rendues récemment disponibles en français dans la belle traduction de François Turner) vont asseoir la prédominance de cette forme dans la très longue période du pétrarquisme européen, et au delà. Par exemple, encore chez W. H. Auden aux États-Unis. Il faut remarquer pour finir que la tierce rime, choisie finalement par Dante pour son grand œuvre, est par nature dirigée vers l’avant – ou l’en-avant, comme dira Rimbaud –, avec un pas marchant infini, et un élan comparable à celui de la prose, structure aussi ouverte que celle de la sextine est close : forme fixe et perfection d’un côté, poésie narrative en mouvement, libérée de tout “genre”, de l’autre.
Votre traduction de La Comédie ne comporte aucune note, à l’inverse de la traduction de Jacqueline Risset parue chez Flammarion. Pouvez-vous nous expliquer ce parti pris, qui est un choix très fort, comme si nous entrions nus dans une forêt, ainsi que d’autres choix pour lesquels vous avez opté pour accomplir votre traduction ?
Vous aurez remarqué que la première nouveauté de cette édition est de figurer dans la collection NRF de Poésie, généralement dépourvue de notes, et non, mettons, dans Folio classique qui m’avait également sollicité : il était fondamental, pour moi (et je pense pour André Velter qui la dirige), de réinscrire le grand Livre, parfois ressenti comme intimidant, réservé aux spécialistes, dans le flux vivant de la poésie de tous les temps, magnifiquement représenté par cette collection-là. Dès les premières lignes de la première des courtes préfaces (à l’Enfer, donc, mais aussi à l’ensemble de l’entreprise), je précise d’ailleurs avoir travaillé au jour le jour non pas sur la monumentale édition critique de Petrocchi en quatre forts volumes, mais sur le seul texte qui en a été repris dans une édition de poche sans notes, chez Einaudi. Autrement dit, le texte originaire peut être diffusé et lu sans notes ; pourquoi pas le texte destinataire, si la traduction “tient” dans la langue d’accueil ? Je n’ai pas à en juger bien entendu, mais les lecteurs nous l’indiqueront. Ensuite : prenez l’édition que vous citez, ou d’autres encore plus fournies de notes infra-paginales (celle de Pézard par exemple, pour moi exemplaire, dans la Pléiade) et trouvez une Note du Traducteur réellement utile – ne disons pas indispensable – : j’ai quelque doute, si nous parlons bien de ces fameuses NdT et non de précisions para-textuelles ou philologiques sur le texte originaire (celles-ci figurent bien dans les brèves notices et leurs gloses, en tête de chaque chant de mon édition). Mais pour ces dernières même, il faut savoir se limiter et ne pas alourdir l’objet de plaisir que doit être aussi une œuvre poétique : je m’en suis tenu strictement, en ce qui me concerne, à l’espace circonscrit d’une page, en tête de chaque chant. Pour les autres, un exemple suffira, chez Pézard justement, envers lequel on ne me soupçonnera pas d’irrespect. L’allégorie, dite du grand vieillard pleurant (statue figurant la décadence des époques de l’Histoire humaine), s’achève par la description des larmes qui s’en écoulent,
le quali, accolte, fóran quella grotta
à savoir finissent par percer la grotte qui abrite la statue et, à la fin de leur parcours souterrain, par former les fleuves infernaux immondes. Tout le malheur du monde finit dans le royaume du mal absolu dont nous avons déjà parlé. Or Pézard – qui traduisait d’après la leçon la plus répandue [questa grotta], à laquelle revient par exemple l’édition récente de Lanza – a cru bon d’ajouter la NdT suivante : « on voit ici que l’enfer est une profonde caverne (mais Dante ne dit pas caverna en ce sens), et que toute la première partie du poème est une vaste “allégorie de la caverne” renouvelée du mythe platonicien » (Pléiade, p. 968) ; ce qui ne peut qu’accroître la perplexité du lecteur, lequel ne sait plus s’il faut entendre la grotte de la statue (en Crète) ou la vaste grotte de l’Enfer où se trouvent à ce moment du récit Dante et Virgile. Que l’on choisisse quella “celle-là” ou questa “celle-ci”, celle dont on vient de parler, il s’agit bien de la grotte crétoise – les éditeurs alternatifs comme Lanza le précisent d’ailleurs –, et le rapport à la caverne platonicienne ne va pas de soi (il y faudrait alors une autre note). Vous voyez combien le problème est complexe, et peut-être sans réelle nécessité à cette complexité…
Au chant XI d’Enfer, le personnage Virgile explique à son élève que le Cercle de la violence (le 7e) est divisé en trois « gironi » (mot à mot “grands tours”) ; le mot se retrouvera du reste au second livre, pour les corniches entourant le mont Purgatoire. Il contient donc indifféremment les sèmes /convexe/ et /concave/, ou saillant et rentrant. L’habitude a été prise, en français, d’utiliser le calque “giron”, qui rend nécessaire une NdT, et éventuellement une autre encore lorsqu’un autre mot « grembo » sera rendu, plus loin, par l’exact “giron” (aussi bien “la pente fait d’elle-même un giron” que “viennent du giron de Marie” : Purgatoire VII, 68 et VIII, 37). Un sens approchant, en français, de ce “giron” abusif pourrait être la partie des marches d’un escalier qui, pour tourner, sont coupées en trapèze – voire en triangle – entre deux contremarches : ce qui, sans doute, par son caractère spécifique (ou sectoriel), nécessiterait derechef une nouvelle NdT pour les lecteurs non experts en menuiserie. N’est-il pas plus raisonnable, alors, d’essayer de trouver des termes différents, aptes à éviter cette impasse, du genre de “anneau”, “vire”, “enceinte”, etc. ? C’est ce que j’ai toujours tenté, de même que – pardon pour la comparaison indue – l’avaient fait Klossowski pour L’Énéide (Gallimard 1964) et Chouraqui pour La Bible (Desclée de Brouwer, 1989) : celui-ci avec de rares indications philologiques ou de renvois internes, celui-là sans aucune note ni notice ni glose (je ne suis pas allé jusque-là). J’aime terminer par cet hommage à deux modèles idéaux pour moi, mais je répète que Pézard est constamment resté, lui aussi, sous mes yeux : et il a été, tout de même, le dernier et quasiment le seul occupant d’une chaire d’italien au Collège de France, nous ne l’oublions pas ; et il ne fut pas très élégant (mais très parisien), il n’y a guère, de prétendre le liquider aussi vite.
Reste une perplexité, je suppose : ne vaudrait-il pas mieux, du point de vue de la cohérence lexicale, conserver un seul et même terme “giron” (le calque, et l’autre) en face de girone ? J’ai beaucoup réfléchi à cette question, étant en général très attentif précisément à une telle cohérence, bien souvent seule garante de la constitution en texte de la version étrangère proposée, garde-fou à la dispersion incohérente de nombreuses traductions. Les instruments informatiques, désormais, nous y aident puissamment. Pourtant, ainsi que j’ai essayé de le dire il y a longtemps dans mon D’écrire la traduction (PSN, 1996) au titre assez explicite, il y a toujours priorité du texte destinataire, avec son inscription possible dans une Littérature d’accueil et sa nécessaire autonomie sémantique. Les langues « doivent » exprimer des réalités différentes, même si – au prix de petits coups de force à la marge, sans doute – elles « peuvent » tout traduire (je cite scrupuleusement Jakobson) : la traduction se meut courageusement entre cet impératif et cette totale disponibilité. Elle ne saurait, à tout le moins, être si peu que ce soit terroriste.
Dernière question, cher Jean-Charles Vegliante. Au sortir de cette version — mais peut-on sortir d’une telle entreprise ? — vous avez traduit La Comédie à travers laquelle Dante traduisait autre chose, la Poésie elle-même, peut-être, pourrait-on dire. Cela fait-il de vous un autre Dante ? Nous voulons dire : La Comédie, dans le corps à corps que vous avez joué avec elle en la réécrivant, a‑t-elle agi comme une échelle paradisiaque ?
Voilà qui risque de me mener tout droit parmi les orgueilleux de la première corniche, là où Dante lui-même craignait de se retrouver (il répond à une femme envieuse punie, elle, dans la deuxième : « plus grande est la peur qui tient mon âme / en suspens pour la peine expiée dessous, / dont je sens déjà la charge m’opprimer » – Purgatoire XIII, 136–38) ! Mais je ne puis supposer que vous me tentez, cher ami interlocuteur : aussi vais-je vous répondre très simplement oui. Ce travail, cette joie de plus de dix années, ont été une montée presque constante, malgré quelques moments d’abattement et de fatigue, certes : un exercice (ascèse) d’ascension en effet, non pas de retrait du monde et de ses laideurs mais au contraire de compréhension et de tolérance, et d’un certain détachement aussi, suivant le sourire médiéval de “comédie” au sens que nous avons partagé plus haut. Je vous avoue d’ailleurs que plus le texte est riche et beau, plus sa traduction est en réalité facile, car offerte à d’infinies possibilités de recréation. Et puis vient le partage (pour la Vie nouvelle, nous avions travaillé d’abord collectivement, en séminaire à la Sorbonne Nouvelle). Mon entourage, mes étudiants, quelques vrais amis m’ont beaucoup aidé ; les plus jeunes, qui voient devant eux tellement de difficultés s’amonceler, sont merveilleux. Quant aux aigreurs dont j’ai laissé entendre un pâle écho dans la réponse précédente, le bon guide Virgile aurait dit : « Viens après moi et laisse dire les gens » – ce à quoi le disciple répondrait pour nous : « Que pouvais-je redire, sinon “Je viens” ? » (Purgatoire, chant V). Donc, vous le voyez, l’échelle paradisiaque est encore loin ; mais, en traducteur avisé, j’essaie de rendre le moins pour suggérer le plus.
propos recueillis par Gwen Garnier-Duguy
- ZÉNO BIANU : Rencontre avec Gwen Garnier Duguy - 7 juillet 2024
- L’honneur des poètes - 5 juillet 2021
- Revue des revues - 4 juillet 2021
- Marc ALYN, Le temps est un faucon qui plonge - 5 mai 2018
- Xavier Bordes : la conjuration du mensonge - 1 mars 2018
- Entretien avec Nohad Salameh - 1 mars 2018
- Rencontre avec Richard Millet - 8 novembre 2017
- RENCONTRE AVEC BERTRAND LACARELLE - 2 septembre 2017
- Jean-Louis VALLAS - 31 mars 2017
- Elie-Charles Flamand, La vigilance domine les hauteurs - 28 juillet 2016
- Elie-Charles Flamand - 21 juillet 2016
- Munesu Mabika De Cugnac : Un monde plus fort que le reste - 31 mai 2016
- ZÉNO BIANU - 29 mars 2016
- JAMES SACRÉ - 27 février 2016
- Avec Claire BARRÉ pour son roman ” Phrères” - 8 février 2016
- La collection poésie/Gallimard fête ses 50 ans : rencontre avec André VELTER - 3 janvier 2016
- André Velter/Ernest Pignon-Ernest, Pour l’amour de l’amour - 21 novembre 2015
- Conversation avec Xavier BORDES - 8 septembre 2015
- THAUMA, n°12, La Terre - 14 juillet 2015
- Jean Maison, Presque l’oubli - 5 juillet 2015
- Paul Pugnaud, Sur les routes du vent - 10 mai 2015
- JEAN-FRANÇOIS MATHÉ - 28 février 2015
- Juan Gelman, Vers le sud - 20 février 2015
- CHRISTOPHE DAUPHIN - 1 février 2015
- Claude Michel Cluny - 11 janvier 2015
- MARC DUGARDIN - 13 décembre 2014
- A‑M Lemnaru, Arcanes - 6 décembre 2014
- Maram al-Masri, L’amour au temps de l’insurrection et de la guerre - 30 novembre 2014
- Revue Les Hommes sans Epaules, n°38 - 1 novembre 2014
- Onzième n° de la revue THAUMA - 19 octobre 2014
- François Angot, A l’étale - 13 octobre 2014
- Si loin le rivage,d’Eva-Maria Berg - 14 septembre 2014
- Sur deux livres récents de Jigmé Thrinlé Gyatso - 7 septembre 2014
- Saraswati, revue de poésie, d’art et de réflexion, n°13 - 7 septembre 2014
- JEAN MAISON 2ème partie - 28 août 2014
- Nunc n° 33 : sur Joë Bousquet - 25 août 2014
- PHILIPPE DELAVEAU - 13 juillet 2014
- Le prix Charles Vildrac 2014 remis à notre ami et collaborateur le poète Jean Maison pour son recueil Le boulier cosmique (éditions Ad Solem) Extraits - 16 juin 2014
- Rencontre avec Nohad Salameh - 13 juin 2014
- Jean-François Mathé, La vie atteinte - 8 juin 2014
- PASCAL BOULANGER - 18 mai 2014
- Charles Bukowski, Les jours s’en vont comme des chevaux sauvages dans les collines - 21 avril 2014
- Paul Verlaine, Cellulairement - 7 avril 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (10) Arnaud Bourven - 6 avril 2014
- La vie lointaine de Jean Maison - 30 mars 2014
- L’Heure présente, Yves Bonnefoy - 23 mars 2014
- MARC ALYN - 22 février 2014
- BERNARD MAZO — AOÛT 2010 - 12 février 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (6) Pascal Boulanger - 8 février 2014
- Pierre Garnier - 1 février 2014
- Une nouvelle maison d’édition : Le Bateau Fantôme - 30 janvier 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (5) Gérard Bocholier - 26 janvier 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (4) : Alain Santacreu - 12 janvier 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (3) : Jean-François Mathé - 30 décembre 2013
- JEAN-LUC MAXENCE - 29 décembre 2013
- Rencontre avec Gilles Baudry - 30 novembre 2013
- A L’Index, n°24 - 25 novembre 2013
- Jean-Pierre Lemaire - 1 novembre 2013
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (1) - 23 octobre 2013
- Le dernier mot cependant de Jean-Pierre Védrines - 16 octobre 2013
- Mille grues de papier, de Chantal Dupuy-Dunier - 9 octobre 2013
- Rencontre avec Balthus de Matthieu Gosztola - 29 septembre 2013
- Demeure le veilleur de Gilles Baudry - 25 septembre 2013
- EUGENIO DE SIGNORIBUS - 25 août 2013
- Dans la poigne du vent, de F.X Maigre - 16 juillet 2013
- L’extrême-occidentale de Ghérasim Luca - 8 juillet 2013
- Au commencement des douleurs, de Pascal Boulanger - 22 juin 2013
- Le 23e numéro de A l’Index - 20 mai 2013
- James Longenbach, Résistance à la poésie - 10 mai 2013
- Jean Grosjean, Une voix, un regard - 19 avril 2013
- Etienne Orsini, “Gravure sur braise” - 5 avril 2013
- Paroles à tous les vents, Boulic - 22 mars 2013
- Gérard Bocholier, ses deux derniers recueils - 15 mars 2013
- Jean-Pierre Lemaire, Faire place - 8 mars 2013
- Ariane Dreyfus, par Matthieu Gosztola - 2 mars 2013
- Marc Delouze, “14975 jours entre” - 24 février 2013
- Mangú : Le sens de l’épopée - 23 février 2013
- Les poèmes choisis de Paul Pugnaud - 9 février 2013
- Faites entrer l’Infini, n°54 - 2 février 2013
- Au coeur de la Roya - 19 janvier 2013
- Entretien avec Jean-Charles Vegliante - 24 novembre 2012
- Un regard sur Recours au Poème - 3 novembre 2012
- Pierrick de Chermont, “Portes de l’anonymat” - 7 octobre 2012
- Denis Emorine, “De toute éternité” - 6 octobre 2012
- Hommage à Sarane Alexandrian, Supérieur Inconnu n°30 - 6 août 2012
- POESIEDirecte n°19, le désir - 2 août 2012
- Marc Baron, Ma page blanche mon amour - 1 août 2012
- Bernard Grasset, Au temps du mystère… - 1 août 2012
- Totems aux yeux de rasoir - 19 juillet 2012
- Vers l’Autre - 5 juillet 2012
- Jean-Pierre Boulic - 2 juillet 2012
- Jean-Luc Wauthier - 2 juillet 2012
- Le bleu de Max Alhau - 30 juin 2012
- Jean Maison, Araire - 21 juin 2012
- Rencontre Jean MAISON [1ère partie] - 13 juin 2012
- Patrice de La Tour du Pin, le poète de la Joie - 18 mai 2012
- Rencontre avec Iris Cushing - 5 avril 2012