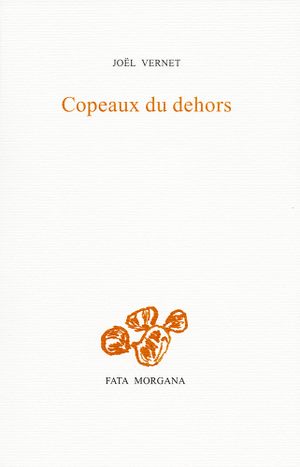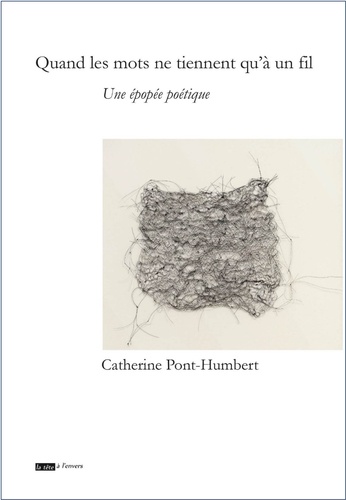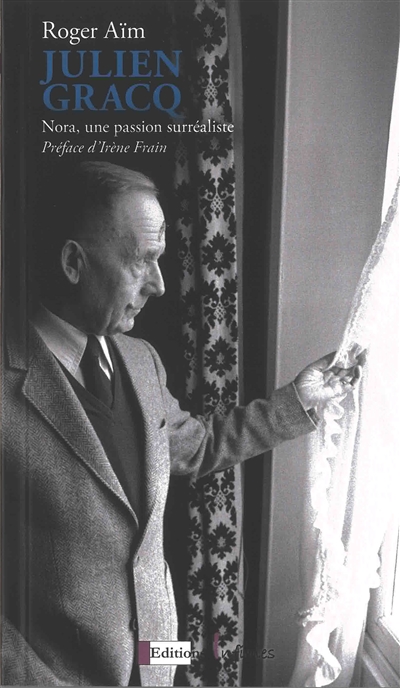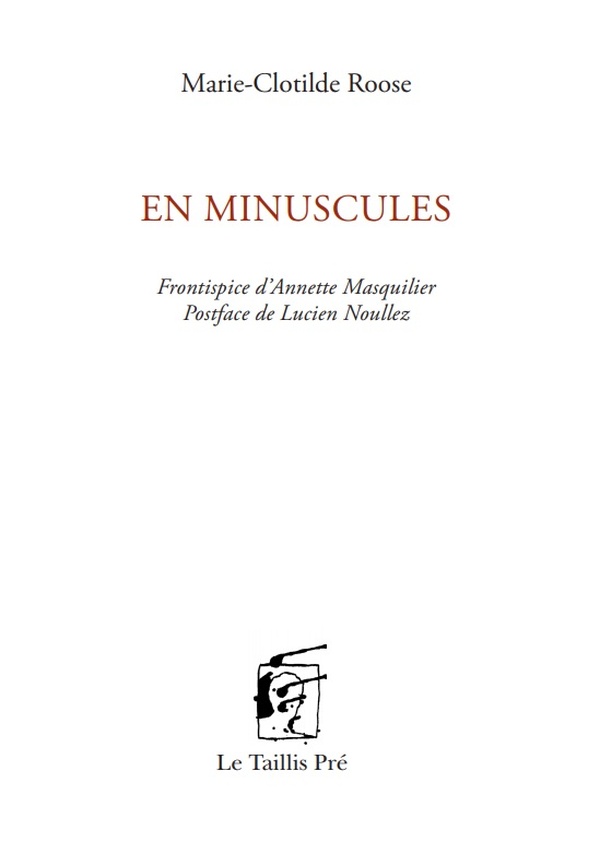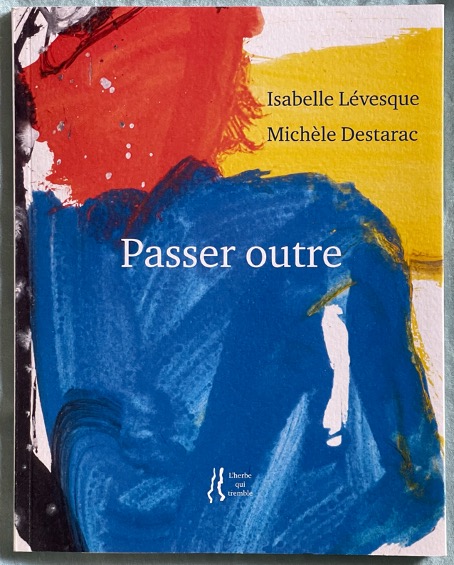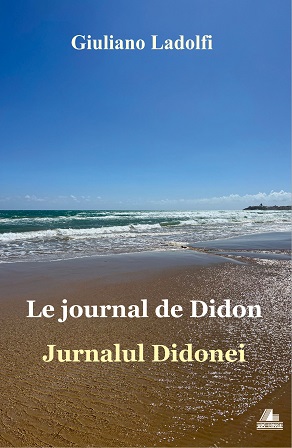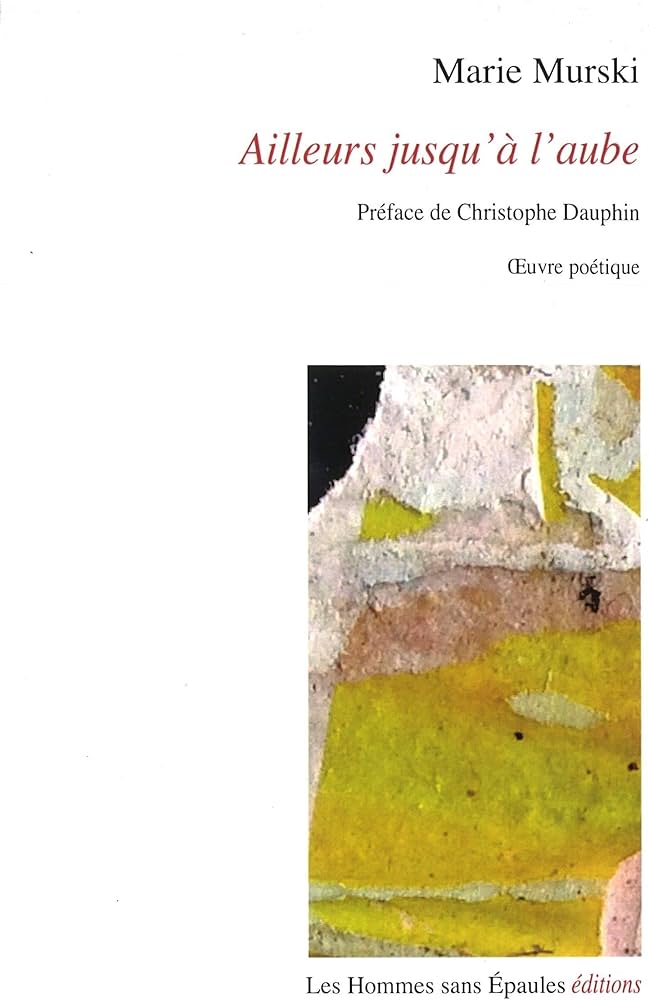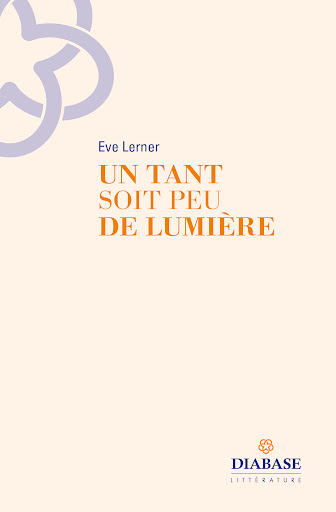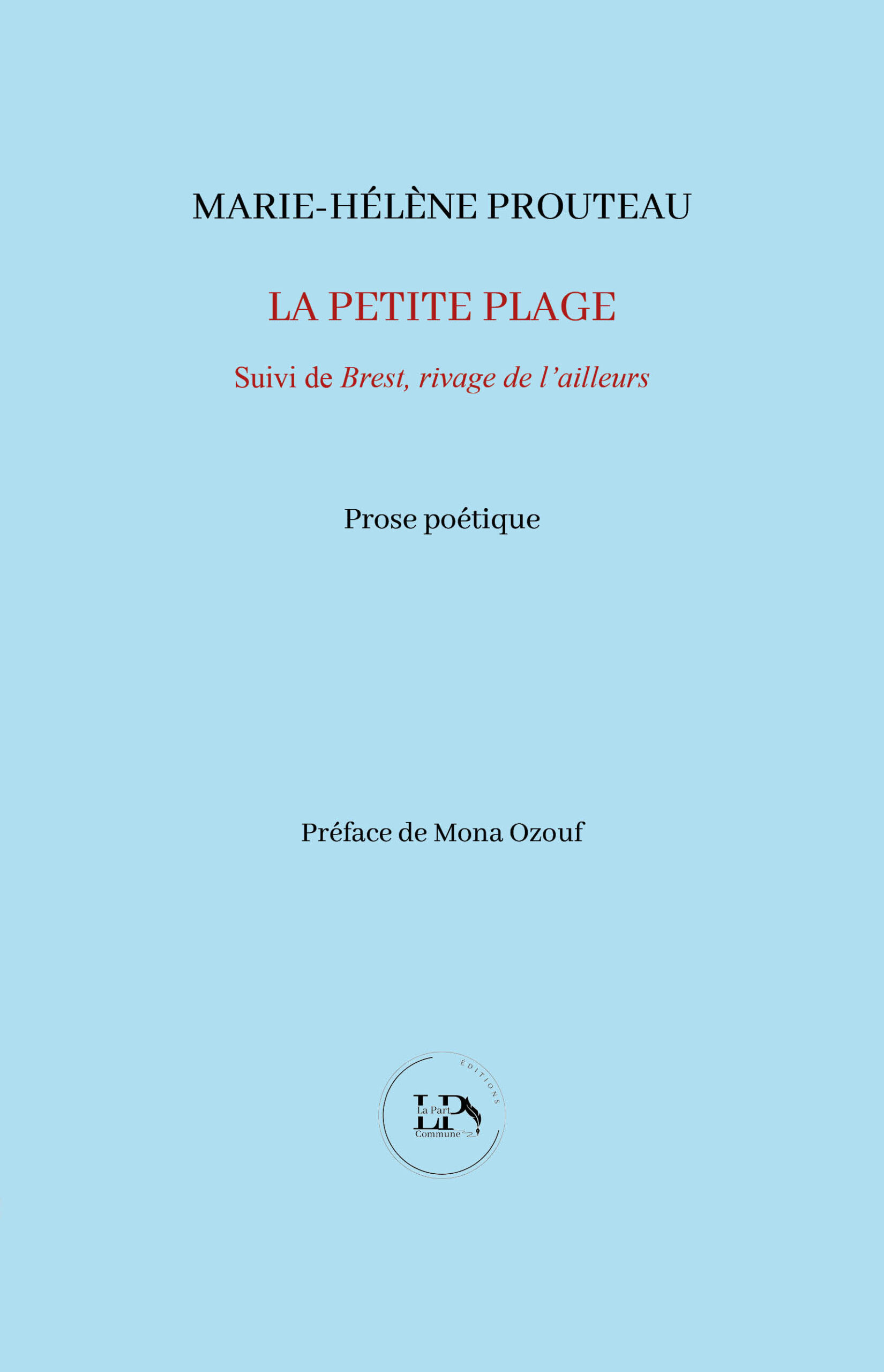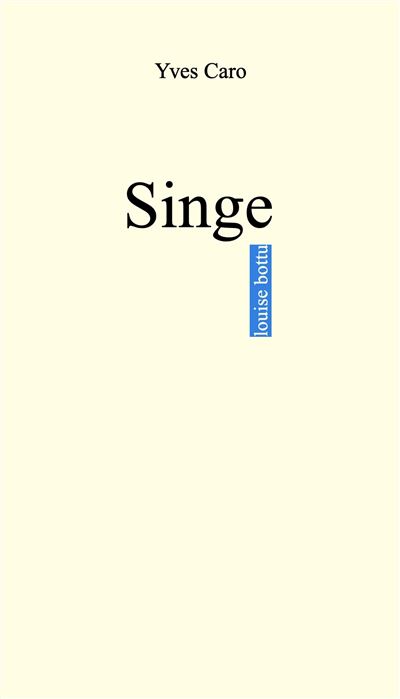Pénétrer par mégarde dans l’œuvre poétique d’Esther Tellermann peut présenter un risque conjugué à l’instance d’une violation « non autorisée » de l’ensemble des procédés qui habitent cette œuvre rare et pour le moins déterminée. Née le 28 juin 1947 à Paris, normalienne, agrégée de lettres, mais également psychanalyste, profession qui n’a rien d’anodin ; auteur d’une trentaine d’ouvrages, Grand Prix de poésie de l’Académie Française en 1996, et Prix Max Jacob en 2016 – au-delà de l’aspect purement biographique, dont la pudeur s’avère certaine, il y a chez elle, une complexité de tous les instants dont le langage est en quelque sorte le soubassement intime.
Une intimité inavouée cela va de soi, presque refoulée dans les profondeurs de l’indicible comme si la vie de l’auteur avait imprimé par inadvertance, une frontière entre ce qui peut être dit, et ce qui jamais ne peut l’être ; à défaut d’une confrontation profonde entre le MOI de la réalité quotidienne (au fil des années) et l’expérience d’une déflagration intérieure qui en constituerait l’ossature, cependant tue. Et à condition toutefois que cette déflagration soit à un moment donné partiellement révélée et que l’ossature elle-même conduise à l’édification d’un langage nouveau au sein d’une sphère cognitive plus perceptible. Certes en lisant Esther Tellermann, on songe souvent à l’empreinte non dissimulée d’André Du Bouchet, ou de Paul Celan. Verticalité structurelle autant qu’économie des mots qui n’ont rien ici de parallèle, plutôt écrire que la verticalité même, la précision des termes, renvoient à une essence d’ordre symbolique juxtaposant des épisodes distincts d’une mémoire se cherchant au-delà du factice ou de l’artificiel.
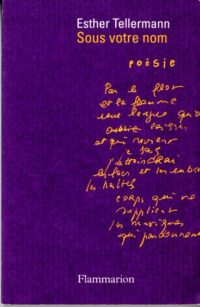
Esther Tellermann, Sous votre nom, 256 pages,
18 euros, Editions Flammarion, 2015.
Un mot encore
fut notre temps
et nous étions
pourtant les écorces
au-dessus et en
dessous.
Dans les métamorphoses
et les césures
à rebours
des peuples muets
inscrivions
dans les craies
le rythme des
royaumes.
Aujourd’hui vint
Un son de cordes
Sur les 3 univers.
Derrière tes doigts
je vis monter
la fugue
valses lentes
transfigurent
la douleur.(Sous votre nom. Editions Flammarion. 2015)
Et de ce point de vue, et c’est là tout l’intérêt de cette poésie qui n’a rien de didactique ; ses aspects originels, dont il faut là encore aller chercher le sens, relève à bien des égards de ce que je qualifierais d’érosion mentale. Erosion mémorielle, mais aussi érosion sémantique dont les contours linguistiques définissent une toute autre appréhension du SUJET, vécu comme un ajout supplémentaire à la quête. Le sujet en effet n’est pas la quête elle-même, il n’en est que le complément indirect qui s’est perdu quelque part dans la mémoire du silence, que l’auteur ne cesse de malmener au fur et à mesure de son avancée dans sa propre obscurité. Le rythme des royaumes devient ainsi une échappatoire à l’informulé où le temps s’est arrêté au sein d’une contrée passagère. Les époques, ainsi, se succèdent-elles aux prises avec (sous) le joug du langage forcé – raboté – et qui n’est pas ici un simple exercice conventionnel, mais plus encore – affairant au rythme des nécessités – dès lors que « sous le nom » puisse apparaitre un « autre nom » qui ne soit pas précisément celui de l’écrivant. Peut-on alors parler de négation du sujet ? Certes non ! Le sujet demeure bien au coeur du débat, comme une ultime condition, où bien que L’OBJET de la quête, insuffisamment promu conduise à faire surgir une simple métaphore, parabole syntaxique de l’inconscient « vaincu » (déshabillé) à force de patience et de souffrance. Il n’est pas certain cependant que l’auteur au travers ses nombreux ouvrages ait souhaité prendre un risque supplémentaire au –jeu d’écriture – en jouant sur des variations déjà connues (verticalité, horizontalité) mais plus justement en intimisant – le jeu des profondeurs -, à la manière d’un « coup de dé » dont les voyages seraient le seul réceptacle avoué. Fuir alors ? Une fois de plus restons prudent sur le sens à donner à la presque évidence, car finalement elle n’en est pas une. Ce qui est donné à lire, n’est pas forcément ce qu’il faut comprendre d’emblée. Il faut aller chercher ailleurs, dans l’ailleurs insatiable, une pensée plus souterraine en phase avec ses multiples réalités. A cet égard Freud reste impuissant, il n’est pas le meilleur recours à l’explication des schèmes existants et volontairement visibles, ceux-là ne lui ressemblent pas. Lacan peut-être ?
Dans l’épaisseur qui rejoint
le trait enfoui
longtemps tu fis
surgir du lieu
grand ouvert
espace entre
la syllabe défont
les brûlures de
la chaux coulées tout à coup chassent
l’aigu de la
parole en amont
de l’érosion.
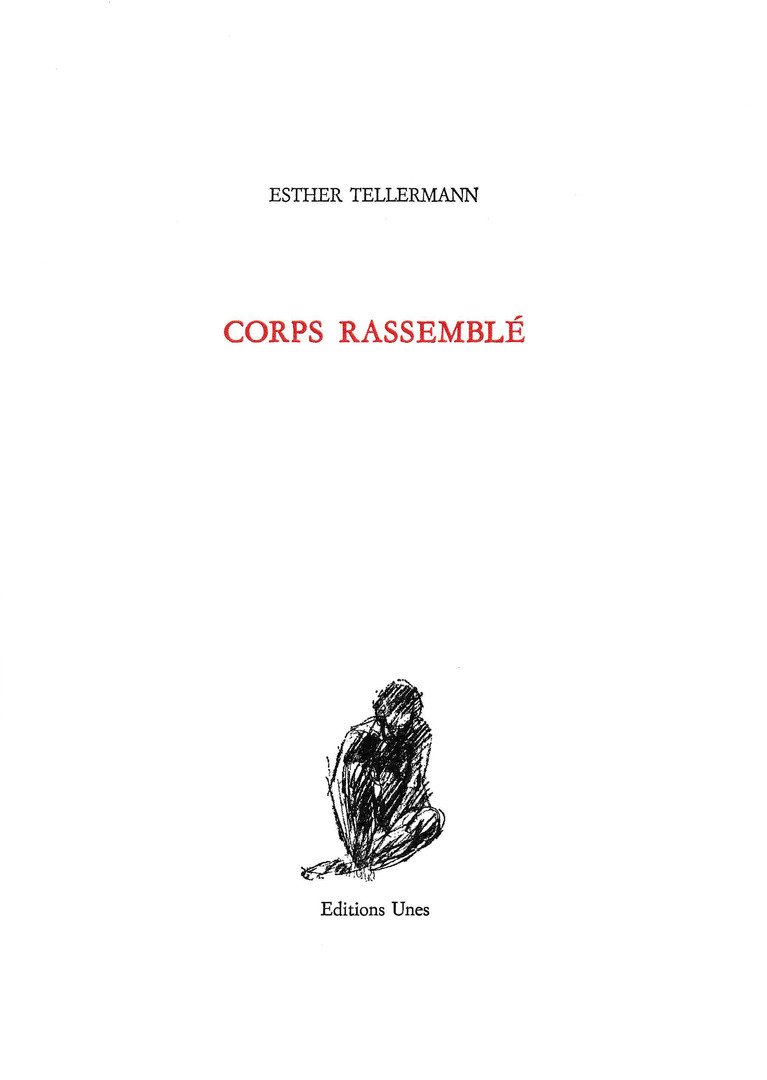
Esther Tellermann, Corps rassemblé, 128 pages, 21 euros, Editions Unes, 2020.
Et puis plus loin encore, entre ouverture au monde et surgissement de l’instant, l‘altérité en profondeur regagnant le vide, tout en comblant les marges d’un trop plein brûlant – l’espace n’y est pour rien ; c’est la syllabe qui commande à la « ré-flexion » (réfection), comblant les limites en amont ou bien encore au-delà des frontières verbales, il existe de fait, de nombreuses pistes à suivre et à explorer qui ne soient pas seulement « le regard de l’habitude », mais aussi et plus certainement la tentative de sortir de l’interrogation abyssale – celle là même qui ne dit plus rien, hormis la hantise de son émergence et de sa vacuité dans le règne de l’humain. Et toute la difficulté consiste alors pour le lecteur patient, de trouver un pont viable, entre « ce qui EST, et ce qu’il y PARAIT » et ce sans se brûler précisément les ailes : La chaux coulées tout à coup… comme un ultime rempart perceptible entré le dit et le non-dit fécond.
Voix voix
dans la marge qui
se dérobe
aura sur
je ne respire tu
soulignes
l’écorchure
glaciers entre les matières confondues
un même mot noyé
dans la couleur
qui se disperse
chaque fois plusretenue
(Carnets à bruire. Europe. Juin-Juillet 2011. n° 986–987. Editions La Lettre volée, 2014)
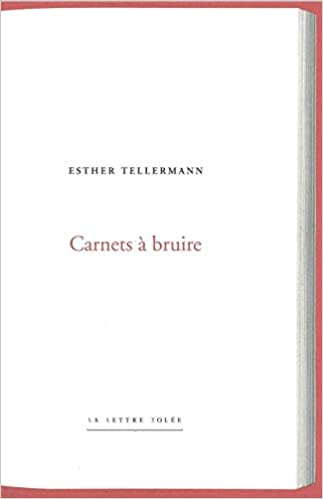
Esther Tellermann, Carnets à Bruire, 104 pages, 17 euros, La Lettre volée, 2014.
D’ailleurs, dans son dernier ouvrage intitulé « Corps rassemblé », au singulier, Esther Tellermann rentre en quelque sorte dans le vif du sujet, mais cette-fois au travers de l’œuvre de Claude Garache, artiste-peintre, né le 20 janvier 1930 à Paris, et où il fréquenta les ateliers de Fernand Léger et André Lhote avant de devenir ami avec Alberti Giacometti qui rappelons-le était proche d’André Du Bouchet. Aussi il n’est pas innocent, que la poétesse se soit penchée sur cette œuvre plastique au « pouvoir certain » » comme l’écrira Raoul Ubac. « Corps rouges, estompés, rappelant la couleur du sang – comme un suaire inachevé, toujours en extension. Féminité hachée et toujours en trompe l’œil – l’empreinte des corps, malmenés, torturés ». On imagine alors qu’Esther Tellermann n’ait guère eu de difficulté à s’immerger intégralement au sein de cette plasticité peu commune. Car si les images jamais ne remplacent vraiment les mots, on peut supposer qu’il existe un apport profitable à ces deux disciplines (art et poésie), sans que l’une ou l’autre ne soit oblitérée dans leur substance même, comme en témoigne le style utilisé par l’auteur. Un long poème qui n’en finit pas de se mouvoir à l’intérieur et à l’extérieur de lui-même, sans cesse se cherchant et sans cesse se fuyant, mais plus encore (se) martelant de manière elliptique, « dans un grand espace blanc » où les limites ne sont pas encore connues, invitant à la fugue silencieuse et au temps renversé – en chute libre – « Il est impossible de percer certains secrets malgré un nombre incalculable d’enquêtes, on est simplement frappé par l’étroitesse des circonstances. »
Puis je revins
dans le cadre
vous laisse
peindre
un présent
corrompu par
l’odeur des aisselles
des sueurs âcres
Ariane
j’avais rapporté
ta douleur
et ton poids
- Lire Baudelaire - 22 septembre 2023
- Mylène Besson - 6 juin 2023
- A propos d’Yves Bonnefoy : entretien avec Jérôme Thélot - 5 mai 2023
- Amir Parsa, Littéramûndi - 29 avril 2023
- La liberté d’expression ou la liberté avant tout ! - 21 février 2023
- Dominique Sampiero reconvertit l’espace intime de la dissidence ! - 5 février 2023
- Gabrielle Althen, La fête invisible - 5 mars 2022
- Anthologie mondiale de la poésie… - 20 février 2022
- Carole Marcillo Mesrobian, De Nihilo Nihil ou la simulation des origines…. - 6 février 2022
- ESTHER TELLERMANN : Divine prophétie ! Ou l’essence de l’indicible ! - 24 janvier 2022
- Jacques Ancet, Perdre les traces - 3 janvier 2022
- Pierre Rosanvallon, Les Epreuves de la vie, Comprendre autrement les français - 5 décembre 2021
- Carole Carcillo Mesrobian, nihIL - 21 novembre 2021
- Marc Alyn, L’Etat naissant - 6 octobre 2021
- Thierry Radière, Entre midi et minuit - 6 juin 2021