Étienne Faure, 7 remarques sur Tête en bas et une causerie avec l’auteur
«… car il avait l’impression qu’il se cachait, par extraordinaire,
quelque part un mot juste. »
Samuel Beckett
1. à Tharros où le vent se lève
Je commence à la page que je préfère. Chance, c’en est une qui se termine bien (encore que). Certainement Étienne Faure n’use guère de happy end. Tête en bas, oui, mais vu d’en-dessous. Ça n’empêche pas de voyager. Par avion, dans les escaliers de l’amour, et même, dans le passé. Ça ne mange pas de pain / les souvenirs : derniers mots du livre. Un grand-père mort à la guerre – peut-être. L’autobiographie non plus n’est pas le premier souci de l’auteur, même si (à ma connaissance) il n’avait jamais jusque-là employé la première personne du singulier.
En quatre ou cinq occurrences : il ne faut pas exagérer. Et la deuxième personne, un peu moins : Tous les vêtements que tu portas, la mémoire / depuis l’enfance n’en peut mais… Fausses pistes ? Qu’importe. On se laisse entraîner. Les poèmes s’imposent, un à un, et d’abord dans l’ordre, choisi, où l’auteur les a disposés, par la précision de ce qu’ils décrivent, par cette attention minutieuse, réjouissante, à la matérialité des choses, au réel et au réel encore (dont le rêve, le souvenir font partie) : le plus souvent en une seule phrase dessinée d’un trait, on dirait même lancée, avec des brisures de rythme pour arrêter, dérouter le regard, un instant suspendre la respiration ; et le lecteur revient deux lignes plus haut et recommence, parce que, ah oui, cela chante. Le vent se lève avec la pluie dans les ruines d’un temple antique. Il y a là quelque chose de nervalien, me disais-je. Je me trompe peut-être. Pourquoi des références ? C’est qu’on n’est pas seul, quand on écrit : les autres écrivains sont là aussi. On écrit pour être une part de la conversation. Un passage de relais. (…) sans répit ni repos, / des blocs de lave refroidie / assombris sous la pluie font leur âge, / où les piliers pâles, détachés tout à l’heure / impunément dans le bleu fixe, / lèvent à présent au ciel comme au soleil / punique leur ossature, rappels / de bras tendus, geste ancien que le vent / érode.
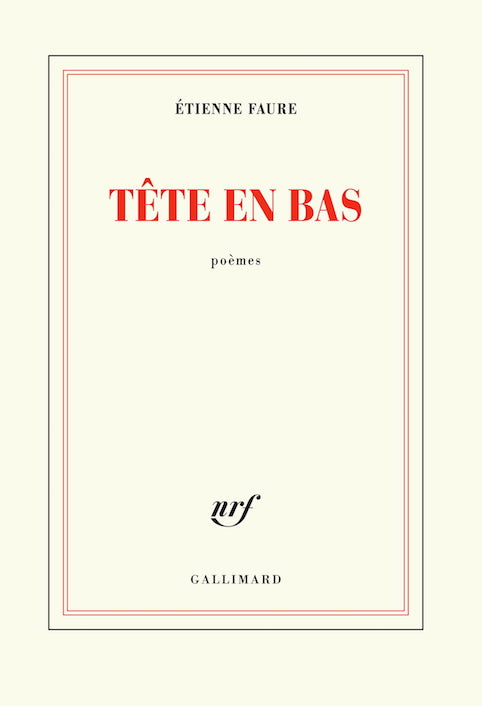
Etienne Faure, Tête en bas, Gallimard, NRF, Paris.
2. extrait séculaire des blés
Étienne Faure aime à ordonner ses textes en ce qu’il appelle des ensembles, bien sûr ouverts à une lecture transversale. On pourrait désigner le thème du sol – ce qu’il y a là, sous nos pas, sous nos yeux, à ras de terre – comme un fil conducteur : à commencer par un ouvrage entier, Horizon du sol (2011), tous ses livres disent un attachement aux lieux, à la géographie et à l’histoire des lieux ; l’endroit où l’on se trouve plutôt que celui d’où l’on vient ; un attachement qu’on pourrait dire sans attaches, sans liens ; d’ailleurs tranchés, les liens, en maint poème, par un humour féroce. Ici c’est la quatrième partie qui s’intitule Travail du sol, où se côtoient les dieux de la Grèce, poly et monothéisme réunis (et désunis) dans le vent du soir qui tombe entre les troncs tors (le poète écrit : maniérisme) des oliviers dans le texte qui donne son titre à l’ensemble ; tandis qu’un peu plus loin, terre inculquée s’achève (logiquement) presque en chanson à boire. Ancestral, ancestral, on ne sait dire que ça, écrit Étienne Faure, avant de revenir à un passé plus proche – un petit siècle ; la moitié ; vingt ans, dix ; hier… – mais qui semble lui tenir à cœur. Un passé toujours pas passé, marqué par le fatalisme de la mélancolie dans cet extrait séculaire des blés, estival, bucolique… n’étaient, soudain, l’ombre des corbeaux, épitaphes du soir, et cette rime, deux lignes plus bas, effraie - ivraie, qui glace le sang. C’est qu’on n’est jamais loin des lieux et des souvenirs de la boucherie de 14-18 : (…) c’est la guerre, et tout ce qui fuit avec, / jeune homme, le heurt des verres, des assiettes, / le fracas émietté des cuisines / aussitôt balayé par l’histoire… Tête en bas, oui, au ras du sol, de la vie de tous les jours, des objets quotidiens, du dépotoir ; et avec le sourire, ne vous déplaise, la tache de vin sur l’inusable carreau vichy en prélude à la chute, sarcastique, de « la terre ne ment pas » (paysage arrière).
3. le ciel en hâte
Bien des poèmes d’Étienne Faure mettent en scène, ou en joue, la « Belle Époque ». Il faudrait lui demander pourquoi il y revient si souvent. Pour mieux tenir à aujourd’hui exactement ? C’est rare, un poète (moderne) aussi concerné par l’histoire. Toute l’histoire. Du xvie siècle à la Grande Guerre, de l’Antiquité au 13 novembre 2015. On pense à Claude Simon, à Histoire de Claude Simon. Il a fait une drôle de tête, Étienne Faure, quand je lui ai dit ça. J’ai essayé d’argumenter (pas très sûr de ce que j’avançais) : les longues phrases foisonnnantes et précises de Claude Simon, les champs de déshonneur de l’Acacia et ceux, plus anciens, deux siècles, ce sont les mêmes, des Géorgiques, j’avais bien cru les reconnaître du fond des aquarelles de Bagetti, où le regard, loin de se perdre, s’affine dans la brume de la bataille lointaine, avec ses fantassins en miniature et sans doute à la loupe / exécutés ; et Stendhal qui promène son miroir embué sur le bord de la route. La sensation de perte, abrupte, inéluctable, se renforce dans le poème suivant, noir figé, où le temps se brise net : (…) la mort me prit au bord du ruisseau / il n’y a pas deux heures, deux cents ans, cela / alla si vite – quel foin dans le crâne.

En effet. La mort à la guerre inscrite, écrite dans le paysage, dans le récit du paysage. Le Dormeur du val bien sûr, et Simon : même attention inlassable, amusée parfois, à ce qui a eu lieu, et aux lieux où cela a eu lieu ; l’accueil, et la (tentative de) restitution, description, le mieux possible, de l’embrasement de l’histoire, et donc, aussi, et à la fois, des histoires, privées, les nôtres, avec leurs filiations étranges, souvent comiques. Les Années folles, mais elles le sont toutes, et c’est encore une fois l’humour qui les sauve, comme dans un film muet, au dernier vers, un dimanche au bordel, hein chéri, / ça s’éteint tout seul.
4. allégories
Un seul poème excède une page, il s’appelle extinction de voix, et l’on se dit qu’il était impossible d’épurer, que ce qui devait être écrit était trop impérieux pour ne pas laisser de côté, là plus encore qu’ailleurs, toute maîtrise ou virtuosité pour seulement faire affleurer la brûlure du souvenir et celle de la poésie. Mais peut-être ne s’agit-il que de deux textes qui se suivent et que sépare un interligne ; dans une autre page, quatre vers ont été isolés, qui forment strophe : La mémoire est un sac où les objets les plus fins / se glissent, resurgis tardivement / – le feu, la lettre ou le mouchoir – / oubliés, retrouvés familiers… Oui, la mémoire est sans fond comme un sac de femme et ce poème fait écho à quelques autres, dans ce recueil, de mélancolie amoureuse, pardon si je m’égare. On appelle aussi un sac fourre-tout, et la mémoire, pour la retrouver ne faut-il pas l’écrire ? Même et peut-être surtout si on ne récolte que des fragments, poèmes en forme de ce que j’ai entendu un jour leur auteur comparer à des fenêtres, ou des tableaux, signés au pied en italiques. Toute la sixième partie du livre, ordonnée en deux sous-ensembles où les poèmes se dévoilent comme des tableaux dans une promenade au musée (sans audioguide, s’il vous plaît) nous fait entrer En peinture, et il n’est pas étonnant que Goya, puis Rebeyrolle soient convoqués. Encore une affaire de sac : l’espoir luit comme une paire de pompes / jaunes… Sans parler du Poète à la tête renversée de Chagall, qui nous regarde pour de bon tête en bas. Mais il me semble que c’est dans ces deux textes qui se font face, page paire et impaire (laquelle appelait-on « belle page » ?), vétusté / restauration, que le poète prend le plus de risques, et dit le plus (sur l’art, la manière de le voir ; le sien, et celui des autres). J’avoue ma préférence pour le premier, le poème-tableau avec les blancs. Non restauré. Mais en irait-il ainsi si je n’avais pas lu l’autre tout de suite après ? Et puis tournant la page, que se passe-t-il ? On est encore dans la peinture ? dans l’art ? (…) c’est ici / qu’on hésite en passant près du corps étendu / dans la rue sans savoir si c’est un cadavre / ou bien l’allégorie de l’hiver à même l’asphalte, / doigts gourds, plus difficiles à représenter.
5. cœurs greffés
Les poètes lisent beaucoup, ils lisent les poètes, c’est bien le moins. Certes ils puisent à même la vie — l’art, la musique, la rue… — l’essentiel de leur inspiration ; mais enfin, si l’on veut écrire à son tour, ne faut-il pas avoir lu ses devanciers, histoire, au moins, de ne répéter ce qui a déjà été dit qu’en connaissance de cause ? (Il ne s’agit pas de vider sa bibliothèque. Certains ne font que ça.) Une parenthèse sur ce mot d’inspiration, naguère encore il pouvait passer pour suranné, sinon condamnable. Le soussigné peut-il risquer une anecdote personnelle ? Un soir de vernissage, à parler de la sorte, un collectionneur, un peu épais, m’assène que si l’on travaille, c’est avec le dictionnaire. J’ai envie de lui répondre (ce qui serait la bonne réponse) que le mot inspiration se trouve lui-même dans le dictionnaire et qu’il serait difficile de nier qu’un petit déclic, parfois… Au lieu de ça je lui rétorque Mais cher Monsieur, que faites-vous des Muses ? À notre amie peintre il parlera de moi comme d’un freluquet, jamais on ne me fit meilleur compliment. Étienne Faure (avec modération) aime à citer ses livres aimés (de longue date ou plus récemment découverts) au détour d’un vers, ou en épigraphe. Ne faut-il pas marquer des points de repère ? Une balise, un signe sur la carte ? Tête en bas s’ouvre sur deux citations, la première de Hannah Arendt, la seconde de Tchekhov, « … je voyais l’envers de la vie que l’on menait en ville ».

Marc Chagall (1887–1985), Étude pour Le Poète à
tête renversée, 1911Gouache, plume et encre sur papier,
27 x 21 cm
Une centaine de pages plus loin, prélude à la dernière partie du livre, Aux temps rassis (voyages anciens et modernes vers l’Est lointain), on lira quelques mots de Kurt Tucholsky qui vit ses livres brûlés par les nazis et préféra en finir tout de suite, dès 1935 ; et juste avant, dernier texte de l’ensemble précédent, Thoraciques, le dialogue d’Héloïse et Abélard. Est-ce parce qu’ils nous reviennent du douzième siècle que ces cœurs greffés sont le poème le plus poignant du recueil ? (…) encore palpitant / des émotions que tu me donnas, serré / près de toi quand je me demandais, amour, / par quel trépas passer… Bégaiement nécessaire. La deuxième personne l’est aussi, il s’agit d’un dialogue, dialogue d’amour, réel, imaginaire ? Un « vrai » souvenir, un souvenir de lecture, un rêve ? Cœur et cœur, cœur à cœur, et l’émotion greffée / comme ici celle de feu François Villon, à cœur fendre. Poursuivons, écrit Étienne Faure. Et Beckett avant lui : « Continuer ». Plus haut, c’est la lecture de Trakl qui accompagne la solitude d’hiver du mot allemand Allein, que le silence de la neige, la nuit, vient un instant soulager sur le blanc de la page.
6. Paris onze
Comment écrit-il, Étienne Faure, comme tout le monde sans doute, assis à une table, chez lui, au café, en promenade, couché sur son lit, ou chuchotant, inlassable, les vers sur ses lèvres comme Mandelstam. Mais en marchant, oui, et depuis longtemps, dans le onzième arrondissement de Paris, meurtri le 13 novembre 2015 mais toujours vivant, un jour ensoleillé que nous y déambulions on pouvait se féliciter de la permanence des terrasses de café bondées, animées, des rires et des sourires d’insouciance prouvant, si besoin était, la défaite des assassins ; non loin, me fit-il remarquer en passant, de la toujours présente (quoique désaffectée, semblait-il) « Clinique du rasoir électrique » de la rue de la Roquette. Parce que bien sûr les choses ont changé depuis le temps : (…) raconté hier / par un vieil enfant du quartier / pendant la guerre bringuebalé de piaule en piaule, / rue de Charonne, Basfroi, rue de la Roquette / puis de Charonne à nouveau, la peur / sous cape affleurant contre les capelines / passant du public au privé dans la cour intérieure / dénuée de vue… L’important, alors, c’est de sortir : de soi, de la chambre, de la rue, du pays, et de préférence sain et sauf, ayant réussi à conjurer l’idée de sortir encore plus vite directement par la fenêtre, quand l’évasion dans les images du papier peint ne suffit plus, voilà (aussi) ce que nous disent les Poèmes d’appartement, septième ensemble du recueil, onze textes, comme le Onzième ? (…) la mer, le large, / un ciel sans la moindre graphie, pas un nuage/ dans le crâne, juste l’été : à la fenêtre / on aperçoit la toile où se côtoient futur / et passé d’un bleu unique, sans l’ombre d’un sillage / hors les reflets, si ce sont des reflets à la fenêtre / de la chambre. C’est de là / que nous partions la nuit pour Londres, Venise, / sous un morceau de toit du Onzième, / enfuis dans le tic-tac peu à peu des ombres. Et partir où ? vers l’Est, assez souvent : en Allemagne avec le cubiste fragmentation d’un serveur berlinois qui ouvre la dernière partie du livre, dans le recueil précédent (Ciné-plage, 2016) en Pologne, en Bohême ; mais dans le monde entier aussi bien, et incidemment, me disait Étienne Faure lors de cette même remontée de la rue de la Roquette, pour entendre autour de soi une autre langue, et du coup se dépayser plus entièrement, retrouver un silence intérieur à l’écoute, attentive ou distraite, de mots inconnus.
7. H
Et chaque mot compte. Bien plus, chaque lettre : (…) tel le h dans le dahlia qui me tracasse, / entre le cueillir et le laisser sur place, au bord / de la vitre embuée par l’hiver de la chambre / me rappelant les prisonnières de Saint-Lazare / payées en monnaie de singe (du troc) / qui regardaient par les barreaux ce qu’il advient du ciel… Quelque chose à voir, envers et contre tout, contre l’ennui, la mort, le désespoir. Plus loin, un poème s’intitule, sobrement, H. Hôpital, silence. Mais il ne faut pas se taire, même et surtout quand la stupeur, la terreur nous figent, interdits, « bouche bée » : voici le O du regard excavé, / absent de l’extérieur, rien qu’en dedans / portant loin la vision ancienne / des mourants imminents, que le regard du poète distinge dans les tableaux de Goya. Mais c’est finalement, dans le même poème lui aussi au titre d’une seule lettre, O, la tendresse et l’amour qui surgissent, en dépit de tout et avec le sourire de l’ardeur, dans l’encoignure d’un cou nacré, / par le désir attisant l’attirance, / et la respiration le feu des yeux / perdus, éperdus, happés. Je suis un peu désolé de couper les poèmes, il faudrait les citer en entier, il faudrait citer le livre en entier. J’ai employé le mot de tendresse et je ne sais pas si Étienne Faure serait d’accord, pourtant je crois bien l’avoir trouvée en lisant ses poèmes et pas seulement entre les lignes, avec la douleur et le froid et la remémoration de la mort, celle d’inconnus et celle des amis (enterrement d’un ami, mains dans les poches). On peut même en éprouver, de la tendresse (et sans nostalgie, n’est-ce pas) pour nos vieux livres, qui, parfois, choient du rayonnage supérieur où la poussière les tenait alignés dans leur beau désordre silencieux, et nous tombent sur la tête. Alors (…) on les ramasse, / en relit quelques lignes, extraits de vie, / fulgurances, les adopte un temps / puis leur sens retombe, les mains les rangent / au plus haut, côté ciel, en réchappent / un dactyle, une fleur inhalée… Lettres d’amour recluses. La vie continue. Elle le mérite. Incipit de Tête en bas : « Vous êtes réveillé ».
21 juin 18, sous le Génie
La poésie peut coûter cher à ceux qui la font. Je lis dans le Monde de ce jour – daté vendredi 22 ; c’est l’été – que l’éditeur et auteur de poésie, et défenseur de la laïcité bangladais, Shahzahan Bachchu « a été abattu par balles le 11 juin ». Le journal n’en dit pas plus. Pourquoi ? Je me sens frère de ce Shahzahan Bachchu que je ne connaisssais pas, n’ai jamais lu, et ne lirai peut-être jamais. Peu importe. Peu importe ? On finit par en mourir de honte, de tout ce qui importe peu, et qu’on laisse passer.
Conversation de poètes, moins risquée, avec Étienne aujourd’hui dans le brouhaha – tonitruant – de la place de la Bastille. Autour de nous tout le monde regarde le foot, on est assis dos à la télé mais on comprend très bien quand les Français marquent un but. E., un rien provocateur (je découvre ça chez lui, ça me plaît bien) marque (crie) hautement sa désapprobation mais personne ne fait attention à nous. L’instant d’avant il me parlait d’une lecture récente, anthologie des poètes précieux. (Si je me souviens bien.) Étienne Jodelle… Un homonyme… Forêts, tourmente, et nuit, longue, orageuse et noire… Pas grand monde, en effet, ne fait attention aux poètes, précieux, pas précieux, c’est pareil, ou presque, et on est bien tranquilles (on ne vit pas au Bangladesh). Un à zéro, pas terrible. On se quitte métro St-Ambroise, ces conversations nous plaisent à tous les deux, poètes alors moins seuls. Est-ce parce que j’ai relu Bolaño récemment, mais cette idée qu’il défend, que des poètes (pas tous) se parlent, ont à se parler (de tout et de rien ; surtout pas de poésie ; ce ne sont pas des critiques ; ah mais, aussi de poésie après tout…) me rassérène. J’ai plaisir à rêver qu’à une troisième chaise de notre table en terrasse au milieu du foot et des préparatifs de la Fête de la musique s’est un temps glissée l’ombre amicale auprès de nous, de Shahzahan Bachchu dont la poésie que je ne connais pas tourne dans ma tête dans le wagon de métro du retour.