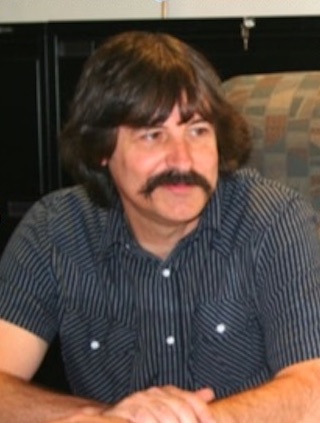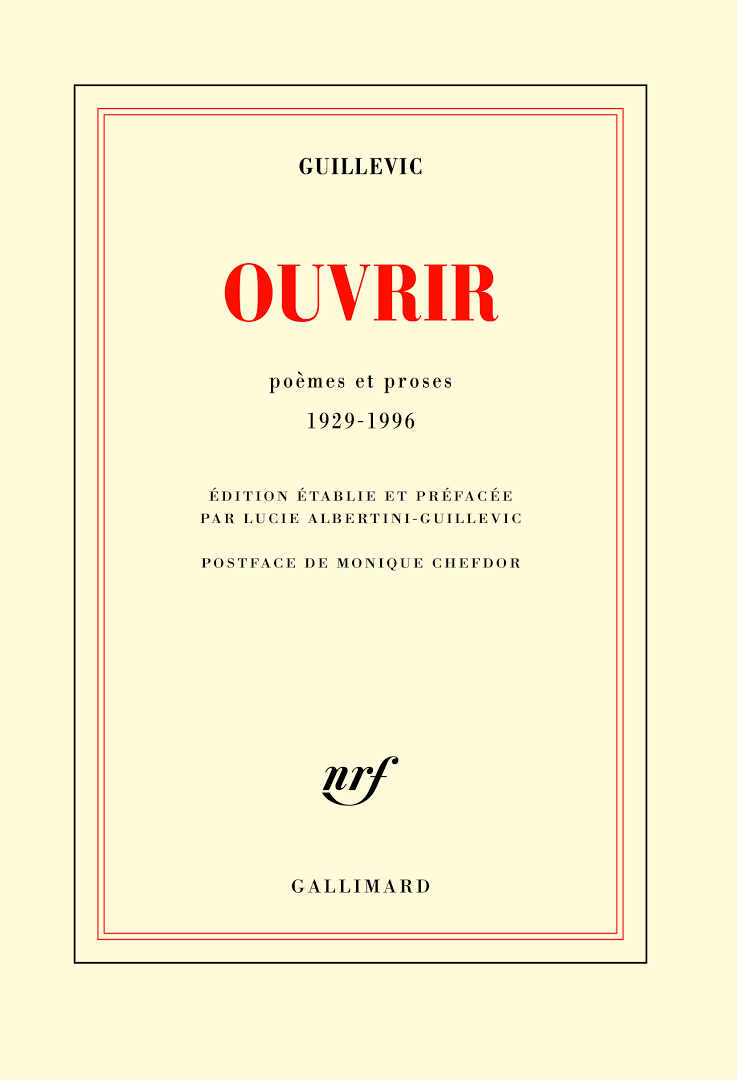Frédérick Tristan nous avait habitués à de longs romans : Les égarés (en 1983) ou Stéphanie Phanistée (en 1997), des livres qui rappelaient les grands romans russes du XIXème siècle finissant ou allemands de l’orée du XXème, ceux de Dostoïevski ou de Thomas Mann. Brèves de rêves – deux cents courts récits – propose un tout autre rythme, un autre espace-temps, mais la substantifique moelle demeure la même.
La frontière entre la veille et le sommeil s’est estompée, le réel et le songe cohabitent et nous perdons nos repères. Une parole d’André Breton placée en exergue donne le ton : « Fermez les yeux afin de les ouvrir ». On retrouvera Breton, plus loin. Et lorsqu’il n’apparaît pas franchement, il lui arrive d’être présent entre les lignes. Car l’état dans lequel se trouve la conscience du narrateur – l’auteur lui-même en fait, ou son double – cet état rappelle les expériences de Breton : l’écriture automatique notamment.
Le premier récit donne une petite idée du type de regard que l’on peut poser sur le monde, une fois les yeux fermés : un regard d’enfant. Parce que les enfants voient derrière le tableau noir une clairière, une forêt dans laquelle ils peuvent se réfugier. Leur instituteur, lui, n’y a pas accès. Le narrateur a su garder une âme d’enfant : il s’émerveille devant les papillons, entend des voix… Il lui arrive un bon nombre de choses improbables en fait. Il croise sa mère : telle qu’elle était il y a soixante ans, durant la guerre. Elle porte deux lourdes valises, un havresac et, sur la tête, en équilibre, une caissette en carton qui, je le sais, contient des albums enfantins que je lisais.
Qui connaît un peu l’auteur sait que cette vision-là est sans doute la sienne, son propre souvenir de l’exode. Quelques pages plus loin, il est question de la Meuse d’ailleurs. Un souvenir personnel là encore. Frédérick Tristan a vécu dans l’est de la France (il est né en 1931 à Sedan). Mais souvenir et conte – ou mythe – ne font qu’un chez lui. Œdipe et le loup du Chaperon rouge sont des membres de sa famille.
Dans cet univers, on fait des bonds vertigineux, le temps d’un battement de cils, d’une forêt au compartiment d’un train, d’une chambre à une salle de concert. L’ellipse est la règle. Elle se produit parfois au milieu d’une action, ce qui provoque une rupture, un déséquilibre. Toutes les caractéristiques du rêve sont réunies. Le rêve a sa logique propre, déroutante.
On croise à la fin d’un récit un chef d’orchestre qui n’est autre que K, l’homme de Prague. Kafka occupe sans aucun doute une place importante dans la filiation qui mène à Frédérick Tristan. Chez ce dernier, comme chez Kafka – dans Le Procès ou Le château notamment – l’absurde apparent permet souvent d’approcher et de dire la vérité. Et parfois de lancer, au passage, un coup de griffes. Aux éditeurs qui vendent des livres comme on vendrait de la viande par exemple.
Le rêve est aussi pure poésie. Les mots deviennent alors des images qui n’ont pas d’autre but que leur propre beauté.
Plus loin, en contrebas, c’est l’ultime marécage. N’y stagnent que des crapauds desséchés, des arbres calcinés, les vieilles amours aux doigts coupés. Je m’affûte grâce à l’instinct fol des spirales de l’orage.
Y a‑t-il un sens caché dans ces quelques lignes ? Il nous échappe. Mais on sait que quelque chose vient d’être dit qui a pour nous toute son importance. On ne se l’explique pas et on apprécie que cela ne soit pas clair.
Si le rêve est souvent obscur – il est question de noces qu’on n’a pas pu célébrer à cause d’un jardin en friche difficile à traverser – il lui arrive aussi d’être léger et joyeux. Madame Berthe rend visite au dormeur affublée d’une perruque faite de sucreries et de raisins confits. Elle semble sortie du Pays des Merveilles, pourrait être une amie du lapin blanc.
Ils sont nombreux ceux qui, dans ce livre, rendent visite au narrateur – à l’auteur. Frédérick Tristan est devenu une sorte de vaste demeure où les vieux amis vont et viennent, puis s’aventurent ailleurs sans plus se soucier de cet hôte qui leur a offert le gîte et le couvert.
Mes personnages s’échappent toujours. Ils profitent de la nuit et se sauvent à légers pas de renard. Ils veulent vivre leur vie comme ils l’entendent. Ont-ils deviné que c’est là mon plus vif désir ?
Mais lui aussi s’échappe sans arrêt.
Les gendarmes sont venus me visiter. Contrôle de routine. Ils veulent être certains que je suis bien là. « Il ne manquerait plus que vous nous jouiez la fille de l’air ! » Ils ignorent que, dès qu’ils auront le dos tourné, et sans même quitter mon chez-moi, je reprendrai mon voyage pour le Zambèze – en compagnie de la fille de l’air, justement.
Il s’invite chez Barbe-Bleue (et constate que ses sept épouses sont bien vivantes) ; il boit du champagne en compagnie de Picasso, Braque, Duchamp et quelques autres à la Coupole…
Il arrive que les fêtes virent au cauchemar, que les autres convives le tournent en dérision par exemple. Mais le plus souvent l’humour contrebalance l’angoisse.
À l’horizon de mes rêves éveillés se lèvent des soleils nouveaux, des lunes, des comètes, et même, si je n’y prends garde, des créatures étranges toutes pétries d’une matière plus noire que la nuit.
Tout le livre de Tristan est, me semble-t-il, dans cette phrase. Car chez lui lumières et ténèbres vont de concert et, avec elles, l’amour et l’aversion, la joie et la peine, la vie et la mort. Pas étonnant que ces courts récits fassent un grand livre. Chaque récit est l’une des pierres de la cathédrale.
Tristan évoque sa propre mort à la fin de son livre. Et il tente de rassurer les personnages qu’il n’a pas convoqués dans ses romans.
« Trop tard ! » disent-ils. Mais ils ont tort. Un autre les écrira.