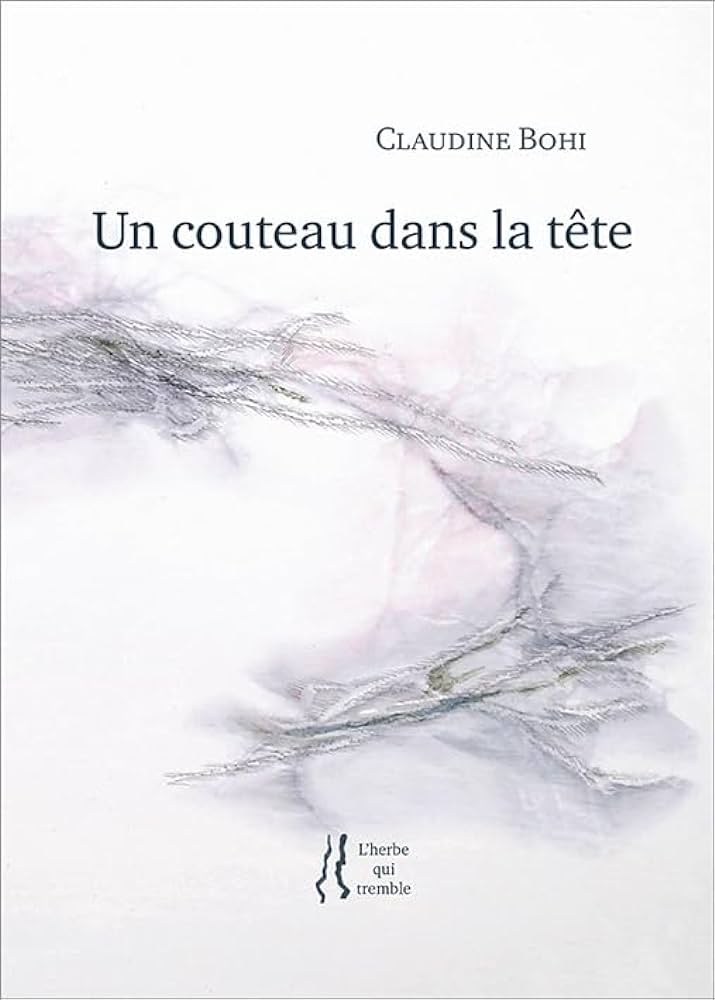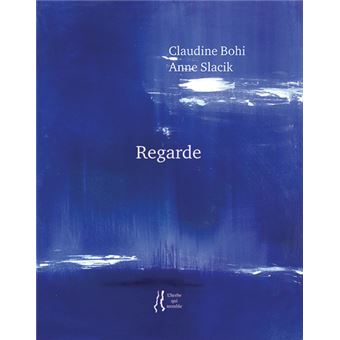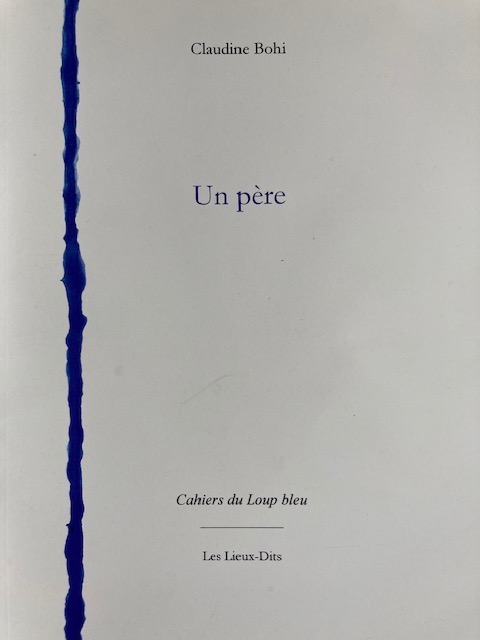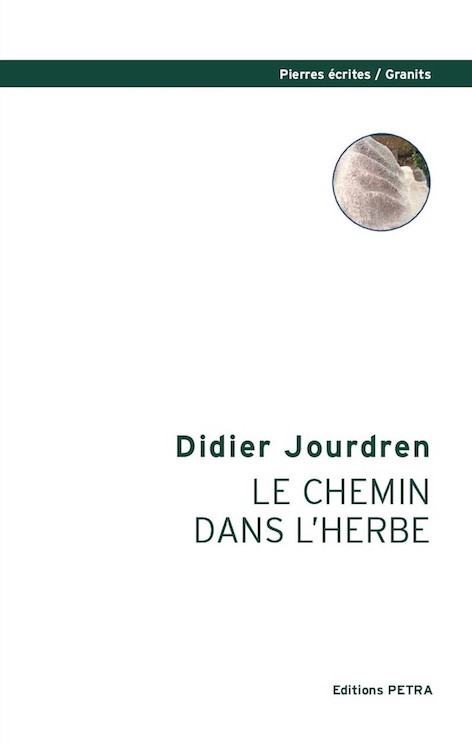Claudine BOHI : « Mettre au monde »
Il y a dans ce recueil comme une musique d’amour inconnu qui cherche son objet… Ce qui ne va pas sans obscurité car ce long poème, comme le dit le prière d’insérer joint au livre, lui-même ne va pas sans obscurité. Claudine Bohi écrit, mais elle doute de ce qu’elle cherche : « cette porte/fermée//qui n’a pas de clé » (p 13). D’où des tournures elliptiques, ces mots comme peut-être qui marquent le poème ; ce qui explique sans doute l’absence de majuscules et de points à la fin du vers et du poème.

Claudine Bohi, Mettre au monde. L’Herbe qui tremble éditions, 160 pages, 14 euros. Peintures d’Anne Slacik.
Chant d’amour car il s’agit de mettre au monde : et si l’objet de ce livre n’était que d’accoucher de ce livre ? Claudine Bohi maîtrise parfaitement l’art d’évoquer sans dire les choses directement : « dans le songe/de naître » écrit-elle (p 141). La polysémie, propre au langage poétique, a besoin d’être décodée. Le vers est bref, incisif même, souvent réduit à un seul mot ; « on bouge les mots » écrit-elle (p 28) ; sait-on jamais « là où ça commence », qui est le titre d’une des huit sections de l’ouvrage (p 33) ? Que penser de l’emploi bizarre de certains verbes comme « on t’obstine » (p 46), qu’est ce « disparu pas passé » (id) ? Claudine Bohi ne cesse de s’interroger « est-ce la chair/est-ce le mot » (p 35, mais il faudrait citer le poème dans sa totalité). Les mots changent même d’une lettre seulement : « rassembles/ressembles » p 47). Cependant, qui est ce tu qui apparaît page 39 ? L’autre moi du poète ? Ou qui d’autre ?
C’est la poésie, l’expression (car “peindre” revient souvent vers la fin du recueil), et si le but de ce livre n’était que de démêler le vrai du faux, de trouver les chemins de la création poétique ? Mais voilà que je me pose aussi des questions, et ce n’est pas par pur mimétisme ! C’est plus profond que cela ; je cherche à démêler « une pelote/de mots de chair de silence » (p 47). On se souvient alors que Claudine Bohi est psychanalyste et le lecteur se trouve, à son corps défendant, embarqué sur une piste de lecture relevant de cette discipline. La cinquième section du recueil intitulée Le lieu premier (pp 51–61) y invite. D’autant que le poème de la page 55 y pousse : « nous avançons (…)//vers ce visage en nous/qui n’a pas de nom//nous avançons vers ça ». Et les mots qui reviennent dans les poèmes suivants : chair, absence, lieu, sexe, corps, mots, langues … Mais, peut-être que je me trompe, que la solution à ce livre réside dans l’amour qui se chante ici (« cela réunit les deux bords/du trou/où tu tombes toujours/et chacun à son tour//pour resurgir unique/ensemble//c’est du rassemblé/tout ça », p 74, et je m’aperçois que j’ai cité tout le poème, de la suite suivante ! Cependant, dans la section qui vient après (et qui porte en titre Là où se noie) les adjectifs de couleur apparaissent : bleus, rouges, noirs, jaune, mauve… Que veulent alors dire ces deux vers : « une main se lève /elle est remplie de couleur » (p 89) ? Ou ces deux autres : « cette langue d’avant les mots/où tu me commences » (p 95) ?
Un livre qui résiste à la lecture, un livre de poèmes qui n’est pas donné, un livre qui ne laisse pas indiffèrent… Oui, quel est ce tu qui apparaît dans maints fragments ?
Yann DUPONT : « Fragilité(s) »
Christophe Chomant éditeur publie sous un format à italienne, comme nous y a habitués La Porte, la récente édition de Yann Dupont. Je ne sais pourquoi (ou je n’en connais que trop les raisons) mais j’ai l’impression, d’avoir déjà vu le poème liminaire dans une toile ou un dessin d’Edward Hopper, le peintre de la solitude… Yann Dupont est un poète de la solitude : « Quand une seule mouche/se cogne contre la vitre »… Un seul être vous manque et tout se repeuple grâce à une mouche ! Ailleurs, « le sang du périphérique coule dans ses veines » (p 10). Mais Yann Dupont ne se fait pas l’écho du seul Hopper, il se fait aussi l’écho d’un poète comme Guillaume Apollinaire « Sous le pont Mirabeau coule la Seine » : « Dans le regard de ce masque en plâtre coule la Seine » (p 12). Poésie savante, bourrée de références et de connivences !
« Un bas résille lui serre la gorge » (p 15) : Yann Dupont ne dit pas clairement les choses, il n’a pas une précision d’entomologiste ou d’enquêteur sur les lieux d’un crime, mais on devine qu’il y a eu meurtre. Plus loin, il récidive avec un poème : « Sans doute a‑t-il plu/Dans le cratère de sa peau jaunie/Mais rien ne ressuscitera /Ce qui lui avait plu » (p 24). Le poète n’oublie pas qu’il n’y a nul besoin qu’en poésie les choses soient dites nettement, et en plus il y a l’homophonie de la fin des vers 1 et 4. D’ailleurs Yann Dupont répète ce procédé dans le vers liminaire du poème — imprimé page 46 « Alanguie elle a la langue » mais c’est pour aboutir au désastre final « … le désir//Celui des hommes de son corps qui maintenant gît dans la brume rose des marécages ». On comprend alors mieux les vers finaux de la plaquette : « Et on se sent plus libres/Nos corps enfouis sous terre » ( p 56).

Yann Dupont : « Fragilité(s) ». Christophe Chomant éditeur, 68 pages, 13,50 euros.
Françoise LE BOUAR : « Le fouillis du ciel, de la terre et des eaux »
C’est une poésie pleine de sensibilité que donne à lire Françoise Le Bouar avec ce recueil, son premier livre de poésie, car elle était surtout connue jusque maintenant comme auteur d’études sur la littérature enfantine publiées essentiellement dans la revue Strenæ de l’Association Française de Recherches sur les Livres et les Objets Culturels de l’Enfance (AFRELOCE). Si Arz est une île du golfe du Morbihan, face à Vannes, le premier poème de Arz vient donner un sens éclairant au titre du recueil : fouillis de ciel, de terre et d’eau… Même le cimetière est dit avec beaucoup de délicatesse (p 20) : le rythme du poème se fait lent et attentif. Mais les aquarelles de Joseph Orsolini sont juste là pour souligner cette lenteur du temps qui passe sur le paysage de l’île, « accordé(e)/à la respiration des marées ». Il y a cependant trop de cascades de perles qui viennent caractériser les rires (p 27) mais ce n’est rien, sinon pas grand-chose, à côté du murmure/de ce qui vient (p 28) car Françoise Le Bouar a l’art de suggérer.
L’aquarelliste n’est pas oublié : un poème lui est même dédié (p 30). Mais Françoise Le Bouar s’intéresse aussi au passé : « c’était là le bassin/d’un très vieux jardin » (p 36) ou les mourants : « Supérieurs, les mourants/ont un œil/qui voit » (p 38). Françoise Le Bouar capte le peu de la vie ; elle célèbre le réel, elle s’en émerveille : elle révèle le monde et c’est bien un fouillis qui en émerge… La poète essaie d’y mettre un peu d’ordre, elle interroge ce semblant d’enfance chez l’adulte qu’elle est devenue.
Mais Françoise Le Bouar s’inquiète de son corps : « et mon corps/lointain vaguement humain » (p 49) ; il est vrai que c’est à l’occasion d’une convalescence (c’est du moins le titre de la suite de poèmes) ; l’état de faiblesse ( ? ) est prétexte à des poèmes comme décousus mais précis quand même. On remarquera la présence de qualificatifs ou de substantifs antagonistes : les choses-syllabes (p 58) permettent au lecteur de se repérer dans ces poèmes : le projet de Françoise Le Bouar est bien de nommer le réel… Même la pollution semble positive , le bord de la Marne est là pour le prouver (p 90).

Françoise Le Bouar : « Le Fouillis du ciel, de la terre et des eaux ». L’Herbe qui tremble, 100 pages, 14 euros. (En librairie ou sur commande via le catalogue).
Il me faut cependant confesser une gêne ressentie à la lecture ode ce recueil : c’est que je remarque un décalage entre le titre des ensembles de poèmes et le contenu ou le nombre de ces pièces de vers. Ainsi Arz, s’il parle bien de cette île ou de la commune parle aussi d’autres lieux (Petite suite ariégeoise, Entre Larnaca et Nicosie …) De même, Convalescence : douze poèmes comporte beaucoup plus que les annoncés (une quarantaine !) : il est vrai que je suis sans doute trop carré…
Didier JOURDREN : « Le chemin dans l’herbe »
Didier Jourdren est en particulier poète : il a publié, entre autres, deux recueils aux éditions Folle Avoine. Ceci pour expliquer que dans le texte passé en quatrième de couverture, il est noté que le poète poursuit sa quête à partir de rencontres fugitives. Et ça commence bien : Didier Jourdren donne raison à Jeanine Baude (qui a sans doute écrit cette présentation du livre de nouvelles), à savoir qu’il est à la recherche de ces sensations fugitives dont il ignore les noms botaniques (p 10) ! Et ce n’est pas pour rien que le mot fugitive revient de nombreuses fois. L’impression (auditive), cette fois, c’est le chant d’un rossignol que l’auteur ne reconnaît pas de prime abord. C’est écrit dans une prose lisse, aux circonvolutions multiples ; mais Didier Jourdren maîtrise parfaitement l’art de la chute puisqu’il nomme l’arbre vu au bas du talus dont il ignorait l’appellation au moment où il l’admirait : l’alisier torminal (p 20). Cela s’appelle poésie : « La poésie vient quand on ne sait plus rien, quand on ne peut plus parler » (p 25). Je n’ai jamais trouvé au cours de mes lectures de définition plus claire de cette chose étrange qu’on désigne sous le vocable de poésie et la place de la vie est bien « entre terre et ciel » (p 27).

Didier JOURDREN , Le chemin dans l’herbe. Editions Pétra, 152 pages, 15 euros. En librairie. Ou sur catalogue (adresse : https://www.editionspetra.fr/), onglet Les livres aux éditions Pétra, clic sur acheter suivant titre et nom de l’auteur, port gratuit.
Le troisième nouvelle, intitulée Une colline autre part, n’échappe pas à la règle. En fait, ce que dit Didier Jourdren c’est le peu de réalité du réel lui-même. Qu’on en juge : « Je ne cesse de quitter ma colline, je m’éloigne, elle me guide pourtant sans que je le voie, m’ouvrant des sentes inattendues. Au fond, je me détourne pas d’elle » (p 37) ou « Quelque chose là nous est propre, intime, au plus profond, au plus impalpable, tout à fait autre, nous dépossède en même temps, nous ouvrant à une autre manière d’habiter le monde » (p 38). C’est que Didier Jourdren ne cherche pas à « habiter le monde, comme je l’ai trop souvent rêvé, ne signifie pas un enracinement définitif, aussi précaire qu’illusoire, mais parvenir à cette appartenance un instant entrevue entre les deux bâtiments de ferme » (p 41). Qu’est alors cette « appartenance » ? Ce sont les choses (un toit, un menhir…) voire des des animaux (un rossignol…) que rencontre Didier Jourdren au cours de ses promenades. Mais c’est toujours la même attention empreinte de curiosité dont il tire une leçon. Il y a fraternité des hommes mêmes lointains dans le temps : « L’éternité a besoin de nous » (p 47), mais la fin de cette pierre approche car en proie aux outrages du temps. Les choses sont à l’image de l’être humain… Belle leçon de modestie. « Au fond, je ne sais rien de ce qui me touche » (p 67) avoue Didier Jourdren. C’est peut-être prétexte à interroger les mots (mis en italiques dans le texte)…
C’est le terme grâce qui vient à l’esprit quand on lit Didier Jourdren (et surtout L’Instant des pins) : « Pour dire en peu de mots ce qui a eu lieu : quelque chose en cet instant en moi a cédé » (p 79) ; il faudrait citer tout le paragraphe, pour saisir ce que ce mot de grâce signifie… Mais qu’est cette brisure ? « Comment vivre ? » (p 89). Accord au monde, acceptation tranquille, jamais l’expression « adéquation soudaine » n’a eu une telle évidence : « C’est vers ce très peu qu’il me faut aller » (p 90). Tout est alors dit, il ne faut pas grand-chose pour trouver le bonheur : un peu de légèreté dans l’air, cette adéquation au lieu, au moment. Quelle est la méthode involontaire pour susciter de telles approches fugitives ? La réponse est donnée à cette question page 97 au début de la nouvelle Dans l’émerveillement des fleurs : « Je ne sais pas ce que j’ai vu. Des fleurs sur le bord de la route, en passant, alors que le regard ne s’attachait à rien et l’esprit suivait des pensées fuyantes et décousues. Je ne les ai pas vues : aperçues tout au plus, à travers la vitre, au moment où elles disparaissaient mais ce si peu m’a d’un coup arraché à ma rêverie ». Ce qui n’empêche pas Didier Jourdren d’établir un parallèle entre la disparition de ces fleurs et celle (fantasmée) de la jeune femme qui lui fait face non loin de lui dans le bus…
Reste encore à s’interroger sur la nature de ce qui arrive à Didier Jourdren. Cette fois-ci, c’est l’exergue de l’avant-dernière nouvelle qui en donne les raisons : « quelque chose en nous est atteint, étonné, enflammé ». « Le plus modeste, le plus pauvre » affirme le nouvelliste (p 108). Cela relève de l’indicible : « Peut-on reconnaître sans reconnaître » s’interroge-t-il. Cela s’appellerait correspondance, fragment oublié, réminiscence, nostalgie ; quelqu’un précise Didier Jourdren (p 110). L’auteur n’arrête pas de se questionner pour mieux préciser. Ce qui vaut au lecteur une digression sur les cabanons au fond du jardin. Et digression dans la digression, ces cabanons de poésie (p 118). Et le dernier texte (intitulé Route des foins), nous amène à ces étendues de foin au bord des routes qui toujours (le) retiennent (p 125). Ce n’est pas simple témoignage pittoresque du passé ; c’est que, marchant, Didier Jourdren a la nostalgie de son enfance, d’un certain passé, de la vie… Entre autres choses !
- Le rôle de la documentation dans Les Communistes de Louis Aragon - 20 février 2022
- Julien Blaine, Carnets de voyages - 5 juillet 2021
- Eve Lerner, Partout et même dans les livres - 21 février 2021
- Revue Cabaret n° 29 et 30 - 5 janvier 2021
- Frédéric Tison, La Table d’attente - 5 janvier 2021
- Eve Lerner, Partout et même dans les livres - 6 octobre 2020
- Louis BERTHOLOM, Au milieu de tout - 6 juin 2020
- Christian Monginot, Après les jours, Véronique Wautier, Continuo, Fabien Abrassart, Si je t’oublie - 6 avril 2020
- Autour de Christine Girard, Louis Dubost et Jean-François Mathé - 6 mars 2020
- Stéphane Sangral, Des dalles posées sur rien, Pierre Dhainaut, Après - 26 février 2020
- Patrick LAUPIN, Le Rien qui précède - 21 janvier 2020
- Pierre Dhainaut, Transferts de souffles - 20 décembre 2019
- Jean MAISON, A‑Eden - 21 novembre 2019
- Jean ESPONDE, A la recherche de Lucy - 6 novembre 2019
- Edith Azam & Bernard Noël : Retours de langue - 14 octobre 2019
- Béatrice Libert, Battre l’immense - 25 septembre 2019
- Les Hommes Sans Epaules n° 47 (1° semestre 2019). - 15 septembre 2019
- Béatrice Marchal et Richard Rognet, Richard Jeffries, Olivier Domerg - 4 juin 2019
- Autour de Jean-Claude Leroy, Olivier Deschizeaux, Alain Breton - 29 mars 2019
- Fil autour de Claudine Bohi, Yann Dupont, Françoise Le Bouar, Didier Jourdren - 3 mars 2019
- François Xavier, Jean Grenier, Gilles Mentré - 3 janvier 2019
- Claire Audhuy, J’aurais préféré que nous fassions obscurité ensemble - 5 octobre 2018
- Trois écritures de femmes - 3 juin 2018
- Brigitte Gyr,Le vide notre demeure - 5 mai 2018
- Eugène Ostashevsky, Le Pirate Qui Ne Connaît Pas La Valeur De Pi - 5 mai 2018
- Actualité de La Rumeur Libre - 5 mai 2018
- Michel Dvorak, Vers le cœur lointain - 5 mai 2018
- Ainsi parlait THOREAU… - 6 avril 2018
- Nicolas VARGAS, EMOVERE - 6 avril 2018
- Patrice BÉGHAIN, Poètes à Lyon au 20e siècle - 6 avril 2018
- DIÉRÈSE n° 70 : Saluer la Beauté - 1 mars 2018
- Du Cloître à la Place publique - 1 mars 2018
- Serge Núñez Tolin La vie où vivre - 26 janvier 2018
- Jean-François Bory, Terminal Language - 26 janvier 2018
- Gérard Pfister, Ce que dit le Centaure - 26 janvier 2018
- Éric Chassefière, Le peu qui reste d’ici - 26 janvier 2018
- Éric Chassefière, La présence simple des choses - 26 janvier 2018
- Claude Albarède, Le Dehors Intime - 29 novembre 2017
- Stéphane Sangral, Circonvolutions - 27 novembre 2017
- Horia Badescu, Le poème va pieds nus - 27 novembre 2017
- Jeanpyer Poëls, Aïeul - 26 novembre 2017
- Alain Dantinne, Précis d’incertitude - 26 novembre 2017
- Gérard Bocholier, Les Étreintes Invisibles - 22 novembre 2017
- Marc Dugardin, Lettre en abyme - 19 octobre 2017
- Christian Viguié, Limites - 19 octobre 2017
- Geneviève Raphanel, Temps d’ici et de là-bas - 19 octobre 2017
- Eric Brogniet, Sahariennes suivi de Célébration de la lumière - 19 octobre 2017
- Laurent Albarracin, Cela - 7 octobre 2017
- Place de la Sorbonne n° 7 - 2 octobre 2017
- Chiendents n° 118, consacré à Marie-Josée CHRISTIEN - 30 septembre 2017
- Fil de lecture : autour des Éditions L’Herbe qui Tremble - 30 septembre 2017
- CHIENDENTS n° 109, consacré à Alain MARC. - 2 septembre 2017
- Fil de lecture autour d’Henri MESCHONNIC, de Rocio DURAN-BARBA, de Marianne WALTER et de Joyce LUSSU - 2 septembre 2017
- Tombeau de Jointure (100) - 31 mai 2017
- POSSIBLES, et INFINIE GÉO-LOCALISATION DU DOUTE n° 2 & 3 - 31 mai 2017
- La nouvelle poésie mexicaine - 24 mai 2017
- Fil de lecture de Lucien WASSELIN - 19 mai 2017
- Actualité éditoriale de Sylvestre Clancier - 30 avril 2017
- Un éditeur et ses auteurs : les Éditions Arfuyen, avec NOVALIS, Marie-Claire BANCQUART, Cécile A. HOLDBAN. - 24 avril 2017
- Diérèse 68 et 69 - 24 mars 2017
- Un éditeur et ses auteurs : L’HERBE QUI TREMBLE avec Isabelle Levesque, André Doms, Pierre Dhainaut, Horia Badescu, Christian Monginot. - 21 février 2017
- Fil de lecture autour de Michel DEGUY, Patricia COTTRON-DAUBIGNE, Serge PEY, Mathias LAIR, et David DUMORTIER - 25 janvier 2017
- Fil de lecture de Lucien WASSELIN : une éditeur et ses auteurs, LA PASSE DU VENT - 21 décembre 2016
- Rectificatif de Lucien Wasselin à propos d’une critique parue dans le numéro 168 : - 29 novembre 2016
- Fil de lecture de Lucien WASSELIN : Un éditeur et ses auteurs, les éditions ROUGERIE - 16 novembre 2016
- Anne MOSER & Jean-Louis BERNARD, Michèle DADOLLE & Chantal DUPUY-DUNIER - 30 octobre 2016
- Fils de Lecture de Lucien Wasselin : éditions des Deux Rives, J.POELS, A. HOLLAN, W.RENFER - 20 septembre 2016
- Fil de lecture de Lucien WASSELIN : ARFUYEN — SPIRITUALITÉ et POÉSIE. - 25 juin 2016
- Fil de Lecture de Lucien WASSELIN : sur Jeanine BAUDE - 15 mai 2016
- Fil de Lecture de Lucien WASSELIN - 3 avril 2016
- Questionnements politiques et poétiques 2 “Les Orphées du Danube” - 4 mars 2016
- FIL DE LECTURE de Lucien Wasselin : Baldacchino, Garnier, Grisel - 8 février 2016
- Fil de Lecture de Lucien Wasselin : Nouveautés de L’Herbe qui tremble - 7 janvier 2016
- Jacques VACHÉ : “Lettres de guerre, 1915–1918”. - 5 décembre 2015
- Eugène Durif : un essai provisoire ? - 1 décembre 2015
- Fil de lecture de Lucien Wasselin : Actualité des Hommes Sans Epaules Editions - 23 novembre 2015
- Fil de lecture de Lucien Wasselin : autour de la Belgique - 11 novembre 2015
- Fil de lecture de Lucien Wasselin : Le Castor Astral a quarante ans - 3 novembre 2015
- Phoenix n°18 - 3 novembre 2015
- Fil de Lecture de Lucien Wasselin : Luca/Pasolini/Siméon - 26 octobre 2015
- Pierre GARNIER : “Le Sable doux” - 26 octobre 2015
- Fil de Lecture de Lucien Wasselin sur : A.Costa Monteiro, G. Hons, C. Langlois, J. Roman - 8 octobre 2015
- INUITS DANS LA JUNGLE n° 6 - 21 septembre 2015
- Fil de lecture de L.Wasselin : Abeille, Althen, Walter - 14 septembre 2015
- Deux lectures de : Christophe Dauphin , Comme un cri d’os, Jacques Simonomis - 24 août 2015
- Fil de lectures de Marie Stoltz : Hennart, Laranco, Corbusier, Maxence, Bazy, Wasselin, Kijno - 11 juillet 2015
- Fil de lectures de Lucien Wasselin : Louis-Combet, Moulin et Loubert, Dunand, Marc, Audiberti - 5 juillet 2015
- Christian Monginot, Le miroir des solitudes - 22 juin 2015
- Jean Chatard, Clameurs du jour - 22 juin 2015
- Contre le simulacre. Enquête sur l’état de l’esprit poétique contemporain en France (3). Réponses de Lucien Wasselin - 21 juin 2015
- EUROPE n° 1033, dossier Claude Simon - 14 juin 2015
- Yves di Manno, Champs - 14 juin 2015
- Jeanpyer Poëls, Le sort est en jeu - 14 juin 2015
- Jean Dubuffet et Marcel Moreau, De l’art brut aux Beaux-Arts convulsifs, - 23 mai 2015
- Mathieu Bénézet, Premier crayon - 10 mai 2015
- ROGER DEXTRE ou L’EXPÉRIENCE POÉTIQUE - 10 mai 2015
- Jacques Pautard, Grand chœur vide des miroirs - 17 avril 2015
- Patrick Beurard-Valdoye, Gadjo-Migrandt - 29 mars 2015
- François Xavier, L’irréparable - 15 mars 2015
- Fernando Pessoa, Poèmes français - 1 mars 2015
- Paola Pigani, Indovina - 1 février 2015
- Michel Baglin, Dieu se moque des lèche-bottes - 1 février 2015
- Didier Guth & Sylvestre Clancier, Dans le noir & à travers les âges - 18 janvier 2015
- Jean-Baptiste Cabaud, Fleurs - 6 décembre 2014
- Sylvie Brès, Cœur troglodyte - 30 novembre 2014
- Sombre comme le temps, Emmanuel Moses - 16 novembre 2014
- Zéno Bianu, Visions de Bob Dylan - 9 novembre 2014
- Marwan Hoss, La Lumière du soir - 19 octobre 2014
- Michel Baglin, Loupés russes - 13 octobre 2014
- Abdellatif Laâbi, La Saison manquante - 13 octobre 2014
- Deux lectures de Max Alhau, Le temps au crible, par P. Leuckx et L. Wasselin - 30 septembre 2014
- Porfirio Mamani Macedo, Amour dans la parole - 30 septembre 2014
- Chroniques du ça et là n° 5 - 2 septembre 2014
- A contre-muraille, de Carole Carcillo Mesrobian - 25 mai 2014
- Hommage à Pierre Garnier - 6 février 2014
- Sous la robe des saisons de Philippe Mathy - 29 janvier 2014
- Sub Rosa de Muriel Verstichel - 20 janvier 2014
- Comment lire la poésie ? - 19 janvier 2014
- Au ressac, au ressaut de Roger Lesgards - 6 janvier 2014
- Sous la robe des saisons de Philippe Mathy - 31 décembre 2013
- L’instant des fantômes de Florence Valéro - 23 décembre 2013
- La proie des yeux de Joël-Claude Meffre - 27 novembre 2013
- Bestiaire minuscule de Jean-Claude Tardif - 19 novembre 2013
- Après le tremblement, de Jean Portante - 18 novembre 2013
- Aragon parle de Paul Eluard - 10 novembre 2013
- Facéties de Pierre Puttemans - 4 novembre 2013
- La tête dans un coquillage de Patrick Pérez-Sécheret - 26 octobre 2013
- À vol d’oiseaux, de Jacques Moulin - 22 octobre 2013
- Vaguedivague de Pablo Néruda - 16 octobre 2013
- Mare Nostrum - 4 octobre 2013
- Rudiments de lumière, de Pierre Dhainaut - 15 septembre 2013
- Et pendant ce temps-là, de Jean-Luc Steinmetz - 15 septembre 2013
- Mémoire de Chavée - 30 août 2013
- Marc Porcu, Ils ont deux ciels entre leurs mains - 12 août 2013
- La chemise de Pétrarque de Mathieu Bénézet - 12 août 2013
- NGC 224 de Ito Naga - 6 août 2013
- LES ILES RITSOS - 7 juillet 2013
- Les Sonnets de Shakespeare traduits par Darras - 30 juin 2013
- Séjour, là, de JL Massot - 7 juin 2013
- Archiviste du vent de P. Vincensini - 27 avril 2013
- Mots et chemins - 8 mars 2013
- Passager de l’incompris de R. Reutenauer - 2 mars 2013
- Tri, ce long tri - 15 février 2013