Fil de lecture autour de Marilyne Bertoncini, Denis Emorine et Jasna Samic
« Aeonde » ? Insolite, ce mot est entendu en rêve par Marilyne Bertoncini. Il n’est ni onde, ni songe, ni ombre, ni aérien, mais peut-être tout cela à la fois. Il incite la poétesse à nous introduire en son théâtre d’ombres révélatrices. L’opuscule se révèle à la façon d’un rébus dispersé entre les divers poèmes.
L’Aeonde est une muse- fantôme composite « errant dans les rues vides ». « L’âme » de la poétesse s’est couchée, tendre et triste, devant cet être spectral aux « ailes repliées ». La citation de Haendel placée en exergue (l’ode Alexander’s feast), rappelle que, pour plaire à une courtisane, le grand Alexandre a brûlé Persépolis. D’où l’interrogation sur les incendies secrets recélés dans le recueil.
La sensibilité aiguë de l’auteure se signale par le placement de nombreux adjectifs avant les substantifs auxquels ils se rapportent. Ils frappent ainsi le lecteur de plein fouet : « grenu grésil », « mercurielle floraison », « anciens désastres », « fatale semeuse », « stagnante lame », « sibyllin murmure », « vives arêtes », « opaque brume », « muet fracas ». Ce dernier reconstruit alors sa propre lecture : fatale-muet-mercurielle- opaque, etc… Autant de miroirs anciens étamés – en quelque sorte - par l’affliction. Ce jeu d’ombres et d’obscur est conforté par des mots dont le sens réel (« obombrée », « anuiter ») se mue parfois en figuré (« sibyllin »). Il en émerge un monde embruni, tout en grisaille. Les sons l’emportent et se répètent en harmonie : pluie de suie, tourbe et tourment, aile et houle, feuille et flamme, cendre et silence. Dans les jardins de la créatrice, un gibet, des repentirs, des mains coupées disent ensemble une détresse intime. Mort au vaincu, mort à toi. La clé de l’énigme est-elle là ?
*
Casanova et Louis II de Bavière ont été – jadis - ses inspirateurs. Le poète Denis Emorine, hanté par la durée, écrit des « mots qui font saigner le temps *». Il conçoit ce même temps tantôt « divisé », tantôt réduit à ses extrêmes que sont les « éphémérides » ou « l’éternité ».
Dans les profondeurs de son abîme se révèle un « labyrinthe » du coeur, dont le poète se veut « le meilleur guide ». Là, « s’étreignent » l’amour et la mort. Deux entités capitales. L’amour d’abord l’emporte de « l’autre côté du monde » grâce à la présence réconfortante des femmes. Si elles sont également inspiratrices, l’une émerge entre toutes – « Marina T. » – en deux poèmes. Il s’agit sans doute de la magnifique Tsvetaieva, cette danseuse de l’âme dont Le ciel brûle. Initiatrice « à la douleur infinie », cette poétesse lui fait reconnaître son appartenance ancestrale : « Je suis russe par ta poésie ». Certes, d’autres femmes sont présentes dans la douceur triste des mots parfois nommées (Anastasia, Anne-Virginie, etc.), parfois suggérées ou subreptices, mais toujours captatrices. La mort ensuite qui est le terme de vie : les « stylos » du poète se brisent alors ou un « couple enlacé se dresse contre la destruction du monde». Néanmoins cette disparition ne le tuera pas, il en restera ses poèmes, traces de soi. Traces inventives comme « accrocher quelques rides à la lune » .
Sans doute le créateur rêve d’immortalité, ce pourquoi il évoque en fin de son ouvrage une rencontre originelle avec Aimé Césaire (dont le contenu littéraire/poétique n’a malheureusement pas survécu dans sa mémoire). Au demeurant, sa présente Fertilité de l’abîme - oxymore ou ébauche dialectique - est également un écho décalé à Jachère des fertilités d’un autre poète Bernard Lefort**.
*Titre d’un recueil aux Editions du Cygne, 2009.
**Editions du Guetteur, 2000
*
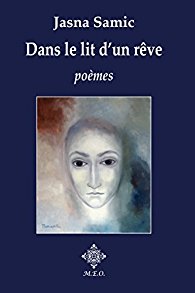
Oui, la Bosnie et la Croatie sont des espaces culturels d’où émergent des voix singulières, littéraires ou poétiques. Celle de Jasma Samic est l’une d’elles. Rebelle, cette poétesse bosniaque a su dénoncer le port du hidjab et les dérives islamistes. Narquoise et provocatrice, elle a osé terminer une conférence littéraire par un fougueux « Baudelaire a’ahbar » ! La fatwa islamiste qui pèse désormais sur elle impose de l’écouter autrement.
Jasma Samic se situe dans la pensée d’Omar Khayyâm, ce poète persan qui sollicitait le bonheur un instant, celui de notre vie. L’auteure qui fait ainsi de son « lit » un rêve (titre d’un des poèmes), cherche dans le réel - de New-York à Istanbul en passant par Paris - un monde à sa mesure. Dans notre monde où tant de livres risquent d’être réduits en « suie », elle marche « à travers la tristesse » et entend « les hurlements des morts » (Srebenica). Certaines villes traversées émergent tantôt hantées par leurs célèbres visiteurs (Agatha Christie et Loti à Istanbul), tantôt par leurs divinités (Ahura Mazda, dieu perse de la lumière, Dieu du Soleil ou d’ivresse, Isis et Ra à Gizeh) qui côtoient la Vierge, les Anges. Paris lui est plus qu’une simple escale : ici Saint-Germain-des-Prés, là le Lucernaire, ici le musée des Tuileries (sans doute du jeu de Paume), là le parc Georges Brassens dont l’âne tire une charrette fleurie, ici les puces de la Porte de Vanves, etc. Sa prédilection pour les quais de la Seine semble dire que le flux de l’eau (fleuve ou mer) lui est un apaisement. Elle convie ça et là des écrivains dans sa quête poétique (Osti, Tzvétaeva, Camus, Chateaubriand, etc.) en les mêlant à ses souvenirs personnels.
Cette errante estime que quel que soit le lieu où nous allions, « nous sommes des étrangers surtout dans notre ville natale ». Une vision politique de l’humain e qui prend sens avec les mouvements migratoires actuels ! Se plaçant dans la lignée soufie, elle s’entoure de divinités protectrices. Au demeurant, le poème lui est « une prière ».
*