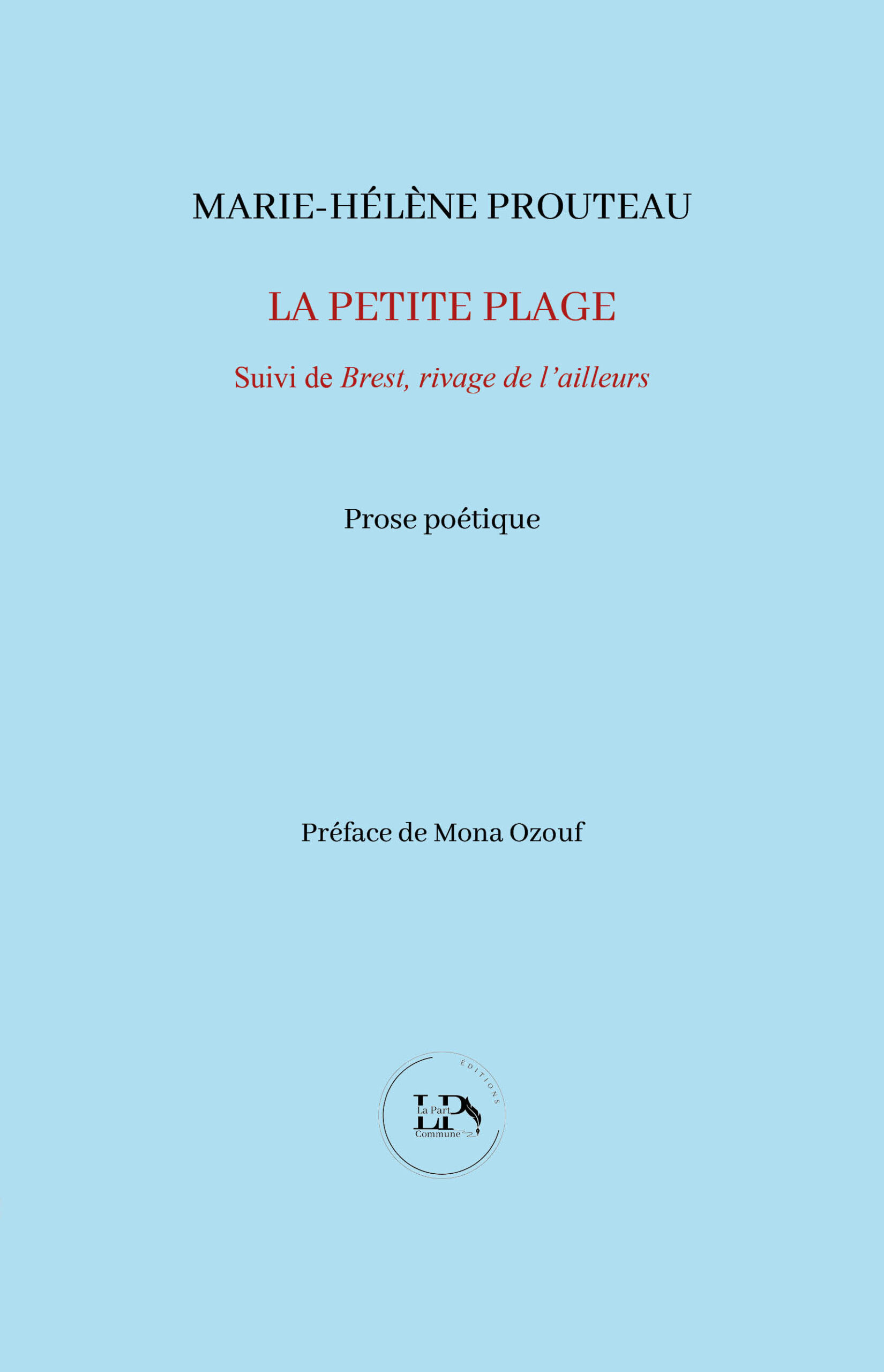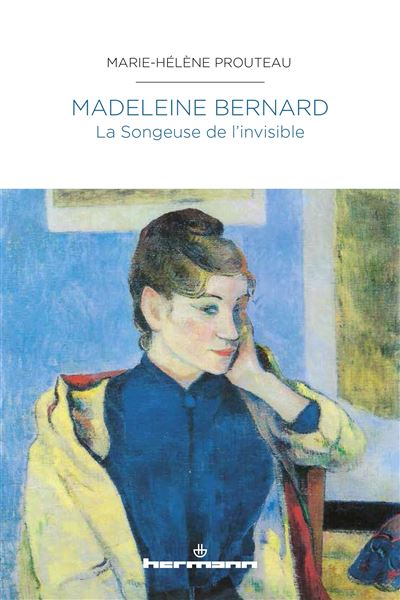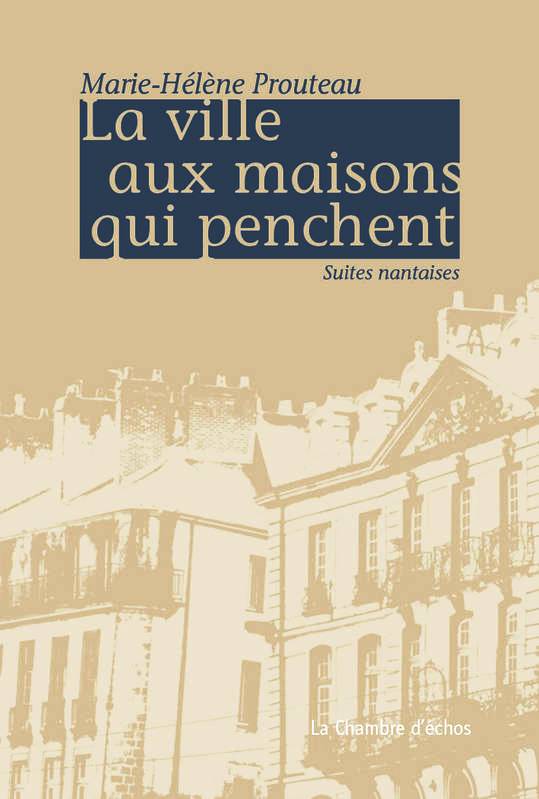Encore et toujours Xavier Grall
La première biographie du poète breton Xavier Grall vient d’être rééditée par Coop Breizh. Son auteur, le journaliste Yves Loisel, l’avait publiée en 1989 aux éditions Jean Picollec, soit huit ans après la mort de Grall. Il lui avait fallu « deux ans et neuf mois d’enquête et de recherches » pour dresser le portrait d’un « personnage aux multiples facettes », qui « déroutait, fascinait, agaçait aussi ».
Le 31 août dernier, interrogé sur les ondes de RCF Alpha, à Rennes, par Arnaud Wassmer, dans son émission « Regards », Yves Loisel a expliqué ce qui l’avait attiré chez Xavier Grall. « Sa hauteur de vue », a‑t-il souligné, évoquant le poète mais aussi le journaliste qu’il lisait chaque semaine dans les colonnes de La Vie catholique. Car Grall a, sans doute, d’abord assis sa renommée en y rédigeant ses fameux « billets d’Olivier ». Ce qui l’a amené à toucher un large public, en particulier quand il évoquait son quotidien à Bossulan, près de Pont-Aven, aux côtés de son épouse Françoise et de leurs cinq filles. « La religion a été, avec la Bretagne, la grande préoccupation de Xavier Grall, un des thèmes qui revenaient le plus souvent sous sa plume », avait souligné Yves Loisel en ouverture du colloque tenu en 2011, au Bois de la Roche (Morbihan), à l’occasion des trente ans de la disparition du poète. Religion, Bretagne (« contrée de l’âme », disait Grall) : cela vaut aussi bien pour ses chroniques que pour ses poèmes.
Tous les amoureux de l’œuvre de Grall reliront donc avec plaisir cette biographie qui replonge notamment les lecteurs dans les enthousiasmes et soubresauts du « revival » culturel et politique breton. Pour Yves Loisel, une seule ambition : « Raconter une vie », loin du panégyrique. Le biographe/journaliste n’apporte, en effet, aucun jugement sur l’œuvre. Des faits, seulement des faits. « Sur la base de « témoignages de première main », affirme-t-il.
Le poète breton aurait 85 ans aujourd’hui (il est né le 22 janvier 1930 à Landivisiau, où il est enterré). Que nous dirait-il, en ces temps troublés, de la barbarie jetant sur les routes des dizaines de milliers de réfugiés ? N’avait-il pas pressenti, comme il l’écrit dans son roman Africa Blues, cette montée d’un islamisme radical se nourrissant « de le misère et du Coran » ? Que dirait-il d’une Bretagne du 21e siècle engagée dans le développement de grosses aires métropolitaines, au détriment d’une « fédération de pays typés par la forme des talus, la chanson des fontaines, l’accent du parler », comme il l’écrivait si joliment et justement.
Oui, revenir aux intonations et convictions des Grall. Le retrouver, grand vivant, dans cette biographie. Mais aussi le retrouver dans certains de ses livres réédités aux éditions Terre de brume : des romans (Africa Blues, Cantique à Melilla, La fête de nuit), des poèmes (Barde imaginé), des essais (Arthur Rimbaud ou la marche ou soleil, L’inconnu me dévore), des chroniques (Parlez-moi de la terre, Mémoires de ronces et de galets). Incontestablement, comme le dit Yves Loisel, un « personnage aux multiples facettes ».
(Xavier Grall, Yves Loisel, Coop Breizh, 432 pages, 19,90 euros.)
*
Philippe Jaccottet : ce qu’il nous dit de la poésie qu’il aime
Poète et traducteur, Philippe Jaccottet a aussi été un grand lecteur dont le chroniques ont alimenté la NRF, les Cahiers de l’Herne, la Revue des Belles-lettres et bien d’autres publications prestigieuses. La plupart de ses écrits sur la poésie sont réunis aujourd’hui en poche sous le titre Une transaction secrète. Jaccottet nous parle bien sûr des poètes qu’il aime et qu’il a traduits (Ungaretti, Mandelstam…), de ses amis poètes romands (Gustave Roud en tête, Anne Perrier, Edmond-Henri Crisinel…) et de ces figures tutélaires que sont, pour lui, Joubert, Holderlin, Novalis, Hopkins… Et il avertit d’emblée : « Aucun de ces textes n’a été écrit pour les spécialistes de la littérature (toutes gens dont la science me confond), qui auraient de bonnes raisons de les trouver légers, et s’étonneraient sans doute aussi d’une naïveté que, pour ma part, je suis bien forcé de revendiquer ». Il affirme aussi ne pas avoir écrit pour les poètes mais « pour d’éventuels amateurs de poésie ». Dont acte.
Au-delà des éclairages qu’il apporte sur tous les auteurs présents dans ce livre, c’est l’approche personnelle de Jaccottet sur la poésie qui transpire dans toutes ces chroniques. Avec une grande constance, il affirme que « la poésie et la vie » lui ont « toujours paru étroitement liés ». Une position, n’hésite-t-il pas à dire, « tout à fait anachronique pour certains », mais qu’il revendique haut et fort face à « la littérature à la mode » qui « se dessèche ou s’empâte » (NRF, septembre 1976). Jaccottet, à la suite de Mandelstam, croit « aux grandes réalités élémentaires usées ou oubliées, à leur présence immédiate, leur poids, leurs dimensions presque infinies ». Une façon de se démarquer des « mots de la poésie, si décriés à juste titre, quand ils brillent pour eux-mêmes ou, aussi bien, quand ils restent opaques ». Il le dit dans un éloge de la poésie d’Anne Perrier à la fois chargée, à ses yeux, de « lumière intérieure » et de simplicité vraie.
Tout passe, rappelle-t-il ici et là, par l’émotion. C’est par elle que naît le poème. « Cette émotion que donne toujours l’ouverture sur les profondeurs et que rien d’autre ne donne », affirmait-il dès 1956 (à 31 ans) dans le discours de remerciement au prix Rambert qu’il venait de recevoir. Gustave Roud est, selon lui, un de ceux qui ont le mieux sondé ces profondeurs. « Il voit ce que les autres vivent sans savoir, il voit plus loin », affirme-t-il à propos du poète solitaire de Carrouge. Et Jaccottet pose la question : « Si ce monde où il n’y a aucune place pour le poète était en réalité, malgré l’éloignement des dieux, tout imprégné encore de leur substance ? Si le vagabond démuni y voyait plus clair, à sa façon, que le penseur ?
Ce « vagabond démuni » peut aussi prendre les traits d’un auteur de haïku. Jaccottet parle, dans plusieurs chroniques, de ce genre littéraire « auquel le poète accède par une série de dépouillements, dont la concision de son vers n’est que la manifestation verbale ». Il parle de « pauvreté, discrétion, effacement sinon abolition de la personne ». Et plus encore, ajoute-t-il, voici « une poésie sans images », une poésie qui « refuse le moindre mouvement d’éloquence » avec sa capacité « d’illuminer d’infini les mots quelconques d’existences quelconques ». Jaccottet en voit des traces dans la poésie de Jean Follain, loin des faiseurs d’une poésie absconse, abstraite et « prétentieuse ». Car « il faut bien cette simplicité pour nous arracher au désordre envahissant ». Des mots qu’on peut lire sous sa plume, en 1960, dans la Nouvelle Revue Française. Et qui restent d’actualité.
(Une transaction secrète, lectures de poésie, Philippe Jaccottet, Poésie/Gallimard, 400 pages, 7,90 euros).
*

« La Petite plage » de Marie-Hélène Prouteau
Pour beaucoup d’entre nous, il y a des lieux fondateurs. Ceux par lesquels on s’est éveillé au monde, parce que le parfum qui s’y dégageait ou l’ambiance qui y régnait, ont pu nous impressionner à jamais. Parce que, en définitive on y a trouvé un espace en adéquation avec notre cœur et notre corps. Pour certains, ce lieu fondateur c’est l’école primaire, pour d’autres le jardin d’une grand’mère ou le grenier de la maison familiale. Pour d’autres encore, le lieu des amours de jeunesse. Tant d’écrivains ont écrit là-dessus.
Pour Marie-Hélène Prouteau, ce lieu fondateur (ou, pour le moins, cette « madeleine de Proust ») est une petite plage de la côte sauvage du Nord-Finistère, du côté de Kerfissien en Cléder. Elle le dit dans une évocation en prose poétique, éclatée en autant d’évocations du lieu qu’elle garde en mémoire et qu’elle n’hésite pas, quittant la métropole nantaise où elle habite, à arpenter régulièrement pour y humer toutes les senteurs la rattachant à son enfance. « L’enfance est peuplée de cabanes, écrit-elle. Les miennes étaient ces rochers et ces grottes (…) Née dans ce Finistère, je ne peux parler comme une visiteuse. Je le ressens vivement : c’est un pays que j’ai quitté mais qui ne me quitte pas. L’amour de loin pour un être lointain très aimé nous grandit, écrit le poète, je me dis qu’il a raison ».
Encore faut-il exprimer cela de façon personnelle et originale. C’est le cas ici car Marie-Hélène Prouteau prend le parti d’associer cette petite plage non seulement à des souvenirs d’enfance mais aussi à des événements actuels ou à des oeuvres culturelles qui l’ont marquée. En définitive, partir du local (et d’un local bien exigu) pour nous parler de ce qui la fait vibrer aujourd’hui. Etablir également des correspondances. Faire surgir du passé des images nouvelles et contemporaines. Ainsi la vue de ces « femmes qui peinent dans les vagues sous un effort intense » la ramène-t-elle au tableau de Gauguin « Pêcheurs de goémon ». Ainsi, encore, ce menhir de Kergallec, « au milieu des artichauts », tout proche de la petite plage, lui évoque Les Stèles de Ségalen. Plus loin, à la vue de la marée montante, c’est « La vague » d’Hokusaï qui surgit. Ailleurs, les rochers lui font penser aux sculptures de Hans Arp. Et comment, face à la mer déchaînée qui s’engouffre dans la petite plage, ne pas évoquer l’héroïsme des Sauveteurs bretons ou les drames actuels de Lampedusa ?
La petite plage charrie tout cela. Elle devient une caisse de résonance du monde. Un chambre d’écho. L’auteure en fait une relecture à l’aune de ses propres expériences et de son bagage culturel. Marie-Hélène Prouteau parle joliment de « champ magnétique » ou de « promenoir des songes », de « contrepoint lumineux », « d’épicentre naturel ». Son appétit des vagues, d’iode et de rochers, reste, en tout cas, insatiable. Evoquant François Cheng, elle parle de « sentiment-paysage » et n’hésite pas, faisant référence à Erri de Luca, à sous-titrer son livre « autobiographie d’un lieu ». Et, convient-elle justement, « la distance a du bon, elle préserve le sacré ».
(La petite plage, Marie-Hélène Prouteau, La Part Commune, 126 pages, 14 euros.)
*

Joël Vernet : « L’adieu est un signe »
On ne met pas impunément, en exergue d’un livre, la fameuse phrase de Novalis, « le paradis est dispersé toute la terre, c’est pourquoi nous ne le reconnaissons plus. Il faut réunir ses traits épars ». Dans le nouveau recueil en « prose poétique » de Joël Vernet, la filiation avec Novalis transpire, en effet, tout au long des pages. Et encore plus avec Gustave Roud et Philippe Jaccottet qui, eux-mêmes, avaient repris à leur compte cette injonction de Novalis.
Le paradis c’est, ici, le pays retrouvé après des années de bourlingue (Joël Vernet est né en 1954 dans un petit village aux confins de la Haute-Loire et de la Lozère). « Rentrant d’un long voyage, je retrouve la maison, son silences, ses pierres anciennes ». Le ton est donné dès les toutes premières lignes du livre. « La splendeur est telle ce matin dans le jardin que mes chevilles foulant l’herbe font remonter jusqu’à mon cœur la douce sensation d’être vivant sur cette terre ». Joël Vernet évoque plus loin « le paradis du jardin qui, loin d’être dans l’ombre apparente, rayonne du feu des saisons ». Et pourtant, avoue le poète, « j’ai consenti au départ, abandonnant le village et la maison : son seuil et tous les visages, ne me retournant pas sur les années anciennes. L’adieu fut un signe (ndlr : titre du livre), mais n’est-il pas celui de tous quand les yeux se ferment sur la lumière ? »
De retour au pays, Joël Vernet constate qu’il est resté « l’enfant immobile ». Il nous entretient de « l’innocence perdue », de son « chagrin en miettes », de la « blessure d’enfance ». Il nous dit surtout, aujourd’hui (et avec quelle puissance d’écriture !), que « la voie royale est le chemin vers la vie pauvre ». Exercice de frugalité et de modestie (« les grands auteurs son invisibles ») doublée d’une forme de profession de foi sur le poète qu’il rêve d’être ou qu’il est sans doute déjà. « Ce qui l’absorbe, ce sont les vies, les êtres, les objets, la lumière, les ombres autour de lui ». C’est, en définitive, un véritable art poétique qu’il décline ainsi lui aussi — après d’autres -, fait de « contemplation et de désoeuvrement ». Nourri de cette « attention soutenue » chère à Czeslaw Milosz, dont Joël Vernet pourrait aussi se revendiquer. Le poète, dit-il, est là pour « retranscrire la beauté dans ce qu’il faut bien nommer un livre, qui n’est autre qu’une chambre d’écho ouverte aux quatre vents ».
Joël Vernet fait surgir, dans ce livre merveilleux, le meilleur de ce qu’il anime. Sous sa plume, la poésie est véritablement, cette « rose d’espérance ».
(L’ adieu est signe, Joël Vernet, dessins de Michel Potage, Fata Morgana, 77 pages, 14 euros.)
*
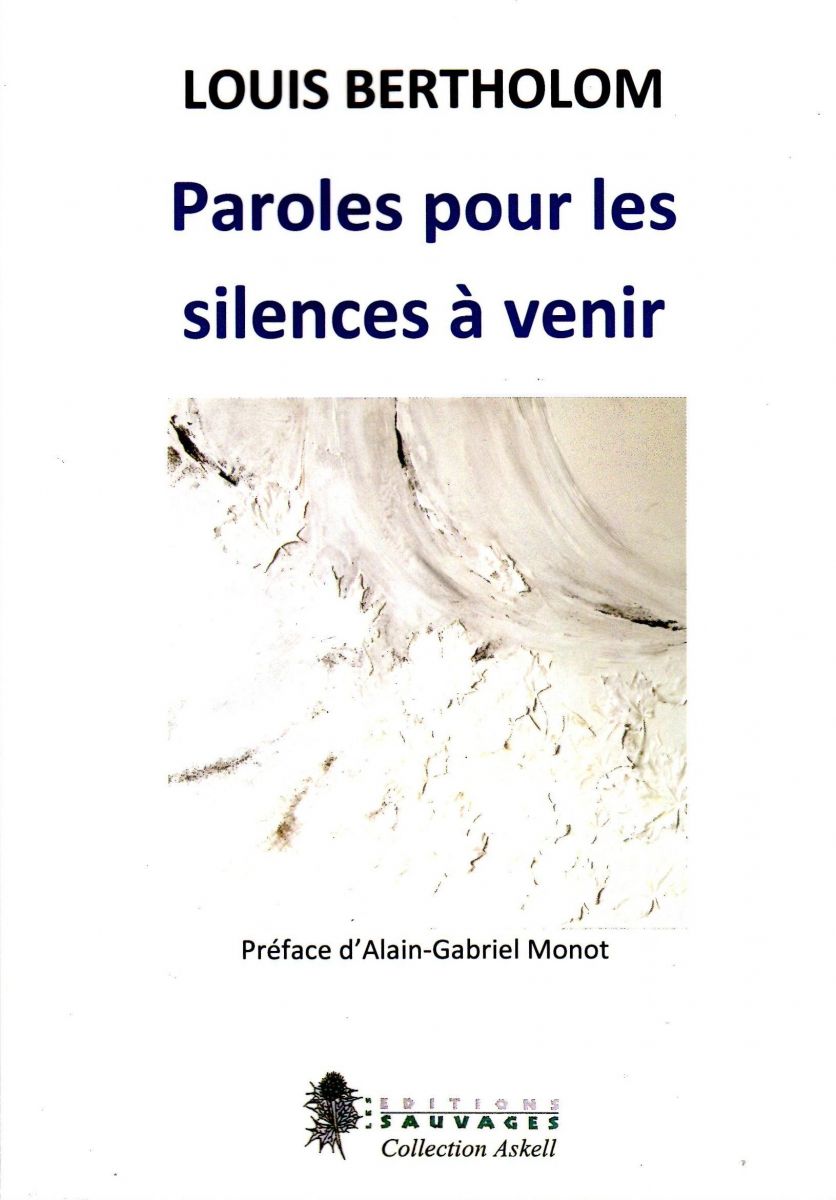
Louis Bertholom : « Paroles pour les silences à venir »
Barde jusqu’au bout des doigts. « Je viens de la gwerz/du pays de la charrue qui creuse le sillon/du chant ancestral ». Louis Bertholom l’affirme dans son nouveau livre Paroles pour les silences à venir (une forme de connivence avec Musiques pour les silences à venir du Quimpérois Dan Ar Bras). Un livre où le poète breton nous parle de son attachement au pays natal, de ses amis, de ses rencontres. De sa vie pour tout dire.
Comme pour tout barde, la parole de Bertholom peut être tonitruante quand il s’agit de dénoncer les turpitudes des hommes. Haro, par exemple, sur le Paris-Dakar ou le football business, symboles de cette société de l’argent que le poète exècre. Haro aussi sur tous les murs qui séparent les hommes et cultivent la haine, à commencer par le mur des Israéliens. La parole de Bertholom peut, alors, prendre carrément l’allure de poèmes-tracts.
Car le poète breton va droit au but. Poète engagé ? Sans doute. A la manière de Xavier Grall dont on retrouve la filiation dans plusieurs pages de ce livre. « Nous avons chanté les blés murs/quand toute vache portait un nom/les fruits cueillis avec tendresse/à savourer les caresses des fenaisons/dans la lente geste paysanne » (poème dédié à Jean-Charles Perazzi). Engagé encore plus à la manière de Glenmor, « le plus grand braillard du Poher/au visage de rocs et de landes », dont il se réclame à sa façon car « vivre en mélancolie c’est être barde, écrit-il, tribun sur les chemins de la bohême ».
Il y a aussi, et surtout, dans son panthéon personnel, le Kerouac breton venu à Brest quêter ses origines. « Tu titubes sous la pluie rue de Siam/clochard céleste aux larmes de Cognac ». Ce « satori » brestois devient un « saturé à Paris » quand Louis Bertholom lui-même déambule, la vague à l’âme, dans la Capitale, côtoyant les bouquinistes le long de la Seine ou partant « rue de Verneuil/lire le mur de Gainsbourg ».
Mais il y a, dans ce nouveau livre, des accents nouveaux. Plus personnels. L’homme se confie. Le Bertholom intime pointe le bout du nez. Ainsi cet émouvant adieu à Moutig, son chien fidèle. « Dans le jardin de mon enfance/il reposera sous l’ombre d’un pommier ». Il y a aussi ce retour sur ces années de labeur d’infirmier psychiatrique et son diagnostic implacable sur l’accueil que l’institution réserve aux « schizos » ou à ceux qu’on appelle les fous. Parlant de l’un d’entre eux, il écrit. « Dans l’océan tourmenté de tes yeux/dansent les remous de l’âme/détresse infinie malgré la sécheresse/lacrymale ».
Bertholom a beaucoup écrit entre l’automne 2014 et le printemps 2015. On y découvre un poète victime d’insomnies. « Absence bloquée à la porte de l’oubli/longue écoute de la nuit/impatience des draps énervés ». Au réveil, c’est le questionnement : « Quel poème écrire aujourd’hui/pour secouer la torpeur/égoutter les mots/dans l’odeur du café/de ce matin frileux ». Il le note noir sur blanc, à Quimper, le 22 novembre 2014.
(Parole pour les silences à venir, Louis Bertholom, préface de Alain-Gabriel Monot, éditions Sauvages, 250 pages, 16,50 euros.)
- Eve Lerner, Un tant soit peu de lumière - 5 février 2025
- Jean-Yves André, Jacques Poullaouec, Femmes de pierre - 6 janvier 2025
- Jacques Josse, Trop épris de solitude - 21 décembre 2024
- Le 30e numéro de Spered Gouez, L’esprit sauvage - 6 novembre 2024
- Antonia Pozzi, Un fabuleux silence - 6 septembre 2024
- Jean-Pierre Boulic, Quelques miettes tombées du poème - 6 mai 2024
- Joseph-Antoine D’Ornano, Instantanés sereins - 1 mars 2024
- Cécile A. Holdban, Premières à éclairer la nuit - 6 février 2024
- Estelle Fenzy, Une saison fragile - 6 janvier 2024
- Maurice Chappaz, Philippe Jaccottet : Correspondance, 1946–2009 - 21 décembre 2023
- Marina Tsvetaïeva, Après la Russie - 6 décembre 2023
- Hélène Dorion, Mes forêts - 29 octobre 2023
- Cécile A.Holdban, Toutes ces choses qui font craquer la nuit - 22 septembre 2023
- Colette Wittorski, Ephéméride - 6 septembre 2023
- Jean-Claude Coiffard, Le ciel était immense - 21 juin 2023
- Cécile A. Holdban, Kaléidoscope, Tapis de chiffons - 6 juin 2023
- Claude Serreau, Réviser pour après - 20 mai 2023
- Philippe Jaccottet, La promenade sous les arbres - 29 avril 2023
- Gérard Bessière, De lumière et de vent - 20 avril 2023
- Chantal Couliou, Instants nomades - 6 avril 2023
- Paul Verlaine, Nos Ardennes - 19 mars 2023
- Michel Dugué, Veille - 1 mars 2023
- Marie de la Tour et Taxis, Souvenirs sur Rainer Maria Rilke - 21 février 2023
- Haïkus : Du bleu en tête - 5 février 2023
- Marie-Josée Christien et Yann Champeau, Marais secrets - 24 janvier 2023
- Yvon Le Men, prix Paul-Verlaine - 29 décembre 2022
- Gustave Roud, Œuvres complètes - 29 décembre 2022
- Liza Kerivel, Nos - 21 décembre 2022
- Cypris Kophidès, La nuit traversière - 4 décembre 2022
- Alain Vircondelet : Des choses qui ne font que passer - 18 novembre 2022
- Benoît Reiss, Un dédale de ciels - 6 octobre 2022
- Anne-Lise Blanchard, L’horizon patient - 22 septembre 2022
- Le haïku face au changement climatique - 1 juillet 2022
- Carles Diaz : L’arbre face au monde - 19 juin 2022
- Alain Vircondelet, Des choses qui ne font que passer - 20 mai 2022
- Olivier Cousin, La vie à l’envers - 3 mai 2022
- Yvon Le Men, Les Epiphaniques - 20 avril 2022
- Jean-Claude Albert Coiffard, Il y aura un chant - 5 avril 2022
- John Keats : La poésie de la terre ne meurt jamais - 21 février 2022
- Jean Lavoué, Carnets de l’enfance des arbres - 21 janvier 2022
- Claude Serreau, Résurgence ou les parenthèses du soir - 28 décembre 2021
- Stefan Zweig, La Vie d’un poète - 21 décembre 2021
- Christine Guénanten, Féerique fougère - 6 décembre 2021
- Xavier Grall – Georges Perros, Regards croisés - 21 novembre 2021
- Marie-Josée Christien, Eclats d’obscur et de lumière - 21 octobre 2021
- Yvon Le Men, La baie vitrée, Alda Merini, La folle de la porte à côté, Chantal Couliou, Du soleil plein les yeux - 6 septembre 2021
- Yeats : le poète irlandais réédité - 5 juillet 2021
- Anne-José Lemonnier, Au clavier des vagues - 20 avril 2021
- Eve Lerner, Le Chaos reste confiant - 21 février 2021
- Marie-Josée Christien, Constante de l’arbre - 6 février 2021
- François Clairambault, Les Anges sont transparents - 21 janvier 2021
- Nathan Katz, La petite chambre qui donnait sur la potence - 6 décembre 2020
- Colette Wittorski : L’immensité des liens - 31 octobre 2020
- Claude Vigée : la disparition d’un grand poète - 19 octobre 2020
- Nicole Laurent-Catrice, Pour la vie - 6 octobre 2020
- La douceur amère de l’Américaine Sara Teasdale - 19 septembre 2020
- Alain Kervern, « praticien » du haïku - 6 septembre 2020
- Marie-Claire Bancquart, De l’improbable précédé de MO®T - 21 juin 2020
- Nicolas Rouzet, Villa mon rêve - 6 juin 2020
- La vision Claire de Jacques Josse - 21 mai 2020
- Bernard Perroy et Nathalie Fréour, Un rendez-vous avec la neige - 6 mai 2020
- Le haïku face au changement climatique - 21 avril 2020
- Yvon Le Men et Simone Massi, Les mains de ma mère - 6 avril 2020
- Yves Elléouët, Dans un pays de lointaine mémoire - 21 mars 2020
- Etty Hillesum et Rainer Maria Rilke - 6 mars 2020
- Janine Modlinger, Pain de lumière - 26 février 2020
- Thierry Cazals et Julie Van Wezemael, Des haïkus plein les poches - 20 janvier 2020
- Bluma Finkelstein, La dame de bonheur - 5 janvier 2020
- Guénane, Ta fleur de l’âge - 20 décembre 2019
- Paul Guillon, La couleur pure - 6 décembre 2019
- Estelle Fenzy, La minute bleue de l’aube - 21 novembre 2019
- Jacques Rouil, Les petites routes - 6 novembre 2019
- Daniel Kay, Vies silencieuses - 25 septembre 2019
- En longeant la mer de Kyôto à Kamakura - 1 septembre 2019
- Autour de Salah Stétié - 6 juillet 2019
- Yvon Le Men : un poète à plein temps - 4 juin 2019
- Collection PO&PSY : le grand art de la forme brève - 4 juin 2019
- Fil autour de Jean-Claude Caër, François de Cornière, Jean-Pierre Boulic - 4 mai 2019
- Cécile A. Holdban : Toucher terre - 3 février 2019
- Rezâ Sâdeghpour, Yvon Le Men, Marc Baron - 4 janvier 2019
- Thierry-Pierre Clément reçoit le Prix Aliénor d’Aquitaine pour Approche de l’aube - 3 décembre 2018
- Gilles Baudry et Philippe Kohn, Roland Halbert, Xavier Grall - 3 décembre 2018
- Autour de Paol Keineg, Jean-Luc Le Cléac’h, Guy Allix et Amaury Nauroy - 5 novembre 2018
- Alexandre Romanès, Le Luth noir - 5 octobre 2018
- Le « roman » du poète Gustave Roud - 5 octobre 2018
- Japon : « Poèmes et pensées en archipel » - 6 avril 2018
- Marie-Hélène Prouteau enchante Nantes - 26 janvier 2018
- Antoine Arsan et son « éloge du haïku » - 26 janvier 2018
- Jean-Pierre Denis, Tranquillement inquiet - 26 janvier 2018
- Pierre Dhainaut, Un art des passages - 26 janvier 2018
- Jean-Marc Sourdillon La vie discontinue - 26 janvier 2018
- Jean Onimus, Qu’est-ce que le poétique ? - 26 janvier 2018
- Les méditations poétiques de Philippe Mac Leod - 14 octobre 2017
- Xavier Grall, Les Billets d’Olivier réédités - 30 septembre 2017
- Jean-Marie Kerwich, Le livre errant - 30 septembre 2017
- Mémoire d’Angèle Vannier - 30 septembre 2017
- Jean Lavoué, Ce rien qui nous éclaire - 30 septembre 2017
- Anne-Lise Blanchard, Le soleil s’est réfugié dans les cailloux - 30 septembre 2017
- Claude Albarède sur le Causse - 30 septembre 2017
- Fil de lecture : Yvon LE MEN, Guy ALLIX, Anne GOYEN, Terada TORAHIKO - 25 mars 2017
- Fil de lecture : Louis BERTHOLOM, Jean-Pierre BOULIC, Roland HALBERT. - 12 novembre 2016
- Fil de Lecture de Pierre Tanguy : Cécile HOLDBAN, Alain KERVERN, Gilles BAUDRY - 16 octobre 2016
- Denis HEUDRE : Sèmes Semés - 15 mai 2016
- Fil de Lecture de Pierre TANGUY : sur Philippe JACCOTTET et Jean-Michel MAULPOIX - 15 mai 2016
- Fil de lecture de Pierre Tanguy : sur Antonia POZZI, et SÔSEKI - 29 avril 2016
- FIL DE LECTURE de Pierre Tanguy : Grall, Jaccottet, Prouteau, Vernet, Bertholom - 8 février 2016
- Paol Keineg Mauvaises langues - 1 mars 2015
- Iraj Valipur, Zabouré Zane, femmes postmodernes d’Iran en 150 poèmes (1963–2013) - 17 février 2015
- Dorianne Laux, Ce que nous portons - 5 janvier 2015
- Sur deux recueils de Roland Halbert - 24 octobre 2014
- Andréï Tarkovski : ce qu’il nous dit de la poésie - 14 septembre 2014
- Pierre Jakez Hélias, une œuvre poétique à (re) découvrir - 31 janvier 2014
- A propos de Claude Vigée - 14 janvier 2014
- Lucia Antonia, funambule de Daniel Morvan - 23 décembre 2013
- Clin d’Yeu de Guénane - 27 novembre 2013
- Traversée de Marie-Hélène Lafon - 19 novembre 2013
- Hommage à Seamus Heaney - 18 novembre 2013
- Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie de François Cheng - 4 novembre 2013
- Le chant de la source de Fanch Peru - 26 octobre 2013
- Il fait un temps de poèmes, textes rassemblés par Yvon Le Men - 22 octobre 2013
- Chemin de feu, peinture et poésie, de Bernard Grasset - 2 octobre 2013
- Poétique de la théologie - 6 août 2013
- Littérature et spiritualité en Bretagne - 30 juillet 2013
- Sans adresse l’automne, Jean-Albert Guénégan - 16 juillet 2013
- Comme un nuage au fond des yeux, Geneviève Le Cœur - 9 juin 2013