François Xavier, Jean Grenier, Gilles Mentré
François XAVIER : Elégies du chaos (Dialogue avec Julius Baltazar).
Cela commence fort, très fort même : page 24, Ben et Buren sont traités d’apparatchiks de l’art et de mystificateurs (et je ne suis pas loin de partager cette formule). L’art est objet de contemplation, non de spéculation : à chaque fois que j’ai vu du Ben ou du Buren, j’ai été déçu… Le rôle de l’observation est bien noté : « C’est là toute la magie du génie baltazarien, laisser sa main décanter à partir de l’observation du réel, (re)faire à partir d’un rien, rendre à la beauté sa place originelle dans l’espace infini bien au-delà du cadre » (p 30). La notion de plan d’action prend alors toute sa valeur. Ailleurs, François Xavier éclate à propos de Julius Baltazar « Le voilà partie intégrante du réel, maître de son idée au sein de l’univers agrandi pour accueillir l’espace déterminé » (p 35).
Julius Baltazar serait-il le dernier peintre réaliste, au risque de sombrer dans le paradoxe ?

François Xavier : Elégies du chaos (Dialogue avec Julius Baltazar). Plus de 150 pages avec les annexes, Co-édition Les éditions du Littéraire & L’Atelier d’artistes, 20 euros. En librairie ou sur commande cher l’éditeur Les éditions du Littéraire ; 70, rue de l’amiral Mouchez. 75014 Paris ; nombreuses illustrations.
Ailleurs encore, citant Pierre Wat, François Xavier ne déclare-t-il pas : « Quand Baltazar regarde le monde et ose l’affronter, il y a chez lui (...) ce face à face entre l’Histoire et la nature [qui] tourne au profit de la seconde » (p 39).
Où l’on apprend que l’artiste pratique la répétition déchirée, mais déplacée, délocalisée. Julius Baltazar peint sur papier par souci de conservation nous dit François Xavier. Mais Julius Baltazar « refuse que l’art soit soit au service d’une vérité supérieure car ne visant pas l’outre-monde, mais l’ici-bas » (p 46). Mais François Xavier ne peut s’empêcher d’affirmer : « D’une pique dans la baudruche Koons…» (p 48). Mais il ne manque pas d’émailler son récit ou sa description d’anecdotes qui révèlent son incorporation dans le milieu des vrais peintres… Baltazar peint des paysages abstraits, de grandes nappes colorées pas si éloignées que cela du réalisme : François Xavier va jusqu’à noter (p 43) : « Il s’agit là de signe abstrait-figuratif », ou ailleurs (p 50) : « Il n’y a donc plus que des formes, ses formes si spéciales que Baltazar est le seul à peindre, ces fantômes d’une vie, jadis, rêvée, désirée et toujours fuyantes comme l’ombre des croûtes grises et salées des marais ». Page 60, revient la notion de chaos qui donne son titre à l’ouvrage : « D’un côté, ce qui peut paraître dramatique, cette fin du monde ou ce chaos originel ; de l’autre, une pratique ancestrale et une technique millénaire maniée avec respect et une pointe d’insolence qui transforme les monstruosités en chefs-d’œuvre » (c’est moi qui souligne !).
« Soyons honnête : il y a pléthore de peintres, alors d’où vient cette magie qui opère sur certaines toiles, offrant sur quelques élus le pouvoir de montrer la Beauté dans toute sa splendeur ? » (p 79). Dès lors, François Xavier va s’employer à trouver réponse(s) à cette question dont la principale est à trouver dans « une extrême sensibilité en relation avec ce Tout ce qui nous effraie » (id). Plus loin, il précise (p 85) : « Son œuvre se gorge de violence, temps sacrificiel qui s’imprègne d’étranges figures lentement abandonnées sur le chemin convulsif d’un retour aux origines ». C’est ce qui fait que l’amateur d’art s’arrête pour contempler… Il y a une véritable osmose qui s’établit quand on contemple les toiles ou les papiers de Julius Baltazar : « les couleurs flottent en nappes nuageuses, les pigments aux diverses intensités libèrent des sensations inconnues : lire devient une activité physique, l’extase foudroie la volonté ; la matière a raison de moi » (p 93). Même pour les livres d’artiste, cette citation s’applique : c’est que Baltazar est « visuel avant d’être cérébral » (p 95)…, mais la saillie sur Aragon est inutile ! Il va sans dire que j’adhère totalement à ce que François Xavier dit page 114 : « Oserai-je paraphraser André Breton quand il écrit […] l’arrivée d’un nouvel esprit. Lequel est bel et bien ancré dans les mœurs du XXIème siècle qui continue sa politique de destruction du Beau par la promotion de l’AC, cet art contemporain, ce divertissement sans intérêt, loin de se soucier de qualité mais seulement de rentabilité et/ou de discours creux et pompeux. De ce monde dédié au libéralisme débridé qui vénère la mondialisation comme l’idéologie suprême…». Cela ne va pas sans efforts si on refuse de rejoindre le troupeau de ceux qui encensent Koons et Cie : « Car chercher la beauté nue pour ressentir sa force brute demande quelque effort, un esprit de contradiction, un appétit sans limite pour affronter l’incohérence contemporaine» (p 122). La peinture de Baltazar, au moment où elle se fait, est résolument hors marché.
Conclusion.
François Xavier fait preuve d’une belle connaissance de l’histoire de la peinture occidentale : l’index des noms cités court sur cinq pages, soit de nombreux peintres. Peinture sensible car Baltazar « cherche à ne retenir les sensations, le mouvement du vent sur la peau, la lumière sur la mer» (p 76). Et ce, à une époque où la spéculation domine, à une époque où l’argent a mauvaise presse chez les vrais amoureux de la peinture, où le kitsch fait la loi, sa loi financière…Tout comme l’annexe intitulée Collections publiques est utile pour qui veut préparer une visite de ces lieux (manque seulement le nombre d’œuvres qu’on peut admirer)… J’aime ces développements sur Kijno qui surviennent au hasard (comme à la page 123), par associations d’idées. J’aime les groupes de vers de Rainer Maria Rilke qui servent d’exergue à chaque nouveau chapitre de l’essai de François Xavier. J’aime tout ; lisez donc ce livre en toute confiance…
KIJNO ET LES ÎLES DE Jean GRENIER
Il est une œuvre de Kijno, Les îles de Jean Grenier, un manuscrit à peintures froissées, qui fait office de fantôme, car jamais vue du plus grand nombre. En 1960, il recopie, à la main, des fragments des îles de Jean Grenier qu’il accompagne de peintures froissées. Seule, une note biographique, très succincte, signale cette réalisation dans la monographie de Raoul-Jean Moulin ((Raoul-Jean Moulin, Kijno, Editions Le Cercle d’Art, Paris, 1994, page 284. R-J Moulin écrit (p 44) : «…avant d’atteindre Les îles de Jean Grenier (1959-1960) et bien d’autres ports jusqu’à ce jour ».)) : « 1960 : illustre Les îles de Jean Grenier ». Malou Kijno, qui a retrouvé ce manuscrit du peintre disparu en 2012, a eu l’excellente idée de le faire reproduire par les Editions Somogy. La librairie Landarchet, Somogy éditions d’Art et Malou Kijno organisèrent une exposition accompagnée, le 12 avril 2018, d’une conférence de Renaud Faroux, le commissaire de l’exposition La grande Utopie de Kijno, qui s’est tenue à Saint-Germain en Laye en 2017.
La reproduction s’accompagne d’une présentation de Renaud Faroux, d’une préface d’Albert Camus écrite à l’époque de la parution des Îles et de la reproduction d’un choix de Kijno, textes et papiers froissés en vis à vis, opéré par Malou Kijno… « Car [Kijno en fit] don […] à son professeur qui le garda précieusement toute sa vie. Son fils, Alain Grenier, a bien voulu extraire de ses archives ce rare manuscrit pour le présenter une première fois au public lors de la rétrospective organisée par Malou Kijno à Saint-Germain-en-Laye en 2017 : La Grande Utopie de Kijno » (p 10).
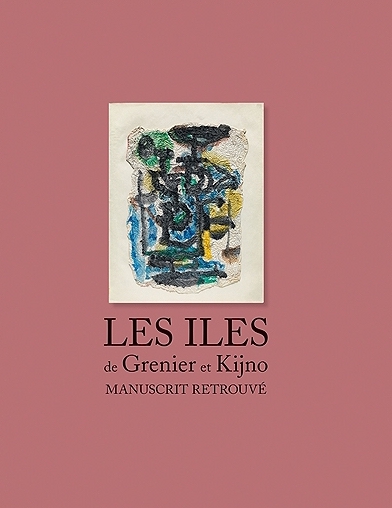
Kijno : Les Îles de Jean Grenier, un manuscrit retrouvé. Somogy éditeur, 208 pages, 27 x 20 cm, reliure suisse cartonnée et contrecollée avec revêtement en toile, 125 euros. Textes manuscrits de Kijno, nombreuses reproductions de papiers froissés. Préface d’Albert Camus, présentation de Renaud Faroux. En librairie ou sur commande chez Somogy.
C’est aujourd’hui cette reproduction qui est offerte à la curiosité des amateurs du peintre disparu en 2012. Il s’agit de véritables « mécaniques mentales » (p 13). Renaud Faroux, dans sa présentation cite Kijno qui déclare « J’invente une langue qui doit nécessairement jaillir d’une poétique nouvelle, que je pourrais définir en ces deux mots : « Peindre non la chose, mais l’effet qu’elle produit…» (p 13). Et il termine sa présentation par ces mots : « … l’association entre l’œil, la main, l’esprit et le cœur produit un jeu subtil entre le verbal et le visuel » (p 16).
La préface d’Albert Camus fut publiée par Gallimard en 1959 aux devants des Îles de Jean Grenier. A l’époque, Camus reçut un choc : « Les Îles venaient, en somme, de nous initier au désenchantement ; nous avions découvert la culture (p 19) » : rien d’étonnant à ce que désenchantement et culture soient associés : qu’est-ce que c’est ? Camus manifeste dans ses propos une belle connaissance de la pensée de Jean Grenier : « Ainsi, je ne dois pas à Grenier de certitudes qu’il ne pouvait ni ne voulait donner. Mais je lui dois, au contraire, un doute (c’est moi qui souligne) qui n’en finira pas, qui m’a empêché d’être un humaniste au sens où on l’entend aujourd’hui, je veux dire un homme aveuglé par de courtes certitudes. Ce tremblement qui court dans Les Îles, dès le premier jour, en tout cas, je l’ai admiré et j’ai voulu l’imiter » (p 20).
Avec la troisième partie, le lecteur entre dans le vif du sujet : Les Îles de Jean Grenier que, pour la commodité de l’ouvrage, Malou Kijno a réduites à huit chapitres raccourcis… Il me faut revenir à ce qu’écrivait Renaud Faroux quant à la reproduction du livre original dans le présent ouvrage : « L’ouvrage original se compose de différents cahiers avec d’un côté le texte copié sur un léger papier kraft et de l’autre comme sur du papier buvard des séries de papiers froissés. Le tout est enchâssé dans dans une pochette de carton dur qui donne à l’œuvre un aspect de véritable parchemin » (p 10). On remarquera une différence dans la reproduction (?) : le texte est reproduit sur du papier de couleur kraft plus clair que le kraft ordinaire… On me permettra de m’arrêter sur le troisième chapitre intitulé Aux îles Kerguelen car c’est là qu’on comprend le mieux que Kijno n’illustre pas, mais peint, non la chose mais l’effet qu’elle produit. Dans ce chapitre, au niveau des papiers froissés de Kijno, on trouve une traduction des coups de vents et des bourrasques qui soufflent sur les îles Kerguelen, comme des idéogrammes ou des pictogrammes extrême-orientaux…
Le moment est sans doute venu de parler du texte avec les Îles Fortunées: celui de Jean Grenier est précis, évocateur, il dit tout ce qu’on peut penser de rares paysages (p.85 et suivantes, et, surtout, la page 86.8) : la beauté est dangereuse. Sur le chapitre ayant pour titre « L’ Île de Pâques » que Kijno visitera quelques dizaines d’années plus tard, rien à dire si ce n’est qu’y furent prises quelques photographies dont une (très belle) de Christian Pinson où l’on voit Lad en majesté et en mouvement… Dans les Îles Borromées, je retrouve le cercle cher à Pierre Garnier : Kijno n’en finira pas de chercher ses îles Borromées…
Un livre, doublement, de poésie…
Gilles MENTRÉ : « Le bruit de la langue ».
Gilles Mentré, dans son recueil « Le bruit de la langue », mêle prose et vers, réflexions sur l’écriture et essai d’écriture poétique (qui ne néglige pas les dites réflexions). Ce livre est composé de différentes parties que séparent les peintures de Christian Gardair. Si la première partie s’interroge sur la poésie, tout en interrogeant le poète lui-même (sur son intégrité, sa liberté, qui ne ne connaissent pas de limites), la seconde s’emploie à traquer la réalité. D’où ces questions : « Comment la réalité peut-elle être si discontinue en nous ? » (p 19), « Est-il possible de regarder les choses en face, comme si c’était nous qui les éclairions ? » (p 20)… Ces questions sont légions, comme les peut-être, les mais qui amorcent des hypothèses de réponse… Que viennent vérifier les poèmes qui terminent chacune de ces parties? Peut-être est-ce le rôle de l’homme ou de la femme (du poète) que de s’interroger sur l’adéquation des mots et du monde ? En tout cas le poème s’y essaie : désespérément.
Gilles Mentré s’empare ensuite de la particularité des bobacs((il s'agit d'une marmotte des steppes de Sibérie, dont le suicide collectif annuel constaté depuis la fin du XIXème siècle est relaté par Jean Giono dans le Nice-matin du 12 septembre 1964 et repris par Barjavel dans La Faim du tigre.)) (leur « suicide » collectif depuis plus d’un siècle) et en produit un poème fait d’accumulations et qui interroge le lecteur sur l’écriture poétique. Gilles Mentré s’essaie à la justification à droite pour le poème (p 56). Les considérations linguistiques du poète sont parfois difficiles à suivre ; j’en veux pour preuve ces deux vers : « si la phrase ne contient pas seulement les mots /mais la langue »… Alors ?
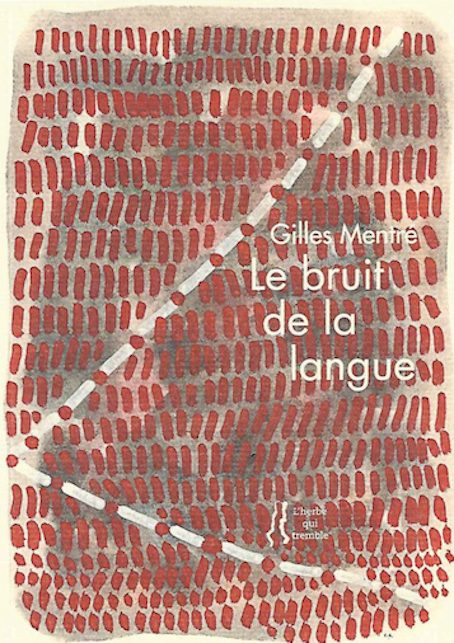
Gilles Mentré, « Le bruit de la langue ».
L’Herbe qui tremble éditeur, peintures de
Christian Gardair, 96 pages, 14 euros. En
librairie ou sur commande sur le site de l’éditeur…
Gilles Mentré passe au conte dans ses proses mais continue sa méditation: « la possession est dans les mots / et les mots seront rendus au langage » (p 68). Et si le poète n’écrivait que la difficulté à saisir le réel ? Et s’il s’interrogeait sur ce qui fait la singularité du langage ? Et si, et si… Il faut lire ce recueil pour son originalité et pour celle de la démarche de Gilles Mentré…