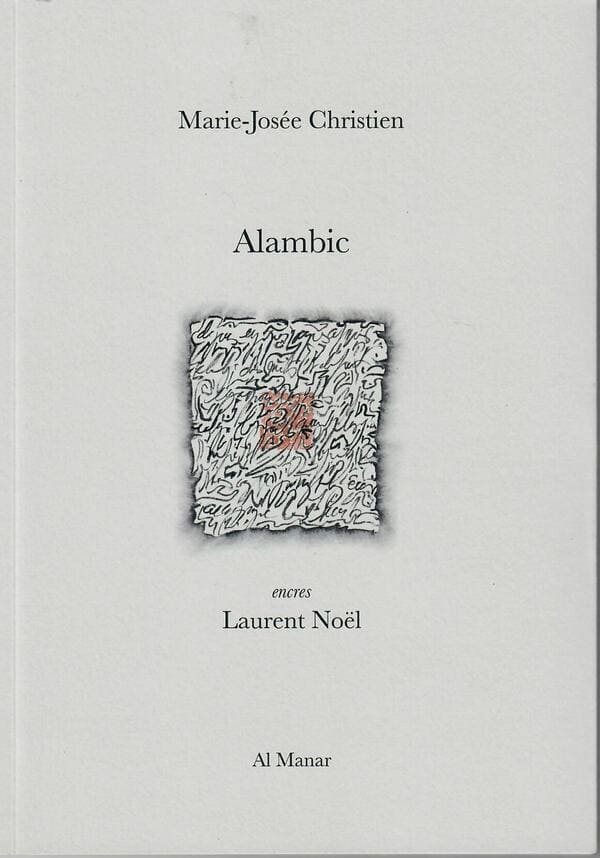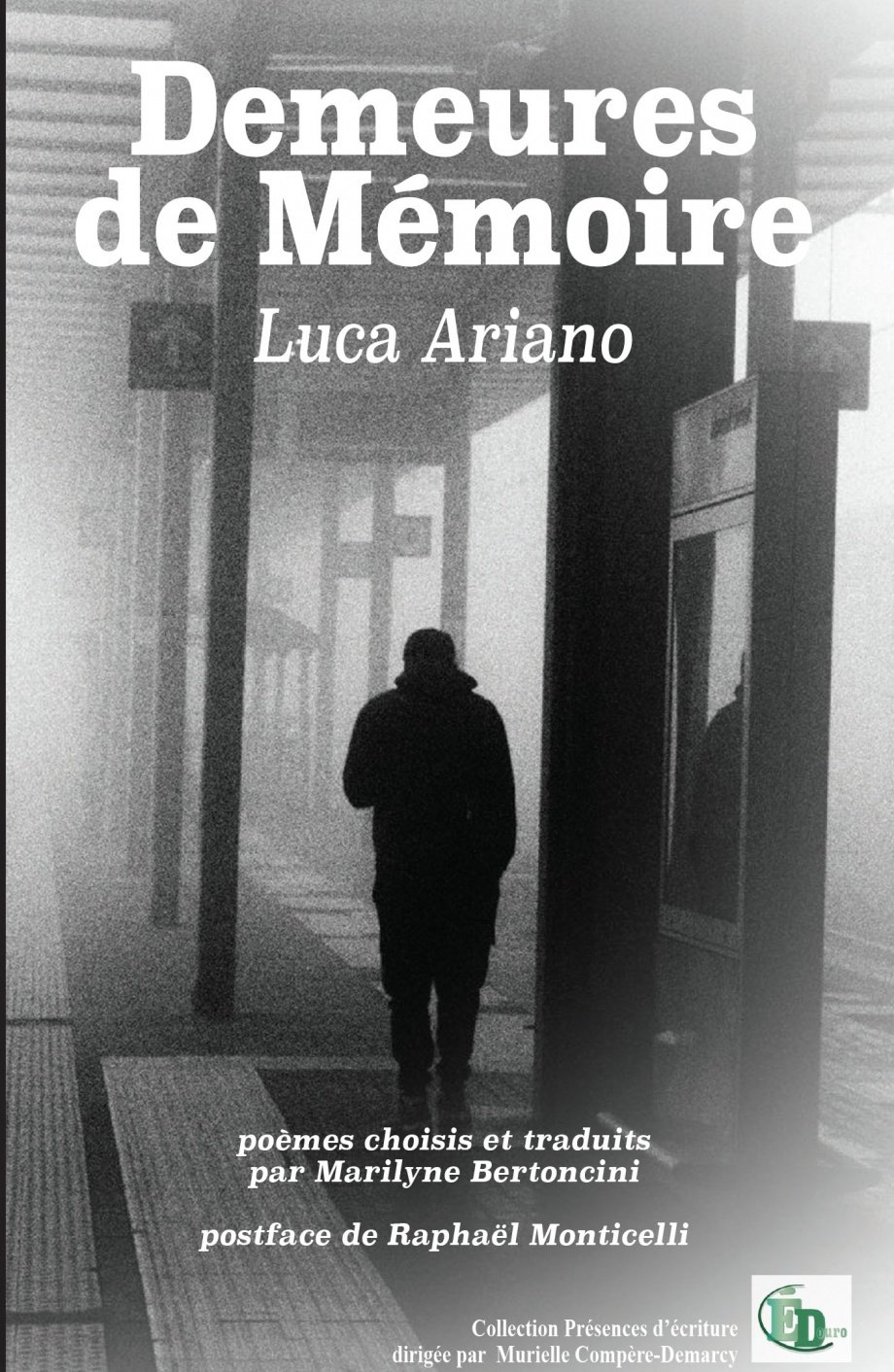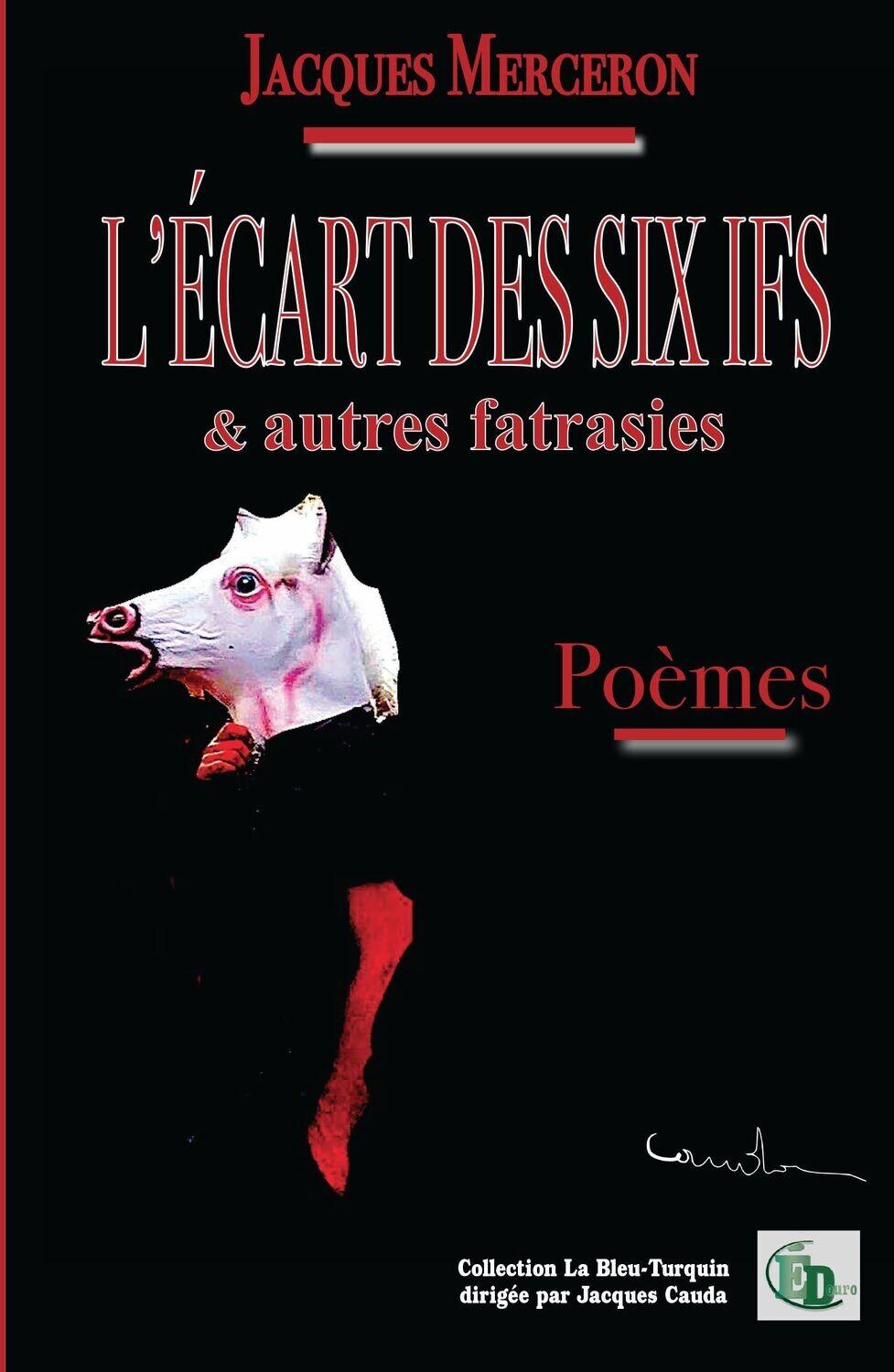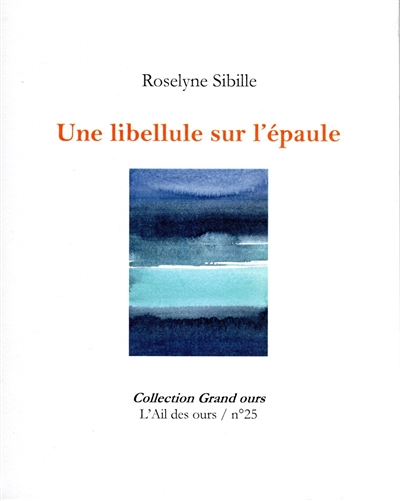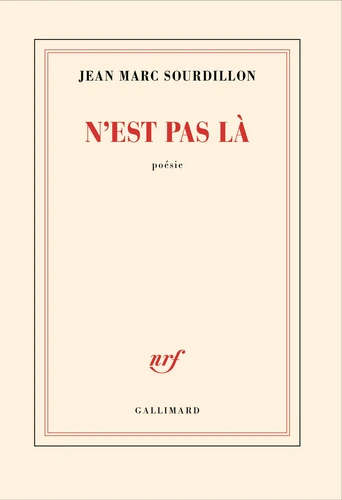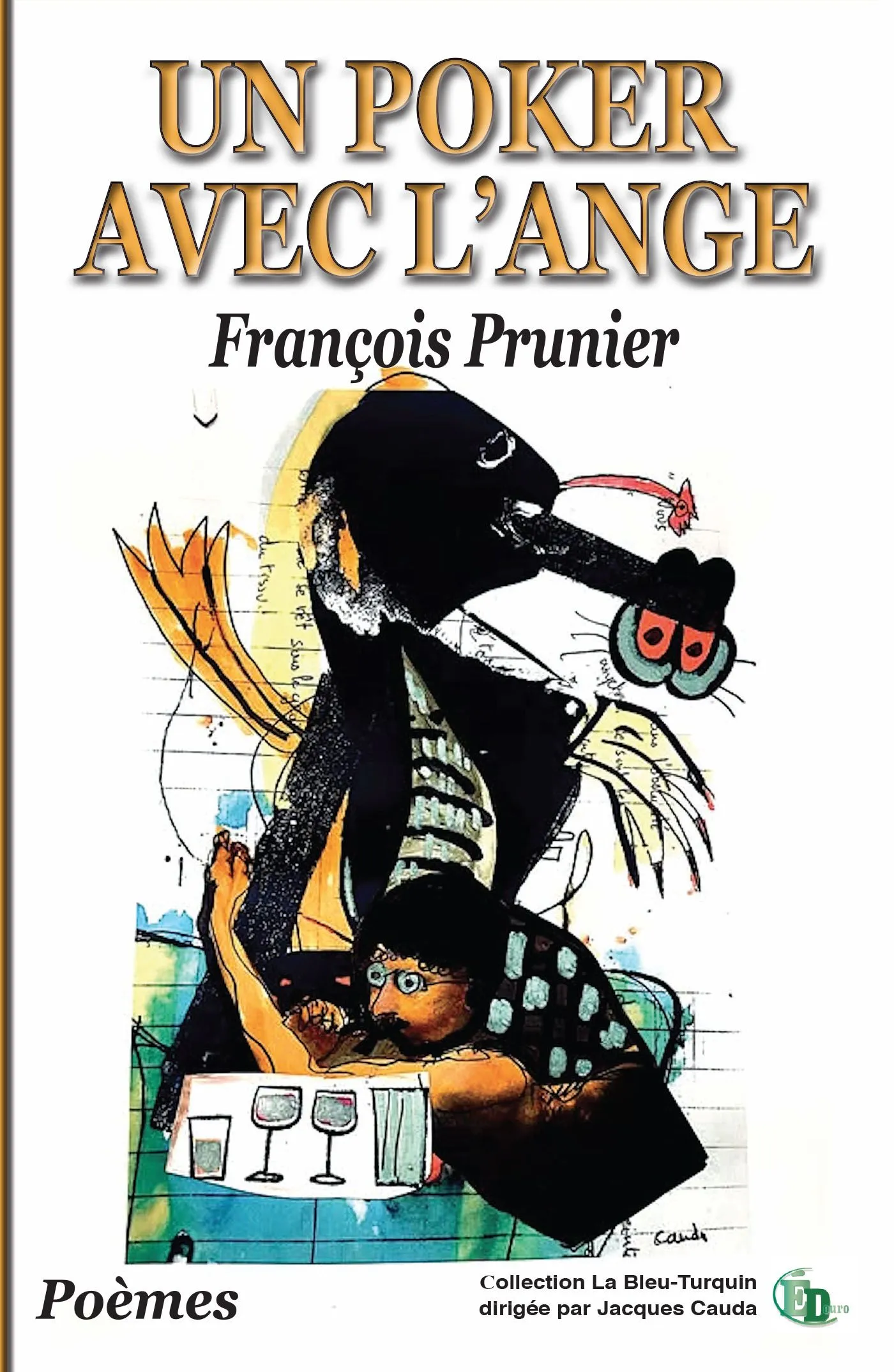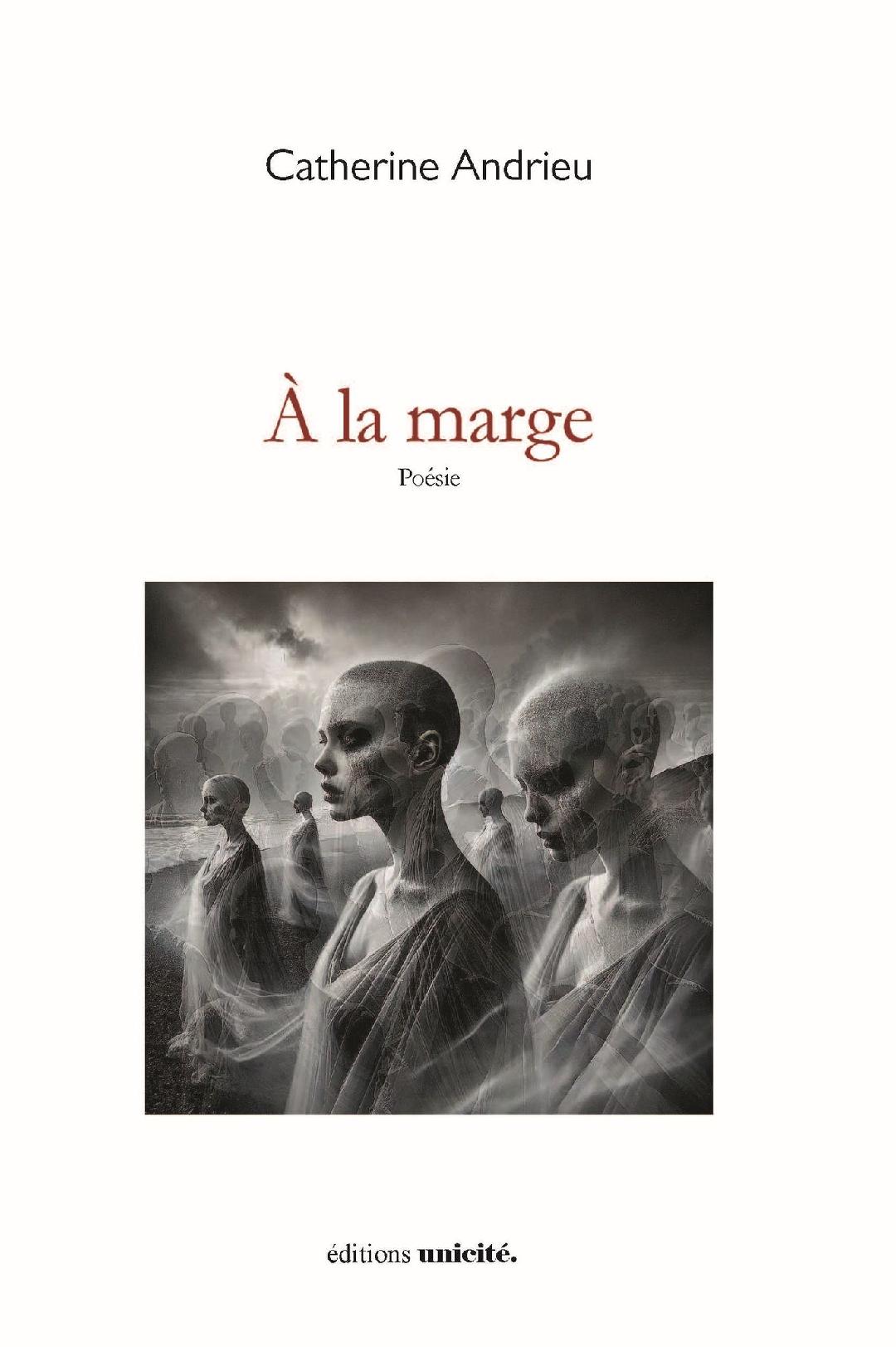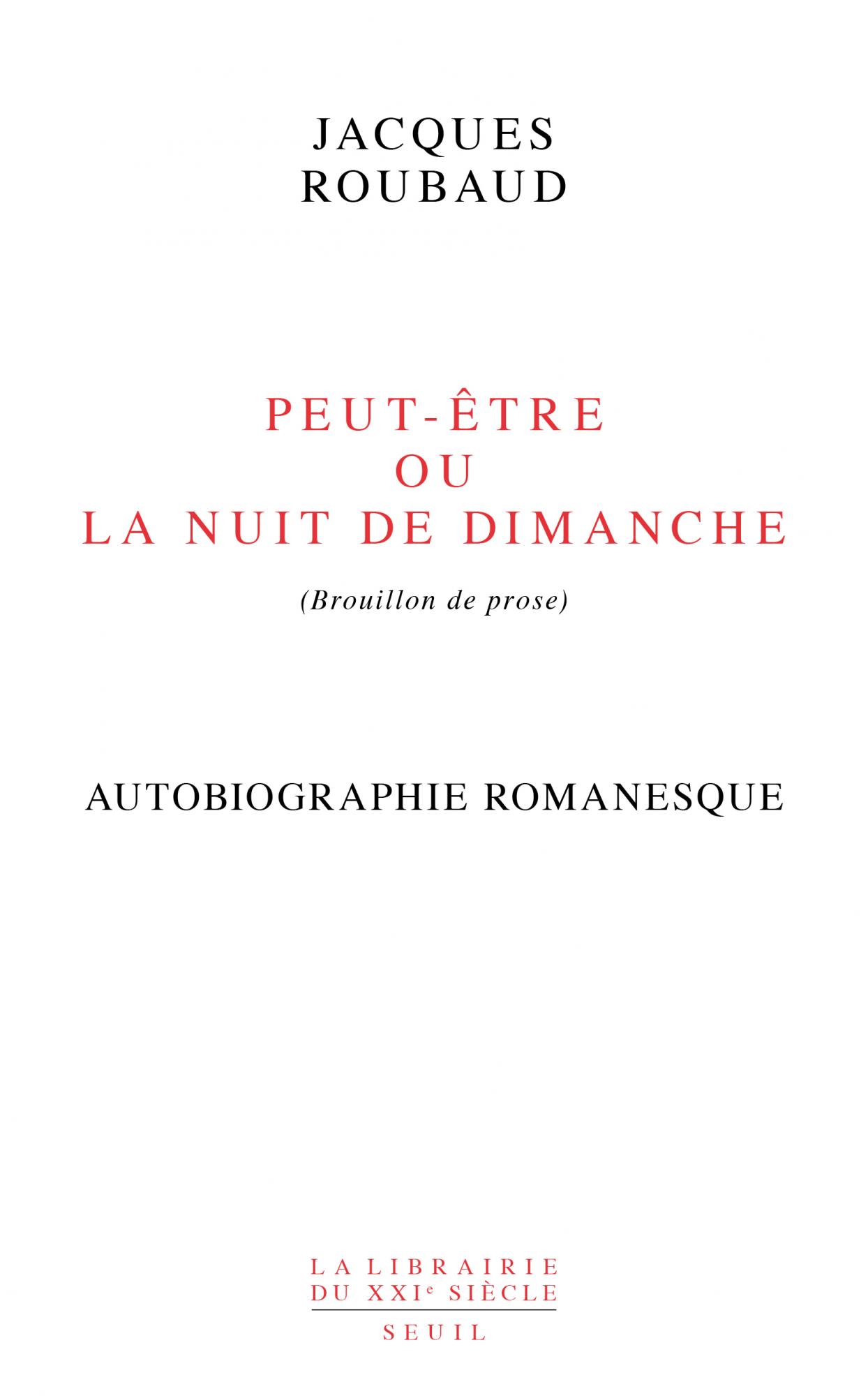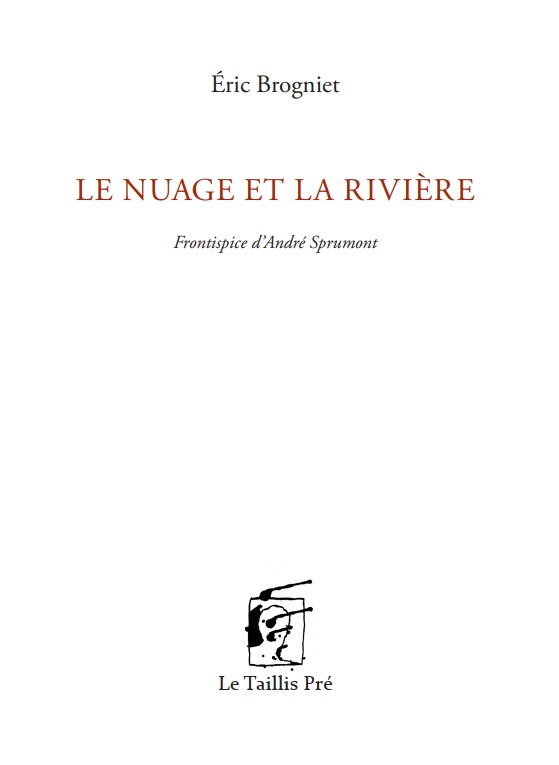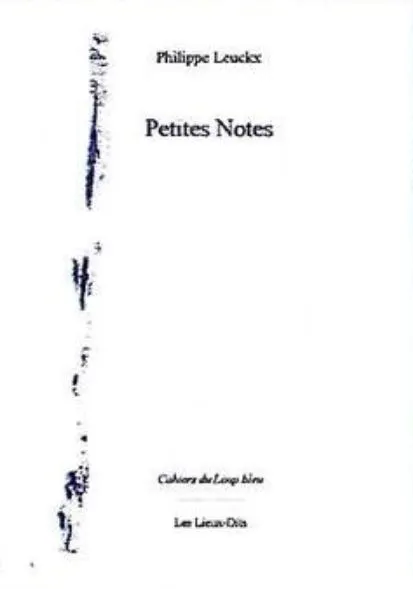Le Livre est un livre sur le livre, qui dit ce que devrait être le livre mais aussi ce que le livre ne saurait être. En proposant des modalités d’écriture du livre idéal, mais en énonçant aussi les limites du livre, de la possibilité du livre, Gérard Pfister dessine en creux ce monde qui est au-delà des mots. C’est donc un livre vertigineux qu’il nous offre là, un livre qui ouvre des fenêtres sur un horizon indicible. Au-delà du paradoxe, c’est une liberté merveilleuse qui nous est offerte, de percevoir d’une autre façon, de partir du livre pour aller au-delà, métamorphosés. Accepter de ne jamais pouvoir dire ce qu’il y aurait à dire, lire ce qu’il y aurait à comprendre, c’est aussi se libérer de l’angoisse de l’indicible en reconnaissant qu’il est d’autres manières de toucher à l’essentiel.
Nous nous perdons dans des reflets à l’infini, dans des méandres conceptuels, et nous restons, au terme de la lecture, sur l’impression très rassérénante qu’il existe bien un monde infiniment plus riche que les mots ne pourraient le dire, mais qu’ils peuvent nous dévoiler.
Un art poétique
Illustré par les cinq cents stances
Dernier volet d’une trilogie ouverte avec Ce qui n’a pas de nom et poursuivie avec Hautes Huttes, Le Livre contient en fait deux livres, un recueil de cinq cents stances, regroupées en cinq centuries de cent fragments, et un essai qu’on dirait métapoétique, « L’expérience des mots ». Ce dernier propose, au moyen d’une réflexion sur ce qu’est la poésie, une grille de lecture de ce recueil mais aussi, peut-être, de tous les recueils de l’auteur. En somme, dans « L’expérience des mots », c’est l’intention présidant à l’expérience poétique de Gérard Pfister qui s’exprime, mais c’est aussi, plus amplement, une proposition de ce que devrait être ou pourrait être, idéalement, la poésie. Le propos est ambitieux, mais il est formulé avec clarté et détermination.
Le Livre n’est donc pas une allusion à la Bible, ensemble des livres subsumés en un seul, mais une énonciation de ce que le livre est et n’est pas, ou plutôt doit être et doit ne pas être. La tonalité plus assertive, le volume plus resserré que les précédents, donnent le sentiment qu’il y va sinon d’une théorisation, du moins d’une poétique à fixer. Et c’est ce que confirme le désir du paratexte explicatif. C’est une poétique qui s’assume et s’illustre.
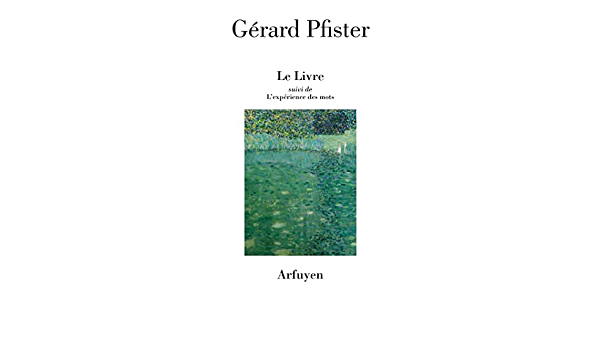
Le Livre constitue un manifeste, ce qui était en somme à deviner dans le titre, avec ce caractère absolu et définitif conféré par l’article défini singulier. C’est un mode d’emploi aussi, en somme, qui nous dit ce que doit être un livre mais donc aussi, implicitement, ce qu’est le livre que nous tenons entre les mains. Il s’agit donc aussi de bien lire. L’exigence d’écriture revient en boomerang au lecteur.
Le point de vue ne manque ni de franchise ni de mordant, qui affirme d’emblée ce que n’est pas le livre, et ce que le mauvais livre est. Bien sûr, la jubilation du lecteur est grande de saisir tout ce que la démarche a de risqué et de réussi : il entre dans un livre qui pose les fondations du Livre et démolit les bases vermoulues ou artificielles. Gérard Pfister n’a pas la violence d’un entrepreneur de démolition, mais il ne tergiverse pas ; la critique des livres pleins de mots (fragment 239)n’a rien de lénifiant. A la vanité du verbiage impénitent, à son remplissage creux, est opposé un vide déstabilisant mais riche de possibles. Le mauvais livre raconte une histoire en laquelle il se résume et dans laquelle nous cherchons absolument à nous retrouver. Ce livre rempli de lui et de nous ne laisse pas place au silence, et manque son objet. Il passe à côté de ce qu’il doit être. Il n’a de « livre » que le nom, mais
267
Les mots
s’enchaînenttout est justifié
268
Les margesrestent étanches
le silence est dompté
Ces deux strophes illustrent, forme et fond, leur propos, et donnent l’exemple de ce que n’est pas le bon livre… Le texte authentique n’est pas « justifié », dans aucun sens. Les mots ne s’enchaînent pas, au contraire, le blanc typographique introduit un espace aléatoire qui sépare par exemple le sujet de son verbe dans le fragment 268. C’est le lieu d’observer que Gérard Pfister préfère, dans Le Livre, l’impair… Aux quatrains de Hautes Huttes il oppose ici un autre rythme, et intègre le vide au sein de la plénitude de chaque stance. Chaque strophe, si brève soit-elle, constitue en effet une unité de sens, caractère propre à la stance. Mais contrairement au contre-modèle de livre, ici les marges ne sont pas étanches et le silence règne en maître, introduisant un principe d’incertitude : où faire porter l’accent, où introduire une pause ? La variété des rythmes de ces tercets (2+1 ; 1+2) produit à l’échelle du recueil un effet particulièrement mélodieux, scandé par le silence d’un espace (blanc).
Ce manifeste pour un livre qui soit Le Livre n’isole pas le lecteur dans sa passivité. Fréquemment intégré, sollicité par le « tu » et le « nous », c’est à lui que l’on s’adresse, puisque le livre n’est rien sans lui. Mais le lecteur n’est pas laissé à son irresponsabilité, il a sa part de travail à fournir, son rôle à jouer dans cette entreprise du sens. Des injonctions lui sont données, qui impriment une orientation à sa lecture, sollicitent une attitude co-créative. Et tout d’abord, il lui faut ne pas trop attendre du livre. C’est, avant la lecture, le regard porté sur le livre qu’il faut changer. Il s’agit de laisser le livre en paix. Les impératifs secouent le lecteur, lui imposent une démarche. Car s’il est question du livre idéal, il est aussi, en somme, question d’un lecteur idéal.
318
Ne cherchez pasdans les pages du livre
laissez-le écouter319
Laissez-le se tairedans les mots
n’est pas sa vérité323
Ne parlez pas du livre[…]
A ce « vous » qui isole, succède souvent un « nous » (qui ? là est la question) qui intègre. La démarche de lecture est pipée tant que c’est « nous » que nous cherchons dans le livre et c’est pourquoi la lecture ne cesse jamais, est toujours inaboutie. Nous consommons des livres, sans jamais nous rassasier du livre. Nous prenons un livre, le reposons, en prenons un autre, cherchons à nous y retrouver, à en faire un miroir de nos médiocrités, à le rabaisser à l’aune de notre petitesse. Toujours c’est nous que nous cherchons et que nous trouvons, et c’est pourquoi le but n’est jamais atteint et l’insatisfaction toujours renouvelée.
421
Nous voulons
qu’on nous parlequ’on nous sauve
422
voir enfinnotre visage
que chaque ligne soit nos traits
Or ce « nous voulons » est plus qu’un constat, c’est une condamnation. Car ce n’est pas cela que nous devons vouloir, et ce n’est pas cela que le livre a pour vocation de donner. En affirmant ce que le Livre doit ou ne doit pas être, ce livre-là dit aussi ce que « nous » sommes ou ne sommes pas et ce que nous devrions être. C’est l’une des particularités de ce recueil : son assurance, cette autorité masquée mais bien présente qui permet d’exprimer des souhaits sur un mode qui est plutôt celui de la volition, comme ces fragments qui commencent par « Il faudrait »
437
il faudrait
que le livre ne soitque cette vibration
440
il faudraitque le livre soit cet adieu
cette dépossession
Argumenté dans l’essai qui suit
Avec « L’expérience des mots », Gérard Pfister clôt le recueil en explicitant sa démarche. Ce petit traité confirme la valeur de manifeste de l’intégralité du recueil Le Livre et fixe une poétique cohérente, illustrée magistralement par les cinq sections de centuries précédentes. Dès le premier paragraphe, l’essayiste définit à son tour le leurre que le poète avait déjà dénoncé : « Nous croyons vivre parmi les choses, nous ne vivons que parmi les mots. […] Nous croyons être au monde, nous restons enfermés dans notre bavardage intérieur. » Ce « Nous » inaugural est très frappant dans l’ensemble du recueil. La réfutation de l’illusion (« nous croyons », « nous pensons ») justifie un ton véhément, parfois presque prophétique. Certes, le poète s’inclut dans cette errance collective, mais en l’énonçant, il révèle néanmoins une place à part, au-dessus ou à côté, la voix de celui dont les yeux sont dessillés et le verbe limpide. Que le poète ou le prophète s’en prenne à l’instrument même de sa dénonciation, les mots, se révèle particulièrement efficace. Non seulement les mots, en vérité, ne disent pas grand-chose de ce qui est perçu, non seulement nous ne percevons pas grand-chose de ce qui est, mais nous nous laissons prendre à ce mirage, à ce tourbillon qui n’a rien à voir avec le mouvement d’un Verbe créateur. Ce « brouhaha de signes et d’images » n’est ni paroles ni musique, pas plus que ne l’est notre « bavardage intérieur ». Bavardage, logorrhée et griserie conceptuelle restent à la surface, seuls la musique et le silence sondent les profondeurs.
L’essai revient aussi sur cette spécularité stérile qui guide nos lectures : « nous revenons à nos sujets accoutumés comme on referme une parenthèse », nous refusons de nous laisser secouer par l’altérité, l’étrangeté auxquelles les mots devraient, s’ils jouaient leur rôle, nous confronter. Nous cherchons dans les textes la confirmation de ce que nous savons déjà et de nos identités artificielles, nous les domestiquons pour les faire servir nos causes. « Ce sont les choses parfois, à l’improviste, qui viennent nous surprendre, et nous ne savions plus même qu’il existait une telle étrangeté, une réalité à ce point irréductible à nos menues existences, aussi déconcertante, menaçante. » Le monde s’oppose ainsi aux mots qui disent le monde, et c’est là toute la tragédie des livres qui ne sont pas Le Livre. Le leurre des mots empêche de voir ce que le monde a de radicalement « autre », de réfractaire au langage. Mais comment dire cette altérité que nous ne percevons que par le phénomène ? C’est toujours la question de l’essence qui se dérobe. On pourrait objecter qu’écrire pour dénoncer les mots est une façon de tourner en rond, de ne pas sortir du problème, mais comment faire alors, et comme dire ? Justement en écrivant les cinq cents fragments qui illustrent, en acte, en dire, comment ouvrir une brèche dans la cloison des mots, pour percevoir une autre réalité.
Le pire, constate Gérard Pfister, c’est que ces mots à vocation rassurante, où nous pensons nous retrouver et trouver les repères du monde, ne remplissent même pas ce rôle. Contrairement à ce que nous nous figurons, les mots, de la tribu ou non, ne rendent pas compte des choses, ils ne nous permettent pas de maîtriser le réel, qui toujours se dérobe. Gérard Pfister renouvelle de façon poétique la querelle des Universaux, et tout un arrière-plan métaphysique où s’opposeraient nominalisme et platonisme. La référence au nominalisme et à « l’illusion réaliste » engendrée par les mots se fait d’ailleurs explicite, mais très discrètement, à l’occasion d’une mention de Guillaume d’Ockham. On songe aussi aux réticences d’Antisthène envers la capacité du langage à définir l’essence, à ses paradoxes aporétiques. Et d’autres références surgissent, d’autres échos de la grande querelle du nominalisme résonnent, à voir rappelé combien les mots sont trompeurs et inaptes à rendre compte de la variété et de la beauté du monde, combien la Forme platonicienne est un leurre :
« Nous disons « homme » ou « chien » ou « arbre » et nous en venons à croire qu’un tel concept se rapporte à une réalité, alors qu’il n’existe rien de tel sous le soleil, mais seulement des hommes. »
En écho à, dans le poème :
113
Tu peux citer « des hêtres »
« des pins »« des châtaigniers »
L’écriture de « L’expérience des mots », didactique, se fait elle aussi performative, met en pratique la théorie en la formulant. « Le travail de composition consiste à ménager la dynamique de l’ensemble et l’articulation des éléments » énonce par exemple l’auteur de l’essai (p. 208), définissant par là-même le livre en cours. La méthode d’écriture ainsi explicitée est aussi guide de lecture à valeur rétroactive, applicable aux cinq sections précédentes. En fait, il faut lire en diptyque ces deux parties du Livre qui se reflètent l’une l’autre. Toutes deux poursuivent le même but, selon des tonalités très différentes. Par l’intermédiaire de verbes de modalité (devoir, falloir), c’est une théorie littéraire qui s’édicte (« il s’agira de »). La démarche poétique telle qu’elle est définie dans le traité « L’expérience des mots » est une proposition ferme, pesée, argumentée et illustrée, délivrée en propositions qui sont autant d’étapes. Le poète prodigue des conseils qui nous éclairent sur sa manière. Par exemple, si l’œuvre est longue, il est nécessaire de la segmenter en sections. De même, pour éviter une déperdition d’attention du lecteur, « il faut créer des contrastes de couleur, de ton, de rythme, qui donnent à voir toujours autrement le matériau verbal. » Dans le même ordre d’idée (permettre au lecteur d’avoir des repères dans l’œuvre), il s’agit de recourir au leitmotiv, emprunt direct au registre musical cher à l’auteur. C’est d’ailleurs précisément là un des traits frappants et efficaces de la poésie de Gérard Pfister, le retour régulier « de strophes ou de petites suites de strophes qui auront déjà été énoncées et qui, se trouveront répétées une ou plusieurs fois, sous une forme identique ou légèrement modifiée. » La proposition se trouve donc, non seulement prospective (dire ce que « sera » l’œuvre idéale) mais aussi rétroactive (éclairer un procédé utilisé dans le cours même du Livre, et dans les œuvres précédentes).
Présence-absence auctoriale
Il est donc question d’une poétique, voire d’un manifeste ou d’un traité. Toutefois, sa grande singularité tient à l’effacement de la référence auctoriale. Les injonctions sont à la tournure impersonnelle, elles préconisent ce qu’il conviendra de faire, mais la discrétion du poète est ici une manière de laisser vivre le livre en toute autonomie. C’est Le Livre en quête d’auteur. Tout au long du recueil, « Le Livre » est le sujet et l’objet du livre. Son existence défie les lois du réel, il semble s’auto-suffire. C’est d’ailleurs à la fin seulement des cinq sections (actes ?) que la question de l’écriture du livre, de la pensée qui y préside et de la conscience qui lui donne forme, est posée.
432
Car nul n’écritnul ne lit
le livre433
Ligne après ligne
le texte seulconduit la main
Le texte pré-existant paraît guider l’écriture en acte. C’est peut-être la stance la plus importante, car elle pose la question du lieu de résidence de cette auctorialité. Une forme de réponse est donnée un peu plus loin :
458
Écrire
n’est rienque se quitter
459
est-il
plus grand bonheurque n’être plus à soi
Le retrait de l’auteur correspond à ce don du Livre. « Il ne s’appartient plus » en quelque sorte. En un sens, c’est le lecteur qui a écrit le livre, pour l’avoir lu puis refermé. Nous sommes pris au piège de cette belle réflexion. Gérard Pfister nous a conduits à notre insu à accomplir le programme d’une lecture optimale : il nous a mis en mouvement, a créé l’étincelle, la rencontre, qui est l’un des desseins du Livre.
Le mot « auteur » n’apparaît significativement que très tard dans son œuvre, et c’est pour parler de cet égarement / effacement, du lecteur ensuite, de l’auteur d’abord.
473
Un livre est un labyrinthe
où l’auteurle premier s’est perdu
Et pourtant l’auteur est bien là et même nous assistons comme en direct à l’acte de création poétique, qui s’énonce en se faisant (puisque tout est performatif dans cette histoire). L’auteur se révèle dans les signes qu’il nous donne, toujours avec la même discrétion. Il nous invite à une lecture attentive, un déchiffrement. En voici un exemple.
Dans « Résonances », ce lieu de transition après le recueil poétique et avant l’essai littéraire, l’auteur délivre, comme il en est coutumier, quelques clefs de lecture. Il est toujours émouvant et intellectuellement stimulant de découvrir les sources d’inspiration de tel ou tel passage du poème. Or le lecteur en quête de signe découvre un niveau supplémentaire d’intrication du sens : une trentaine de fragments ont en effet été inspirés par « Hautes Huttes ».
« Hautes Huttes (147–174, 493–498) : une touffe de canche flexueuse. En descendant vers le col du Wettstein. Orbey, Haut-Rhin. »
On sait qu’il s’agit d’un lieu, mais également désormais du titre d’une œuvre, au centre du triptyque dont le dernier volet, Le Livre, est ainsi doublement relié à l’environnement du poète : d’abord par l’évocation d’un lieu qui est un livre, en l’occurrence le précédent, ensuite par celle d’« une touffe de canche flexueuse » passée dans le champ de vision du poète. Nous assistons à l’acte de création poétique, avec ce processus d’inférence d’une « touffe de canche flexueuse » (la description est déjà une suite de quatre mots formant et sens et musique) à trente-deux fragments d’écriture ? Et ces fragments, repris et isolés, constituent un « poème » à part entière au sein de la section, l’évocation de la danse des « hautes tiges » de Hautes Huttes, dont les épillets nous réenchanteront. Les ondulations, vibrations, de ces imperceptibles graminées – mais perçues par l’œil du poète – participent de la prodigieuse danse cosmique que décrit Le Livre. Oscillation et ondoiement figurent dans l’antépénultième fragment de cette série, où ils deviennent le signe de l’éclat du temps.
495
Le temps brille
en minuscules épilletsondoyant sous la main
Constamment se tissent et s’entremêlent ainsi les niveaux d’écriture du promeneur/observateur/poète et critique. J’en donnerai un deuxième exemple, la modification du style à la fin de l’essai. La prose poétique vient en effet rejoindre le ton plus neutre de la proposition théorique. Critique et poésie se mêlent ultimement, révélant le travail poétique complexe de ce passage a priori didactique. A la fin du Livre (p. 218–219), le traité reprend le rythme et la musicalité du poème !
« Si vivante, si présente, la lumière qui joue entre les plans du paysage, à peine se souvient-on encore des petit-bois finement moulurés, feuillurés, des reflets, des traces sur les verres. »
Ou encore les dernières phrases, en apothéose, qui plus est mimétiques du rythme d’un fragment en tercet 2+1 :
« La musique n’est là que pour faire retentir cet espace.
La parole n’est là que pour donner voix à ce souffle.
Ce n’est pas du livre qu’il faut parler, mais de l’expérience. »
En outre, la dernière phrase est identique au premier fragment, comme si la répétition (ou « la reprise »), conduisait à ce point d’orgue.
1
Ce n’est pas du livre
qu’il faut parlermais de l’expérience
L’alpha et l’oméga fusionnent, façon de représenter précisément le point extatique en quoi se résume la vibration parfaite que doit engendrer le bon agencement des mots. L’auteur est bien là, quoi qu’il en dise…
Il est d’ailleurs constamment présent dans l’agencement de l’ensemble comme dans le travail du détail, invitant le lecteur à des interprétations qui restent ouvertes. Aucune « résonance » n’explicitant la dédicace « aux Essais, aux Élégies, aux Vagues », nous voilà réduits aux conjectures, et ce caractère énigmatique même nous invite d’emblée à une lecture active, de co-création. Homme du Livre unique qu’est Montaigne, Élégies de Duino d’un Rilke nommément présent, énorme symphonie des Vagues de Woolf, ces vagues qui participent d’ailleurs de la construction du leitmotiv du mouvement ? A chacun de voir ce qui s’harmonise le plus avec sa propre lecture du Livre.
Loin d’être sans auteur, Le Livre est une partition que le compositeur a minutieusement constituée, et non pas seulement dans le choix et l’ordonnancement des motifs musicaux ou la scansion métrique. A titre d’exemple, faisons voir et entendre :
- quelques échos internes dessinant aussi un reflet typographique, comme un reflux et un flux dans la page :
90
Ne dis rien de l’amisouviens-toi
de sa voix91
Tu ne sais
rien de luique saurait-il de toi
- un travail subtil sur les allitérations et assonances (subtil, car il fait sens)
332
Le livren’est qu’un vide
où s’élance l’éveil
- ou encore le très réussi
387
Le livre
n’est làque pour nous délivrer
repris en écho au fragment 431, comme pour prolonger l’effet d’écho homonymique du « livre délivre » (des livres ?)
Certaines fulgurances révèlent un sens de la formule gnomique qui ne surprend guère chez le fondateur des « Ainsi parlait ». Ainsi de la maxime euphonique « La fugue des mots ne dit que la fuite du monde », où le jeu étymologique, la paronomase et la référence musicale s’associent pour former un aphorisme parfaitement équilibré.
Il y aurait beaucoup à dire sur les traits stylistiques récurrents de l’écriture poétique de Gérard Pfister. Ce sont tous des éléments qui contribuent à créer ces fameux repères auxquels le lecteur peut se raccrocher, ce sont aussi des modalités phrastiques constitutives d’un style propre. On pourrait mentionner l’utilisation de l’interrogative, — d’ailleurs relevée dans le petit traité fermant le recueil — en particulier celle ouverte par l’adverbe « comment ». A propos de syntaxe, notons aussi un autre trait marquant car mélodieux, la tournure qui consiste à disloquer les syntagmes, avec antéposition du complément repris par un pronom (dans l’exemple suivant, le pronom adverbial « en »). Le thème principal est ainsi mis en valeur et la redondance produit un effet musical :
320
La profondeur du cielnul n’en revient
quand il s’y est jeté
De manière générale, les compléments viennent en tête de phrase, pour ménager aussi cet effet de suspens qui fait partie, selon la poétique même de l’auteur, du bon usage des mots.
116
Sur la pages’étire
un funèbre cortège
Le livre est musique et danse
Les six procédés majeurs recommandés par le manifeste du Livre sont explicitement fondés sur des analogies avec la musique. Mais la musique sert aussi de référent pour suggérer d’autres procédés poétiques. Par exemple la disparition du passé et du futur au bénéfice du présent, ce qui se produit lors de l’audition du son. Les mots devraient pouvoir désigner ce qui advient dans cette immédiateté. « La parole du poème est performative ou n’est pas. Le poème parle au présent, toujours. Dans l’absolu du présent. » (p. 212) Le ton est, on le voit, assertif ; non pas dogmatique, mais assuré. Le poème doit donc être le chant de ce présent seul apte à dire l’éternel présent de l’être. « Nous sommes celui que nous étions avant de naître. Nous sommes celui que nous serons après notre mort. Ici, maintenant. Nous ne sommes rien d’autre. Nous sommes tout ce possible, ici, présent. (p. 213) « Nothing has to come; it is now. Now is eternity; now is the immortal life » écrivait Richard Jefferies. C’est dans ce « now » que se place le poème. Cet éternel présent évoquant une permanence de l’être rappelle une série de fragments de l’œuvre qui précède :
466
Un livre est un berceautout poème
est un tombeau467
Si tu n’es prêt
pour cette vie nouvelleà quoi bon ce berceau
468
Si tu as peurde te quitter
inutile ce tombeau
ce motif du berceau et du tombeau illustre également ce qui vient d’être conseillé en matière de retour de motifs thématique et prosodique. En effet, le poème avance par reprises et adjonctions, par retours de strophes avec variations. On l’a vu, le dessein formulé est de scander la parole poétique afin qu’elle imprègne la mémoire et la sensibilité du lecteur. Or cette image du berceau et du tombeau avait été annoncée dans la section précédente (fragment 336) :
Un livre
est un tombeau
un berceau
Cette reprise d’un thème souligne la valeur esthétique de la poésie. L’accent est mis sur ce chant qui a valeur autonome, sans dépendre des mots qui le constituent, et où nous nous obstinons à chercher concepts et autres autorités sémantiques. Il ne faut pas trop demander aux mots, il faut surtout les écouter (p. 203). La poésie se définit alors comme musique, uniquement. « Ces mots, nous les écoutons, et déjà ils sont musique. […] La poésie, ce ne serait rien d’autre. » Les mots sont un art, non pas un outil, ils ne servent à rien. « Nuances, chatoiements, suggestions, rythmes, résonances. Il suffit d’écouter. » (p. 202) Car voir c’est regarder, en une synesthésie toujours renouvelée. L’écriture est invitation à regarder l’écriture, le lecteur enjoint de se faire auditeur et spectateur, les deux confondus dans ce spectacle total. « Regardez : c’est un jeu perpétuel, chaque mot danse dans le vide, chaque syllabe gambade avec les autres. »
Loin de remonter à la Forme, c’est à un contre-Platon et à une célébration des manifestations que nous invite Gérard Pfister. Le phénomène, « l’expérience », comme il est écrit aux seuils liminaire et ultime du poème, valent sans doute plus que la perfection de l’Idée. Et à l’immuabilité des formes est préféré le changement, le mouvement.
445
Si tu ne vois
l’intime mouvementque sais-tu de la forme
L’image des vagues imprime d’ailleurs tout au long du livre ce mouvement de flux et de reflux, d’accélération. Car la musique entraîne la danse. Mais de même que Le Livre forme une boucle dans son invitation à ne parler que de l’expérience et non du livre, de même la danse cosmique est une rotation des sphères, une giration de derviches, un mouvement perpétuel circulaire :
396
Dans le livretout est question
de vitesse397
Le livre est une danse
une ivresseun perpétuel tournoiement
Ce diptyque de tercets est d’ailleurs bien caractéristique, dans sa performativité même, d’une recherche musicale, qui passe ici par la rime interne et le système d’écho et d’homéotéleutes (ivresse, vitesse). La musique est constitutive du livre.
La danse, ce perpétuel tournoiement, n’est pas mouvement dépourvu de finalité. Elle provoque le vertige, et c’est précisément ce vertige qui déconcerte. Non qu’il rompe l’harmonie, au contraire, sa finalité est là :
391
Le livre
n’est làque pour nous accorder
392
Que chaque motvibre
à la juste fréquence393
Que chaque instant
résonnede l’infini qui est en lui
Cet accord que le livre permet d’obtenir passe par une perte de contrôle. On a vu ce que le livre ne doit pas être : le miroir complaisant, la confirmation des masques. Mais le vertige qu’il suscite réaccorde le lecteur avec un infini qu’il porte en lui et dont il fuit précisément la terrifiante rencontre. Le vrai livre – le poème – est roboratif. Il provoque le vertige pour rétablir une harmonie authentique.
Pour que la danse accomplisse sa finalité sacrée, elle doit s’appuyer sur une musique bien particulière. Le son et le mouvement convergent pour parvenir à cette longueur d’onde qui détonne dans l’harmonie conventionnelle mais ouvre à un autre univers : la vibration. C’est la vibration vitale, le « Om » primordial, le son fondateur et soubassement de l’univers. Le mantra du Livre est cette vibration essentielle qui sort le lecteur de lui-même pour le mettre à l’unisson de ce qui le dépasse.
404
PortésPar l’unique insistante
vibration405
Cette basse
obstinéeen toutes choses
Comment l’assemblage des mots peut-il conduire à ce vertige, à cette vibration ? Il ne suffit pas d’écouter mais de bien regarder pour bien saisir (puisque nommer ne dit rien de l’être). De l’union avec l’objet regardé, celui que nous montre le poème, naît un vacillement, unique comme l’est la vibration fondamentale. « Tout n’a de réalité / qu’en ce vertige » (fr. 133) On peut certes nommer (fr. 136 et suivants) les éléments de la nature, le nom ne dira rien de la chose à voir s’il ne produit pas la vibration qui est signe de la fusion complète (regard et étreinte) avec les choses vues. La deuxième section du Livre s’attache à révéler ce mouvement essentiel, à faire comprendre la nature de ce vertige, « ondulation », « vagues » « vibrations ». Le livre n’a de sens que religieux au sens d’un lien avec l’univers. On sait ce que le livre ne doit pas être ; on découvre ce qu’il peut tendre à être :
« Il faudrait que le livre ne soit / que cet ondoiement » (fr. 183)
Du passage à l’illumination
S’il est impossible d’abolir le temps, il est possible d’épuiser le temps dans l’éternel présent de l’illumination. Le livre est une naissance toujours renouvelée, la réalisation d’une promesse, le lieu d’un passage. Il est toujours mouvement, toujours transition entre un avant et un après : œuf qui se fissure, matrice où l’infans entend les mots avant de les prononcer et de les voir. La méditation sur le temps et son abolition n’est pas sans rappeler la poésie de T.S. Eliot.
L’obstacle au livre est la pesanteur et le statisme encombrant du lecteur, qui voudrait figer le temps, l’arrimer.
372
Nous n’aimons que les pierresle fleuve
ne les entraîne pas373
Nous nous rêvons
dans des palaisinvulnérables au temps
Or le livre n’est pas demeure mais passage. Le livre n’est rien en soi, il est moins le temple irréfragable que la coquille qui se brise. Le livre, nous enseigne le poète, ne doit être que le lieu d’une rencontre, seule finalité, seul « sens » du livre.
Le livre est un truchement, rien en soi, un passage de la cause à l’effet, le lieu d’une fabrication, lieu poétique par excellence. C’est aussi pour cette raison que la fabrique est mouvement, que la création du livre est toujours recommencée par la lecture, que le livre ne saurait être espace immuable. La métaphore filée du mouvement, et son corollaire la vitesse, court tout au long des sections, elle est reprise par différentes images, notamment celle de la ruche, riche de multiples connotations.
335
L’abeille
ne s’endort pasdans sa loge de cire
Le livre est donc un endroit d’où l’on part et où l’on va, c’est le lieu d’une production, mais la poésie n’est pas dans ses mots, elle est dans le mouvement insufflé par toutes les lectures possibles. Chaque lecteur vient d’une direction qui lui est propre, repart dans une autre direction et dans le livre se fait la rencontre, s’opère la magie : le lecteur n’en repart pas comme il y est arrivé.
340
Un livre n’est rienque le lieu
du possible
Le livre n’est qu’intermédiaire, en somme, et Le Livre de Gérard Pfister, le disant, le démontre, et nous invite, au terme du parcours, à déposer notre vade-mecum… Signe discret adressé au lecteur, dans le petit essai de « L’expérience des mots » Gérard Pfister évoque justement le « dire c’est faire » d’Austin (qu’il désigne nommément) et les mots qui sont des actes. Ce langage qui crée et ne se borne pas à constater, c’est bien celui que nous tient Le Livre. C’est en cela que ce livre, Le Livre, est bien le dernier de la trilogie, il est le livre des livres, la notice explicative à rebours. Le livre, mode d’emploi.
Il serait donc vain de n’attendre du livre que l’identité à soi-même, que la confirmation de ce que nous sommes. Le livre incite, nous l’avons vu, à faire l’épreuve du vertige. Seul ce vertige peut être fécond — nourrissant comme le miel de la ruche -, mais une telle démarche nécessite du lecteur qu’il soit prêt à faire l’expérience d’autre chose, à se laisser sortir de ses gonds…
376
Le livre est un miroirpour désapprendre
à nous chercher
Ce miroir ne répond donc pas à sa fonction attendue : le reflet. C’est en réalité un miroir déformant, l’image qu’il nous propose donne le vertige et déstabilise. Ni l’Autre ni nous-même ne s’y réfléchissent comme attendu. A certains égards, et puisque la lecture du Livre est une lecture ouverte où chacun est libre de naviguer à sa guise, la vision ainsi proposée me fait songer aux fantasmagories du XIXe siècle, aux « effets d’optique et de catoptrique » (Saintine) dont un Théophile Gautier réclamait l’usage au théâtre, afin de donner « quelque illusion de catoptrique, pareille à celle que produit une fantasmagorie ». La possibilité d’envisager le livre comme autre chose qu’un véhicule de sens, un miroir du réel ou un objet vénérable et inamovible, libère le lecteur d’une aliénation ancienne.
379
Le livre
est une loupeun télescope
380
Tout s’éloignetout s’approche[…]
Le livre n’est donc pas le réel, il n’est pas là pour nous « authentifier », sa finalité est au contraire de nous apprendre à voir autrement. En ce sens il a une vocation, une fonction, presque une utilité, ce qui revient aussi à le désacraliser et à désacraliser le discours sur le livre. Le livre n’est là que pour nous apprendre à le quitter (fragment 388), à prendre un nouveau départ après lui. Du livre ne reste que ce qu’il a engendré, et cet engendrement est un nouveau lien avec le monde. Là aussi la démarche est performative ; le livre qui s’achève (nous arrivons à son terme) nous dit ce que nous devons garder de lui, quels sont les ultima verba à retenir.
On peut d’ailleurs rapprocher la suggestion du fragment 488 et le fragment ultime :
488
Ne parle pasdu livre
seulement de l’expérience500
le livrereste
inachevé
Même la fin de ce livre est promesse d’une suite, non d’une suite de livres, ce n’est pas de cela qu’il est question, mais d’un « parachèvement » parce que le livre réussi poursuit sur son élan, développe encore son mouvement dans les échos trouvés en son lecteur. Inaugurée avec l’Innommé (Ce qui n’a pas de nom), la trilogie s’achève avec l’Inachevé, mais l’un comme l’autre dit par le détour négatif une réalité lumineuse et évidemment mystique.
Cette expérience, cette rencontre qu’a favorisées le (bon) livre, conduisent en effet idéalement à cette vibration précédemment évoquée, cet unisson sur une fréquence inhabituelle, harmonieuse, qui ne suppose pas une gradation du sensible vers l’intelligible mais une concomitance. Du silence de la page s’élève un son, une vibration, accompagnant une sorte de sentiment océanique. La fin du livre évoque ce moment où le livre a accompli sa mission : il a fait naître une extase chez le lecteur, produisant une petite apocalypse, un dévoilement dans l’art de voir les choses, le monde, microcosme et macrocosme.
495
Le temps brille
en minuscules épilletsondoyant sous la main
496
Oscillantau moindre souffle
scintillant dans la lumière
On ne se lancera pas dans de scolaires analyses stylistiques (même si l’envie nous en prend souvent en lisant la poésie de Gérard Pfister !) mais ici le mouvement perpétuel du temps s’exprime tout autant dans l’image de l’ondoiement des épis que dans l’anaphore de la syllabe « ill », qui donne à voir presque visuellement ces minuscules épillets ondoyant, oscillant, scintillant et brillant. Qu’ils soient minuscules n’ôte d’ailleurs rien à l’importance qu’ils ont, et que le livre, dont le pouvoir grossissant a été plus haut énoncé (loupe et télescope), donne à voir sous un autre angle.
Le livre est vibration primordiale, ouverture soudaine à l’immédiateté du sens. Il surprend par les petites épiphanies qu’il peut provoquer. Là est ce miracle (voir les fragments 355–365), quand l’illumination se produit. On ne peut déterminer précisément sa cause, mot, pensée, musicalité, mais parfois, soudain, un « éclair » se produit, une vision qui est aussi un son primordial, celui qui ouvre les portes de l’univers.
Comment dire Ce qui n’a pas de nom
Tel est l’essence du livre, le modèle du poème. Gérard Pfister ne se contente pas de ce que le poème doit être, il propose, avec « La conscience des mots », un manifeste associant théorie et pratique. La grammaire et la linguistique constituent d’utiles outils au service de l’écriture. Car le poème n’est pas seulement un objet rêvé, il est fait d’images et de mots, dont l’agencement produit – ou ne produit pas, ou peu – la vibration, le son cristallin, l’illumination. La poésie est fabrique, elle passe par le sensible, et il faut savoir gré à Gérard Pfister de ne pas contourner la difficulté du « comment faire ? »
Mais il ne s’agit pas d’un manuel d’écriture ou d’un traité du beau style ! En réalité, c’est une démarche très personnelle, auto-explicative, et qui nous permet d’entrevoir les arcanes du texte. En particulier, Gérard Pfister montre que le monde offert par le poète au lecteur n’a pas de référent commun extérieur qu’il s’agirait de commenter. La subtilité est d’importance : « une telle ostension ne montre rien au-dehors de la phrase : c’est l’énoncé qui se montre lui-même comme une réalité autonome. » Cette précision permet de mieux saisir la portée de l’exemple donné, « une fleur s’ouvre ». Cette fleur-là n’existe en fait que par les mots qui la désignent, elle ne vit pas indépendamment d’eux, elle n’est pas un objet préexistant à cette énonciation. Les autres tournures de phrases proposées, ces autres modalités pour dire cette fleur que les mots ouvrent pour nous, jouent le même rôle. C’est le cas par exemple de la solennité de l’injonction (« “Regarde !” C’est une injonction. Il n’est plus question de nous détourner de la réalité nouvelle qui nous est ici offerte. » (p. 214), ou encore de la possibilité même d’un tel épanouissement de la fleur à travers la modalité interrogative : « Une fleur s’ouvre-telle ? en même temps qu’il est posé comme réalité, sans cesse le présent est posé aussi comme question. Y a‑t-il vraiment une fleur ? est-ce que vraiment elle s’ouvre ? L’ici, le maintenant ne sont réalité qu’en tant qu’ils sont un possible. Mais ce possible est-il vraiment réalité ? ». La mise en abyme se prolonge ainsi, dans la mesure où l’écriture de Gérard Pfister, dans le poème ou dans son commentaire, recourt volontiers aux modalités injonctives et interrogatives. Même chose pour la forme emphatique : « C’est une fleur qui s’ouvre » ou encore pour la forme passive, car le lecteur attentif de Gérard Pfister sait qu’il use de ces tournures tout au long des cinq cents fragments qui précèdent. Par exemple :
139
Que croyais-tu
Trouverà l’horizon (interrogative)
321
C’est un vertige
dans la chairqui s’est gravé (emphatique)
Ou encore :
231
entends-tu cette voix
regardele texte se brise (ou sont associées l’interrogative et l’injonction)
Le Livre contient d’ailleurs plusieurs fragments utilisant cet exemple d’injonction précisément proposé dans « La conscience des mots » : « Regarde ! » et « Regardez ! » Et même au sein de l’essai explicatif, l’écriture se met en abyme en recourant… à la même injonction ! Encore une fois le poème et le traité du poème entrelacent leurs mots.
443
On croirait une trace
Regardezce n’est que mouvement
« Regardez : c’est un jeu perpétuel » (p. 202)
Autant dire que le jeu de renvois devient vertigineux. Le diptyque « Le Livre » / « L’expérience des mots » fonctionne « en vase clos » dans la mesure où tout renvoie à tout, la lecture peut se faire en boucle, comme pour la Recherche proustienne, elle peut se faire dans tous les sens puisque la poésie du recueil n’est pas seulement illustration anticipée de ce que l’essai formulera de manière gnomique, mais que l’inverse est également valable : le poème énonce ce que la théorie illustre. En définitive, l’essai lui-même entre dans ce tout qu’est Le Livre constitué de « Le Livre » et de « L’expérience des mots ». Les leitmotive et répétitions (ou basses obstinées, autre métaphore musicale du Livre) courent dans l’intégralité des pages du recueil, sans que l’essai et le poème soient à distinguer. Telle est la plus grande subtilité de ce livre subtil, qui aurait bien pu nous faire croire que l’illustration de la langue précède sa défense. Le Livre est un Tout, il est Un, il est le Mot.
D’ailleurs, la dernière modalité énonciative possible pour dire l’ouverture de cette fleur-modèle, fleur-Idée (du seul fait des mots, rappelons en effet qu’elle n’existe pas en dehors de l’invitation du langage à la voir s’ouvrir) est la forme impersonnelle. Or cet exemple prétendument grammatical, « Il s’ouvre une fleur », évoque une absence de sujet réel de l’action, la fleur semblant « être ouverte » en quelque sorte par un agent mystérieux. « C’est une action occulte qui serait alors suggérée, comme si cette éclosion était l’œuvre non de la fleur elle-même mais de quelque puissance dont on ne pourrait dire le nom. »
On pourrait dire, de la même façon « Il s’écrit un livre », ou même « Il s’écrit Le Livre », faisant écho à une forme de passivité, à cet effacement de l’auteur précédemment constatée, qui renvoie elle-même à un motif présent dans toute l’œuvre de Gérard Pfister, en l’occurrence ce qui n’a pas de nom, motif excédant bien sûr la seule théologie. Ce mystère de l’auctorialité (du livre, de Le Livre, du Livre, du Monde !) « action occulte », est ainsi tout entier contenu dans l’apparent simple exemple de grammaire.
Les mots échouent à dire le monde, car, selon la très belle formulation de Gérard Pfister, « Ce qui est le plus particulier, le plus individuel, jamais les mots ne le nomment. Ils ne connaissent par nécessité que le plus ou moins général. Ce qui est le plus propre à une chose, cela n’a pas de nom et c’est cela pourtant qui fait le caractère unique de son existence, ce qui la fait précieuse entre toutes. » (p. 198)
Ce constat n’est pas pour autant négatif, car si les mots ne désignent pas la réalité unique de l’objet, ils peuvent produire une rencontre d’où résulte une « unique vibration », « unique pulsation », créant « Un point. Un vide merveilleux où tout vibre ». Dans la mesure où ils sont les vecteurs de cette expérience, les mots, selon le bon usage qu’il convient d’en faire, peuvent devenir artisans d’une révélation.
***
La fleur est sans pourquoi, elle s’ouvre parce qu’elle s’ouvre. Ce mystère qui nous échappe, le livre peut le montrer, le désigner, nullement l’expliquer, pas même le « transcrire ». La fascination des mots a pourtant gagné même jusqu’aux grands mystiques : Gérard Pfister, qui a publié Angelus Silesius et en est imprégné, dénonce la folie qu’il y a pourtant à devenir le livre, selon l’invitation, (nous le découvrons dans les « Résonances » finales), de L’Errant chérubinique(« deviens l’écriture et toi-même l’essence. ») Le livre sert, le livre est support, le livre est délivrance, et nullement invitation à s’y complaire ou à le devenir.
Ce qu’il faut retenir du Livre, c’est le refrain :
Le livre
n’est là
que pour nous délivrer
que glose la page 217, définissant la visée du livre, non comme suppression du temps, mais comme transmutation de celui-ci en ce que Rilke nomme « l’Ouvert ».
« Le temps – c’est-à-dire les sons, les mots – ouvre les yeux. Et soudain : un espace sans limites. Où tout était déjà, où tout déjà résonnait – mais nous ne le voyions pas, ne l’entendions pas. Il était là. Il est là. Et on dirait soudain que tout le travail n’était que pour cela : ce dévoilement, cette soudaine, cette simple éclaircie. »
Le « brouhaha de signes et d’images » qui épargne les enfants et les animaux nous voile l’essence des choses. Maisle livre est apocalypse, dévoilement. Après qu’on l’a reposé, peu importe par quelle modalité la fleur s’ouvre. Elle est ouverte, et le sortilège maudit du livre-miroir a été aboli par cette lecture : nous qui ne pouvons voir l’infini de la fleur qui s’ouvre (car nous avons la perspective de la mort, qui fait refermer la fleur) nous avons grâce au livre les yeux de l’âme ouverts et non plus retournés, nous pouvons voir les fleurs s’ouvrir à l’infini, comme la créature, selon la huitième des Elégies de Duino. Le Livre a dit ce que le livre pouvait faire. Tous deux sont refermés et la fleur s’ouvre. Éternellement.
- Gérard Pfister, A livre ouvert - 6 avril 2023
- Gérard Pfister, Vertiges de hautes huttes - 28 décembre 2021
- Ce qui n’a pas de nom : la chance des mots - 14 octobre 2019