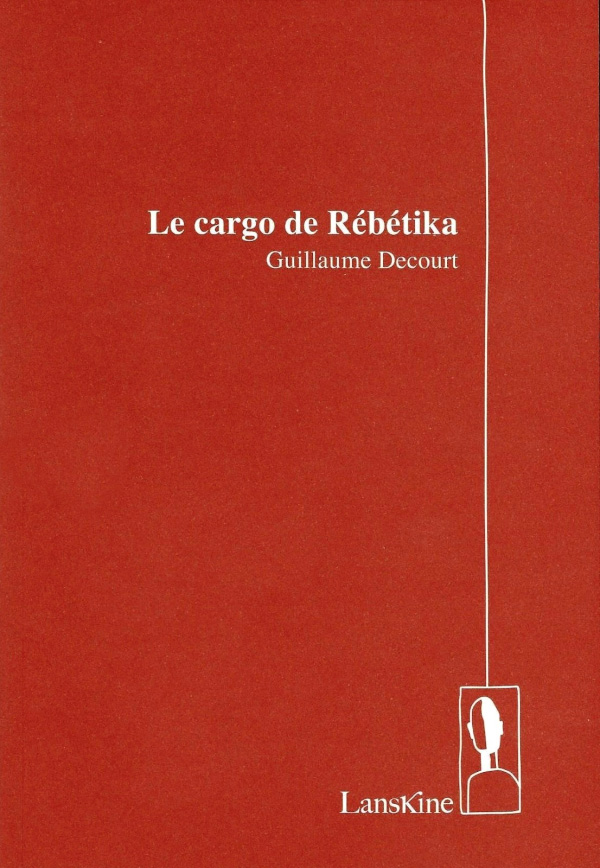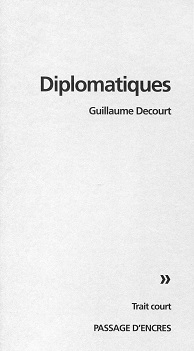Le titre en lui-même, déjà, Le Cargo de Rébétika, c’est l’art de l’ouverture dans lequel peu sont passés maîtres, on songe à la grande Marguerite : Les Petits Chevaux de Tarquinia, Un barrage contre le Pacifique. On a envie d’ouvrir le livre.
Et puis la quatrième de couverture : « Un homme ; deux femmes ; des autochtones ; un cargo qui n’arrive pas ». C’est une accroche cinématographique. On songe à la bande annonce de La Nuit de l’Iguane de John Huston : « Un homme… trois femmes… une nuit… » Mais il s’agit du résumé du dernier livre de poèmes de Guillaume Decourt.
Si l’écriture de Decourt n’a strictement rien de cinématographique (pas de découpage scénaristique), ce Cargo constitue pourtant une œuvre filmique totale, par la pureté des images, l’inventivité picturale, le rythme narratif et la richesse psychologique des personnages, rien à voir avec ce qu’on nomme aujourd’hui le « vidéo-poème », piètre tentative de transcription du poème alors qu’il est par essence, comme le disait Gracq, « soluble dans la mémoire ».
N’imagine-t-on pas le plan-séquence de ce poème XXII :
Je mangeais une banane sur la dune aux Outrages. Seul.
J’avais pris mon paratonnerre préhistorique, trouvé
dans un surplus de l’Est.
C’était un temps où j’avais encore le regain nécessaire
pour me mouvoir en période de ponte.
Sur ma carapace on inscrit maintenant des graffitis.
Et les « moineaux enjoliveurs » qui ponctuent cet épopée de leur « phti tribilibi » ou l’acupuncteur plantant ses aiguilles dans « le palais d’un patient qui ne patientait point » au rythme d’un « tsst tsst » maladif n’évoquent-ils pas les délires Felliniens de la dernière période ? Et l’homme murmurant le nom de la femme aimée « Rébétika !» dans la solitude de son île n’est-il pas le frère du jeune Nur-Ed-Din qui cherche sa compagne Zumurrud dans les Mille et une nuits de Pasolini ?
« Un homme ; deux femmes ; des autochtones ; un cargo qui n’arrive pas », donc.
Un homme, le narrateur, déchiré entre deux femmes, deux amours, condamné au choix qu’il ne peut prendre, Grupetta ou Rébétika, quand il voudrait peut-être Grupetta et Rébétika. Deux femmes aux tempéraments contrastés et dont les prénoms évoquent dans une forme féminisée le grupetto, cet ornement musical dérivé du mordant baroque, et le Rébétiko ce genre musical grec né en Asie mineure. Deux femmes que tout oppose, Grupetta l’extravagante, qui réclame, exige, et Rébétika, la femme marmoréenne, qui incarne le bien-être sûr.
Tous, ainsi que les autochtones (l’acupuncteur, le fauve sale, le tenancier de l’embarcadère, Aristide…) attendent avec espoir l’arrivée d’un cargo de bananes, mythe qui semble souder les affects des personnages et les lier par le sang, alors même qu’ils ne font souvent que se croiser, chacun condamné à sa propre camisole. C’est une sacralisation du bananier (le cargo) qui n’est pas sans évoquer avec humour l’anthropologique « culte du cargo » mélanésien.
Les lieux répondent aux idiosyncrasies des personnages : l’Hôtel de l’Existence dans lequel Grupetta traite l’homme de bouc, la dune aux Outrages sur laquelle l’homme mange une banane dans sa solitude, la fontaine aux Affins autour de laquelle le fauve tourne comme un derviche, et le Tombeau « en forme de dragée » avec « une amande en sa contenance » que lui prépare respectivement Grupetta et Rébétika :
Le Tombeau, toujours le Tombeau ! Je la couvre
de légumes de mère et d’assurance ligaturée,
rien n’y fait. Ma petite Grupetta,
comment te faire entendre ceci ?
Tu me parles encore d’ancre et de gigot, d’arbalète pubienne ; tu t’accroches
aux tartines d’antan, aux rites des luettes. J’ai perdu aux jeux
de la phalène, je suis un bien mauvais parti, un jour, je te
conterai l’histoire de celle du dernier tour de Piste, de celle qui me fit
comme on se fait dans son entièreté, qui roulait délicatement dans ses doigts
ma barbe de maïs.
On raconte la fin (tant pis pour les spectateurs). Après maintes péripéties, l’homme fuira ses deux femmes, son île et ses autochtones, il s’en ira seul on ne sait où — une île, encore ? — et se souviendra de ce qui fut. Le recueil se termine sur une berceuse, chanson rimée doucement cynique que le narrateur fredonne en se rappelant ses amours :
Il est tard. Je me trouve bien loin déjà. Qu’êtes-vous devenues mes
petites bougresses ? J’ai trouvé un
métier à tisser, un fusil qui flotte comme un chat dans la mer. Je me rappelle
vaguement cette berceuse : « J’ai perdu mon panama
sur le port », nos « Dam di dou da » ; ces amours astringentes
que vous partageâtes. Vos Tombeaux, les avez-vous bâtis ?
Je cultive la Joie des Apiculteurs.
On attend qu’un réalisateur, pourquoi pas Godard — mais le dernier Godard, le plus libre — et pourquoi pas Mocky — mais le dernier Mocky, le plus libre -, prenne le risque d’adapter — et non pas de transcrire ! — à l’écran ce Cargo de Rébétika. On aimerait Morricone pour la mise en musique, avec quelques pincements de cordes nasillardes sur ce début de berceuse qui pourrait servir de bande originale :
J’ai perdu mon panama
sur le port,
cette négligence m’a
fait du tort.
On n’est rien sans couvre-chef
aux abords
des femmes, j’ai des griefs
depuis lors.
Silence, on tourne de la poésie…
Présentation de l’auteur
- Olivier Apert, Si et seulement si - 5 octobre 2018
- Dominique Dou, Bagdad sous l’ordure - 5 mai 2018
- Guillaume Decourt, Le Cargo de Rébétika - 23 octobre 2017